NOTES SUR LA TRANSCRIPTION:
—Les erreurs clairement introduites par le typographe ont été corrigées.
—On a conservé l’orthographie de l’original, incluant ses variantes.
—La couverture de ce livre électronique a été crée par le transcripteur; l’image a été placée dans le domaine public.
ARMAND DE PONTMARTIN
SA VIE ET SES ŒUVRES
1811-1890
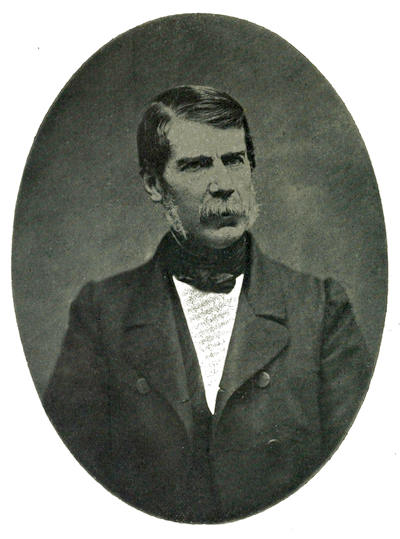
EDMOND BIRÉ
ARMAND DE PONTMARTIN
SA VIE ET SES ŒUVRES
1811-1890
PARIS
GARNIER FRÈRES, LIBRAIRES-ÉDITEURS
6, RUE DES SAINTS-PÈRES, 6
1904
PRÉFACE
Très nombreux sont les documents que j’ai eus à ma disposition pour écrire ce volume. Dans ses Mémoires, Pontmartin a fait à l’imagination une part peut-être trop large; ils n’en sont pas moins très sincères et demeurent, pour son biographe, une source précieuse de renseignements. Les souvenirs abondent, et cette fois presque toujours très exacts, dans ses Causeries littéraires, et en particulier dans les vingt volumes des Nouveaux Samedis et dans les dix volumes des Souvenirs d’un vieux critique. Mais c’est surtout sa Correspondance qui m’a été d’un puissant secours. Outre quelles sont charmantes,—on le verra bien,—ses lettres, écrites de premier jet, toujours sous l’impression du moment, nous apprennent tout de sa vie, de son caractère, de ses sentiments. Il a écrit là, au jour le jour, ses vrais Mémoires. Aux lettres que, pendant plus de trente ans, il n’avait cessé de m’adresser et où il ne taisait rien de ses joies et de ses deuils, de ses succès et de ses mécomptes, sont venues se joindre d’autres correspondances, celles qu’il entretenait avec Joseph Autran,[ii] Victor de Laprade, Cuvillier-Fleury, Alfred Nettement, Jules Claretie. La communication m’en a été libéralement accordée par Mme et M. Jacques Normand, fille et gendre d’Autran, par MM. Victor et Paul de Laprade, par Mme Victor Tiby, fille de Cuvillier-Fleury, par Mlle Marie-Alfred Nettement, par M. Claretie. Que tous reçoivent ici l’expression de ma profonde gratitude! Mon livre, cependant, eût été incomplet si je n’avais eu l’aide, précieuse entre toutes, de M. Henri de Pontmartin, qui m’a soutenu de ses conseils et qui m’a si gracieusement ouvert le trésor de ses souvenirs. Qu’il en soit particulièrement remercié!
J’ai été l’ami d’Armand de Pontmartin: l’affection et la reconnaissance ont-elles influencé mes jugements? M’ont-elles conduit à parler de lui et de ses œuvres avec trop de faveur? Je ne le crois pas. Comme l’abbé de Féletz, qui venait de louer un de ses amis, je crois être en droit de dire: «L’amitié que j’ai pour lui n’a point enflé les éloges que je lui ai donnés; elle n’a pas dû m’empêcher de lui rendre justice: elle a fait seulement que je lui ai donné ces éloges et rendu cette justice avec plus de plaisir[1].»
ARMAND DE PONTMARTIN
CHAPITRE PREMIER
LA FAMILLE ET L’ENFANCE
(1811-1823)
Les Ferrar. Le traducteur du Tasse. Le comte Joseph-Antoine et Monsieur des Angles. L’Émigration. En Ukraine.—Retour aux Angles. L’Oncle Joseph. M. Eugène de Pontmartin et Mlle Émilie de Cambis. La marquise de Guerry et les Trois Veuves.—Naissance d’Armand de Pontmartin. L’hôtel de Calvière et Mademoiselle de Sombreuil. La Mission de 1819 et le voyage de la duchesse d’Angoulême. Virgile et M. Ract-Madoux.
I
Armand de Pontmartin n’a jamais voulu être autre chose qu’un écrivain, un homme de lettres. Rien ne lui était plus déplaisant que de s’entendre appeler Monsieur le Comte! Démocrate, il ne l’était guère; cela ne l’empêchait pas d’avoir en horreur les généalogies et tout ce qui ressemblait à des préoccupations aristocratiques. Que de fois il s’est égayé à propos d’écrivains-gentilshommes qui, dans leurs Mémoires, commencent par déclarer[2] avec fracas qu’ils n’admettent d’autre distinction que celles de l’intelligence, et qui, ensuite, ne nous font grâce, ni d’un quartier, ni d’un détail héraldique! Le jour où, sur mes instances, il consentit enfin à écrire ses Mémoires, ses souvenirs d’enfance et de jeunesse, il évita soigneusement de parler de ses ancêtres; des origines et de l’ancienneté de sa famille, il ne dit pas un mot. Je n’ai pas le droit d’être aussi discret que lui. Le premier devoir d’un biographe est de replacer dans son milieu celui dont il écrit la vie, de faire connaître ses parents, de remonter au moins à deux ou trois générations en arrière.
Le nom patronymique des Pontmartin est Ferrar et se montre d’abord à Avignon sous Henri IV. Les Ferrar étaient sans doute d’origine italienne, comme tant d’autres familles avignonnaises; ce qui le ferait croire, c’est cette orthographe d’un nom en ar sans autre consonne finale, qui semble une transcription littérale du nom italien Ferrari. Sous Louis XIII, un Ferrar va d’Avignon s’établir à Montpellier, où il acquiert le titre et remplit les fonctions de Conseiller à la Cour des comptes, aides et finances de cette ville. Cet office devint héréditaire dans la famille et se transmit d’aîné en aîné jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. La branche aînée possédait aussi le domaine de Pontmartin[2], acquis en 1625.
Suivant l’usage des familles parlementaires, les aînés, tout en possédant ce domaine, érigé pour eux en seigneurie en 1644, n’en portaient pas le nom et s’appelaient Messieurs de Ferrar; ils laissaient prendre ce nom à leurs cadets, dépourvus de tout apanage. Un de ces conseillers, Antoine, traduisit, non sans succès, la Jérusalem délivrée, du Tasse, ce qui lui a valu de figurer dans la Biographie universelle de Michaud[3]. La branche aînée s’éteignit à l’époque de la Révolution et les trois filles du dernier représentant de cette branche vendirent au père de l’écrivain, en 1813, le domaine de Pontmartin.
Tandis que les aînés conservaient avec soin leur office de judicature, les cadets se tournaient du côté des armes. Le traducteur du Tasse avait un frère officier. Un autre de ses frères, son successeur dans sa charge (car lui-même mourut sans être marié), eut deux fils officiers, outre l’aîné qui, bien entendu, se réserva pour la magistrature. L’un devint général au service de l’Espagne et mourut, vers 1750, gouverneur de Lérida. L’autre, Antoine, qui porta toujours le double nom de Ferrar de Pontmartin, fit la campagne d’Espagne sous le Régent comme capitaine au régiment de Rouergue: forcé par une blessure de quitter le service actif, il fut nommé directeur général des fortifications du Roussillon. Il mourut à Perpignan, en 1748, laissant un fils âgé de quatre ans, Joseph-Antoine. Sa[4] veuve n’eut pour toute ressource qu’une pension de deux cents livres et traversa quelques années de cruelle misère; mais en 1753 elle eut le bonheur de faire admettre son fils à l’École militaire, récemment fondée à Paris. Joseph-Antoine (ce fut le grand-père d’Armand de Pontmartin) eut une carrière militaire extrêmement brillante. C’était un homme superbe, un cavalier incomparable, dont il est fait mention dans plusieurs ouvrages du temps. Sorti de l’école à seize ans, en 1760, il fit les dernières campagnes de la guerre de Sept Ans. Son avancement fut rapide. Il était en 1780 mestre de camp commandant le régiment Commissaire-général-cavalerie, chevalier de Saint-Louis, titré de comte dans ses brevets. Lieutenant des gardes du corps en 1784, il n’avait que quarante-cinq ans en 1789 et pouvait espérer arriver plus haut. La Révolution brisa sa carrière. Il devait devenir plus tard maréchal de camp, mais seulement en 1798, pendant l’émigration, et en vertu d’un brevet daté de Blankenbourg et signé par le roi de France en exil.
En 1781, son grade de mestre de camp, et peut-être aussi sa belle prestance lui avaient valu de faire un mariage qui, de la situation d’officier sans fortune, l’avait fait passer à celle de grand propriétaire. Il avait épousé, le 20 mars 1781, dans l’église du village des Angles[4], Jeanne-Thérèse Calvet des Angles, d’une famille de bonne bourgeoisie[5] avignonnaise; son père était capitaine au régiment de Guienne et chevalier de Saint-Louis; sa mère était fille d’un bâtonnier des avocats au Parlement de Paris. Elle était l’héritière du domaine des Angles et même de la seigneurie de ce nom, acquise par son oncle, l’homme important de la famille, Monsieur des Angles, comme on l’appelle, celui qui bâtit la maison où a vécu et où est mort Armand de Pontmartin.
Elle eut deux fils, Joseph, né le 12 janvier 1782, et Eugène, né le 6 février 1783. Devenus presque aussitôt orphelins, Mme de Pontmartin étant morte à vingt-sept ans des suites de sa seconde couche; privés de la présence de leur père que sa carrière retenait dans de lointaines garnisons, Valenciennes d’abord, puis Versailles, les deux enfants trouvèrent une seconde mère dans une cousine de celle qu’ils avaient perdue, personne d’une exquise bonté, qui se dévoua à eux et ne les quitta plus.
II
A la fin de 1791, M. de Pontmartin émigra en Suisse et s’établit provisoirement à Vevey, où ses fils allèrent le rejoindre. De là, on alla à Soleure, où les enfants passèrent deux ans au collège des Oratoriens de Bellelay. Ils y prirent le goût des lettres, en dépit de dures privations, souffrant du froid et même un peu de la faim. Les maîtres[6] étaient comme eux des émigrés, dénués de toutes ressources. Au printemps de 1793, la famille est à Vienne, d’où elle passe bientôt en Pologne, puis en Ukraine, dans un domaine rural appele Boubenoska. Un peu plus tard, on se fixe à Tulczin, toujours en Ukraine. Dans cette petite ville de la Russie polonaise, nos émigrés retrouvent comme un petit coin de France, où l’ancien lieutenant des gardes du corps essaie par moments d’oublier ses peines en ravivant les douces et mélancoliques images de Versailles et de Trianon. Il y avait là, en effet, presque tous les Polignac, la comtesse Diane, non pas la brillante amie de la reine Marie-Antoinette, mais sa belle-sœur, non mariée, et avec elle ses trois neveux, Jules, Armand et Melchior de Polignac, qui se lièrent étroitement avec Joseph et Eugène de Pontmartin.
Faisant contre fortune bon cœur, les pauvres émigrés avaient organisé chez le comte Vincent Potocki, au château de Kovalovka, une troupe de comédie et d’opéra-comique; on jouait Nina ou la Folle par amour, Zémire et Azor, le Déserteur, Richard Cœur de Lion. On jouait aussi les pièces d’un membre de la colonie, l’abbé Chalenton. Lorsque Armand de Pontmartin arriva à Paris, en octobre 1823, pour faire ses classes, l’abbé Chalenton vivait encore. Il venait voir souvent les Pontmartin, et il déclara un jour que notre collégien aurait des prix de mémoire, parce que celui-ci venait de lui réciter toute une tirade de sa comédie de Monsieur de Porcalaise ou le Gourmand,[7] composée tout exprès pour être représentée sur le théâtre de Kovalovka. Il y en avait trois comme celle-là, et l’abbé les avait recueillies dans un volume, sous ce pseudonyme: Par un nouveau Sarmate.
Une voisine de Kovalovka, la comtesse Moczinska, très riche, mais d’une noblesse inférieure à celle des Potocki, avait offert la plus généreuse hospitalité à M. de Pontmartin et à ses deux fils. Un jour, le voyant découragé par les lenteurs des années d’exil, elle lui dit: «Vous retournerez en France; vous rentrerez dans votre maison; moi, j’irai vous faire une visite, et vous demander l’hospitalité que je suis si heureuse de vous offrir.» Son âge et l’état de l’Europe et de la France, à la veille du 18 Brumaire, rendaient sa prédiction bien invraisemblable. Pourtant, elle arriva, fidèle à sa promesse, en avril 1803, avec une suite nombreuse où figurait un jeune médecin, qui fut plus tard le célèbre docteur Double[5], membre de l’Académie des sciences, père de Léopold Double, le fameux collectionneur, et beau-père du non moins fameux Libri, qui collectionnait, lui aussi, à sa façon.
Chez la comtesse Moczinska, M. de Pontmartin fit connaissance avec Souvarow, qui lui offrit un grade de général dans l’armée russe: il opposa à toutes les instances qui lui furent faites un refus inébranlable.
En 1801, il rentra en France, mais il ne voulut[8] pas quitter l’Ukraine avant d’avoir épousé la compagne de son émigration, la seconde mère de ses enfants. Ce mariage fut célébré à Tulczin, le 17 mars 1801, sur une permission accordée en latin et en polonais par l’évêque de Kaminiec.
On retrouva la propriété des Angles intacte; c’était un bien de mineurs, et ces mineurs n’avaient pas été considérés comme volontairement émigrés. Même la belle allée de marronniers, qui devait presque jouer un rôle dans la vie littéraire de l’auteur des Samedis, avait été sauvée par le dévouement d’un fermier. M. de Pontmartin envoya alors ses fils à Paris pour y compléter des études que tant de déplacements et de hasards avaient dû singulièrement contrarier. Il mourut aux Angles le 3 août 1806. Sa veuve, qui lui survécut jusqu’en 1824, eut le temps de connaître et de combler de gâteries maternelles cet Armand qu’elle considérait comme son petit-fils et qui, au terme de sa vie, parlait encore avec une tendre reconnaissance de celle que ses parents et lui n’avaient jamais appelée que Tatan-Bonne.
III
Des deux fils de l’ancien émigré, l’aîné ne se maria point; il ne devait être, toute sa vie, que l’oncle Joseph. Très bel enfant en naissant, il[9] éprouva pendant les jours de trouble qui suivirent la mort de sa mère un accident qui le rendit contrefait. L’oncle Joseph était donc bossu et d’une santé excessivement délicate. Mais ni cette épreuve ni toutes celles qu’il subit pendant l’émigration n’avaient altéré son humeur. Personne n’eut plus d’entrain, plus de bonne grâce dans les relations mondaines, une plus souriante bonté. Il avait cédé tous les droits du chef de famille à son frère, dont il ne se sépara d’ailleurs jamais. Quand il eut un neveu, on peut deviner de quelle affection il l’entoura et avec quel soin il s’occupa de son éducation: il fut son premier maître, l’initia au latin et au grec, et aussi à la chasse et au dessin, ses deux passions. L’oncle Joseph avait fait ses études à bâtons rompus, mais il avait conservé le goût des humanités; il s’y remit avec ardeur quand vinrent les années de collège d’Armand; bref, quand l’oncle et le neveu se trouvaient, par hasard, éloignés l’un de l’autre durant quelques semaines, ils s’écrivaient presque chaque jour, mais leur correspondance ne s’échangeait qu’en vers latins! Humaniste émérite, botaniste distingué, M. Joseph de Pontmartin était, en outre, un paysagiste de talent, et la peinture était, avec l’éducation de son neveu, la principale occupation de sa vie. Les vues prises par lui d’après nature dans ses promenades et ses voyages forment un album d’aquarelles et de sépias, qui sont, non d’un simple amateur, mais d’un véritable artiste. A l’huile, il pratiqua malheureusement un genre aujourd’hui démodé, le[10] paysage composé: Corot n’était pas encore venu! Néanmoins, le genre une fois admis, on trouve à ces petits tableaux de sérieuses qualités. Leur auteur savait son métier. S’il lui avait pris fantaisie, aux environs de 1825, d’envoyer ses paysages au Salon de peinture, ils n’auraient pas fait trop mauvaise figure à côté des toiles de Bidault et de Jean-Victor Bertin. L’oncle Joseph eut le chagrin de survivre à son frère; il mourut à Paris, où il avait suivi sa belle-sœur et son neveu, le 13 janvier 1832, le lendemain du jour où il avait eu cinquante ans.
Son frère, Castor-Louis-Eugène, qui le suivit d’un an dans la vie et le précéda d’un an dans la mort, avait hérité de la haute taille et de la belle figure de leur père. Il avait tout près de six pieds, et son fils, si grand pourtant, paraissait petit à côté de lui. Eugène avait la plupart des goûts et des aptitudes de l’oncle Joseph, sauf qu’il négligeait l’aquarelle et le paysage composé pour se livrer à l’étude de la philosophie. Comme lui, il s’occupa avec un intérêt passionné des études classiques de son cher Armand; mais il n’avait pas le caractère enjoué de son frère. Malgré une bonté et une douceur sans bornes, il eut toujours quelque chose de mélancolique, comme s’il eût prévu qu’il était destiné à mourir à quarante-huit ans, de celle de toutes les maladies qui porte le plus à la tristesse, un cancer à l’estomac. Sa piété était austère, avec peut-être une nuance de jansénisme inconscient. Il n’allait au théâtre que pour voir de loin en loin jouer une tragédie. Une seule fois, il y alla pour[11] une comédie, l’École des Vieillards[6], de Casimir Delavigne, et encore savait-il qu’il y retrouverait Talma. Si plus tard il lui arriva de se relâcher de cette rigueur, c’était afin d’accompagner, pour le récompenser de ses succès, son fils qui a toujours été un peu réfractaire à la tragédie. De tous ceux que j’ai nommés ou nommerai dans ces pages, celui-là était sans doute le meilleur, et je n’oublierai jamais avec quelle affectueuse vénération son fils parlait de lui.
En décembre 1807, à vingt-quatre ans, il épousa à Montpellier Émilie de Cambis, qui avait vingt ans. La famille de Cambis, venue de Florence au XVe siècle, tenait le premier rang à Avignon, soit par les fonctions qu’elle y exerçait au nom du Pape, soit par sa popularité presque égale à celle des Crillon, soit par tous les serviteurs distingués qu’elle avait donnés à la France, en vertu du privilège de régnicoles accordé par François Ier aux habitants d’Avignon et du Comtat. Ce mariage présentait, au point de vue des idées aristocratiques, une certaine disproportion; mais la belle mine, la vertu et la fortune relative du marié équivalaient à un supplément de parchemins; d’ailleurs, au lendemain de la Révolution et de ses ruines, on devait se montrer moins exigeant qu’on ne l’eût été vingt ans plus tôt. Mlle de Cambis était petite, avec de gros traits, un teint bilieux qui lui[12] était commun avec son frère, le futur pair de France; mais, par ses qualités morales, sa haute intelligence, son instruction, c’était une femme supérieure. Quelles que fussent les charmantes qualités d’esprit de son mari et de son beau-frère, comme on le voit presque toujours quand on étudie les origines des hommes de talent, c’est de sa mère qu’Armand de Pontmartin tenait ses brillantes facultés comme les traits de son visage; de son père il n’avait gardé que la haute taille.
Émilie de Cambis avait, comme son mari, passé par bien des épreuves. Née à Avignon, elle avait été emmenée à Chartres par son père, Henri de Cambis d’Orsan, marquis de Lagnes, colonel de dragons, qui fuyait les excès de la Révolution. A Chartres, il fut mis en prison et y mourut le 5 janvier 1793; le procès du Roi et la perspective du sort réservé à l’auguste victime lui avaient porté un coup dont il ne put se relever. Sa veuve, Augustine de Grave, se retira alors à Montpellier, son pays natal, avec ses trois enfants, Henriette, Auguste et Émilie, qui, admirablement doués tous les trois, firent ensemble et presque sans maîtres des études exceptionnellement approfondies. Mme de Cambis avait deux frères: l’aîné, le marquis de Grave, capitaine au régiment d’Hervilly, fut tué à Quiberon le 21 juillet 1795; le second, le chevalier de Grave, plus tard marquis, fut pendant quelques semaines, du 10 mars au 8 mai 1792, ministre de la Guerre du roi Louis XVI. Décrété d’accusation le 27 août 1792, il se réfugia en Angleterre,[13] d’où il ne revint qu’en 1804. Louis XVIII le nomma pair de France le 17 août 1815. Il mourut sans enfants le 16 janvier 1823[7]. Son frère avait laissé une fille, qui épousa sous l’Empire le marquis de Guerry, Vendéen de race et de sentiments, et qui ne tarda pas à devenir veuve, son mari ayant été tué lors de la prise d’armes de 1815. Ce beau-père fusillé à Quiberon, ce gendre tué au combat des Mathes, il me semble bien les avoir déjà rencontrés quelque part. Ajoutez-y par l’imagination une troisième génération qui sera la dernière, un autre Vendéen mourant, lui aussi, pour le Roi, à la Pénissière, en 1832, et vous avez les Trois Veuves[8], une des premières et l’une des plus remarquables nouvelles d’Armand de Pontmartin. J’ai toujours pensé que ce petit récit était né du souvenir des morts héroïques qui avaient voué Mme de Guerry à un deuil éternel. Cette tragique histoire d’une cousine germaine de sa mère, contée souvent à la veillée, avait dû lui causer une ineffaçable impression[9].
Mme de Cambis, revenue à Montpellier, comme je l’ai dit, après avoir perdu son mari, vécut dans cette ville jusqu’à sa mort, en 1821. Armand, dans ses jeunes années, fut souvent conduit en visite chez cette vénérable et très vénérée aïeule. L’aînée de ses filles, Henriette, une sainte, avait épousé, en 1798, un Cambis d’une autre branche, habitant les Cévennes; elle eut cinq enfants, cousins germains et amis d’enfance de Pontmartin. Tous l’ont précédée dans la tombe; le dernier disparu est l’abbé Adalbert de Cambis, longtemps premier vicaire de Saint-Sulpice, mort en 1879.
IV
Jamais ménage ne fut plus uni que celui de [15]M. et de Mme Eugène de Pontmartin; ils avaient les mêmes goûts, les mêmes sentiments, les mêmes vertus austères. Mme de Pontmartin n’alla jamais au théâtre. Elle lisait et relisait sans cesse les grands écrivains religieux du XVIIe siècle, Bossuet, Bourdaloue, Massillon. Elle a aimé ardemment son fils, l’a trop gâté peut-être. Entre eux, l’intimité fut toujours grande; toujours il lui fut doux de parler d’elle et d’évoquer son image. Je ne sais pourtant s’il n’y avait point, dans la voix de Pontmartin, plus d’émotion encore, plus d’infinie tendresse, quand il parlait de son père et de l’oncle Joseph; c’est qu’aussi on ne trouve pas facilement d’autres bontés comme celles-là.
M. de Pontmartin et sa jeune femme vinrent s’établir aux Angles et louèrent pour l’hiver un appartement à Avignon, rue Sainte-Praxède, dans la maison d’une famille amie, la famille d’Oléon. C’est là que vint au monde, après une attente de près de quatre ans, leur premier et unique enfant, Armand, né le 16 juillet 1811[10]; il fut baptisé le[16] lendemain dans l’église de Saint-Agricol, alors cathédrale d’Avignon; le parrain fut l’oncle Joseph, et la marraine, Mme de Cambis, la grand’mère maternelle.
Les douze premières années de sa vie se passèrent en grande partie aux Angles, avec un séjour de quelques mois chaque hiver à Avignon, dans un appartement qui n’était plus celui de la rue Sainte-Praxède, mais qui se trouvait rue Saint-Marc, dans l’hôtel du marquis de Calvière[11], devenu quelques années plus tard la résidence des[17] Pères Jésuites. Armand de Pontmartin avait un vague souvenir des événements de 1815, des efforts énergiques et couronnés de succès que fit son père pour empêcher une bande de pêcheurs du Rhône, d’un royalisme trop exalté, d’aller à la Vernède, à l’extrémité du territoire de la commune des Angles, piller le château d’un général bonapartiste, le général Gilly. Il se rappelait avec plus de précision cette lugubre soirée de février 1820, où son père et un autre locataire de la maison Calvière, ayant entendu circuler de sinistres rumeurs, se rendirent à la préfecture et revinrent un quart d’heure après en disant: «Hélas! c’est trop vrai! le duc de Berry est assassiné!» Quelques jours plus tard, M. de Pontmartin se trouvait seul aux Angles; on lui envoya d’Avignon une pauvre femme, presque une mendiante, qui lui dit ces simples mots: «Cazes[12] n’est plus rien!» Dans son enthousiasme, il lui donna cinq francs pour la récompenser d’avoir apporté une si bonne nouvelle, et pourtant, il était d’un caractère modéré, il ne partageait aucune des passions des ultras; mais il lui arrivait parfois, comme à beaucoup d’honnêtes gens de ce temps-là, d’être plus royaliste que le roi. Comment ne se serait-il pas réjoui de[18] la chute de M. Decazes, puisque ce ministre était la bête noire de tous les blancs de 1820?
M. et Mme de Pontmartin allaient peu dans le monde, et presque chaque soir, pendant une heure, on faisait une lecture à la table de famille, le plus souvent dans les Essais de morale de Nicole. A certains jours, on s’humanisait un peu, et on lisait les Oraisons funèbres de Bossuet, Corneille, Racine, voire même le Misanthrope et les Femmes savantes. Dans ce vieil hôtel de Calvière, d’une si fière mine avec son escalier monumental, son portique d’ordre toscan, ses moulures en pierre et ses panneaux de boiseries sculptées, avec ses niches veuves de leurs statues, son bassin et sa fontaine rocaille, habitait aussi Mme de Villelume, née de Sombreuil, l’héroïne des massacres de Septembre. Son mari avait été envoyé à Avignon comme gouverneur de la succursale des Invalides. Elle venait quelquefois dîner chez M. de Pontmartin, et ces jours-là on ne servait sur la table que du vin blanc[13]!
Les douze premières années d’Armand de Pontmartin, avant son départ pour Paris, ne lui avaient laissé, à travers les visions confuses de son enfance, que deux souvenirs bien distincts: la mission des Pères de la Foi, ayant à leur tête le P. Guyon, dont la parole rappelait celle du P. Bridaine, et le voyage de MADAME, duchesse d’Angoulême.
La mission des Pères de la Foi est restée légendaire à Avignon. Commencée le 28 février 1819,[20] elle se termina le dimanche 28 avril par la plantation d’une croix sur le rocher des Doms, au-dessous duquel s’étagent la métropole et le palais des Papes et qui domine un merveilleux panorama. La cérémonie fut belle entre toutes. Plus de quarante mille étrangers étaient accourus de toute la contrée d’alentour, et, sans le débordement de la Durance, le nombre en eût été plus considérable encore[14]. Naturellement, les enfants n’avaient pas été oubliés. Pontmartin, qui n’avait pas encore huit ans, était du cortège. Il le décrira plus tard, avec un enthousiasme que soixante ans écoulés n’avaient pu affaiblir[15].
Le récit du passage de la duchesse d’Angoulême a également trouvé place dans les Mémoires[16]. L’auteur seulement a légèrement romancé ce petit épisode; il l’a même, pour m’en tenir à ce seul point, antidaté d’un an. Ce n’est pas en 1822, mais en 1823 que MADAME visita nos provinces méridionales. C’était au moment de la guerre d’Espagne. Pendant que le duc d’Angoulême était, de l’autre côté des Pyrénées, à la tête de nos troupes, la princesse parcourait le midi de la France, où le sentiment royaliste n’avait encore rien perdu de son ardeur. Le 12 mai 1823,—et non, comme le dit Pontmartin, le 27 avril 1822,—elle se rendit de Nimes à Avignon. La route royale côtoyait les[21] Angles. Tous les habitants, villageois et châtelains, étaient à leur poste, au bord de la route: au premier rang, M. de Pontmartin, qui devait haranguer la fille de Louis XVI et qui jetait de temps en temps les yeux sur son papier: à quelques pas en arrière, l’oncle Joseph, tenant par la main son neveu, dont le cœur battait à se rompre.
Tout à coup, on aperçoit, au haut de la montée de Saze, un énorme nuage de poussière, qui accourait d’un train effrayant: «C’est elle! s’écrie-t-on; c’est la duchesse! c’est Madame!» Bientôt le nuage s’éclaircit; un rayon de soleil le perce de part en part; on voit briller les casques et les sabres de l’escorte: puis les harnais de l’attelage et les chapeaux enrubannés des postillons. Deux calèches, menées à quatre chevaux, passèrent devant les bonnes gens des Angles sans s’arrêter. Inclinée à la portière, la duchesse salua d’un signe de tête. «Vive le roi!» crièrent les paysans avec un ensemble digne d’un meilleur sort. Au moment où ils allaient crier: «Vive Madame!» ils s’aperçurent que les voitures avaient disparu. «Ce fut, dit Pontmartin, ma première leçon de philosophie politique; depuis lors, j’en ai subi de plus rudes.»
Son éducation, cependant, commencée de bonne heure, amoureusement poussée et surveillée par les trois êtres dont il était l’affection principale, s’annonçait comme devant être exceptionnellement brillante. Dès qu’il eut huit ans, on lui donna un Virgile, et dans sa joie, il ne voulut plus s’en séparer, ni jour ni nuit. Un professeur du collège[22] royal d’Avignon. M. Ract-Madoux, lui donnait des leçons. Voyant qu’il en profitait si bien, on eut l’idée de lui faire faire les mêmes compositions que les élèves de la classe de troisième. Il fut premier dans toutes, il avait alors douze ans. Ses parents jugèrent bientôt qu’il serait dommage de se contenter pour lui d’une éducation provinciale. Encore bien qu’une telle combinaison fût un peu au-dessus de ce que leur permettait leur fortune, ils se décidèrent à quitter Avignon et les Angles pour aller s’établir à Paris. C’était au mois d’octobre 1823, et Armand de Pontmartin venait d’entrer dans sa treizième année.
CHAPITRE II
LES ANNÉES DE COLLÈGE
(1823-1829)
Le voyage d’Avignon à Paris en 1823. Au 37 de la rue de Vaugirard. Le collège Saint-Louis. Le catéchisme de Saint-Thomas-d’Aquin et l’abbé de La Bourdonnaye.—MM. Roberge, Étienne Gros et Vendel-Heyl. Vox faucibus hæsit.—M. Valette et M. Michelle. Le Concours général. Sainte-Beuve et les vers latins.—Le jardin du Luxembourg, le salon du marquis de Cambis et le salon du docteur Double. Le comte Ory. Les camarades de Saint-Louis. Emmanuel d’Alzon et Henri de Cambis.
I
On loua une voiture de poste, on coucha cinq fois en route et on arriva à Paris dans la matinée du sixième jour, le 13 octobre. M. de Pontmartin avait arrêté un appartement, rue de Vaugirard, au second étage de la maison portant alors le numéro 37, plus tard 31, aujourd’hui 21. Cette maison faisait le coin du jardin du Luxembourg, presque en face de la rue du Pot-de-Fer[17]; trois de ses fenêtres avaient vue sur le jardin.
En même temps que les Pontmartin, deux autres familles méridionales,—les Cambis et les d’Alzon, que des liens de parenté et d’amitié unissaient aux châtelains des Angles,—venaient également se fixer à Paris et prendre gîte, comme eux, dans la rue de Vaugirard, les d’Alzon au numéro 9, hôtel Crapelet; les Cambis, au numéro 18, hôtel Boulay de la Meurthe. Le but des trois familles était le même: l’éducation de leurs fils. Ces fils étaient au nombre de quatre: Henri et Alfred de Cambis, Emmanuel d’Alzon, Armand de Pontmartin. On décida qu’ils suivraient comme externes les classes de Saint-Louis. Ce collège avait une petite porte à l’usage des externes, qui ouvrait sur la rue Monsieur-le-Prince, presque en face de la rue de Vaugirard. Il n’y aurait donc qu’un pas à faire pour conduire les enfants et les aller chercher. Pas un seul instant les parents n’avaient songé à les mettre internes. Ils se défiaient, non sans raison, de l’esprit qui régnait alors dans les collèges de Paris.
Ce sera l’honneur de la Restauration d’avoir, au sortir de la Révolution et de l’Empire, donné le signal de la renaissance religieuse en même temps que de la renaissance littéraire. Aucune époque n’a été plus féconde en œuvres catholiques; si la plupart n’ont acquis tout leur développement et n’ont donné tous leurs fruits que plus tard, la justice n’en commande pas moins de lui en reporter le principal mérite. Sur un point seulement ses efforts restèrent complètement infructueux, ses intentions et ses actes demeurèrent frappés de stérilité.[25] Dans son désir de réformer l’enseignement universitaire, le gouvernement royal confia la direction de l’Instruction publique à un évêque. Un prêtre, dont le zèle égalait le talent, l’abbé de Scorbiac, fut investi des fonctions d’aumônier général de l’Université, avec mission de visiter tour à tour tous les collèges de France et d’y donner des retraites. Le soin le plus attentif fut apporté au choix des recteurs et des proviseurs. Les aumôniers furent pris parmi les jeunes hommes les plus distingués du clergé, et c’est ainsi, par exemple, que, de 1822 à 1830, le collège Henri IV eut pour aumôniers l’abbé de Salinis, l’abbé Gerbet et l’abbé Lacordaire. Mais c’est vainement que l’on sème, si «les graines tombent sur un terrain pierreux et parmi les épines qui croissent et les étouffent». Les professeurs, hommes d’ailleurs instruits et d’une conduite privée irréprochable, étaient presque tous imbus des doctrines philosophiques du XVIIIe siècle: leurs élèves étaient, pour la plupart, libéraux et voltairiens. «Un jour, dit M. Armand de Melun dans ses Mémoires, pendant que nous faisions notre philosophie[18] il nous prit fantaisie de discuter entre nous l’existence de Dieu. C’était pendant l’étude. Nous eûmes la délicatesse d’engager le surveillant à se retirer, pour nous laisser une plus entière[26] liberté et n’avoir pas à se compromettre lui-même. La discussion fut vive et approfondie; et lorsqu’on passa au vote, l’existence de Dieu obtint la majorité d’une voix! Je votai pour le bon Dieu. Telle était la religion des collèges de l’État[19]...»
Deux collèges, cependant, Stanislas et Saint-Louis, avaient, dans une certaine mesure, échappé à la contagion régnante. Le proviseur de Saint-Louis était un ecclésiastique, l’abbé Thibault[20], qui avait établi au collège une discipline tout à la fois ferme sans rigueur et paternelle sans faiblesse. Il y avait deux aumôniers, l’abbé Léon Sibour, qui allait être remplacé par l’abbé Dumarsais[21], et l’abbé Salacroux.
Armand de Pontmartin fut placé en quatrième sous la férule clémente du bon M. Roberge. Cette même année, il fit sa première communion, non à Saint-Sulpice, dont les locataires du no 37 de la rue de Vaugirard étaient pourtant paroissiens,—mais à Saint-Thomas-d’Aquin. Les âmes les plus droites et les meilleures, celles qui se désintéressent le plus d’elles-mêmes, ont pourtant, elles aussi, [27]leurs secrètes faiblesses. Si M. et Mme de Pontmartin et leurs amis s’étaient arrachés aux douceurs du vieux logis familial, au soleil de l’Hérault et de la Provence, aux prairies de Lavagnac, aux riantes îles du Rhône; s’ils s’étaient aventurés dans ce dangereux et terrible Paris, ce n’était pas pour préparer leurs enfants à être journalistes, maires de leur village, conseillers municipaux ou même grands vicaires. Ils rêvaient pour eux les plus brillantes destinées, ils les voyaient déjà montés aux plus hauts postes. En attendant, ne convenait-il pas de les rapprocher le plus vite possible des futurs ducs et marquis du pur faubourg, des futurs propriétaires des beaux hôtels de la rue de l’Université et de la rue de Varenne? Ces marquis et ces ducs ne manqueraient pas, un jour venant, d’ouvrir à leurs anciens compagnons de catéchisme les portes des Tuileries et de les transformer en ambassadeurs, en pairs de France ou en gentilshommes de la Chambre. Et voilà pourquoi, au trop modeste Saint-Sulpice, on avait préféré l’aristocratique Saint-Thomas-d’Aquin. C’est surtout de l’oncle Joseph que l’idée était venue. L’excellent homme, six ans plus tard, dut s’écrier, non plus avec son cher Virgile, mais avec Lucrèce qu’il connaissait presque aussi bien: O vanas hominum mentes!
A Saint-Sulpice, Pontmartin aurait eu pour catéchistes son cousin germain, le saint abbé Adalbert de Cambis, et un jeune prêtre, déjà presque célèbre, qui s’appelait l’abbé Dupanloup. A Saint-Thomas-d’Aquin, il fut presque aussi bien partagé. Le catéchiste en titre était l’abbé de La Bourdonnaye,[28] prêtre fénelonien, d’une piété fervente, d’une éloquence pathétique, mais d’une santé délicate, qui dépensait pour ses élèves les restes de ses forces et de sa vie. Lorsqu’on lui apportait une tasse de bouillon, il leur disait avec un sourire qui leur serrait le cœur: «Mes enfants! ne me regardez pas! Ne m’imitez pas! Je vis comme un païen!» Il était secondé par l’abbé Hamelin, qui devint plus tard curé de Sainte-Clotilde. Les dimanches, Pontmartin et ses camarades de catéchisme avaient souvent Mgr de Quélen et l’abbé Borderies, qui mourut évêque de Versailles; quelquefois, l’abbé duc de Rohan, dont ils admiraient la suprême élégance, les pieuses coquetteries de geste et de parole, la tenue exquise, le rochet brodé de dentelles, le calice incrusté de saphirs et d’opales.
Au même printemps de 1824 se rattache un épisode raconté au tome IV des Souvenirs d’un vieux critique. Armand de Pontmartin et ses parents allaient à la messe à la chapelle du couvent des Carmes, situé à deux pas de leur demeure et occupé par des religieuses carmélites[22]. Le dimanche 23 mai, en se rendant à l’église, il longea le mur du jardin de l’hôtel d’Hinnisdal, qui formait l’angle de la rue de Vaugirard et de la rue Cassette. Sur le trottoir, il vit un jeune homme qui paraissait en proie à une agitation extraordinaire; non loin[29] de lui stationnait un fiacre. Un peu ému, Pontmartin alla prendre dans la chapelle sa place accoutumée. Dans le chœur, à côté du grillage où se plaçaient les religieuses, il y avait une porte. Au moment où la messe allait finir, cette porte s’ouvrit et les assistants virent sortir une Carmélite qui, après avoir regardé à droite et à gauche, traversa rapidement l’église, comme si elle eût craint d’être poursuivie. On ne la poursuivit pas. Lorsque la fugitive avait passé près de lui en le frôlant de sa guimpe et de son voile, Pontmartin avait eu peine à retenir un cri de stupeur. Il aperçut ses compagnes pressées, comme des ombres, contre le grillage qu’il leur était interdit de franchir. Il entendit un chuchotement vague, un susurrement insaisissable, pareil à un souffle de brise expirant sur les bords d’un lac. Puis plus rien, que ce qui reste d’une apparition ou d’une hallucination! De cette vision de son enfance, il restera seulement à l’élève de Saint-Louis un souvenir qui, après de longues années, lui inspirera une Nouvelle[23] dont le prologue seul est exact.
II
Les vacances de 1824 se passèrent à Paris, les Angles étant trop loin pour que l’on pût y revenir chaque année. En octobre 1824, Armand de Pontmartin[30] commença sa troisième sous un professeur, M. Étienne Gros, qui était un helléniste remarquable. Sa santé toujours délicate fut éprouvée à ce moment par une croissance excessive, et au printemps de 1825, ses parents le ramenèrent aux Angles. Quand vint l’été, on alla passer six semaines aux bains de mer, à Marseille; mais l’oncle Joseph n’y accompagna pas son frère et son neveu; aussi ce fut la grande année de la correspondance en vers latins.
A la rentrée de 1825, complètement rétabli, il recommença sa troisième, qu’il fit avec le plus grand succès. Aux vacances du jour de l’an 1826, son père, pour ses étrennes, lui offrit le choix entre une tragédie jouée par Talma et un spectacle du Cirque Olympique, l’Incendie de Salins[24], qui attirait alors tout Paris. Hélas! il choisit le Cirque. Talma mourut peu de temps après[25], si bien que, par sa faute, Pontmartin, qui devait être un fanatique de théâtre, n’a jamais vu le grand tragédien.
Il prit, du reste, sa revanche aux mois d’août et de septembre 1827, après son année de seconde, où, sous la direction d’un excellent maître, M. Vendel-Heyl, il avait fait une ample moisson de couronnes. Pour l’indemniser de ses vacances manquées (comme celles de 1826, celles de 1827 se passèrent encore à Paris), ses parents lui accordèrent[31] cinq soirées théâtrales: à l’Opéra, Moïse; au Théâtre-Français, Mlle Mars dans les Femmes savantes et dans la Jeunesse de Henri V; à l’Opéra-Comique, la Dame Blanche; au théâtre de Madame, le Mariage de raison, joué par Léontine Fay, Jenny Vertpré, Gontier, Ferville, Paul et Numa; et enfin, à la Porte-Saint-Martin, le drame de Trente ans ou la vie d’un joueur, où Frédérick Lemaître et Mme Dorval, par leur merveilleux talent, faisaient illusion aux spectateurs sur la valeur réelle de la pièce de Victor Ducange et Dinaux[26].
Dans la seconde série de ses Mémoires[27], Pontmartin a longuement parlé d’un accident, dont il fut victime à cette date, et qui, d’après lui, «a dominé toute sa vie, a décidé de sa carrière, a mêlé une souffrance secrète, intime, à la fois chronique et aiguë, à tous les épisodes, à tous les chagrins, à toutes les joies de son existence».
C’était le 12 septembre 1827, il était allé herboriser, avec deux ou trois camarades de Saint-Louis, sur les coteaux de Bellevue et de la Celle-Saint-Cloud; soudain il tomba en arrêt—comme Jean-Jacques devant la pervenche—devant une jolie petite fleur bleue, dont il ignorait le nom. Ce nom, il voulut le demander au plus savant de ses[32] camarades; mais ces derniers, pendant ses extases et ses rêveries contemplatives, avaient pris les devants et étaient déjà loin. Alors il voulut crier... Vox faucibus hæsit! En quelques minutes, le timbre de sa voix avait subi une altération inexplicable; ou plutôt cette voix sans timbre passait incessamment d’une sorte d’extinction à des notes aiguës et fausses, d’autant plus pénibles pour lui qu’il avait et qu’il eut toujours l’oreille juste. «Ce n’est rien, c’est la mue!» lui dirent ses camarades après l’avoir entendu.—«C’est la mue!» dirent le soir ses parents. Cette mue devait durer toujours.
Devons-nous croire que vraiment cette défectuosité vocale «a dominé toute sa vie», que cette voix fluette, si peu en rapport avec sa haute taille, a été pour lui un martyre continu, la cause de tristesses et de déceptions sans nombre; qu’elle l’a empêché de se présenter à l’Académie, où plus d’une fois, en effet, il n’a dépendu que de lui d’être élu[28]? Il lui a plu de le dire, un jour qu’il avait ses nerfs, mais nous ne sommes pas obligés de le croire. Et d’abord, cette prétendue aphonie était bien relative. Que de gens ont causé avec lui sans jamais s’en apercevoir! Mais, réelle ou non, peut-être avait-elle pu impressionner son imagination assez vivement pour produire ce demi-désespoir dont il nous parle? Sans doute, mais c’est ce désespoir que je nie. On le comprendrait à peine, si Pontmartin avait jamais eu le désir d’aborder le barreau[33] ou la tribune. A aucun moment de sa vie, il n’y a songé. Sa seule ambition fut d’être un écrivain, et pour réussir dans les lettres, point n’est besoin d’avoir une grosse voix, os magna sonaturum. Le discours de réception à l’Académie? Mais, franchement, se préoccupe-t-on trente ans d’avance d’une mauvaise heure à passer, quand cette heure doit être unique? Et d’ailleurs, là même, n’a-t-on pas la ressource de prétexter au dernier moment une indisposition et de prier un Legouvé ou un Camille Doucet de lire à votre place? Autre considération: quand un jeune homme est ou se croit atteint d’une infirmité qui l’humilie, la première chose qu’il fait d’instinct, c’est de fuir le monde, où il redoute la raillerie des autres jeunes gens et plus encore celle des femmes. Or, nous savons, par le témoignage de ses amis et par le sien propre, que personne plus que lui n’y brilla, que nul n’y déploya plus de verve et de gaieté, et cela précisément dans les années où il voudrait nous faire croire qu’il vivait à l’écart, en proie à ses sombres pensées. Autre chose encore: Pontmartin a siégé huit ans au Conseil général du Gard, et à coup sûr il ne s’y est pas senti humilié et inférieur à ses collègues, qui avaient peut-être plus d’accent que lui, mais qui, toutes les fois qu’il prenait la parole, l’écoutaient avec un plaisir sans mélange. Une seule fois, je l’ai entendu parler de sa voix grêle, et c’était en manière de plaisanterie, pour faire passer un de ces calembours dont il était coutumier.
III
Au mois d’octobre 1827, il entra en rhétorique où il retrouva, comme professeur de rhétorique latine, son professeur de seconde, M. Vendel-Heyl. Le professeur de rhétorique française était M. Charles Alexandre[29], plus tard membre de l’Institut, helléniste de premier ordre et bon latiniste. Les deux professeurs d’histoire étaient également deux hommes d’un réel talent, M. Dumont et M. Charles Durozoir: le premier, auteur d’une bonne Histoire romaine, et le second, collaborateur très actif de la Biographie universelle de Michaud.
Les vacances de 1828 procurèrent à Pontmartin une grande joie, le retour aux Angles après trois ans d’absence.
En 1828-1829, il fit sa philosophie avec M. Valette pour professeur. Afin de compléter et de rectifier au besoin les leçons du collège, ses parents lui avaient donné pour répétiteur M. Michelle, lui-même professeur de philosophie à Stanislas, fervent chrétien et membre de la Congrégation.
Jusqu’à la fin, il avait été sans conteste l’élève le plus brillant de Saint-Louis. Dans les années[35] 1826, 1827, 1828 et 1829, le collège Saint-Louis a remporté vingt prix au concours général. Armand de Pontmartin en a eu, à lui seul, plus du tiers: deux en 1826, deux en 1827, deux en 1828, un en 1829. Il obtint, en troisième (1826), le premier prix de vers latins et le second prix de version grecque:—en seconde (1827), le premier prix de narration latine et le second prix de version latine;—en rhétorique (1828), le premier prix de discours français et le second prix de version latine; en philosophie (1829), le second prix de dissertation latine. A ces sept prix se venaient ajouter une douzaine d’accessits. Dix-neuf nominations au concours général, le cas assurément était rare. Dans la bibliothèque de sa maison des Angles, Pontmartin avait conservé ses volumes de prix; il y en a cent soixante-quatre; cent un obtenus au collège, soixante-trois au concours général. Au nombre de ces derniers, et parmi ceux qu’il a le plus souvent feuilletés, je remarque les volumes de critique de l’abbé de Féletz[30], de l’Académie française. Les maîtres de Pontmartin prévoyaient-ils qu’un jour, avec plus d’esprit encore et avec un bien autre éclat que le très spirituel abbé, il ferait à son tour des Causeries littéraires, qui resteront les chefs-d’œuvre du genre?
Ses succès étaient d’autant plus remarquables que le surmenage n’y était pour rien. L’élève Pontmartin n’était pas ce que, dans le langage des[36] écoles, on appelle une bête à concours; il était externe libre, et nous verrons tout à l’heure que déjà il allait dans le monde et fréquentait quelques salons où les lettres étaient en honneur. Il soignait sa toilette,—ce qu’il sera loin de faire plus tard, et le mardi, jour de composition, il éblouissait les internes par l’élégance et l’éclat de ses bottes. En rien il ne ressemblait à ces piocheurs que les chefs d’institution chauffent en vue du concours général et qui sont voués à une ou deux spécialités. Il n’était pas seulement un fort en thème, il était fort en tout, en discours français et en version latine, en thème latin et en version grecque, en vers latins, en discours latin et en dissertation française; soit au collège, soit au concours général, il a remporté des prix dans toutes les facultés latines, grecques et françaises. Sainte-Beuve, si exact d’ordinaire, s’est donc trompé lorsque, dans ses Nouveaux Lundis, il a écrit que Pontmartin péchait par le manque d’études premières; que, chez lui, le fonds classique était faible et insuffisant. «Il cite sobrement du latin, dit-il, quelquefois de l’Horace; mais aux moindres citations, pour peu qu’on en fasse, le bout de l’oreille s’aperçoit; quand il cite le vers: Urit enim fulgore suo..., il oublie l’enim: par où je soupçonne qu’il ne scande pas très couramment les vers latins. Un jour, à une fin de chronique littéraire[31], parlant de la Dame aux Camélias et lui opposant la vertu des[37] bourgeoises et des chastes Lucrèce, il a dit: DOMUM mansit, lanam fecit; d’où je conclus qu’au collège il était plus fort en discours qu’en thème[32].» La vérité, au contraire, est que Pontmartin, écolier, avait réussi de façon peu commune dans les facultés latines. Le hasard fait que j’ai ici, sous la main, à la campagne, les Annales des concours généraux pour la classe de troisième. L’invasion de la Grèce par les armées de Xerxès, Athènes menacée par les Perses et sauvée par Minerve, Pallas Athenarum servatrix, telle était en 1826 la matière à mettre en vers latins. Pontmartin eut le premier prix. Hélas! quarante-quatre ans plus tard, lorsque les armées allemandes se sont, à flots pressés, précipitées sur la moderne Athènes,—où Minerve était représentée par Jules Favre,—le vieux critique aurait pu murmurer les vers de l’élève de Saint-Louis:
Adsit, et insultet patriis jam mœnibus hostis
Barbarus; ingenuâ se jactet servus in urbe.
Vos tamen, o cives, nunquam cognata relinquet
Libertas, inter bellique fugæque labores,
Vobis libertas vultu arridebit amico...
Tuque, novo splendore nitens rediviva resurge.
O dilecta Diis! ô patria[33]!...
IV
Rien n’égalait pour Pontmartin la douceur de ces souvenirs d’enfance et de jeunesse. Le collège n’avait point été pour lui un exil et une prison. Les conseils affectueux et le sourire de son père, les encouragements de l’oncle Joseph, les baisers de sa mère, ne lui avaient pas manqué un seul jour. De sa fenêtre, quand il interrompait un moment son travail, au lieu d’un noir et lugubre préau, il voyait le jardin du Luxembourg; il apercevait les palombes perchées sur les hautes branches des platanes, des hêtres et des tilleuls, le grand carré où des étudiants et des rapins jouaient à la paume, se servant de leurs mains en guise de raquettes. Pour se rendre au collège, il lui fallait suivre dans toute sa longueur l’allée qui passe devant la façade du palais et conduit à la grille, voisine de l’Odéon; il s’y croisait parfois avec des hommes célèbres qui auraient bien troqué leur renommée contre ses quinze ans s’il eût voulu les leur céder: Cambacérès, le docteur Portal, François Arago, M. de Sémonville, le grand référendaire, et le chancelier, M. Dambray. Dans la belle saison, il avait presque tous les jours la bonne fortune de pouvoir s’incliner discrètement devant un petit homme à la chevelure grise, mais à la tournure encore jeune, invariablement vêtu du même costume: chapeau gris, gilet blanc, redingote bleu de roi, pantalon[39] de nankin, guêtres blanches, et, à la main, une petite badine en ébène. Il ne se lassait pas d’admirer sa figure longue, un peu osseuse et pâle, son front d’une ampleur olympienne, ses yeux de génie. C’était Chateaubriand, qui s’acheminait d’un pas leste de la rue d’Enfer à l’Abbaye-au-Bois. Plus régulièrement encore, il rencontrait, le matin, un autre jeune vieillard, d’une tenue fort correcte, d’une physionomie spirituelle, appuyé sur une canne à pomme d’or et un livre sous le bras, qui ne manquait jamais de lui faire un petit signe d’amitié. C’était son voisin, le comte Joseph Boulay de la Meurthe[34], propriétaire d’un très bel hôtel entre cour et jardin, situé au coin de la rue du Pot-de-Fer et de la rue de Vaugirard, en face du no 37. Notre collégien cependant continuait sa route; mais avant d’entrer en classe, il s’arrêtait chez le pâtissier de la rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, qui se nommait Bussonier, et qu’il appelait Buissonière, parce qu’on y faisait l’école de ce nom, Pontmartin a fait depuis de meilleurs calembours, il en a fait de pires.
Il lui arrivait souvent, les jours de congé, de passer la soirée chez son oncle, le marquis de Cambis[35], qui occupait le premier étage de l’hôtel Boulay de la Meurthe. M. de Cambis donnait[40] d’excellents dîners et avait un salon politique, dont les principaux habitués étaient M. Lainé, l’éloquent orateur; le vicomte de Bonald; le comte Armand de Saint-Priest, père du spirituel académicien qui remplaça du même coup, en 1849, Ballanche et Jean Vatout; M. Renouvier[36], député de l’Hérault; M. Delalot, député de la Marne, un fin lettré, longtemps rédacteur du Journal des Débats. Les lettrés, du reste, n’étaient pas rares, en ce temps-là, sur les bancs de la Chambre. M. de Cambis, qui allait être bientôt député de Vaucluse, puis pair de France, était lui-même un helléniste distingué. Dans sa jeunesse, en collaboration avec son ami M. Renouvier, il avait publié une traduction de l’Iliade, très neuve et en avance sur son temps de plus d’un demi-siècle. Mise au jour en 1810, elle n’avait pas réussi, parce qu’elle était trop littérale, trop homérique, et que les contemporains de Luce de Lancival, de Bitaubé et d’Esménard ne pouvaient pas décemment supporter que l’on appelât Minerve la déesse aux yeux de génisse. Cet oncle de Pontmartin était du reste une encyclopédie vivante. Il connaissait bien les littératures italienne et anglaise, s’intéressait aux sciences, avait même étudié la théologie. Mais ce qu’il possédait le mieux, c’était la littérature française du XVIIe siècle. Il savait par cœur plusieurs tragédies entières de Corneille et de Racine,[41] les Oraisons funèbres de Bossuet, les Caractères de La Bruyère. Malgré sa tendance au scepticisme, il mettait au-dessus de tout l’Histoire des variations des Églises protestantes, de Bossuet, et y trouvait encore plus d’esprit que dans Voltaire, qui ne laissait pas pourtant de lui être cher.
M. de Pontmartin conduisait aussi quelquefois son fils chez son ami le docteur Double. Le salon de M. Double, 19, rue des Petits-Augustins, ressemblait à une succursale ou à un vestibule de l’Institut. André-Marie Ampère, Arago, Poisson, Gay-Lussac, Mathieu, Biot, Thénard, Alibert, Récamier s’y rencontraient avec Paul Delaroche, Pradier, Ary Scheffer, Guizot et Villemain. La conversation, la vue seule de ces savants, de ces artistes, de ces écrivains, n’était-elle pas pour le jeune collégien la plus éloquente des leçons, la mieux faite pour lui inspirer le goût du travail, la passion de l’étude?
Quand il avait été premier trois fois de suite, son père le menait voir Iphigénie en Aulide, jouée par Mlle Duchesnois, ou entendre la Dame Blanche chantée par Ponchard et par Mme Rigaut-Palar. A la fin de février 1829, il était en philosophie, et, déjà, malgré les explications de son professeur, il commençait à trouver, comme M. Jourdain, qu’il y avait là beaucoup de tintamarre et de brouillamini. Cela ne l’empêchait pas d’être encore premier à l’occasion. Un jour, à la suite d’un coup double en dissertation latine et française, on lui promit pour récompense une demi-soirée à l’Opéra. Il sortirait[42] du théâtre avant le ballet, de peur que les pirouettes et les ronds de jambes de Mmes Legallois, Noblet et Montessu ne fissent une trop dangereuse concurrence à Descartes et à Condillac; mais il entendrait d’un bout à l’autre le Comte Ory, qui était alors dans toute la fraîcheur de son succès et qui ne durait que deux heures. Ces deux heures furent pour lui un véritable enchantement. Le chef-d’œuvre de Rossini était chanté par Adolphe Nourrit, Levasseur, Dabadie, Alexis Dupont, Mme Damoreau, Mlle Iawureck. Nourrit surtout y était la perfection même. Le jeune philosophe était sous le charme. Le lendemain, quand le digne M. Valette lui demanda son opinion sur l’Ontologie, il fut sur le point de répondre: Une dame de haut parage. Quand M. Valette voulut savoir ce qu’il pensait de l’association des idées, peu s’en fallut qu’il ne répliquât: A la faveur de cette nuit obscure...
Le Comte Ory s’était décidément emparé de ses souvenirs, de ses songes, de sa mémoire... Il le savait par cœur; il en fredonnait les principaux airs en traversant la grande allée du Luxembourg, et lorsqu’il franchissait la petite porte de la rue Monsieur-le-Prince, il répétait mezza voce le chœur du second acte: En ce séjour chaste et tranquille! Qu’il dût devenir un critique célèbre, il ne s’en doutait guère, à coup sûr; mais ce qu’il savait bien déjà, c’est qu’il serait certainement un mélomane!
Malgré le charme qui ramenait si souvent le vieux critique et le vieux mélomane à ces heureuses et lointaines années, le plus vivant de ses souvenirs[43] de jeunesse était celui qui lui était resté de ses camarades de collège.
Saint-Louis, en ce moment, passait pour un aristocrate, plus distingué, mieux surveillé, mieux élevé, mieux vêtu, mieux chaussé que Louis-le-Grand et Henri IV, Charlemagne et Bourbon. Dans la cour et dans les classes retentissaient les noms d’Ugolin du Cayla, de Louis d’Eckmühl, de Guy de la Tour du Pin, de Pierre de Brézé (le futur évêque de Moulins), de Raymond de Monteynard, d’Henri de Cambis, de Charles de la Bouillerie, d’Emmanuel d’Alzon, d’Adrien Delahante, d’Hector de La Ferrière, de Léon de Bernis, de Féodor de Torcy, etc., etc. Entre ces fils de grands seigneurs et les élèves de condition plus modeste, Armand de Pontmartin était volontiers le trait d’union. Il était aussi lié avec Casimir Gaillardin[37], dont le père était portier chez le marquis de Dreux-Brézé, qu’avec Pierre de Brézé lui-même. Un de ses meilleurs amis était le fils d’un petit bourgeois de Limoges, Léonard Retouret, très brillant élève et le porte-drapeau des libéraux. Parmi ceux qui, comme Retouret, lui disputaient les premières places, il aimait à se rappeler deux autres de ses condisciples, Emmanuel Richomme et Armand de Crochard. Richomme était son rival le plus dangereux au point de vue des fins d’année scolaire. Gai, amusant, spirituellement fantaisiste,[44] Armand de Crochard était le sourire de la classe. D’une intelligence extraordinaire, doué d’un vrai talent poétique, il aurait certainement fait parler de lui, s’il n’eût préféré se retirer en province, dès qu’il eut fini son droit. Il mourut en 1833 à Nogent-le-Rotrou, dans le pays Chartrain, où il avait accepté les modestes fonctions de juge suppléant près le tribunal de première instance. Mais de tous les camarades de Pontmartin, celui qui lui inspira la plus vive affection,—une affection qui se mélangeait déjà de respect,—ce fut Emmanuel d’Alzon.
Emmanuel d’Alzon[38], qui devait être plus tard un si rude travailleur, l’infatigable ouvrier de tant de belles œuvres, le fondateur du collège de l’Assomption, à Nimes, était à Saint-Louis un élève, non pas médiocre, mais inégal, un peu fantasque, traité souvent de paresseux par ses professeurs. Un samedi, on venait de donner les places: Pontmartin était premier; d’Alzon n’avait pas fini sa composition, il fut classé parmi les derniers et ne parut pas d’ailleurs s’en émouvoir autrement. Les deux amis sortirent du collège en se donnant le bras: «Sais-tu, dit Pontmartin, à quoi je songeais pendant qu’on donnait les places? A ces paroles de l’Évangile: Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers.»
Quelques années plus tard, Armand de Pontmartin[45] et Henri de Cambis[39] se préparaient à passer leur soirée au Théâtre-Italien: on donnait Otello avec Rubini et Mme Malibran! Au moment où ils terminaient leur toilette, ils virent entrer leur cousin, l’abbé Adalbert de Cambis: «Je vous annonce, leur dit-il, une grande nouvelle, Emmanuel d’Alzon est depuis trois jours au séminaire de Montpellier.»
Et sans respect pour la cravate blanche d’Henri de Cambis et le bel habit de Pontmartin (un habit de Blain!), l’abbé ajouta: «Il a choisi la meilleure part.»
CHAPITRE III
L’ÉCOLE DE DROIT
(1829-1832)
M. Poncelet ou le professeur mélomane. A la Sorbonne. Cours de MM. Guizot, Villemain et Cousin.—Jules Janin et le Siècle de Charles X. Les arts et les lettres en l’an de grâce 1829. Le romantisme de Pontmartin.—L’atelier de Paul Huet et la première représentation d’Hernani. Félix Lebertre et la Silhouette. Le Petit Plutarque français. Le Correspondant. Première rencontre de Pontmartin avec l’Académie. Mort de M. Eugène de Pontmartin.—Mort de l’oncle Joseph. Le choléra. La prédiction de Léonard Retouret et le 19 avril 1832. La première représentation de la Tour de Nesle. Alfred Thureau-Dangin.—Retour à Avignon.
I
Au mois d’août 1829, Armand de Pontmartin passa son baccalauréat, ce qui fut, on le pense bien, une simple formalité. Si j’en parle, c’est pour ce petit détail: un de ses examinateurs s’appelait Villemain. Trois mois après, il prenait sa première inscription de droit. Des cours de l’école, il ne semblait avoir gardé aucun souvenir; de ses professeurs il ne parlait jamais, sauf quelquefois de[47] M. Poncelet[40] professeur d’histoire du droit. Un soir, aux Italiens, à une représentation d’Otello, M. Poncelet n’avait pas de place; Pontmartin lui donna la sienne, sous le fallacieux prétexte qu’il allait au bal chez l’ambassadeur d’Angleterre. Depuis ce soir-là, ils furent amis, et ils prirent bientôt l’habitude de se rencontrer dans la grande allée du Luxembourg, où ils dissertaient à perte de vue sur Gluck et sur Rossini, sur Nourrit et sur Ponchard, sur Mlle Sontag et sur Mme Damoreau. Au bout de trois mois, l’accord était si parfait entre nos deux mélomanes qu’ils se tutoyaient. Cette liaison du reste n’eut point pour effet d’éveiller chez Pontmartin le goût de la procédure ou celui des Pandectes, et il continua de briller surtout par son absence aux leçons de MM. Duranton, Demante et Du Caurroy. En revanche, il était des plus assidus à la Sorbonne. Dès le collège, il avait été plus d’une fois conduit par son père et par l’oncle Joseph aux cours de MM. Guizot, Cousin et Villemain. Étudiant, il ne manqua aucune de leurs leçons. L’impression qu’il en ressentit ne devait jamais s’effacer.
M. Guizot avait choisi pour sujet de son cours de 1829-1830 l’histoire de la civilisation en France pendant les XIe, XIIe et XIIIe siècles, de Hugues Capet à Philippe de Valois. M. Villemain exposait[48] l’histoire de la langue et des lettres au moyen âge en France et dans l’Europe méridionale. M. Cousin avait pris pour thème l’histoire de la philosophie du XVIIIe siècle.
Il n’était pas un jour de la semaine où le public, de plus en plus nombreux, ne fût assuré de voir monter en chaire un des trois professeurs:
Le lundi, M. Guizot;
Le mardi, M. Villemain;
Le mercredi, M. Villemain;
Le jeudi, M. Cousin;
Le vendredi, M. Cousin;
Le samedi, M. Guizot.
Dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, devenu un rendez-vous plus accrédité que le Bois de Boulogne, le Jardin des Tuileries et le Boulevard des Italiens, se rencontraient, au milieu d’une jeunesse enthousiaste, le député et le pair de France, le membre de l’Institut et le journaliste, l’artiste et le poète, l’universitaire et le séminariste, les femmes savantes et les beautés à la mode, Philaminte et Célimène. Autour de la chaire se pressaient tous ceux qui, ayant un nom, voulaient le soutenir, ou qui, n’en ayant pas, voulaient le faire; tous ceux qui allaient être ou qui ont failli être célèbres. Le duc de Broglie—l’ancien—y coudoyait le duc de Noailles; Théodore Jouffroy s’asseyait côte à côte avec Sainte-Beuve; les rédacteurs du Globe, du Journal des Débats, de la Revue française, préludaient à leurs destinées plus ou moins brillantes; ils venaient apprendre à parler en écoutant.[49] Saint-Marc Girardin, Vitet, Nisard, Cuvillier-Fleury, Charles Magnin, Duvergier de Hauranne, P.-J. Dubois, Louis de Carné, Silvestre de Sacy, Charles de Rémusat, Montalembert, Larcy, Damiron, Alfred de Falloux, et quelquefois Alfred de Musset, l’Académie de l’avenir, un vaillant état-major de lieutenants prêts à passer capitaines, ou de capitaines destinés à devenir généraux!
Des trois illustres maîtres de la Sorbonne, M. Guizot, s’il était le plus original et le plus éloquent, n’était pas le plus couru et le plus applaudi. Ses leçons sur les éléments constitutifs de la société moderne, l’aristocratie féodale, l’Église, la royauté, les communes, étaient des modèles d’impartialité. D’une science profonde, d’une forme élevée, sobre et ferme, elles étaient certainement supérieures à celles de ses deux collègues. Mais ce grave professeur au teint pâle, au profil correct, à la physionomie austère, imposait à ses auditeurs plus qu’il ne les attirait. Son magnifique organe, si net, si vibrant, avait conservé, de son éducation et de sa jeunesse, je ne sais quelle rigidité calviniste qui refroidissait l’enthousiasme. On l’admirait, mais l’admiration était tempérée par une sorte de respect. Il n’y avait pas entre l’orateur et son public ces courants électriques qui triplent le succès. On était conquis, on n’était pas charmé. Le charmeur, c’était Villemain.
Lorsque ce dernier traversait la foule pour arriver jusqu’à sa chaire, le sourire était déjà sur toutes les lèvres. On s’était habitué si vite à sa[50] spirituelle laideur, qu’elle semblait une grâce et une malice de plus. Cinquante ans plus tard, Pontmartin évoquera en ces termes le souvenir de ces inoubliables leçons du Villemain de 1829:
Il me semble que je le vois encore, une liasse de livres ou de papiers sous le bras, le dos voûté, la tête penchée sur une épaule, le scintillement du regard voilé sous le renflement des paupières, le pli des lèvres s’essayant au sourire comme un arc qui va lancer des flèches, le tout avec un petit air de Sainte-Nitouche qui ne présageait rien de bon pour les idées communes, les ignorants, les pédants et les imbéciles.
Il s’asseyait, il parlait, et aussitôt le charme opérait, l’orateur et l’auditoire étaient unis par un fil magnétique. Sa voix, par une incroyable flexibilité d’organe, une étonnante variété d’intonations, donnait une valeur prodigieuse non seulement à toutes ses paroles, mais à tous ses silences. Quelle ingéniosité! Quelle souplesse! Quel art caché sous ce naturel! Quelle justesse de demi-teintes et de nuances!... Les allusions, les épigrammes, les malices, les prétéritions narquoises, étaient saisies au vol avec une promptitude qui nous mettait de moitié dans les spirituelles intentions de notre enchanteur. C’était plaisir de souligner ce qu’il disait, d’achever ce qu’il commençait, de deviner ce qu’il taisait[41]...
Et pourtant, plus étonnant encore était Victor Cousin. Villemain était un merveilleux, un incomparable virtuose, Cousin était tout un orchestre. Ce n’est pas de ses leçons de la Sorbonne que l’on aurait pu dire: Cela manque de musique. Il parlait histoire comme Guizot, littérature comme Villemain;[51] il parlait même philosophie, et il obtenait des effets plus extraordinaires en traitant des sujets plus arides. Sa faculté d’exposition avait toute la valeur d’une invention originale. Partout où il voulait mener son auditoire, son auditoire le suivait, avec frémissement, avec transport.
Nous sommes en 1887. Les maîtres sont morts. De leurs auditeurs, combien peu survivent! Pontmartin, l’un des derniers, se plaît à raviver, pour un moment, ces figures disparues, ces images éteintes, ces grands jours de la Sorbonne depuis longtemps évanouis.
Le cours de M. Cousin, écrit-il, eut l’heureuse fortune de coïncider avec les premières ardeurs du romantisme. On lui a reproché d’avoir fait le roman de la philosophie plutôt que son histoire. C’était là justement ce qui nous transportait. Pour passer des Méditations, des Odes et Ballades, des Orientales, d’Eloa, de Cromwell et de sa préface aux leçons de M. Cousin, nous n’avions pas besoin de changer d’atmosphère. Poésie, art, philosophie, découlaient de la même source, s’allumaient au même foyer, échangeaient tour à tour leurs rayonnements et leurs reflets. L’éloquent professeur réagissait énergiquement contre la philosophie sensualiste des demeurants du dernier siècle, tandis que nos poètes et nos artistes appliquaient le même effort de réaction aux pâles continuateurs de Voltaire et à l’école de l’abbé Delille... S’il ne disait pas assez clairement ce que devait être la philosophie, il nous apprenait au moins ce qu’elle devait ne pas être. D’ailleurs, encore une fois, ce détail nous semblait secondaire. Il était pour nous un oracle plutôt qu’un professeur, et il sied aux oracles de s’entourer de nuages. Au bout de soixante ans, je crois le voir et l’entendre encore: Deus! ecce Deus!... Il restait debout, et sa chaire devenait un trépied. Ses yeux lançaient des flammes.[52] Ses gestes excessifs ajoutaient à l’entraînement de sa parole. Il était sibyllin sans être pédant, et ses obscurités paraissaient calculées pour rendre plus vifs et plus éclatants ses jets de lumière. Il avait des hardiesses de pensée et de langage qui saisissaient nos intelligences, élargissaient les horizons et introduisaient violemment l’histoire contemporaine dans la philosophie de tous les temps[42].
II
Pour un jeune homme épris de l’amour des lettres, pour le lauréat du collège Saint-Louis et du concours général, quelles fêtes que ces matinées de la Sorbonne et quelles fêtes aussi au dehors! Partout, dans la poésie, dans le roman, dans les arts, à la tribune comme au théâtre, c’est un renouveau merveilleux, «le plus beau comme le plus hardi mouvement intellectuel qu’aucun de nos siècles ait encore vu[43].»—«Allons-nous donc, écrit Jules Janin, allons-nous donc avoir le siècle de Charles X, comme nous avons eu le siècle de Louis XIV[44]?» Hélas! Charles X va tomber; il va reprendre le chemin de l’exil. Mais il semble que, à cette heure suprême, les chefs-d’œuvre veuillent se presser sur ses pas pour lui former un cortège digne de cette maison de Bourbon, qui a fait la France. Au dernier Salon de[53] peinture de la Restauration, les plus grands noms de l’art au XIXe siècle se donnent rendez-vous. Parmi les peintres, Ingres, Eugène Delacroix, Paul Delaroche, Léopold Robert, le baron Gérard, Eugène Devéria, Isabey, Schnetz, Horace Vernet, Gudin, Heim, Sigalon, Brascassat, Paul Huet, Bonington, Granet, Ary Scheffer. Parmi les statuaires, Dumont, Cortot, Pradier, David d’Angers, Foyatier, Rude, Nanteuil et Bosio. Du mois de juillet 1829, au mois d’août 1830, pendant cette dernière année de la Restauration, qui fut précisément la première année de droit de Pontmartin, Rossini fait représenter Guillaume Tell, et Auber Fra Diavolo; Victor Hugo et Alfred de Vigny donnent au Théâtre-Français Hernani et le More de Venise[45], Alfred de Musset publie les Contes d’Espagne et d’Italie, Sainte-Beuve les Consolations, Lamartine les Harmonies, Théophile Gautier ses premières Poésies[46]. Après s’être essayé sous les pseudonymes d’Horace de Saint-Aubin, de Viellerglé de[54] Saint-Alme et de lord R’hoone, Balzac, entré en pleine possession de son talent, écrit les Scènes de la vie privée[47], tandis que Prosper Mérimée, après avoir fait paraître, au mois de mars 1829, la Chronique du règne de Charles IX, compose ces nouvelles qui sont restées ses œuvres les plus achevées, la Partie de trictrac, le Vase étrusque et l’Enlèvement de la Redoute. En même temps que Guizot, Villemain et Victor Cousin professent à la Sorbonne, Cuvier, après quinze ans de silence, reprend son cours au Collège de France. Berryer prononce son premier discours parlementaire, Montalembert écrit son premier article.
Chaque matin, sans y manquer jamais, Pontmartin allait bouquiner, sous les galeries de l’Odéon, chez son voisin le libraire Masgana, sûr d’y trouver le chef-d’œuvre du jour, en attendant celui du lendemain. Comme sa bourse d’étudiant était bien garnie, il achetait le volume et, sans perdre une heure, il allait le lire, l’hiver dans sa chambre de la rue de Vaugirard, en été sous les tilleuls du Luxembourg.
En dépit de ses brillantes études classiques, ou peut-être à cause d’elles, il était romantique,—romantique avec Victor Hugo et Sainte-Beuve, mais plus encore avec Chateaubriand, Lamartine, lord Byron et Walter Scott. Il applaudissait à la chute des trois unités, à la brisure du rythme, à la césure[55] plus libre, à la rime plus riche: mais ces questions de forme et de style n’avaient à ses yeux qu’une importance secondaire. Ce qui l’attirait, ce qui le passionnait dans le romantisme, pur encore de tout excès, c’était le retour aux idées spiritualistes et chrétiennes. Il saluait en lui l’allié de l’opinion royaliste, l’adversaire des coryphées du libéralisme, des voltigeurs de Voltaire et de l’Encyclopédie. Dans son juvénile enthousiasme, il se plaisait à y voir la revanche de l’art chrétien, des siècles de foi, de la cathédrale gothique, contre le temple grec, le néo-paganisme du dernier siècle, sa littérature aussi glaciale que sa philosophie. Plus tard, quand l’École nouvelle, au lendemain de la révolution de 1830, reniera ses glorieux débuts et se fera anti-chrétienne, quand 93 aura remplacé 89, quand le Cénacle sera devenu un club démagogique, Pontmartin s’en séparera, mais il ne se ralliera point pour cela au pseudo-classicisme de Ponsard et de Lucrèce. Il demeurera ce qu’il avait été en 1829; jusqu’à la fin, il sera un romantique impénitent.
III
Emmanuel Richomme, son ancien condisciple de Saint-Louis, était le neveu du peintre Paul Huet, le précurseur de notre grande école paysagiste. Pontmartin fréquenta l’atelier de l’artiste, son aîné seulement de quelques années[48], et noua[56] avec lui une amitié, qu’il consacrera plus tard en lui dédiant les Mémoires d’un notaire, ce roman qui côtoie souvent de trop près le mélodrame, mais où il y a de si charmants paysages, d’un ton si juste et si vrai. Lors de la première représentation d’Hernani, Paul Huet fut chargé de fournir une bande; il la recruta parmi ses élèves et les amis de son neveu. Et voilà comment Armand de Pontmartin se trouva, le soir du 25 février 1830, au parterre du Théâtre-Français, applaudissant à tout rompre les vers de Hugo, en compagnie des rapins les plus frénétiques.
Dans ses Mémoires[49], il a retracé les principaux épisodes de cette soirée mémorable. Il sortit du théâtre plus hugolâtre que jamais, pressé du besoin de dire à tous—urbi et orbi—son admiration et son enthousiasme. Il y avait justement, en ce temps-là, sur le pavé de Paris, un petit journal qui lui avait quelques obligations et ne demandait pas mieux que d’insérer sa prose. De ses deux cousins, Henri et Alfred de Cambis, le second, paresseux et étourdi, avait été retiré du collège, où il perdait son temps; le marquis de Cambis lui avait[57] donné pour précepteur un jeune universitaire, quelque peu journaliste, nommé Félix Lebertre. Lebertre était libéral et hostile au parti prêtre; mais comme cet ennemi de la Congrégation n’était pas, malgré tout, bien féroce, et qu’il avait la passion de la littérature, Pontmartin s’était lié avec lui et avait été un des premiers souscripteurs de son journal, la Silhouette: c’était une feuille à images, à prétentions mondaines, et qui s’occupait volontiers des théâtres. Elle ouvrit avec empressement ses colonnes à l’article de Pontmartin sur Hernani, improvisé en quelques heures le lendemain de la première représentation.
En même temps que la Silhouette, Lebertre dirigeait une autre publication, le Petit Plutarque français, Pontmartin y donna deux notices sur Corneille et sur La Fontaine, ornées de gravures sur bois. Mais il allait bientôt débuter dans un recueil plus important, dans une des principales Revues de l’époque, le Correspondant.
Fondé le 10 mars 1829 par MM. Bailly de Surcy, Edmond de Cazalès et Louis de Carné, le Correspondant, après avoir été d’abord hebdomadaire, paraissait, depuis le 2 mars 1830, deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, en un cahier de huit pages in-4o, à deux colonnes.
A la fois religieuse, politique et littéraire, la nouvelle Revue, dont presque tous les rédacteurs étaient des jeunes, professait hautement les doctrines catholiques et monarchiques; en littérature, elle inclinait vers le romantisme, mais avec de[58] sages réserves. Elle venait justement de publier sur Hernani deux grands articles, où je relève, à côté des éloges les plus mérités, ces lignes quasi prophétiques: «L’invocation au tombeau de Charlemagne est noble et grande... toutefois l’ensemble est entaché du vice d’une fausse profondeur; il y a plus d’images que de pensées, et les pensées arrivent par les images... Mon oreille est étonnée, mon âme n’est pas profondément ébranlée[50]...»
Il y a plus d’images que de pensées, et les pensées arrivent par les images: Victor Hugo poète, avec ses qualités et ses défauts, n’est-il pas tout entier dans cette phrase?
Toutes les sympathies de Pontmartin allaient naturellement au Correspondant, et il se disait que, lorsqu’il aurait quelques années de plus, il serait heureux de se joindre à ce groupe d’élite. Plus tôt qu’il ne le pensait, et avant la fin de sa première année de droit, la porte de la Revue s’ouvrit à demi devant lui, en attendant de s’ouvrir plus tard toute grande.
Le 29 juin 1830, eut lieu à l’Académie française la double réception du général Philippe de Ségur et de M. de Pongerville. Les deux récipiendaires et MM. Arnault et de Jouy, chargés de leur répondre, attaquèrent le romantisme avec une véritable furie:
Ils étaient quatre
Qui voulaient se battre...
Armand de Pontmartin assistait à la séance, avec un billet que lui avait procuré son oncle, M. de Cambis. Rentré chez lui, il écrivit trois ou quatre pages où il parlait des quatre immortels et aussi d’un demi-quarteron de leurs confrères, avec la plus parfaite irrévérence. Une heure après, l’article était dans la boîte du Correspondant, au numéro 5 de la rue Saint-Thomas-d’Enfer.
Ce premier article, on s’en souvient toujours. «Moi-même, écrira Pontmartin dans une de ses causeries de 1876, moi-même, à un demi-siècle de distance, je ne puis oublier avec quel battement de cœur je jetai dans la boîte du Correspondant le premier en date de mes innombrables articles, et quelle fut ma joie, trois jours après, en me voyant imprimé tout vif sur la même page que mes aînés, Louis de Carné et Edmond de Cazalès. Ce sont là de ces impressions de jeunesse qui s’effacent et que l’on croit mortes, tant que la vie semble encore avoir encore quelque chose à nous donner. Mais quand tout manque à la fois, quand on n’a plus devant soi que deuil et que ténèbres, on se retourne et l’on aperçoit bien loin, à l’extrémité de l’horizon, une pâle et faible lueur. C’est le fugitif rayon de la vingtième année, l’adieu furtif du premier rêve à la dernière réalité[51].»
Toutes nos joies sont courtes. L’article du Correspondant avait paru le 2 juillet: moins de quatre semaines après, éclatait la Révolution de 1830.[60] Pontmartin était encore à Paris, où il était resté avec sa mère et son oncle Joseph. Après les premiers jours de trouble, et dès que les routes furent rouvertes, on revint aux Angles, où M. de Pontmartin le père s’était rendu dès le printemps. On le trouva très souffrant, accablé par les nouvelles de Paris. Bientôt même il fallut le transporter à Avignon, dans la maison de son beau-frère de Cambis, afin d’être plus à portée des médecins. La douleur causée au fidèle royaliste par la chute de ses princes, ses inquiétudes pendant plusieurs mois pour la vie de M. de Polignac, son compagnon des années d’émigration, aggravèrent sa maladie et hâtèrent sa mort, qui eut lieu en un jour de deuil monarchique, particulièrement poignant au lendemain d’un nouvel exil des Bourbons, le 21 janvier 1831.
IV
Ce fut seulement au mois d’octobre suivant que la famille, privée de son chef, rentra à Paris, et que Pontmartin commença sa deuxième année de droit. Cette seconde année ne devait guère ressembler à la première. Plus de fêtes en Sorbonne, plus de soirées aux Italiens, plus de lectures paisibles et charmantes sous les arbres du Luxembourg. Les émeutes succédaient aux émeutes et des menaces de guerre venaient du dehors. Pendant que [61]Mme la duchesse de Berry tentait en Vendée son héroïque aventure, les républicains se battaient au cloître Saint-Merry. Paris était mis en état de siège. Aux tristesses publiques venait se joindre pour Armand de Pontmartin un nouveau deuil de famille. Le 13 janvier 1832, un an presque jour pour jour après la mort de son père, il eut la grande douleur de perdre l’oncle Joseph, qui, malgré son chagrin, malgré une fatigue qui équivalait pour son corps débile à une grave maladie, avait tenu à suivre son neveu à Paris et à se réinstaller avec lui dans l’appartement de la rue de Vaugirard. Son corps fut rapporté aux Angles, accompagné par un prêtre ami. Mme de Pontmartin n’avait pas voulu que son fils interrompît encore ses études pour faire ce triste voyage.
Dans les derniers jours de mars 1832, le choléra fit son apparition à Paris. Commencée le 26 mars, l’épidémie ne devait finir que le 30 septembre. Pendant ces cent quatre-vingt-neuf jours, le chiffre des victimes s’éleva à 18,406[52].
De cette effroyable tragédie, de l’état d’âme des Parisiens pendant que le terrible fléau multipliait ses coups, de jour en jour plus meurtriers, Pontmartin a donné, dans ses Mémoires[53], une émouvante et très fidèle peinture. Ce chapitre parut dans le Correspondant du 25 novembre 1881. Après[62] l’avoir lu, Cuvillier-Fleury lui écrivait: «Je suis encore ému, mon cher ami, de l’émotion que votre récit, daté du choléra, a causée à ma femme. Que cela est bien pensé, bien dit! Si je ne suis pas avec vous, aussi avant que vous, dans un certain mysticisme, qui convient aux solitaires quand ils ont de belles âmes, je n’en suis pas moins touché de ces nobles réminiscences, qui vont chercher en remontant quarante ou cinquante ans leurs souvenirs d’autrefois, et les trouvent presque rajeunis par cette éternelle fraîcheur des bons sentiments...»
Dès le milieu d’avril, Paris n’était plus qu’une nécropole. Les marchands, sans doute, ouvraient leurs boutiques, les théâtres ne fermaient pas leurs portes; les fiacres roulaient, les bourgeois montaient leur garde. Rien n’était suspendu dans le mouvement des affaires, et l’on affichait même chaque matin les plaisirs de la journée[54]. Mais ces vains simulacres et ces fausses apparences ne trompaient personne. Les chiffres de la mortalité augmentaient d’heure en heure. Les hôpitaux regorgeaient; les corbillards étaient débordés, et, pour suppléer à leur insuffisance, il avait fallu recourir à des omnibus funéraires, à de gigantesques tapissières, tendues de noir, qui dissimulaient aux regards le chiffre des déménagements. Une indicible terreur enveloppait la ville, et les plus braves eux-mêmes n’en étaient pas exempts. Quand on[63] se séparait le soir, on n’osait pas se dire: «A demain!»
Pour ne pas effrayer sa mère, Pontmartin s’efforçait de faire bonne contenance; mais, nerveux et impressionnable à l’excès, il avait peine à y réussir. Les images de mort qui se renouvelaient sans cesse sous ses yeux, en lui rappelant les chers défunts qu’il avait récemment perdus, le faisaient constamment songer à un proverbe provençal, qui dit que, lorsque la mort est installée dans une maison, elle n’en sort plus. A ces préoccupations funèbres s’ajoutait une pensée superstitieuse et puérile. Il était encore sur les bancs du collège, lorsque son ami Léonard Retouret, dont une des toquades était de prédire l’avenir, lui avait dit: «Tu sais, toi, tu mourras dans cinq ans.» Pontmartin avait écrit, à la première page de son Virgile, la date de cette prédiction: 19 avril 1827. A mesure que l’on approchait de l’échéance fatale—19 avril 1832,—il croyait de plus en plus à la réalisation de la prophétie. Ce brave Retouret s’était trompé—et trompé de près de soixante ans. Le 20 avril, Pontmartin se leva, pleinement rassuré, si bien que, le 29 mai suivant, il assistait avec quelques amis, au théâtre de la Porte-Saint-Martin, à la première représentation de la Tour de Nesle. Comme on était loin déjà de la première représentation d’Hernani! Ce n’était plus le même public. Les rapins d’atelier étaient toujours là, sans doute; mais où étaient les autres claqueurs du 25 février 1830, fils de famille, lauréats de l’Université, rédacteurs du Globe,[64] artistes arrivés, poètes du Cénacle? Ils étaient remplacés par des habitués d’estaminet, des acteurs et des actrices des petits théâtres, des journalistes républicains, des bousingots en bérets et en casquettes rouges. La fameuse tirade des Grandes dames provoqua des applaudissements frénétiques. Ces bravos redoublèrent quand le pauvre roi Louis le Hutin, après avoir dit aux seigneurs de sa cour: «Je vais donner l’ordre qu’une taxe soit levée sur la ville de Paris à l’occasion de ma rentrée», s’avança sur le balcon et dit au peuple: «Oui, mes enfants, je m’occupe de diminuer les impôts; je veux que vous soyez tous heureux, car je vous aime!» Pontmartin était consterné. Son cher romantisme n’était plus, après trois ans, qu’un épisode du triomphe révolutionnaire, gonflé de phrases de mélodrame et pimenté de tirades démocratiques. «Ah! disait-il tristement à ses amis pendant les entr’actes,—ce n’est plus ça, mais plus du tout! Adieu nos beaux rêves.»
Parmi les étudiants qui l’accompagnaient à cette première de la Tour de Nesle, il en était un qui d’habitude n’allait point au théâtre, Alfred Thureau-Dangin[55], qu’il avait connu dès le collège et qui était devenu son meilleur ami. Très lettré, d’un esprit charmant, d’une piété ardente, Alfred Thureau était dès lors ce qu’il devait être toujours, et de plus en plus, un chrétien modèle, l’homme[65] de tous les devoirs et de toutes les vertus[56]. Pontmartin était d’un caractère un peu faible, prompt aux entraînements. A cette heure critique, et si souvent décisive, de la jeunesse, il avait besoin d’un guide et d’un appui. Ce lui fut une inestimable fortune de trouver dans Alfred Thureau l’ami-apôtre, celui qui est toujours prêt à donner les bons conseils et surtout les bons exemples.
Quand le choléra fut en décroissance, au mois d’août, Pontmartin quitta Paris avec sa mère. Il y revint seul au mois de novembre, non pour y terminer ses études juridiques, mais pour y faire un court séjour, emballer les meubles à destination d’Avignon et dire un adieu définitif à la place du Panthéon et à la rue de Vaugirard. La littérature l’avait décidément conquis sur le droit, dont en somme il n’avait fait que deux années et passé que deux examens: il se contentait du titre de bachelier en droit, ce qui, après tout, était suffisant pour être un jour maire de village.
CHAPITRE IV
LES ANNÉES D’AVIGNON
(1833-1838)
La rue Violette et le baron de Montfaucon. Un maire d’autrefois. Le Cercle de l’Escarène et le Café Boudin.—L’Affaire du Carlo Alberto, le vicomte de Saint-Priest et la marquise de Calvière. Les bureaux d’une feuille royaliste en 1833, Henri Abel et Eugène Roux. Les Revues littéraires de la Gazette du Midi. Esprit Requien et ses dîners du dimanche. Prosper Mérimée.—Le bonhomme Joudou et le Messager de Vaucluse. Mme Dorval. Pontmartin et le théâtre romantique. Les élections de 1837. Brochure sur Berryer.—L’Album d’Avignon. Pages sur Alfred de Musset. Joseph Michaud à Avignon. «Lisez du Voltaire.»
I
Tel qui part pour douze ans croit partir pour un jour.
Pontmartin, en s’éloignant de Paris, se promettait d’y revenir bientôt. Il avait déjà quelques relations dans le monde des lettres et des arts: la littérature, il le sentait bien, était sa véritable, sa seule vocation. Il louerait un appartement modeste, mais convenable, sur la rive gauche, dans un quartier classique, entre l’Institut et l’Abbaye-aux-Bois,[67] à deux pas de la Revue des Deux Mondes; il se ferait présenter dans quelques-uns de ces salons où se réunissent les célébrités littéraires et scientifiques et qui sont souvent le chemin le plus court pour arriver à l’Académie. Ce rêve, rien ne lui était plus facile que de le réaliser. Il y renonça, parce qu’il lui aurait fallu quitter sa mère.
Mme de Pontmartin était d’une santé délicate, elle ne pouvait plus supporter le climat de Paris; il lui fallait désormais le soleil du Midi. De plus, privée de son mari, de son beau-frère, elle se trouvait hors d’état de diriger un jeune homme vif, ardent, passionné de théâtre, épris de ce romantisme qui ne lui disait rien de bon, prêt à fréquenter, en même temps que les salons, ces ateliers et ces cénacles, qu’elle connaissait mal sans doute, mais qui lui apparaissaient comme des lieux de perdition. Pontmartin ne put se décider à lui faire le chagrin de rester seul à Paris à vingt et un ans. Peut-être, se disait-il in petto, qu’après deux ou trois ans de séjour en province, ayant un peu mûri, il pourrait, sans effaroucher sa mère, se partager entre Avignon et la capitale, et passer dans cette dernière plusieurs mois chaque année. Il restera donc provisoirement à Avignon; mais, on le sait, rien ne dure plus longtemps que le provisoire.
On s’installa, non à la campagne, mais à la ville. Mme de Pontmartin s’y trouvait mieux pour sa santé et à cause du voisinage de l’église, celle des des Angles étant d’un accès très difficile. Elle habita, avec son fils, un appartement situé rue Violette,[68] dans l’hôtel du baron de Montfaucon[57], le dernier maire d’Avignon sous la Restauration. C’était un maire, comme on n’en fait plus, un de ces originaux comme il en existait encore beaucoup à cette date et qui donnaient à la province une physionomie particulière, qu’elle a depuis longtemps perdue. Bon, affable, généreux, recherché dans les salons et populaire dans les faubourgs, il chantait joliment la romance sentimentale, jouait à merveille la comédie à ariettes, déclamait sans broncher des scènes de tragédie. Jamais édile, du reste, ne sut mieux mêler l’utile à l’agréable. Quand le budget de la ville était menacé d’un déficit, ou lorsque son conseil municipal reculait devant une grosse dépense, il avait une méthode qu’on peut recommander sans crainte à nos maires républicains, car on est sûr qu’ils ne la suivront pas. Il payait de ses propres deniers de quoi combler les lacunes. C’est ainsi qu’à l’inauguration de la nouvelle salle de spectacle, il avait recruté à ses frais une troupe que lui enviaient Lyon, Marseille et Toulouse.
Pris en grande amitié par le baron de Montfaucon, spirituel jusqu’au bout des ongles, professant en toute rencontre le carlisme le plus intransigeant, Armand de Pontmartin devint bien vite le[69] favori de la haute société avignonnaise. Or, Avignon à cette époque, était une vraie succursale du faubourg Saint-Germain. On y rencontrait, dans le même salon, les Crillon, les Gramont-Caderousse, les Caumont, les Galléan (ducs de Gadagne), les Monteynard, les Bernis, les Calvière, les Tournon, les Piolenc, les La Fare, les Forbin, les Cambis, les des Isnards, etc.
Et comme elle avait son faubourg Saint-Germain, la ville des Papes avait aussi son Jockey-Club, le cercle de l’Escarène, où la jeunesse dorée passait sa vie, Pontmartin y fréquentait et y jouait le soir à la bouillotte. Le matin, il allait de préférence au Café Boudin,—un café ou plutôt un immense jardin, avec de beaux arbres, dont la renommée s’étendait à cinquante lieues à la ronde, grâce surtout à son magnifique jeu de paume. Le propriétaire, le père Boudin, dont l’un des fils devint secrétaire d’Augustin Thierry, avait installé une tonnelle dans la cour attenante à la salle. Au printemps, ces treillis peints en vert se couvraient de plantes grimpantes, houblon et vigne vierge, glycine et clématite. Les causeurs et les beaux esprits avignonnais s’y donnaient rendez-vous pour prendre leur tasse de chocolat avec le classique pain au beurre, lire les journaux et parler politique. Pontmartin était un des habitués de la tonnelle. Il lui arrivait même d’y aller le soir, quand elle s’illumiminait à giorno à l’aide de six quinquets et que les élégants et les belles dames y venaient, de neuf à onze heures, prendre des glaces.
Tout cela, paraît-il, ne laissait pas d’être grave. Aller dans le monde, passer ses soirées au cercle, dîner avec de joyeux amis, fréquenter le Café Boudin! Horreur! Sainte-Beuve en est tout suffoqué; il se voile la face et il écrit ces lignes: «A ceux qui en douteraient à voir la sévérité de sa doctrine, je dirai (ce qui n’est jamais une injure pour un galant homme) que M. de Pontmartin eut de la jeunesse. La ville d’Avignon s’en est longtemps souvenue, me dit-on et les échos l’ont répété[58].»
Si Pontmartin se pliait volontiers à la vie provinciale, il ne renonçait pas pour cela à ses visées littéraires. Il dévorait tous les livres nouveaux, il lisait tous les articles de la Revue de Paris et de la Revue des Deux Mondes, et après chacune de ces lectures, il se disait: Semper ego auditor tantum? Doué dès cette époque d’une incroyable facilité de plume, il se sentait attiré surtout vers le journalisme. Malheureusement il n’y avait à Avignon aucun journal où il pût écrire. Il allait en trouver un ailleurs.
II
Il y avait alors dans les prisons de Marseille un certain nombre de royalistes, qui s’étaient associés à l’imprudente mais chevaleresque entreprise de la duchesse de Berry et qui avaient été arrêtés à la Ciotat[71] au moment où ils débarquaient du Carlo-Alberto. Depuis le 1er mai 1832, ils attendaient leur mise en jugement. Le plus marquant de ces détenus était le général vicomte de Saint-Priest[59], ancien ambassadeur de France à Madrid. Sa sœur, la marquise de Calvière, était l’amie intime de Mme de Pontmartin, qui avait logé dans sa maison jusqu’en 1823[60]; elle lui écrivit qu’elle était venue à Marseille pour voir son frère, qu’elle était horriblement[72] inquiète[61] et que ce lui serait une grande consolation de l’avoir auprès d’elle. Deux jours après, Mme de Pontmartin et son fils descendaient à l’hôtel Beauvau.
On était au mois de janvier 1833. La Gazette du Midi, qui paraissait à Marseille depuis le mois d’octobre 1830, avait déjà pris dans toute la région une sérieuse importance. Une des premières visites de Pontmartin fut pour la feuille royaliste.
La presse de province n’était pas riche en ce temps-là (les choses ont-elles beaucoup changé depuis?). L’imprimerie de la Gazette occupait un sordide hangar dans la cour d’une maison de la rue Paradis, au no 47. On accédait par un escalier en bois au cabinet de rédaction, sorte de soupente qu’éclairait une seule fenêtre, et dont tout l’ameublement se composait de quelques chaises de paille et de deux pupitres en bois blanc peint de noir, avec encrier en tête de pipe, fiché dans la tablette supérieure[62].—Oui, mais devant ces pupitres d’écoliers,[73] s’asseyaient chaque matin deux maîtres journalistes, Henri Abel[63] et Eugène Roux[64].
Henri Abel, le rédacteur en chef, avait trente-sept ans. Il y avait deux ans que, sur les instances de quelques amis, il avait quitté le commerce des denrées de Provence pour devenir le directeur du journal. Ses immenses lectures, sa prodigieuse mémoire, la rectitude de son esprit et l’énergie de ses convictions lui avaient permis, dès les premiers jours, d’écrire des articles, qui furent très remarqués. Comme ils n’étaient pas signés, on les attribuait à de hautes personnalités, quelquefois à Berryer lui-même. Si l’on objectait que l’article, tout d’actualité, avait certainement été fait sur place, que les lettres de Paris mettaient trois jours à venir, et que le ministre de l’Intérieur n’avait sans doute pas mis le télégraphe à la disposition du chef de l’opposition légitimiste: «Alors, reprenaient nos gens, qui ne voulaient pas se tenir pour battus, il doit être de Laboulie[65], à moins qu’il ne soit du marquis de Montgrand[66].» Et personne[74] ne se doutait que l’anonyme, déjà célèbre à ses débuts, était le modeste commerçant, enlevé d’hier par la politique aux vulgarités de la «chère vôtre».
En 1833, le nom d’Henri Abel était victorieusement sorti de l’ombre, et le temps était proche où deux ou trois journaux parisiens lui feraient les propositions les plus séduisantes: il refusera sans hésiter. Il était bien trop spirituel, et surtout trop Marseillais, pour sacrifier la Cannebière aux Boulevards, pour échanger le soleil et la mer contre les brouillards de la rue du Croissant ou le ruisseau de la rue Montmartre.
Armand de Pontmartin et Abel eurent vite fait de s’entendre. Il fut convenu, dès leur premier entretien, que l’ancien élève de Saint-Louis enverrait à la Gazette du Midi des articles de critique littéraire. Le premier parut le 5 septembre 1833; il était consacré aux Prisons de Silvio Pellico. Vinrent ensuite des feuilletons sur Volupté, de Sainte-Beuve; Stello, d’Alfred de Vigny; le Lys dans la vallée, de Balzac; la Confession d’un Enfant du siècle, d’Alfred de Musset; les Chants du Crépuscule, de Victor Hugo; Simon et Mauprat, de George Sand, etc., etc. Ils eurent du succès, si bien qu’après les avoir signés d’abord A. P., puis A. de P., l’auteur se décida à y mettre son nom en toutes lettres.
Cette collaboration, qui dura jusqu’en 1843, ne[75] tarda pas d’avoir pour lui d’heureux résultats. Jusque-là ses compatriotes n’avaient guère vu en lui qu’un jeune homme instruit, riche, titré, spirituel, héros de cercle et de salons, qui ne manquerait pas de faire un jour un beau mariage; après quoi, tout serait dit. Depuis que paraissaient, dans le journal le plus important de la région, ses Revues littéraires, on le jugeait autrement; on commençait à se demander s’il n’y avait pas en lui l’étoffe d’un écrivain de talent et s’il n’était pas destiné à devenir célèbre. Parmi ceux qui suivaient ses articles avec le plus d’intérêt et qui lui prodiguaient le plus d’encouragements, était M. Esprit Requien[67], botaniste et géologue de premier ordre qui, sur un plus grand théâtre, eût été le rival des Jussieu, des Candolle et des Mirbel. Sa science encyclopédique n’avait rien de pédantesque, d’officiel et de gourmé. Sa simplicité, son esprit et sa belle humeur égalaient son savoir. Ses dîners du dimanche, où la chère était d’ailleurs excellente, avaient un succès universel. Les célébrités qui passaient à Avignon acceptaient volontiers son hospitalité. Pontmartin vit successivement à sa table le duc de Luynes, Horace Vernet, Paul Delaroche,[76] Xavier Marmier, Méry, J.-J. Ampère, Fauriel, M. de Mirbel, le peintre Champmartin, Liszt, Castil-Blaze et son fils Henry Blaze de Bury, sans compter Prosper Mérimée, alors inspecteur des monuments historiques dans le Midi de la France.
Le dimanche 17 août 1834, au dîner hebdomadaire de la rue des Tanneurs, Pontmartin fut placé à côté de Mérimée, qui venait justement de publier, dans la Revue des Deux Mondes, une de ses nouvelles, les Ames du Purgatoire[68], et à qui Requien, dont il était l’hôte depuis deux ou trois jours, avait fait lire quelques-uns des articles de son jeune ami. On causa littérature et beaux-arts. Malgré ses préventions contre la province, malgré son désir de ne jamais être ou paraître dupe, l’auteur de la Double Méprise ne put conserver jusqu’au bout son attitude glaciale et un peu hautaine. Charmé par l’esprit et la bonne grâce de son voisin, il se montra bienveillant, aimable, bon enfant. Quand on sortit de table, il avait quitté tout à fait son air de pince-sans-rire, et il dit à Pontmartin:
—Avez-vous la vocation?
—Oui, je le crois... j’en suis sûr... D’ailleurs, pourrais-je en avoir une autre?
—Eh bien, si vous avez la vocation, vous aurez tôt ou tard l’occasion. J’ai idée que nous nous reverrons un jour aux bureaux de la Revue[77] des Deux Mondes, chez Buloz, dans cette singulière maison de la rue Saint-Benoît, qui a un jardin au premier étage.
Cet oracle était plus sûr que celui de Léonard Retouret.
III
La collaboration de Pontmartin à la Gazette du Midi lui laissait des loisirs. Il regrettait de ne pas avoir sous la main, à Avignon même, une feuille, si modeste fût-elle, où il pourrait écrire des chroniques mondaines et des feuilletons de théâtre. Par une belle matinée d’hiver, au mois de novembre 1836, il reçut la visite d’un vieil original, nommé Joudou, dont la manie était de fonder des journaux qui vivaient, en moyenne, trois mois ou six semaines. Le bonhomme Joudou lui annonça qu’il allait créer un nouveau journal, le Messager de Vaucluse, et il lui demanda de vouloir bien se charger du feuilleton. Pontmartin accepta, mais à la condition de ne pas signer.
Le Messager devait paraître deux fois par semaine, le jeudi et le dimanche; il ne parlerait pas politique et traiterait seulement les questions de littérature, d’histoire locale, d’archéologie, de travaux publics et d’hygiène. Le premier numéro parut le jeudi 1er décembre 1836; Pontmartin inaugura sa collaboration, dans celui du 11 décembre, par un feuilleton signé Z.Z.Z.
Mme Dorval venait d’arriver à Avignon, où elle devait donner une série de dix à douze représentations. C’était une bonne fortune pour le critique du Messager d’avoir l’occasion de parler d’une grande artiste et de passer en revue les principales pièces du théâtre romantique. Mme Dorval joua successivement Trente ans ou la Vie d’un joueur, de Victor Ducange et Dinaux; Clotilde, de Frédéric Soulié; Antony, la Tour de Nesle, Henri III et sa Cour, d’Alexandre Dumas; Jeanne Vaubernier, de Pierre Lafitte[69]; Angelo, de Victor Hugo; Chatterton, d’Alfred de Vigny.
Pontmartin ne lui consacra pas moins de six feuilletons[70]. Il parla d’elle avec enthousiasme. L’enthousiasme, du reste, était justifié. Mme Dorval n’avait pas la distinction aristocratique de Mlle Mars, son élégance incomparable, son art savant et profond; mais, plus que sa glorieuse rivale, elle était une artiste d’inspiration, l’interprète par excellence du drame moderne. Elle était la passion même, comédienne par hasard et par instinct, comme Mlle Mars était une comédienne par la nature et par l’étude; comédienne avec son cœur comme[79] Mlle Mars était comédienne avec son esprit[71].
Pontmartin dit dans ses Mémoires: «J’avais habilement mélangé la prose doctorale de Gustave Planche, les gentilles paillettes de Jules Janin et mes souvenirs personnels du théâtre de la Porte-Saint-Martin. J’exprimai le plus fougueux enthousiasme et je citai un passage de la Revue des Deux Mondes, d’où il résultait que Mlle Mars n’allait pas à la cheville de Mme Dorval[72].» Cela n’est pas exact. Quoique romantique, Pontmartin aimait par-dessus tout ce qui était correct, délicat, charmant, distingué. Ses préférences devaient donc aller à Mlle Mars. Quand il eut à parler de Henri III et sa Cour, évoquant son souvenir dans le rôle de la duchesse de Guise, qu’elle avait créé au Théâtre-Français, il n’hésita pas à la déclarer supérieure à Mme Dorval[73].
Dans ce même article sur le drame de Dumas, il juge ses amis les romantiques comme un homme affranchi de toute servitude d’école:
Notre ami Alexandre Dumas, dit-il, esprit aventureux, peu profond, prêt à toute circonstance, avait d’abord fait sa pièce en trois actes, sous le titre de la Duchesse de Guise. Mais, à cette époque, on était engoué de chroniques, de moyen âge et de barbes pointues; on ne voyait plus au théâtre et dans nos musées la moindre toge romaine, la moindre tunique grecque, mais des pourpoints, des justaucorps, des souliers à la poulaine et des vertugadins. Notre auteur, voyant cette mode, imagina de plaquer au drame primitif deux[80] actes de couleur locale et il l’intitula gravement Henri III et sa Cour. Le drame fut joué[74] et eut un grand succès que les romantiques (il y en avait alors) attribuèrent obstinément à la sarbacane du duc de Joyeuse, au bilboquet de d’Epernon et à la fraise de Saint-Mégrin: innocentes bribes historiques auxquelles personne aujourd’hui ne fait attention. Mais par bonheur Dumas, qui était dès lors un écrivain passionné, un cœur chaud et énergique, avait jeté à travers ces réminiscences d’Anquetil quelques scènes de passion véritable...
Dans son feuilleton sur Angelo, après avoir dit son admiration pour Mme Dorval, qui jouait le rôle de Catarina Bragadini, la femme du podestat, il ne se souvient d’avoir été l’un des claqueurs d’Hernani que pour condamner plus sévèrement le nouveau drame de Hugo: «Elle nous a tant émus, écrit-il, nous l’avons si bien applaudie, que nous avons oublié de ne pas applaudir la pièce. Elle a tendu sa main à M. Hugo, et elle l’a sauvé. Que d’aumônes semblables elle a faites, dans sa vie! Que de naufrages elle a épargné à ses poètes, et comme elle a mérité de rencontrer enfin celui qui ne lui laissera plus qu’à traduire et ne lui donnera rien à corriger[75]!»
Mme Dorval une fois partie, Pontmartin remplaça les comptes rendus de théâtre par des Causeries littéraires et mondaines, en même temps qu’il écrivait de courtes nouvelles, songeant déjà à mener de front, s’il le pouvait, la critique et le roman. Du 16 février au 20 avril 1837, il publia, dans le[81] Messager, une suite d’Esquisses, qui avaient pour titre: I. La Vie d’artiste; II. Une Heure dans la vie; III. Les Courtisans de l’exil; IV. Les Deux violons. Le 25 juin, il commençait une nouvelle série, à laquelle il donnait ce titre: Souvenirs du monde, et qu’il faisait précéder de cette note: «Les fragments qu’on va lire font partie d’un ouvrage intitulé la Vérité vraie, qui paraîtra cet hiver chez Eugène Renduel.» Eugène Renduel était alors l’éditeur des romantiques. De ces Souvenirs du monde, deux chapitres seulement ont paru: Partie Carrée[76] et Suicides amoureux[77].
Mais la politique à ce même moment, allait le distraire de la littérature.
Le 4 octobre 1837, la dissolution de la Chambre des députés fut prononcée, et les électeurs convoqués pour le 4 novembre. Les électeurs d’Avignon allaient avoir à remplacer le marquis de Cambis, qui venait d’être appelé à la pairie. Le candidat constitutionnel était M. Eugène Poncet[78]; les royalistes lui opposèrent M. Berryer, lequel, du reste, ne prit aucune part à la lutte, étant assuré de sa[82] réélection à Marseille. Entre les deux candidats, la situation de Pontmartin était particulièrement délicate. M. Poncet était ouvertement patronné par le marquis de Cambis; il n’avait même consenti à lui succéder qu’à la condition de se retirer dès que Henri de Cambis aurait trente ans, ce qui devait avoir lieu en 1840. Pontmartin avait une sincère affection pour son oncle, une vive amitié pour son cousin. Entre eux et Berryer cependant il n’hésita pas. Henriquinquiste intransigeant, il estima que c’était le cas, ou jamais, de mettre en pratique la vieille maxime: Amicus Plato, sed magis amica veritas.
Le 22 octobre 1837, il faisait paraître dans le Messager un grand article intitulé: Puissances intellectuelles de notre époque. I. Berryer. Premier article: Berryer homme politique. Ce premier article était suivi de cette note: «Au numéro prochain le deuxième article: Berryer orateur.»
Le Messager de Vaucluse n’avait pas le droit de parler politique, faute d’un cautionnement que le bon Joudou s’était trouvé hors d’état de verser. La préfecture lui fit comprendre qu’il serait sage à lui de s’arrêter dans la voie où il venait de s’engager. Il refusa donc d’insérer l’article promis. Le jour du vote approchait. Pontmartin réunit ses deux articles en une petite brochure, qui parut le 28 octobre, accompagnée de ces lignes:
La première partie de cette esquisse a paru dans le Messager de Vaucluse; la suite n’ayant pu y être insérée, des motifs d’à-propos ont fait désirer qu’elle fût publiée, ce qui[83] a forcé de réimprimer le tout. Nous rappelons ceci, non pour blâmer l’administration, mais de peur qu’on nous accuse d’avoir prétendu donner à un simple article de journal la valeur d’une œuvre plus durable. A. P.
La brochure, on le pense bien, était un panégyrique enthousiaste du grand orateur, alors dans tout l’éclat de son magnifique talent. Sept jours après sa publication, avait lieu le vote. M. Poncet fut élu avec 268 suffrages sur 434 votants. Berryer obtint 163 voix[79].
IV
Il ne lui était pas permis dans le Messager—Pontmartin venait d’en avoir la preuve—de faire, même en passant, de la politique. Pourquoi n’aurait-il pas un journal où il serait chez lui et où le timide Joudou n’aurait rien à voir? La main lui démangeait d’écrire, il avait du temps, de l’esprit et de l’argent à perdre; bravement, il fonda une Revue, à laquelle il donna pour titre: l’Album d’Avignon, Recueil d’intérêt social et littéraire, publié par un des rédacteurs du Messager de Vaucluse.
La Revue était mensuelle et son premier numéro parut le 1er janvier 1838; sa collection forme deux volumes.
Quelques hommes de cœur et d’esprit, MM. Jules Courtet, H. d’Anselme, J. Bastet et Antonin de Sigoyer, prêtaient bien à Pontmartin leur collaboration, mais d’une façon tout à fait intermittente, et il arrivait, presque chaque mois, que la livraison était son œuvre pour plus des trois quarts. Souvent même il évitait de signer ses articles, pour empêcher les lecteurs de voir qu’il était à lui seul toute la rédaction. Sa plume facile suffisait à tout. Études littéraires, artistiques et musicales, chroniques politiques, contes et nouvelles, il s’essayait dans tous les genres. L’abbé Charles Deplace[80] prêchait l’Avent à Avignon: le rédacteur de l’Album analyse ses sermons avec le plus grand soin sous ce titre: Prédications de la métropole[81]. Lorsqu’il faut descendre de ces hauteurs pour traiter les questions locales, s’occuper des levées de la Barthelasse ou du pont suspendu entre Villeneuve et la Porte de la Ligne, il est également prêt; aussi bien, il s’agit du pont d’Avignon sur lequel, on le sait, tout le monde passe, même les littérateurs, même les poètes. Poète, il l’était aussi à ses heures: comprendrait-on d’ailleurs un Album qui ne renfermerait pas de vers? Pontmartin inséra dans le sien un[85] court poème, le Lit de mort d’Arthur[82] et des stances: A deux voyageurs[83].
Le poète, du reste, cédait volontiers chez lui le pas au conteur. Celui-ci ne se proposait alors rien moins que de publier, dans l’Album d’Avignon, vingt-quatre Nouvelles, les unes d’imagination, les autres empruntées à l’histoire, et dont les héroïnes auraient successivement pour initiales les vingt-quatre lettres de l’alphabet. Je me hâte de dire que l’alphabet n’y passa point tout entier.
Après avoir fait paraître Alix, Béatrix et Caroline, Armand de Pontmartin abandonna la partie et laissa là les dés. L’une au moins de ces trois nouvelles cependant, Caroline[84], est déjà très remarquable; mais c’est surtout le critique qui se révèle dès ce moment, qui prélude avec succès, vif, spirituel, ennemi du factice et du convenu, ayant ses préférences et sachant les justifier. A cette date de 1838, la royauté poétique de Lamartine et de Victor Hugo était incontestée, et il ne semblait pas qu’Alfred de Musset pût prétendre à partager le trône avec eux. Sur ce point, il n’y avait qu’une voix parmi les critiques du temps. Sainte-Beuve ne voyait dans l’auteur de la Nuit de mai et de l’Espoir[86] en Dieu qu’un poète «charmant», plein d’esprit et de naturel, et qui donnait de «bien gracieuses espérances». Un des écrivains de la Revue de Paris, J. Chaudes-Aigues, résumait ainsi une étude sur le chantre de Rolla: «De la verve, mais une verve insuffisante et qui a besoin d’être échauffée par une idée étrangère; une imagination très folle, très vagabonde, très capricieuse, incapable de réflexion, habile à broder, inhabile à produire; une versification claire, nette et franche: voilà, selon nous, ce qui appartient en propre à M. Alfred de Musset[85].» On voyait plus juste à Avignon; Armand de Pontmartin n’hésitait pas à saluer dans Alfred de Musset un très grand poète, aussi grand que Lamartine et Hugo. De l’un de ses articles, je détache cette page:
...C’est là le caractère de la vraie poésie, dans notre temps: d’abord l’essai infructueux, le mécompte, le reproche amer, la lutte stérile, la folie même et le blasphème; puis, si l’âme est vraiment grande et poétique, après la récrimination, l’aveu naïf de l’erreur; après la halte désespérée, une fuite nouvelle vers les idéales régions de la prière, de la rêverie et de l’amour, et l’échange des premiers vêtements, déchirés par l’orage, contre les voiles éblouissants et purs que rien ne déchire et ne flétrit. C’est ainsi que le poète devient le symbole à la fois le plus complet, le plus élevé et le plus consolant du siècle qu’il traverse, auquel il indique et le mal qui l’agite et ce qui peut le calmer, et avec lequel tout lui est commun, l’angoisse et l’espoir, la blessure et le baume, le blasphème réparé et l’hymne immortel, tout enfin, excepté la langue céleste que tout le monde entend, et qu’il[87] est seul à parler. C’est pour cela que Victor Hugo et Lamartine, malgré leur incontestable génie, nous sont entièrement étrangers, et qu’ils n’ont conquis parmi nous qu’une position glorieuse, mais solitaire. L’un est un admirable et opiniâtre artiste, dessinant aux œuvres de sa fantaisie des broderies délicates, de merveilleuses ciselures; l’autre est une lyre infatigable, une sorte de harpe éolienne, toujours prête à rendre des sons d’une mélodieuse uniformité: mais le souffle de notre vie et de notre monde n’a point passé sur eux; ils n’en ont été que de factices interprètes et ils sont restés les brillants échos de leur pensée personnelle. Il est cependant un poète, un jeune homme de vingt-sept ans, auquel on n’a pas fait encore toute la place qu’il mérite, et qui nous semble réaliser en lui d’une façon saisissante ce type que nous indiquons et que nous voudrions faire comprendre. Alfred de Musset, qui eut le tort de donner à ses débuts l’éclat d’un scandale littéraire et de fournir, par sa fameuse ballade à la lune, un prétexte aux ricanements des plaisants et des badauds, est la personnification éclatante de cet esprit poétique qui aime à se poser sur les débris d’un noble cœur, pour leur rendre la jeunesse et la vie et s’élancer de là, d’un vol infatigable, vers l’idéal et l’infini. Le public d’Alfred de Musset n’est pas encore formé; aussi c’est à peine si nous osons dire que, parmi tous nos poètes, aucun n’a la ligne plus pure, le dessin plus correct et plus simple, l’allure plus libre et plus droite. Tous les jeunes gens qui savent par cœur Rolla, Frank et Namouna, qui ont lu avec délices toutes ces ravissantes fantaisies, Marianne, Emmeline, On ne badine pas avec l’amour, Fantasio, achèveront sans peine notre pensée et comprennent depuis longtemps avec nous quelle place nous devons donner dans nos affections littéraires à ce génie svelte et gracieux comme Ariel, qui a su rendre original même le pastiche, qui a donné une forme exquise et délicate à tant de songes de notre jeunesse, et dont le souffle enchanteur poétise et réveille tout ce qui semblait mort et muet en nous.
...Que lui manque-t-il encore? Il manque à Musset ce[88] qui manquait à Byron, une pensée vivifiante et venue du ciel, une croyance qui change pour lui les lueurs trompeuses et passagères en un phare inaltérable et immortel. Ces regrets, qu’il n’est peut-être pas le dernier à ressentir, tout le monde peut les partager; mais un catholique seul a le droit de les dire, parce que seul il pourrait donner au génie quelque chose de plus grand et de plus beau que le génie même[86].
De telles pages n’étaient pas pour passer inaperçues. L’Album d’Avignon fut cité plus d’une fois par les feuilles royalistes de Paris et, en particulier, par la Quotidienne. Au mois de novembre 1838, le directeur de cette dernière feuille, Joseph Michaud[87], passa deux jours à Avignon. Accompagné de l’un de ses plus fidèles collaborateurs, M. Poujoulat[88], il se rendait à Pise, où l’envoyaient ses médecins. Pontmartin lui fut présenté dans une maison amie. Longtemps après, dans un article sur Poujoulat, il parlera ainsi de cette visite: «Michaud n’avait plus que le souffle; mais ce souffle s’exhalait en paroles exquises murmurées[89] à demi-voix, que l’on écoutait trop avidement pour ne pas les entendre. Il ne se faisait aucune illusion sur son état, et se comparait en souriant à cette tour penchée vers laquelle on l’envoyait. Sa haute taille, sa pâleur, sa bonhomie un peu narquoise, sa résignation mélancolique et sereine, l’ombre d’une mort prochaine s’étendant peu à peu sur son visage émacié, prête à éteindre le rayonnement de la bonne humeur et de l’esprit, tout cet ensemble produisit sur moi une impression profonde qui ne s’est jamais effacée[89].»
Le directeur de la Quotidienne accueillit Pontmartin avec une bienveillance toute paternelle. Il avait lu quelques-uns de ses articles de l’Album et de la Gazette du Midi, et les avait remarqués; il joignit à ses encouragements de précieux conseils. Homme du XVIIIe siècle, plus que du XVIIe, attaquant ses adversaires avec leurs propres armes, comme ces généraux russes et allemands qui, à force d’être battus par Napoléon, avaient fini par apprendre de lui à le battre, il mettait au service de sa foi monarchique et religieuse une ironie délicate, un spirituel atticisme, et quelques-unes des malices du scepticisme philosophique et politique. Son dernier mot à Pontmartin, en le quittant, fut celui-ci: «Bravo, jeune homme! bon début! Seulement, lisez du Voltaire!»
L’année finissait bien; les abonnés commençaient à venir; la petite Revue faisait ses frais, et son[90] rédacteur promettait monts et merveilles pour l’année nouvelle. L’année nouvelle, il ne devait pas y en avoir pour l’Album. La livraison de décembre 1838 fut la dernière. Des considérations de famille et les inquiétudes de sa mère décidèrent Pontmartin à interrompre sa publication[90].
CHAPITRE V
LES ANNÉES D’AVIGNON
(1839-1845)
LA MOUCHE, journal des Salons. Le journaliste Deretz. Un duel dans l’île de la Barthelasse. «L’Affaire d’Avignon». MM. de Salvador, d’Averton et de Renoard. La garde nationale d’Henri V. Gustave de Laboulie et M. Dugabé. Le président Monnier des Taillades et le procureur du roi Rigaud. Le coût d’un article et les Mie Prigioni du gérant de la Gazette du Midi.—Les Causeries provinciales de la Quotidienne. Berryer et l’Académie. Première rencontre de Pontmartin avec Cuvillier-Fleury.—L’Inondation du Rhône à Avignon et aux Angles en novembre 1840. La maison de la rue Banasterie et les Mémoires d’un notaire. Pontmartin conseiller général. Le vicomte Édouard Walsh et la Mode. Mariage d’Armand de Pontmartin. Le départ pour Paris.
I
Trois événements d’une inégale importance allaient marquer pour Pontmartin l’année 1839: un duel, un procès, et son entrée dans la presse parisienne.
Les passions politiques, très vives à cette époque dans toute la France, étaient particulièrement[92] ardentes dans le Midi. Exaspérés, non sans raison, il faut bien le dire, par les airs goguenards, par les allures batailleuses et provocatrices de la jeune aristocratie légitimiste, quelques jeunes gens de la bourgeoisie libérale voulurent avoir eux aussi un journal, une petite feuille légère, incisive, hardie, qui harcèlerait à son tour l’adversaire, et ne lui ménagerait pas les coups. C’était de bonne guerre. Le tort des fondateurs de la nouvelle feuille,—La Mouche, Journal des Salons,—fut de ne pas se mettre eux-mêmes en avant, de se tenir derrière le rideau, faisant venir de Paris un pauvre diable de journaliste ambulant nommé Deretz, qui se chargeait, moyennant quelques écus, d’endosser toutes les responsabilités. Ce Deretz avait, du reste, de l’esprit, plus d’esprit que de courage, comme on va le voir. Le journal paraissait depuis quelque temps, lorsqu’un matin, après avoir vidé son carquois contre les noblions et les hobereaux avignonnais, il décocha une dernière flèche à l’adresse de Mossieu de Pontmartin. Ce dernier prit aussitôt la mouche (c’était le cas), courut à son cercle, y trouva deux de ses meilleurs amis, Frédéric d’Averton et Jules de Salvador, et les chargea d’aller demander au Parisien une réparation par les armes. Après une longue hésitation, Deretz consentit à se battre; seulement, il demanda un délai de trente-six heures pour chercher et trouver des témoins. Rendez-vous fut pris pour le surlendemain dans l’île de la Barthelasse. A cette époque, elle appartenait encore au département du Gard,[93] ce qui assurait nos duellistes contre l’intervention des gendarmes.
Au jour dit,—le 27 mars 1839,—les adversaires arrivèrent sur le terrain, Deretz un peu en retard; il avait recruté à grand’peine ses témoins, et il avait dû les prendre parmi les buveurs de chopes du Café Tailleux, le Lemblin vauclusien; les patrons de la Mouche avaient énergiquement refusé de l’assister. L’arme choisie était l’épée. Au moment où Pontmartin allait se fendre, Deretz laissa tomber son fleuret, et déclara que, décidément, il ne se battrait pas. «Je suis trop pauvre, dit-il; la législation est sévère, et s’il arrivait malheur, je n’aurais pas, comme M. le comte, qui est riche, de quoi m’enfuir et me cacher.»—«Soit, répondit Jules de Salvador, mais alors vous allez vous engager par écrit à ne plus recommencer vos attaques, et à nommer vos inspirateurs, si vous ne pouvez les décider à se nommer eux-mêmes».
Il y avait dans l’île une guinguette où les bons bourgeois d’Avignon venaient, le dimanche, jouer aux boules. On y entra, et le pauvre Deretz signa tout ce qu’on voulut. Le soir même, il partait pour Marseille, et on ne le revit plus. La Mouche, journal des Salons, avait vécu[91]!
Après le duel, le procès. Au mois de juin 1839, les deux témoins de Pontmartin, Frédéric d’Averton[94] et Jules de Salvador, étaient, en compagnie d’un de leurs amis, M. Ulric de Renoard, traduits devant le tribunal correctionnel d’Avignon, sous la double prévention de réunion illicite et de détention d’armes et de munitions de guerre. Étaient poursuivis, en même temps qu’eux, vingt-neuf jeunes gens appartenant à la classe ouvrière. Ces derniers ne faisaient pas plus mystère que les trois gentilshommes de leurs sentiments royalistes, et l’un d’eux, dans l’instruction, pressé de questions par le magistrat, avait répondu: «Eh bien! si nous avions des armes chez nous, c’est que nous sommes la garde nationale d’Henri V[92]!»
Les débats durèrent trois jours, du 27 au 29 juin. Devant le bureau du tribunal figuraient les pièces à conviction: fusils de munition, carabines, cartouches et cocardes blanches et vertes. Le siège du ministère public était occupé par M. Rigaud, procureur du roi. La défense fut présentée par Me Adolphe Teste (rien de l’avocat Jean-Baptiste Teste, le futur condamné de la Cour des pairs), par Mes Redon père et fils et par Gustave de Laboulie, dont la plaidoirie fut une merveille d’éloquence,[95] de verve et de spirituelle ironie[93]. Les prévenus n’en furent pas moins condamnés à un certain nombre de mois de prison[94]. MM. d’Averton, Salvador et Renoard furent, comme il était juste, gratifiés de la peine la plus forte. Ils n’avaient pas eu le temps de maudire leurs juges que déjà ils étaient consolés par la lecture, dans la Gazette du Midi, du compte rendu humoristique de leur procès, rédigé par leur ami Pontmartin. Ce dernier leur avait fait bonne mesure et n’avait pas consacré moins de cinq articles à «l’Affaire d’Avignon».
Le président du tribunal était M. Monnier des Taillades, magistrat intègre et jurisconsulte de premier ordre. Le bruit s’étant répandu qu’il avait dit, en parlant du procureur du roi: «Ce monsieur n’est pas fort», Pontmartin crut pouvoir risquer ceci—ou à peu près—dans l’un de ses feuilletons: «M. le président a-t-il dit ou n’a-t-il pas dit que M. Rigaud n’était pas fort? Peu importe, après tout. Dire du beurre qu’il est fort, est-ce le complimenter? Un fort de la halle est-il plus aimable que le plus faible des académiciens?[96] Lorsque vous êtes exaspéré d’une injustice, d’une bêtise, d’une catastrophe ou d’un scandale, vous ne dites pas: ‘C’est trop faible!’ mais: ‘C’est trop fort!’»
Ce n’était peut-être pas très fort; mais, en tout cas, ce n’était pas bien méchant. Grande rumeur pourtant dans la ville. Le tribunal s’émeut, le parquet s’indigne. Poursuites contre la Gazette du Midi, et, le 8 août, à Avignon, condamnation du journal à mille francs d’amende et du gérant à un mois de prison. Quant à Pontmartin, quoiqu’il n’eût pas signé son article, il paya l’amende avec les frais. Si pauvre mathématicien qu’il fût, il se livra à un calcul d’arithmétique, et il reconnut que ses six lignes lui coûtaient 200 francs la ligne, 17 francs la syllabe et 4 francs la lettre[95]. C’était à dégoûter du métier!
A quelque temps de là, comme il venait de s’acquitter envers le fisc, il vit entrer dans son cabinet un homme au teint fleuri, à l’œil émerillonné, à la lèvre souriante, le gérant de la Gazette, qui sortait de prison, rayonnant de joie et de santé. «Monsieur le comte, disait-il, avec le plus pur accent de la Cannebière, quels remerciements je vous dois! Quel bon mois, grâce à vous, je viens de passer! J’ai déjeuné et dîné tous les jours avec M. de Salvador, M. d’Averton et M. de Renoard. Quels braves jeunes gens! quels repas! Jamais, dans toute ma vie, je n’avais mangé autant de[97] perdrix, de bécasses, de lièvres, de poulardes, de truites, d’écrevisses!... Ah! monsieur le comte, je suis tout à votre service et prêt à recommencer, quand cela vous plaira. C’est égal! vous aviez fait là un fameux feuilleton!...» Les 1 200 francs de Pontmartin n’avaient pas été placés à fonds perdus; il avait fait un heureux!
II
Il avait écrit, à la dernière page de l’Album d’Avignon: «La Quotidienne nous a fait l’honneur de nous citer trois fois et nous a demandé pour l’avenir des articles qui s’appelleraient Causeries provinciales et qui paraîtraient le même jour dans son feuilleton et dans notre mosaïque[96].»
Par suite de la disparition de l’Album, cette combinaison ne put se réaliser. Il fut alors convenu que Pontmartin donnerait, deux ou trois fois par mois, à la feuille parisienne une Causerie provinciale. La première parut le 22 novembre 1839. J’ai sous les yeux le brouillon de ce premier article, et j’y remarque un assez grand nombre de ratures. Le moment n’est pas encore venu où l’auteur des Samedis écrira toutes ses Causeries de premier jet, sans brouillon, sans remaniement,[98] sans retouches, effaçant à peine ici et là deux ou trois mots parasites.
A cette date de fin novembre 1839, ce qui passionnait la cour et la ville, Paris et la province, c’était de savoir qui serait élu à l’Académie, de Victor Hugo ou de Berryer. Le fauteuil de Michaud était vacant[97]. Quatre candidats s’étaient mis sur les rangs, Victor Hugo, Berryer, Casimir Bonjour et M. Vatout.
Berryer était à ce moment le maître incontesté de la tribune. C’était le temps où Timon écrivait: «Depuis Mirabeau, personne n’a égalé Berryer[98]»;—où Royer-Collard disait avec l’autorité de sa parole: «J’ai entendu Mirabeau dans sa gloire; j’ai entendu M. de Serre et M. Lainé; aucun n’égalait Berryer dans les qualités principales qui font l’orateur»[99];—où l’un de ses adversaires politiques, Henri Fonfrède, écrivait à un ami, dans une lettre particulière: «Berryer est le plus grand orateur qu’on ait jamais entendu[100].» Il n’était pas seulement le prince des orateurs, il était aussi le chef d’un grand parti. Sa candidature devenait dès lors une grosse affaire. Le gouvernement s’en émut; ses journaux se jetèrent dans la lutte avec ardeur, et à leur tête le Journal des Débats, où Cuvillier-Fleury publia des[99] articles violemment hostiles. Il était certes permis à ceux dont Berryer était l’adversaire de ne point l’aimer, de dire, par exemple, comme M. Doudan, au sortir d’une séance où l’orateur légitimiste avait été magnifique: «Je n’aime pas qu’on prêche bien ailleurs que dans ma paroisse[101].» Cuvillier-Fleury allait beaucoup plus loin. Il n’accordait pas que Berryer eût du talent; tout au plus avait-il «des poumons redoutables». Berryer, un orateur! Allons donc! un avocat, et pas davantage, l’avocat des intérêts du prince de Polignac et de la petite cour de Goritz! «De grâce, disait-il, que l’Académie ne devienne pas une succursale de la Basoche, une doublure de la Société des Bonnes-Études[102]!»
C’est à ces vives attaques que répondit Pontmartin dans son article du 22 novembre, et il fut à son tour, vis-à-vis du rédacteur des Débats, aussi agressif que possible. On les eût bien étonnés l’un et l’autre si on leur eût annoncé qu’un jour ils seraient unis d’une étroite amitié. Il y avait d’ailleurs, dans le feuilleton de la Quotidienne, à côté des épigrammes et des railleries, des réponses qui portaient et qui n’ont rien perdu de leur justesse. Voici l’une de ces répliques:
M. Berryer, selon vous, n’est qu’un avocat, et rien de plus. La vérité est qu’une fois à la Chambre et à la tribune, il est avocat moins que personne. Dans son geste, son attitude, son accent, son langage, rien ne révèle les habitudes et les[100] traditions du barreau; il n’est plus avocat, il est au plus haut degré orateur, ce titre que M. Cuvillier lui refuse, sous prétexte qu’il n’a rien écrit. De bonne foi, comment un homme d’une opinion hostile à la grande majorité de ses collègues, serait-il proclamé par eux tous le premier orateur de son temps; comment, sans autre puissance que sa haute intelligence, conserverait-il une telle action sur les affaires; comment serait-il chef d’un parti où il y a des hommes plus spirituels que M. Fleury, s’il n’était qu’un ergoteur de tribunal et de cour d’assises, un disputeur de mur mitoyen et d’hypothèques?
Mais M. Berryer «qui a des poumons, un geste véhément, une voix sonore, c’est-à-dire tout ce qui s’appelle l’éloquence» (merci pour l’éloquence!), ne peut compter dans le monde, parce qu’il n’écrit pas ses discours. En d’autres termes, c’est parce qu’il possède au plus haut degré cet admirable talent d’improvisation, le premier de tous, celui que rien ne remplace, et dont l’absence rendra toujours incomplète la puissance d’un orateur; c’est parce qu’à l’aide de ce privilège merveilleux, il passionne, entraîne, remue à son gré une assemblée que laissent froide les phrases les plus régulières, et les périodes les plus harmonieuses, c’est pour cela qu’il n’est pas orateur! Lord Chatham et Mirabeau étaient des orateurs, mais Berryer point! La comparaison est malheureuse; car s’il y a un homme qui, après avoir joué un grand rôle par la puissance de sa parole, ait perdu aux yeux de la postérité qui lit ses discours, cette puissance et ce prestige, c’est à coup sûr Mirabeau. Mieux vaudrait pour lui n’avoir rien laissé et n’être jugé par nous que sur la foi de cet éclat immense que sa parole jeta sur l’Assemblée constituante! Ou plutôt qu’importe à Mirabeau, qu’importe à Berryer! Ils auront eu sur leur époque une influence sans rivale, ils seront arrivés aux plus grands effets de la parole! Ils auront été les rois de l’éloquence politique! Qu’importe après cela qu’ils aient peu écrit, ou que leurs écrits, lus après cinquante ans, ne réveillent plus les émotions contemporaines! Qu’importe[101] surtout qu’on leur refuse le droit littéraire de s’asseoir aujourd’hui auprès de MM. Dupaty et Viennet, demain peut-être auprès de M. Cuvillier-Fleury[103].
Les articles de Pontmartin à la Quotidienne étaient tantôt des Causeries littéraires ou artistiques[104], tantôt des chroniques humouristiques[105], quelquefois même des Nouvelles, Dulcinée[106], Fabiano le Novice[107], etc. Ils obtinrent tout aussitôt un vif succès, même à côté des feuilletons de J.-T. Merle[108], le plus ancien des rédacteurs de la Quotidienne, esprit fin et sans prétention, écrivain élégant, causeur aimable, pour lequel assurément n’avait point été créé le proverbe: Faute de grives on prend des merles. Pontmartin cependant ne pouvait se décider encore à quitter Avignon, sa famille, ses amis, ses habitudes. N’allait-il pas bientôt avoir trente ans, et n’était-ce pas un peu tard pour un début à Paris? N’y arriverait-il pas d’ailleurs dans d’assez mauvaises conditions? Il[102] était riche et gentilhomme, deux méchantes notes, il ne l’ignorait pas. Sans doute on lui ferait porter la peine de son titre de comte et de sa modeste fortune. On se refuserait à voir en lui autre chose qu’un «amateur», et l’on s’obstinerait à le traiter de «cher confrère» du bout des lèvres seulement, tandis qu’on l’appellerait «Monsieur le comte» gros comme le bras. Le plus sage ne serait-il pas de préférer à l’honneur de devenir un membre de la Société des gens de lettres, voire même un académicien, le plaisir d’écrire à son aise et à ses heures, sans ambition de renommée; de ne point fausser compagnie à la province, de n’aller à Paris chaque année que pour y prendre langue et pour revenir bien vite, auprès de sa mère, dans l’hôtel du toujours jeune M. de Montfaucon ou dans sa vieille maison des Angles?
III
Pontmartin disait souvent que les trois événements tragiques qui l’avaient le plus frappé et dont il avait gardé la vision toujours présente, étaient le choléra de 1832 à Paris, l’inondation du Rhône à Avignon et aux Angles en novembre 1840 et les Journées de Juin 1848.
L’automne de 1840 avait été excessivement pluvieux; les plaines étaient, depuis trois semaines, entièrement submergées lorsque, le 4 novembre, l’inondation atteignit son maximum, c’est-à-dire[103] la cote de huit mètres qui dépassait de soixante-quinze centimètres les plus fortes crues mentionnées dans l’histoire du Comtat. Pontmartin et sa mère étaient à ce moment dans leur maison des Angles. Le rez-de-chaussée fut envahi par les eaux jusqu’à une hauteur d’un mètre vingt au-dessus du sol. Tandis que Mme de Pontmartin était immobilisée au premier étage, son fils, obligé de pourvoir aux besoins de la maison, sortait par une échelle placée à la fenêtre d’une chambre au nord-est du logis, à un endroit où le chemin public, qui passe derrière les Angles, surplombe de deux mètres le niveau du rez-de-chaussée. Une fois sur ce chemin, il lui était facile de monter au village, situé au sommet d’une haute colline, de prendre la route venant de Nimes qui redescend vers le Rhône, de traverser le pont qui, fortement menacé, ne fut cependant ni emporté, ni couvert par les eaux et d’arriver à Avignon. Les quatre cinquièmes de la ville étaient submergés et on ne circulait qu’en bateau. L’hôtel de Montfaucon, où Mme de Pontmartin et son fils avaient un appartement, était envahi par l’eau jusqu’au premier étage.
Ce qui ajoutait à la désolation et à l’horreur de ces spectacles, c’étaient les scènes tragiques dont les plaines qui entourent les Angles étaient journellement le théâtre, les nombreux écroulements de maisons isolées, les incessants coups de fusil tirés en signe de détresse par les malheureux qui se trouvaient bloqués par le fleuve et en danger de mort, les efforts des courageux bateliers pour leur[104] porter des vivres et des secours, efforts qui n’empêchaient pas toujours des catastrophes et qui en amenaient parfois de nouvelles.
Quand il écrira, quelques années plus tard, les Mémoires d’un notaire, c’est avec ses souvenirs de l’inondation de novembre 1840 que Pontmartin retracera les scènes de la terrible inondation de novembre 1755[109]. Le livre parut seulement en 1849, mais il commença d’y songer dès 1842. Cette année-là, en effet, il acheta dans une rue assez triste, la rue Banasterie, à l’angle de la rue du Vice-Légat, une maison assez belle, dont la porte était surmontée de panonceaux et dont la façade était agrémentée d’affiches de toutes couleurs, annonçant les ventes, licitations, faillites, jugements et enchères du département. C’était la demeure d’un officier ministériel, héritier d’une dynastie de notaires. A peine Pontmartin y fut-il installé, qu’il eut l’idée de reconstituer par l’imagination tout ce dont ce vieux logis avait été témoin depuis un siècle. De là les Mémoires d’un notaire, qui ont pour cadre la maison de la rue Banasterie.
Pontmartin, à cette date, tournait décidément au propriétaire. Le siège de conseiller général, pour le canton de Villeneuve-lès-Avignon, étant devenu vacant, il posa sa candidature. Son concurrent, le marquis de Fournès, cousin germain du duc[105] Victor de Broglie, fut nommé. Deux ans après, en 1844, Pontmartin fut élu à l’unanimité.
Son entrée au Conseil général avait été précédée de son entrée à la Mode, et, de ce dernier succès, il s’était plus réjoui que de son triomphe électoral.
Les trois condamnés de 1839, Jules de Salvador, Ulric de Renoard et Frédéric d’Averton, étaient allés passer en Italie l’hiver de 1842-1843. Leur retour était annoncé pour le mois d’avril, et Pontmartin guettait l’arrivée de la malle-poste. Il en vit descendre avec eux un petit homme assez laid, mais dont la physionomie originale et fantaisiste méritait de ne pas passer inaperçue. Il était si expansif, si liant, que les trois Avignonnais et lui s’étant rencontrés à Naples quelques semaines auparavant, on en était déjà au tutoiement. C’était le vicomte Édouard Walsh, directeur de la Mode[110].
La présentation à peine faite, Édouard Walsh dit à Pontmartin: «J’ai lu vos articles envoyés à la Quotidienne: voulez-vous écrire dans la Mode?» Dès le 15 mai suivant, l’élégante Revue royaliste publiait le Bouquet de marguerites. Une seconde nouvelle, les Trois Veuves, parut dans la livraison[106] du 25 septembre. C’était le début d’une longue collaboration.
Le mariage de Pontmartin suivit de près son entrée à la Mode. A la fin de 1843, il épousa Mlle Cécile de Montravel.
Sortie du Forez, la famille de Montravel s’était fixée avant la Révolution dans la partie la plus méridionale du Vivarais. Peu après la naissance de sa fille[111], M. de Montravel était allé demeurer avec sa belle-mère, Mme de Larochette, au château du Plantier[112], quittant ainsi une Provence pour une Auvergne, tant sont grandes, entre le sud et le nord du département de l’Ardèche, les différences de langage, de races, de costumes et de cultures. Le château du Plantier était la Providence du pays. La vie de ses hôtes était toute de piété et de bonnes œuvres. Tous, à l’exemple de la vénérable aïeule, semblaient avoir pour devise: Dieu, le Roi et les Pauvres. Mme de Larochette, qui avait couru les plus grands dangers et montré le plus ferme courage pendant la Terreur, consacrait son existence à secourir les malheureux et à faire refleurir autour d’elle la religion. Elle avait restauré dans[107] son voisinage la chapelle de Notre-Dame d’Ay[113], que fréquentaient maintenant, comme avant la Révolution, de nombreux pèlerins. C’est dans cette chapelle que fut célébré, le 16 décembre 1843, le mariage d’Armand de Pontmartin et de Mlle de Montravel.
Comme deux bons provinciaux, ils firent leur voyage de noces à Paris, où ils passèrent deux mois dans la mélancolique rue du Mont-Thabor.
De retour à Avignon, à la fin de février 1844, il reprit sa collaboration à la Mode. Marguerite Vidal parut dans les numéros des 25 juin, 5 et 15 juillet 1844. A cette nouvelle succéda, dans les premiers mois de 1845, Napoléon Potard, qui avait presque les dimensions d’un volume.
M. Walsh écrivit à l’auteur qu’il réussissait, que les lecteurs de la Revue étaient ravis, et qu’il ne tenait qu’à lui de se croire un écrivain à la mode (sans italiques). La tentation était trop forte. Au mois d’octobre 1845, Pontmartin se résolut à aller passer l’hiver à Paris.
CHAPITRE VI
LES PREMIÈRES ANNÉES DE PARIS
(1845-1848)
Rue Neuve-Saint-Augustin. Les bureaux de la Mode. Jules Sandeau et le pavillon de la rue de Lille. Contes et Rêveries d’un Planteur de choux. Mme Cardinal et le cabinet de lecture de la rue des Canettes.—La Mode en 1845. Les déjeuners chez Véry. Joseph Méry et ses 365 sujets de roman. Rue de Luxembourg. Mort de Mme Eugène de Pontmartin.—M. François Buloz, Octave et la succession de Gustave Planche. Le jardin de la rue Saint-Benoît, Sainte-Beuve et son article des Nouveaux Lundis.
I
Au moment de son arrivée à Paris, à la fin d’octobre 1845, Pontmartin n’avait pas encore pris de résolution définitive au sujet de son installation dans la capitale. S’y fixerait-il à demeure? N’y ferait-il, au contraire, qu’un séjour plus ou moins prolongé? Dans le doute, il ne voulut pas louer un appartement et se mettre dans ses meubles. Il logea à l’hôtel, rue Neuve-Saint-Augustin. Était-ce à cet hôtel de Richelieu[114], où Lamartine, dans sa[109] jeunesse, ne manquait jamais de descendre, toutes les fois qu’il venait à Paris[115]?
Le 26 octobre, à peine débarqué, il se dirigeait vers la rue Neuve-des-Bons-Enfants, franchissait le seuil du numéro 3, montait d’un pied hésitant un escalier boiteux, qui lui rappela celui de la Gazette du Midi, et entrait dans un atelier humide et mal éclairé. C’était là que s’imprimait le recueil le plus élégant de cette époque, la Mode, étalant sur sa couverture jaune paille le double écusson de France et de Naples, afin d’affirmer le patronage de la duchesse de Berry. Il eut vite fait d’oublier toutes ces laideurs, et il se crut transporté dans un palais enchanté, lorsque, quelques instants après, dans son cabinet directorial, étroit et sombre, le vicomte Édouard Walsh lui dit: «Courage! Je crois que nous allons trouver Sandeau corrigeant les épreuves de Catherine. Je vous présenterai, et nous irons déjeuner ensemble.»
La présentation alla toute seule; il leur sembla que, sans s’être jamais vus, ils se reconnaissaient. Jules Sandeau était depuis longtemps le romancier de prédilection de Pontmartin, et, de son côté, l’auteur du Docteur Herbeau avait vivement goûté, dès leur apparition, les premières Nouvelles de son jeune collaborateur, et en particulier l’émouvant récit des Trois Veuves.
Huit jours après, Pontmartin était accueilli chez Sandeau comme un ami. Le romancier habitait[110] alors, rue de Lille, 19, un joli pavillon qu’il fallait aller chercher en traversant la cour d’honneur, en baissant la tête sous la cage du grand escalier et en pénétrant jusqu’au bout du jardin planté d’acacias et de sycomores. «C’est là, écrira Pontmartin au lendemain de la mort de Jules Sandeau, c’est là que je goûtai, pendant six ou sept ans, les douceurs de l’amitié la plus vraie, de l’hospitalité la plus franche. C’est là que les conseils, les bonnes paroles de l’auteur de Marianna m’encouragèrent à persévérer, me soutinrent dans mes défaillances, me consolèrent dans mes tristesses.»
Et un peu plus loin, dans le même article:
Que d’heures charmantes j’ai passées dans ce nid charmant! Je puis vous assurer que, à cette époque, en 1845, Jules Sandeau, jeune encore[116], ne regrettait plus rien. C’est à peine s’il aiguisait d’un peu d’ironie le sourire dont il faisait l’aumône à ses amours d’antan. Il avait auprès de lui sa femme, sa compagne, si gracieuse, si intelligente, mille fois plus dévouée à ses succès que lui-même, et son fils, le petit Jules, un délicieux enfant qui était sa plus douce joie, et qui devait être un jour son plus mortel désespoir[117]. Le babil de ce cher enfant était un véritable enchantement. Il semblait parler à un être invisible, sylphe, ange ou fée, et il terminait ses phrases par un gazouillement de fauvette qui nous ravissait. Pendant les belles soirées d’été, penchés[111] à la fenêtre ouverte, nous écoutions cette fraîche mélodie, tandis qu’un vrai rossignol, caché dans les massifs de verdure, lançait aux étoiles ses trilles et ses roulades. Ah! ce sont là de ces moments qu’il faudrait arrêter au passage, qui laissent du moins dans l’âme un peu de leur parfum, comme ces fleurs que nous touchons sans les cueillir, et dont l’odeur suave s’attache à nos habits et à nos mains[118]!
Au mois de mai 1846, Pontmartin publia son premier ouvrage, Contes et Rêveries d’un planteur de choux; il était dédié à Jules Sandeau.
La première partie du volume renfermait les récits qui avaient paru dans la Mode, Napoléon Potard, les Trois Veuves, Marguerite Vidal, le Bouquet de marguerites. Après les contes, venaient les rêveries, articles humouristiques et de pure fantaisie, que l’auteur, à partir de la seconde édition de son livre, a cru devoir sacrifier. Il m’écrivait, le 20 novembre 1886:
J’ai supprimé, dans les éditions suivantes, des articles sans importance, Melpomène en Provence, Tamburini en voyage, deux épisodes qui ne pouvaient avoir qu’un succès d’à-propos et de localité; puis, dans le même genre, Carpentras apocryphe (dont j’ai fait plus tard la préface de la Petite ville, de Constant Moisand), Carter, Robert-Macaire, feuilletons de province, rien de plus.
Voici, du reste, la liste complète de ces articles, que l’auteur avait réunis sous le titre de Silhouettes d’artistes en Province: L’Artiste en cage, Carter; L’Artiste en haillons, Robert-Macaire;[112] ’Artiste en crimes (Lacenaire); l’Artiste inconnu, Freischütz en Bohême; Melpomène en province; Tamburini en voyage; Carpentras apocryphe.
Pontmartin a-t-il eu raison de supprimer ces feuilletons? J’incline fort à penser le contraire. Sans doute ils dataient son livre; mais je suis, pour mon compte, de ceux qui croient qu’il ne faut pas mépriser les dates; et puis, ces chapitres étaient si spirituels, d’une si amusante fantaisie, que nous aurions encore aujourd’hui grand plaisir à les lire. Maintenant que nous n’avons plus que des auteurs de Tristes, cela nous changerait un peu.
Mes lecteurs, j’en suis sûr, ne connaissent qu’une seule dame Cardinal, celle de Ludovic Halévy. J’en ai connu une autre, et qui valait mieux. A l’époque où je faisais mon droit—je parle de longtemps—il y avait, dans la vieille rue des Canettes, un vieux cabinet de lecture, où l’on ne trouvait que de bons livres. Il était tenu par Madame Cardinal, très connue dans le faubourg Saint-Germain, et que les marquises et les vicomtesses de la rue de Varenne et de la rue de Grenelle chargeaient volontiers de faire elle-même le choix des ouvrages qu’elles devaient, dans la belle saison, emporter à la campagne. C’était une très honnête femme et qui n’avait pas de filles; bonne chrétienne et fervente royaliste, vive, active, enjouée, et avec cela femme de goût, elle donnait, à l’occasion, de sages avis à ses abonnés. Elle me dit un jour, comme je revenais de vacances: «Vous arrivez bien; on vient de me retourner de[113] la campagne un volume rarissime, les Contes et Rêveries d’un planteur de choux, la première édition, la bonne. Je vous recommande surtout les derniers chapitres, Melpomène en voyage et le reste. C’est exquis.» Hélas! le cabinet de lecture de Mme Cardinal est fermé, et le volume de 1846 est maintenant introuvable.
Les contes, du reste, deux surtout, étaient bien pour suffire au succès du volume. Le Bouquet de marguerites est une anecdote finement contée; mais au demeurant, ce n’est qu’une anecdote. Dans Napoléon Potard, la nouvelle la plus développée du volume, si les scènes gracieuses ne font pas défaut, si les détails piquants abondent, l’idée première, la fable même du roman est décidément trop romanesque: un maréchal d’Empire fait par Napoléon duc d’Iéna, et qui veut que son fils, jusqu’au jour où il aura vingt-huit ans, ne connaisse rien de sa naissance, de son illustration et de sa fortune. Il faudra que ce fils vive jusque-là loin de lui et qu’il lutte, avec des ressources médiocres et un nom vulgaire—le nom de Potard!—contre les difficultés de la vie et les obstacles que la société oppose à ceux qui, sans autre titre que leur mérite, demandent leur place au soleil.
Marguerite Vidal, au contraire, est un récit achevé. C’est un petit roman par lettres qui se passe sous le Consulat, à l’époque de la rentrée des émigrés, et qui rappelle les meilleurs ouvrages de Mlle de Souza, avec plus de finesse encore dans l’analyse et la peinture des sentiments.
Dans les Trois Veuves, l’auteur a su faire revivre la Vendée de 1793, celle de 1815 et celle de 1832. Ce glorieux épisode de notre histoire, cette guerre, la plus légitime et en même temps la plus romanesque de toutes, n’avait encore fourni à aucun de nos romanciers d’aussi heureuses inspirations.
II
Édouard Walsh était un vrai journaliste. Il ne lui fallut pas longtemps pour deviner quels services lui pourrait rendre Pontmartin, avec la diversité de ses goûts, la variété de ses aptitudes et son extraordinaire facilité de plume. Au bout de peu de temps, l’auteur de Marguerite Vidal devint, à la Mode, une sorte de Maître Jacques romancier, causeur littéraire, critique dramatique, chroniqueur mondain.
La petite revue, à cette époque, était au plus fort de son succès. Elle rachetait les excès, assurément regrettables, de sa polémique politique, par l’éclat de sa rédaction littéraire. Son directeur avait su grouper autour de lui l’élite des écrivains du temps: Alexandre Dumas, Jules Sandeau, Roger de Beauvoir, Léon Gozlan, Alphonse Karr, J.-T. Merle, Henry Berthoud, Paul Féval, Philarète Chasles, Amédée Achard, Arthur de Gobineau, le marquis de Foudras, le colonel de Gondrecourt, Théodore Muret, Alexis de Valon,[115] Alfred des Essarts, Eugène Pelletan qui signait un Inconnu; Mme Sophie Gay, Mme Ancelot, la comtesse d’Arbouville, la comtesse Merlin, etc. Méry ne faisait pas encore partie du groupe; ce fut Pontmartin qui l’y introduisit au printemps de 1847.
Le vicomte Walsh donnait chaque semaine chez Véry d’excellents déjeuners. Les convives habituels étaient Alfred Nettement, Pontmartin, l’avocat royaliste du Theil, Jules Sandeau, Merle, quelquefois Roger de Beauvoir. Un jour, Pontmartin amena Méry. Il l’avait entrevu à Marseille, trois ans auparavant; l’ayant rencontré à Paris et l’ayant trouvé très disposé à écrire dans la Mode, bien qu’il eût, vingt ans en ça, composé la Villéliade et la Corbiéréide, il lui avait donné rendez-vous chez Véry. Au premier mot que lui dit M. Walsh pour obtenir de lui un roman, l’auteur de la Floride et de la Guerre du Nizam répondit avec un sang-froid magnifique: «J’ai 365 sujets, un pour chaque jour de l’année. Je vais vous les raconter.» Et il raconta le premier, intitulé la Circé de Paris. Naturellement, Walsh s’écria, en battant des mains: «C’est charmant! Nous nous en tiendrons à celui-là!» La Circé de Paris parut, en effet, quelques semaines après.
De la fin de 1845 au commencement de 1848, Pontmartin fit, à la Mode, une campagne de deux ans; il n’est guère de livraison qui ne renferme un article de lui. Sous des signatures variées,—A.—A. P.—Calixte Ermel,—Armand de Pontmartin,—il publia tour à tour des causeries littéraires[119],[116] des causeries mondaines, des causeries artistiques[120], des causeries dramatiques. Comme il avait de l’invention et que le critique chez lui était doublé d’un conteur, lorsque la pièce dont il avait à parler lui paraissait manquée, il ne se privait pas du plaisir de la refaire. C’est ce qui lui arriva, par exemple, au mois de mars 1847, dans son article sur la comédie de Léon Gozlan, Notre fille est princesse.
Comme à la Quotidienne, Pontmartin, à la Mode, entremêlait ses causeries de contes et de nouvelles: en 1846, la Confession d’un hachichin[121]; en 1847, le Dernier Dahlia[122] et les Mémoires d’un notaire[123]. Les Mémoires d’un notaire n’étaient rien moins qu’un roman en trois volumes: le premier seul fut publié avant 1848; les deux autres furent écrits après la révolution de Février, et nous aurons à y revenir.
Après un premier séjour à Paris, d’octobre 1845 à mai 1846, Pontmartin avait passé l’été dans le Midi. Il était revenu seulement au mois d’octobre 1846, et, cette fois encore, il n’avait pas cru devoir prendre un appartement. Il se contenta de louer[117] quelques chambres meublées dans la rue de Luxembourg[124].
Le lundi 21 décembre, il venait d’assister, au théâtre de l’Odéon, à la répétition générale d’Agnès de Méranie. Minuit sonnait aux horloges de l’Assomption et de Saint-Roch, quand il rentra chez lui. La concierge lui remit une large enveloppe, d’une physionomie officielle, portant le timbre du ministère de l’Intérieur. Il l’ouvrit avec un pressentiment sinistre, et voici ce qu’il lut:
CABINET DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
21 décembre 1846. Par télégraphe.
Le préfet de Vaucluse prie M. le Ministre de l’Intérieur[125] de faire prévenir M. Armand de Pontmartin que l’état de madame sa mère s’est fort aggravé depuis quelques heures, et que son oncle[126] l’engage à partir immédiatement.
Le Maître des requêtes,
Chef du Cabinet,
Edmond Leclerc[127].
En 1846, le télégraphe aérien ne fonctionnait pas la nuit; il fallait plusieurs heures pour la transmission et quand le temps était brumeux (cas fréquent[118] en décembre), il fallait souvent toute une journée. Madame de Pontmartin était morte presque subitement dans la matinée du 21 décembre; la dépêche n’était arrivée rue de Luxembourg que dans la soirée, après le départ de Pontmartin pour le théâtre.
La santé toujours délicate de sa mère semblait en bonne veine, quand il l’avait quittée deux mois auparavant. Lorsqu’il l’avait embrassée avant de monter en diligence, elle était presque gaie. Il était parti plein de confiance. La dépêche fut pour lui un coup de foudre; elle ne disait pas sans doute toute la vérité; mais s’il lui était permis de conserver encore une lueur d’espoir, sa douleur et ses inquiétudes étaient d’autant plus cruelles, que les moyens de locomotion étaient à cette époque d’une effroyable lenteur: par la malle-poste,—qu’il fallait retenir longtemps d’avance,—trois nuits et trois jours; par la diligence, quatre jours et quatre nuits. En outre, dans la mauvaise saison, il suffisait d’une tombée de neige, d’une bourrasque, d’une couche de glace à la surface du Rhône ou de la Saône, pour allonger indéfiniment le trajet réglementaire.
Le mardi 22 décembre, à dix heures du matin, son cousin le marquis de Besplas et son ami Joseph d’Ortigue le hissèrent dans le coupé de la diligence. Ce que fut ce voyage, il l’a dit, dans des pages émues, au tome II de ses Mémoires[128]. Arrivé[119] à Chalon le vendredi matin seulement, il put monter sur le bateau à vapeur de la Saône. Le lendemain, il prenait à Lyon le bateau du Rhône; le soir, à la nuit tombante, il arrivait à Avignon. Ses amis l’attendaient sur le quai. Ils se jetèrent dans ses bras, et il n’eut pas à les interroger.
III
Au mois d’octobre 1846, lorsque Pontmartin avait quitté Avignon, sa mère savait qu’il emportait dans sa valise une nouvelle destinée à la Revue des Deux Mondes. Elle lui avait dit, avec un bon sourire: «Jusqu’ici la Revue m’avait toujours fait peur. Je la crois bien encore un peu hérétique; mais elle est certainement en voie de s’amender, puisque tu vas y écrire. Je serai heureuse d’y lire ton article.»
Quelques mois auparavant, en effet, Jules Sandeau, qui venait de terminer son roman de Madeleine[129], avait dit un soir à Pontmartin: «Il est temps d’agrandir votre cadre; Buloz vous a lu, il veut vous connaître; je vais vous conduire rue Saint-Benoît.» Et simplement, sans phrases, avec une cordialité toute fraternelle, l’auteur de Mademoiselle de la Seiglière s’était fait l’introducteur et le patron du modeste auteur des Trois Veuves.
Pontmartin avait passé dix ans à rêver Revue[120] des Deux Mondes, comme les sous-lieutenants rêvent le bâton de maréchal, comme les jeunes filles romanesques rêvent le Prince Charmant. Le cœur lui battait donc bien fort lorsqu’il se présenta, le 2 avril 1846, devant M. Buloz, sa copie à la main et ne demandant pas son salaire. Le tout-puissant directeur était dans son cabinet, avec sa culotte de velours noir et sa robe de chambre de flanelle bleue. Il fut extrêmement poli, serra le manuscrit dans un carton et promit de l’examiner. Quinze jours après, il indiquait à l’auteur des changements, des retouches, puis une refonte générale.
Son goût était plus instinctif que réfléchi, mais, en somme, très sûr. On se trouvait presque toujours bien d’écouter ses avis. La nouvelle, légèrement remaniée, parut dans la livraison du 1er février 1847, sous le titre d’Octave. Elle réussit, et M. Buloz résolut aussitôt de s’attacher Pontmartin comme chroniqueur littéraire et dramatique de la Revue.
Il était, à cette date, en même temps que directeur de la Revue des Deux Mondes, commissaire du roi près le Théâtre-Français. A ce dernier titre, il ne pouvait pas, en conscience, froisser les auteurs en vogue. Il lui fallait ménager M. Scribe, dont deux pièces au moins, Bertrand et Raton et Une Chaîne, tenaient souvent l’affiche, et qui parlait de lui donner une comédie nouvelle en cinq actes[130]. Il lui fallait, d’autre part, assurer le succès d’Alfred[121] de Musset, qui allait débuter à la Comédie-Française avec le Caprice, rapporté de Saint-Pétersbourg, par Mme Allan. Malheureusement Scribe et Musset étaient aussi mal l’un que l’autre dans les papiers de Gustave Planche, qui était alors chargé, chez M. Buloz, de la critique théâtrale. Depuis douze ou quinze ans, il faisait hautement profession de mépriser le talent de M. Scribe. Il ne pouvait le prendre d’aussi haut avec Musset, qui était l’un des principaux collaborateurs de la Revue; mais brouillé avec le poète pour les beaux yeux de Mme Sand, il le traitait par la prétérition, il se déclarait décidé à ne pas dire un mot de son Proverbe, si on le représentait. Comment faire? Comment se tirer de cette situation complexe et concilier les intérêts du directeur de la Revue et ceux du commissaire royal? M. Buloz n’hésita pas; il enleva à Gustave Planche sa férule, et il la remit aux mains plus légères et mieux gantées du très spirituel rédacteur des Causeries dramatiques de la Mode.
Pendant près de cinq ans, du 1er mai 1847 au 15 mars 1852, il fut le chroniqueur attitré de la Revue, rendant compte à la fois des pièces de théâtre et des livres. Il y eut là pour lui, surtout dans les premiers mois et jusqu’en février 1848, des heures délicieuses, ce qu’il appellera plus tard sa lune de miel littéraire.
La Revue des Deux Mondes ne comptait guère alors que deux à trois mille abonnés; mais elle était la Revue, la première, la seule. Son influence[122] dépassait nos frontières et s’étendait sur toute l’Europe. Ses rédacteurs n’étaient pas payés bien cher, mais dans cette glorieuse pléiade, il y en avait plus de sept qui étaient illustres: Alfred de Musset, Augustin Thierry, Prosper Mérimée, Alfred de Vigny, Sainte-Beuve, Ludovic Vitet, Victor Cousin, Henri Heine[131].
Elle ne se permettait pas, d’ailleurs, d’autre luxe que celui d’une rédaction exceptionnellement brillante. Son logis était modeste, une humble et bourgeoise maison, au numéro 20 de la rue Saint-Benoît, qui offrait pourtant cette double singularité d’appartenir à un futur académicien, M. Saint-René Taillandier, et de posséder un jardin au premier étage. Le souvenir de ce jardin légendaire, suspendu comme ceux de Babylone et dont George Sand avait été longtemps la Sémiramis, devait être toujours cher à Pontmartin, qui écrira trente ans plus tard dans ses Nouveaux Samedis:
Que n’a-t-on pas dit de ce jardin? Je crois que les solliciteurs, les martyrs et les refusés de la Revue l’ont jugé à travers leurs frayeurs ou leurs rancunes. Pour moi, il ne m’a jamais paru que les fleurs y fissent des piqûres d’orties et que la verdure y fût jaune. J’aimais cette salle d’attente avec son ombre discrète, ses économies de soleil et ses allées étroites enroulées autour de son microscopique tapis de gazon. J’ai passé là d’agréables heures, ruminant un sujet d’article, méditant sur les corrections demandées, attendant une épreuve, jasant avec un merle à peu près apprivoisé[123] qui semblait chargé de siffler les manuscrits suspects et qui s’acquittait vaillamment de la besogne. De temps à autre, par les fenêtres entr’ouvertes, m’arrivait un bruit de tempête et j’aurais été tenté de redire le suave mari magno... de Lucrèce, si je n’avais songé que j’étais moi-même à bord du navire, sur cette mer agitée par les vents. J’entendais le maître, en proie à la fièvre de la veille du numéro, se déchaîner tour à tour contre M. de Mars[132],—toujours en carême!—contre le prote, contre le rédacteur absent ou présent, contre une malheureuse coquille oubliée sur une moyenne de deux cents pages. Il y avait de mauvais moments; mauvais moments dont on fait plus tard,—trop tard,—de bons souvenirs[133]!
On se réunissait presque tous les jours, de quatre à six heures, dans les bureaux de la Revue, Sainte-Beuve ne manquait guère d’y venir et c’était une fête pour Pontmartin de causer avec le célèbre critique. L’auteur des Portraits littéraires, à cette date de 1844, était bien loin d’être ou du moins de se montrer ce qu’il sera plus tard, sous le second Empire, quêteur de popularité, associant Brutus à César, positiviste et matérialiste, archevêque du diocèse où fleurit l’athéisme. Il fréquentait chez M. Guizot et surtout chez M. Molé, qu’il aimait à visiter en son château du Marais; il était conservateur en politique comme en littérature, aussi loin maintenant d’Armand Carrel que de Victor Hugo. Sa figure rabelaisienne et narquoise s’éclairait d’un pieux sourire lorsqu’il parlait de sait religion et du catholicisme, pour lequel il professait[124] le plus profond respect. Quelquefois, il est vrai, il disait à Pontmartin: «Quand vous parlez des anciens, ne craignez jamais d’en trop dire. Quand vous parlez des contemporains n’ayez jamais l’air d’être leur dupe[134]!» Malgré tout son esprit, Pontmartin était au fond un naïf. Il fut la dupe de Saint-Beuve et il devint son ami. Voici du reste comment ce dernier, dans ses Nouveaux Lundis, parle de leurs premières rencontres dans les bureaux de la rue Saint-Benoît:
Quand je le vis arriver à Paris et s’adresser pour ses premiers essais critiques à la Revue des Deux Mondes, où un compatriote de Castil-Blaze[135] avait naturellement accès, c’était un homme qui n’était plus de la première jeunesse, spirituel, aimable, liant, point du tout intolérant, quoique dans la nuance légitimiste. Il avait déjà écrit quelques contes ou nouvelles, il s’était essayé dans la presse de province et il aspirait à faire des articles critiques plus en vue. J’avoue que mon premier pronostic lui fut aussitôt favorable. Il avait la plume facile, distinguée, élégante, de cette élégance courante, qui ne se donne pas le temps d’approfondir, mais qui sied et suffit au compte rendu de la plupart des œuvres contemporaines[136].
Tout cela est au demeurant assez juste, à la condition pourtant d’ajouter que les comptes rendus de Pontmartin avaient une réelle originalité. La Revue, avant lui, avait eu des critiques très pédantesques[125] et très lourds comme Gustave Planche, ou très érudits et très fins comme Sainte-Beuve lui-même. Elle n’avait pas encore eu un véritable causeur littéraire, c’est-à-dire un homme d’esprit qui, sans approfondir, je le veux bien, sans appuyer, glisse avec grâce sur les sujets les plus divers, passe du roman de la semaine dernière à l’opéra-comique de la veille et à la comédie du jour, parlant de tout avec goût, avec mesure, avec malice, et sachant à l’occasion cacher, sous un mot piquant, une vérité sérieuse et une utile leçon. Ce chroniqueur littéraire, ce causeur qui avait jusqu’alors manqué à M. Buloz, Pontmartin le fut pendant cinq ans. Et comme il n’avait pas eu de prédécesseur à la Revue, il n’y a pas eu non plus de successeur: on ne l’a pas remplacé.
Ces chroniques de la Revue des Deux Mondes, de 1847 à 1852, sont au nombre de vingt-six: elles formeraient aisément deux ou trois volumes. Pontmartin n’en a jamais réimprimé une seule ligne. Combien de centaines d’articles n’a-t-il pas ainsi laissé perdre, sans vouloir prendre le temps et la peine de les recueillir! Rien ne le mortifiait plus, nous le savons, que de s’entendre appeler Monsieur le comte: son unique ambition était d’être un homme de lettres.—Oui, mais il restait malgré tout un gentilhomme, et il semait sans compter ses articles sur sa route, comme d’autres jettent leurs pièces d’or.
CHAPITRE VII
LA RÉPUBLIQUE DE FÉVRIER
L’OPINION PUBLIQUE
(1848-1852)
Rue d’Isly. Sainte-Beuve et le 1er janvier 1848. Le 24 février.—Fondation de l’Opinion publique.—Comment se faisait un journal en l’an de grâce 1848.—Rédacteur en chef sans appointements.—Les Jeunes à l’Opinion publique.—Ponson du Terrail et Henri de Pène.—Cham et Armand de Pontmartin.—Les Lettres d’un sédentaire et les Mémoires d’Outre-Tombe.—La Sixième du second de la première.—Le 16 avril et le 15 mai. Les journées de Juin. La barricade de la rue Lafayette, le lieutenant Paul Rattier et le caporal Émile Charre.—Le ministère de M. de Falloux et la Bibliothèque de Jules Sandeau.—Les Mémoires d’un notaire.—L’Odyssée électorale de M. Buloz et les marronniers des Angles.—La revision de la Constitution et le conseil général du Gard. La Taverne de Richard-Lucas. Le coup d’État du 2 décembre. Suppression de l’Opinion publique.
I
Puisque le succès décidément était venu, Pontmartin ne pouvait pas continuer de vivre à Paris en camp volant; il lui fallait avoir maintenant un vrai domicile. A la fin de décembre 1847, il quitta le passage de la Madeleine, où il logeait depuis le[127] mois d’octobre précédent et il s’installa dans un petit appartement de la rue d’Isly, près la gare Saint-Lazare.
L’année 1848 commença bien, sinon pour les hôtes du château[137], du moins pour le nouveau locataire de la rue d’Isly. Le matin du 1er janvier, il vit entrer chez lui Sainte-Beuve qui venait de monter ses trois étages pour lui souhaiter la bonne année et lui apprendre la prise d’Abd-el-Kader. Quelques jours après, le Théâtre-Français annonçait la prochaine représentation du Puff de M. Scribe. Pour en mieux assurer le succès, qu’il tenait d’ailleurs pour certain, M. Buloz donna la veille même de la première, un petit dîner d’intimes et de critiques influents, auquel Pontmartin fut invité, et qui réunissait Jules Janin (Journal des Débats), Théophile Gautier (la Presse), Hippolyte Rolle (Constitutionnel), Alfred de Musset, Charles Magnin et Régnier, homme d’esprit, comédien charmant, fin lettré, chargé d’un des principaux rôles. Si, le lendemain, la pièce n’obtint qu’un demi-succès, Pontmartin n’en fut pas autrement affligé, et il se consola vite en écrivant sur le Puff deux articles qui parurent, l’un dans la Mode, sous la signature Calixte Ermel, le 26 janvier; l’autre, le 1er février, dans la Revue des Deux Mondes.
L’horizon politique cependant s’assombrissait de jour en jour. Trois fois par mois, dans la Mode, Alfred Nettement annonçait que la révolution était[128] proche, qu’elle allait éclater, que ce n’était plus qu’une question de semaines, de jours, d’heures peut-être. Pontmartin n’en croyait pas un traître mot. Au milieu de février, ses affaires le rappelant aux Angles, il crut pouvoir quitter Paris sans trop d’inquiétude ou de scrupule. Le 24 février le surprit à Avignon, d’où il adressa à la petite Revue de la rue Neuve-des-Bons-Enfants une longue causerie sur la Révolution de février en province. Dès les premiers jours de mars, il était de retour rue d’Isly. Les républicains pullulaient à ce moment. Hier encore une pincée, ils étaient légion maintenant. Parmi les royalistes eux-mêmes, plusieurs, et non des moindres, M. Berryer, M. de Larcy, M. de Falloux, estimaient que le devoir et la loyauté leur commandaient, non certes de se rallier au nouveau gouvernement, mais de lui laisser provisoirement le champ libre, de ne pas ajouter à ses embarras, de lui accorder assez de temps pour montrer ce dont il était capable ou incapable. Pontmartin ne blâma pas ceux de ses amis qui croyaient devoir adopter cette ligne de conduite. Elle le laissait d’ailleurs sans inquiétude: il était bien sûr, en effet, que la République les obligerait bientôt, par ses sottises et ses maléfices, à lui retirer leur adhésion transitoire. Mais s’il ne blâma point ses amis, il ne les suivit pas. S’il n’avait pas ménagé les épigrammes au gouvernement de Juillet, il s’était soigneusement tenu à l’écart de toute compromission, de toute alliance avec l’opposition républicaine. Royaliste de sentiment[129] et de raison, il redisait volontiers avec Homère: «Le gouvernement de plusieurs n’est pas bon; qu’il n’y ait qu’un maître et qu’un roi!» et avec Corneille:
Le pire des états, c’est l’état populaire.
Le régime démocratique était à ses yeux le plus détestable des gouvernements, omnium deterrimum; il ne voulut pas l’accepter, le saluer, ne fût-ce qu’un jour, ne fût-ce qu’une heure.
La Révolution de Février, si elle n’avait pas tué la Mode, lui avait porté un coup dont elle ne devait pas se relever. N’ayant plus Louis-Philippe à cribler de ses épigrammes, elle avait perdu sa raison d’être. M. Edouard Walsh, directeur plein d’entrain et de verve mondaine, aurait peut-être pu la soutenir; mais, à la suite d’un riche mariage, il avait passé la main à un M. de J..., qui avait tout ce qu’il fallait pour changer la retraite en débâcle et en déroute. Elle ne vivait plus que d’une vie précaire, logeant le diable en sa bourse, et voyant s’éloigner l’un après l’autre ses meilleurs rédacteurs. Seuls, Nettement et Pontmartin lui restèrent fidèles, bien qu’elle eût cessé de les payer. De 1848 à 1850, Pontmartin y donna de nombreuses chroniques, parlant de tout, de littérature, d’art, de politique, passant du Théâtre-Français au Salon de peinture[138], rendant compte[130] un jour des Mémoires d’Outre-Tombe, de Chateaubriand[139], un autre jour des Confessions d’un révolutionnaire, de Proudhon[140], mêlant à ses chroniques parisiennes des chroniques de province, et, dans toutes, affirmant hautement sa foi monarchique. Malheureusement, publiés dans la Mode, ces articles ressemblaient à des feux d’artifice tirés dans une cave. Il fallait trouver autre chose: Alfred Nettement et Armand de Pontmartin se résolurent à fonder un journal quotidien.
Dans ses Épisodes littéraires[141], Pontmartin a raconté la naissance et la mort de l’Opinion publique. Le ton épigrammatique de ce chapitre serait de nature à donner le change sur la valeur de la feuille dont il fut l’un des rédacteurs en chef, sur les services qu’elle rendit, sur le rôle à la fois si honorable et si brillant qu’y joua Pontmartin lui-même. Je voudrais, dans les pages qui vont suivre, faire mieux connaître un journal qui a eu son heure d’éclat; qui, dans un temps où la presse n’était pas sans gloire, où les journalistes s’appelaient Louis Veuillot, Laurentie, Emile de Girardin, Lamartine, Proudhon, Eugène de Genoude[142], Silvestre de Sacy, Saint-Marc Girardin, John Lemoinne, a marqué sa place au premier rang.
II
Le 27 mars 1848, eut lieu, chez Alfred Nettement[143], rue de Monceau-du-Roule, une petite réunion, à laquelle il avait convoqué Armand de Pontmartin, Théodore Muret[144], l’un des plus anciens rédacteurs de la Mode, et Adolphe Sala, ex-officier de la garde royale, démissionnaire en 1830, compromis en 1832 dans le procès du Carlo-Alberto, et qui, depuis, s’était occupé d’affaires, sans abandonner la politique. On tint conseil. Entre les deux principaux organes du parti légitimiste, il y avait évidemment une place à prendre, pour un journal plus jeune d’idées, plus vif d’allures que l’Union[145], moins absorbé que la Gazette de France par l’étude abstraite des théories philosophiques et politiques. De cela nos quatre amis tombèrent aisément d’accord, et ils se dirent: «Faisons un journal.»
Aussi bien, rien n’était plus facile. Il ne s’agissait que d’aller chez un imprimeur,—avec de l’argent toutefois. Mais il en fallait si peu! assez seulement pour payer les frais de composition et de tirage du premier numéro, et, en mettant les choses au pis, des cinq ou six suivants. Ce serait affaire aux abonnés—ils ne pouvaient manquer de venir—de faire le reste.
Les premiers fonds furent fournis par des amis de Nettement, le duc des Cars, M. de Saint-Priest, M. d’Escuns. Un imprimeur royaliste, M. Brière, rue Sainte-Anne, très lié avec Théodore Muret, offrit ses presses. Il fallait un bureau. Pour n’avoir pas à payer de loyer, on accepta l’hospitalité de la Mode, qui avait quitté la rue Neuve-des-Bons-Enfants et qui occupait alors, au numéro 25 de la rue du Helder, un petit local dans le fond de la cour, au rez-de-chaussée, avec une pièce fort étroite à l’entresol. Entre temps, on s’était mis d’accord sur le titre: le journal s’appellerait l’Opinion publique. Restait à trouver un gérant, c’est-à-dire un brave homme prêt à faire de la prison toutes les fois qu’il le faudrait. On l’avait sous la main dans la personne d’un Vendéen, combattant de 1832, M. P. Voillet, qui avait déjà fait sous Louis-Philippe plusieurs séjours à Sainte-Pélagie, pour le compte de la Mode, et qui ne demandait qu’à recommencer.
On avait un titre, un imprimeur, un bureau, un[133] gérant. Le 2 mai 1848, deux jours avant la réunion de l’Assemblée nationale, le premier numéro parut avec cet en-tête:
RÉDACTEURS EN CHEF
Politique: M. ALFRED NETTEMENT.
Littérature: M. A. DE PONTMARTIN.
Le journal[146], au début, se faisait d’une assez drôle de façon. Dans la journée, la salle de rédaction était presque toujours vide. Le soir, elle se remplissait d’amis, de députés de la droite, qui venaient aux nouvelles ou qui en apportaient. On fumait beaucoup, on causait davantage encore. Cependant dix heures et demie, onze heures sonnaient à la pendule: «Voyons, messieurs, disait gravement Théodore Muret, il faut laisser Nettement faire son grand article.»
De quart d’heure en quart d’heure, le sage Muret reproduisait sa motion. Enfin, sur le coup de minuit, on se retirait. Resté seul, Nettement se mettait à la besogne. Il couvrait de sa grande écriture de nombreux feuillets, dont le metteur en pages s’emparait vite au fur et à mesure de leur achèvement. Après son grand article, il en composait un second, puis quelquefois un troisième. On finissait toujours par paraître, mais on manquait souvent le chemin de fer. L’accident du reste ne causait[134] pas grande émotion. «Ah çà! messieurs, se bornait-on à dire, le journal n’est pas encore parti ce matin; il faudrait pourtant s’arranger différemment.»
Les lettres des abonnés de province se succédaient alors, toutes conçues à peu près dans les mêmes termes: «Monsieur le rédacteur, je me suis abonné à votre excellent journal, et je vous avoue que c’est dans l’intention de le recevoir. S’il ne me manquait qu’une fois de temps en temps, passe; mais il me manque deux ou trois fois par semaine. C’est un accident, je le veux bien; mais comment se fait-il qu’il soit si fréquent[147]?»
Eh bien! le journal, malgré tout, prospérait. S’il était fait un peu à la diable, il ne laissait pas d’être très bien fait. Outre ses grands articles, Alfred Nettement donnait chaque jour sous ce titre: Impressions à la Chambre, la physionomie de la séance de l’Assemblée. Armand de Pontmartin publiait des Chroniques de Paris, qui étaient les plus spirituelles du monde. La politique, à ce moment, n’était pas renfermée tout entière dans l’enceinte du Palais-Bourbon; elle était partout, dans les cafés, sur la place publique, à la Bourse et sur les boulevards. Théodore Muret et Adolphe Sala avaient charge de recueillir tous les bruits, de multiplier les échos, et, à côté de la physionomie de la Chambre, de peindre la physionomie de la rue. Et ainsi l’Opinion publique avait les allures[135] d’un petit journal autant que d’une feuille sérieuse. C’était une Gazette de France en pleine jeunesse, une Quotidienne de vingt ans.
Après les journées de Juin, trois écrivains de réelle valeur, MM. de Lourdoueix[148], Albert de Circourt[149] et Alphonse de Calonne[150] vinrent renforcer la rédaction du journal. A la fin de 1848, après huit mois seulement d’existence, l’Opinion publique avait six mille abonnés.
Le 28 mai 1849, elle transporta ses bureaux rue Taitbout, numéro 10. Alfred Nettement venait d’être nommé à l’Assemblée législative par les électeurs du Morbihan. La situation nouvelle qui lui était faite ne pouvait manquer d’accroître encore l’importance de son journal. Celui-ci pourtant, à cette heure-là même, traversait une crise grave.
Il ne suffit pas, pour qu’un journal vive et prospère, qu’il ait des écrivains de talent, des abonnés,[136] un public; besoin est qu’il ait aussi un financier, un calculateur, et l’Opinion publique n’en avait pas. Si la rédaction était remarquable, l’administration n’était rien moins que sage. On avait agrandi le format et on avait abaissé le prix de l’abonnement. On avait multiplié, au delà de toute prudence, les Abonnements de propagande. On publiait chaque jeudi un Supplément populaire, qui était très onéreux. Un jour vint où il fallut bien s’avouer que les recettes et les dépenses ne s’équilibraient plus. Que faire? Suspendre le journal, au moment où son influence était en progrès, alors qu’il rendait de véritables services? Il n’y fallait pas songer. Relever le prix d’abonnement? C’était bien périlleux; c’était, dans tous les cas, aller contre le but auquel tendaient les fondateurs, qui avaient surtout voulu faire œuvre de propagande.
Adolphe Sala proposa de recourir à un moyen héroïque. «Nous ne pouvons, dit-il, ni supprimer[137] ni réduire les dépenses matérielles, les frais d’employés. Impossible également de ne pas payer les feuilletons et les articles en dehors. Reste la rédaction habituelle. Décidons qu’elle sera gratuite. Que l’honneur de servir notre cause soit notre seul salaire, et travaillons gratis tant qu’il plaira à Dieu.» La motion fut votée à l’unanimité. Alfred Nettement et Pontmartin restèrent rédacteurs en chef... sans appointements[151]. Et jamais ils n’apportèrent plus de zèle, jamais ils ne fournirent plus de copie.
A quelque chose malheur est bon. Ne pouvant, faute de fonds, s’adresser aux romanciers en vogue, aux feuilletonistes célèbres, les directeurs de l’Opinion publique ouvriront leurs colonnes aux talents nouveaux, à ceux qui n’ont pas encore un nom, mais qui sont capables de s’en faire un. Les Jeunes seront toujours sûrs de trouver près d’eux bon accueil. Un jour, c’est un jeune homme de dix-neuf ans qui apporte rue Taitbout une nouvelle intitulée la Vraie Icarie et signée Pierre du Terrail. Elle est insérée sans retard[152] et il se trouve que, ce jour-là, Pontmartin a présenté au public l’auteur des Exploits de Rocambole et de tant d’autres romans-feuilletons[153]. Un autre jour,[138] c’est Moland[154], destiné à devenir un de nos principaux médiévistes, qui fait recevoir une suite d’articles sur la Condition des savants et des artistes au XIIIe siècle. Comme Ponson du Terrail, Henri de Pène[155] n’avait que dix-neuf ans, lorsque, au mois d’octobre 1849, il se présenta aux bureaux du journal, où il est admis aussitôt comme reporter. On lui confiera bientôt les petits théâtres, puis l’intérim des grands, quand Alphonse de Calonne se trouvera, d’aventure, empêché. Il publiera d’aimables proverbes, Il n’y a pas de fumée sans feu et de feu sans fumée, ou encore Jeunesse ne sait plus. Au besoin, il faisait l’article politique, et le premier-Paris ne l’effrayait pas. Le premier de chaque mois, il rédigeait les Tablettes du mois qui venait de finir, et jamais on ne mit tant d’esprit dans un almanach:
Dans le calendrier lisez-vous quelquefois?
Barbey d’Aurevilly avait quarante ans sonnés en 1849, mais il pouvait passer pour un jeune, puisqu’il était encore à peu près inconnu. Il fit paraître dans l’Opinion publique ses articles sur les[139] Prophètes du passé, sur Joseph de Maistre et M. de Bonald[156], et un peu plus tard une étude sur Marie Stuart[157].
III
Pontmartin, au besoin, aurait pu se passer d’aides; il eût pu se dispenser de chercher des collaborateurs. Il a donné à l’Opinion publique, pendant cette campagne de quatre ans, plusieurs centaines d’articles. Je ne crois pas qu’il y ait un autre exemple, dans la presse littéraire, d’une pareille fécondité. Ces articles (sauf trois sur les Chansons de Béranger), il n’a pas voulu les conserver et les réunir, sans doute parce qu’ils étaient trop; peut-être aussi a-t-il trouvé que la politique y tenait trop de place. J’estime qu’il a eu tort.
Il y a politique et politique, comme il y a fagots et fagots. Celle de Pontmartin était bonne et n’a rien perdu à vieillir. Avec lui, d’ailleurs, tant il avait d’esprit, de bon sens et de belle humeur, la politique même est encore de la littérature, et de la meilleure.
Les articles qu’il a écrits de 1848 à 1852 se peuvent diviser en quatre séries bien distinctes, les Chroniques de Paris, les Causeries musicales, les Causeries dramatiques et artistiques, et les Causeries littéraires.
«Pour raconter heureusement sur les petits[140] sujets, il faut trop de fécondité, c’est créer que de railler ainsi et faire quelque chose de rien.» Cette parole de La Bruyère pourrait servir d’épigraphe aux Courriers de Paris d’Armand de Pontmartin. C’est avec des riens qu’il trouve moyen de composer ses plus jolies chroniques. Il prend, par exemple, l’Almanach national de MM. Guyot et Scribe, et avec cet almanach il fait un article qui renferme les traits les plus piquants et, à côté des anecdotes les plus drôles, les leçons les plus sages[158]. Un autre jour,—c’était le 1er janvier 1850,—assisté de son collègue et ami maître Calixte Ermel, il publie, après l’avoir préalablement ré-rédigé lui-même, le Testament d’une défunte, feu l’année 1849. Jamais, depuis le Légataire universel de Regnard, on n’avait eu tant d’esprit par-devant notaire. Et la Lettre d’un représentant de province à un de ses amis, et les Bulletins de la République... des lettres! Comme tout cela est vif, léger, aimable, et comme, à la lecture de ces pages écrites de verve, le mot de Mme de Sévigné vous revient vite à la mémoire: «Mes pensées, mon encre, ma plume, tout vole!»
Les temps étaient durs, les craintes étaient grandes, la tristesse était générale. Seul, un homme avait réussi à dérider les fronts, à ramener le sourire sur les lèvres. Chaque matin, chaque soir, le crayon de Cham[159] se chargeait de consoler les honnêtes[141] gens, de les rassurer, de les réjouir, en saisissant au vol le côté comique de ces épisodes et de ces personnages, éphémères créations de la nouvelle République. Les légendes étaient encore plus spirituelles que les dessins. Un matin, c’était un bourgeois du Marais marchandant un poisson et s’écriant: «J’aimerais autant qu’il ne fût pas de la veille.» Le soir, c’était un pur, un humanitaire qui, pour sauver le genre humain, demandait trois cent mille têtes, et à qui l’imperturbable Cham répliquait: «Monsieur est coiffeur?»
Ce que le crayon de Cham fut alors pour tous les Parisiens, la plume de Pontmartin le fut, au même moment, pour les lecteurs de l’Opinion publique. L’écrivain et le dessinateur étaient doués l’un et l’autre d’une incroyable facilité d’improvisation; ils rivalisaient aussi à qui serait le plus réactionnaire des deux. Un joyeux compagnon, Auguste Lireux[160], avait tracé, au sortir des séances de l’Assemblée constituante, de très piquants croquis des premiers élus du suffrage universel. Cham joignit à son texte des charges d’une étonnante bouffonnerie,[142] et de leur collaboration sortit un grand et beau volume, qui était tout bonnement un chef-d’œuvre, l’Assemblée nationale comique. Pourquoi la fantaisie n’est-elle pas venue au comte de Noé d’illustrer les Chroniques de Paris du comte de Pontmartin, avec lequel il était lié? Nous aurions eu un livre aussi amusant que l’Assemblée nationale comique et qui aurait pu prendre pour épigraphe: Les bons comtes font les bons amis.
Pontmartin, dans les Souvenirs d’un vieux mélomane, publiés en 1878, a fait revivre pour nous l’âge héroïque de la musique dramatique, ces temps qui semblent aujourd’hui perdus dans la brume des fictions mythologiques, où Nourrit, Duprez, Levasseur, Mlle Falcon et Mme Damoreau chantaient à l’Opéra, où Mme Malibran et Mlle Sontag, Rubini, Lablache et Tamburini chantaient aux Italiens: Tempi passati!... En 1849 et en 1850, la salle Ventadour et la vieille salle de la rue Lepeletier comptaient encore d’admirables chanteurs. Pontmartin se réserva, dans l’Opinion publique, le département de la musique, et il écrivit dans son journal, sous le titre de Causeries musicales, des pages où, après plus d’un demi-siècle, on croit entendre comme un écho lointain de ces merveilleux opéras bouffes qu’interprétaient alors Lablache, Mario et Ronconi, Mme Persiani et Mlle Sophie Véra. Le Théâtre-Italien était son théâtre préféré. Malheureusement, l’heure n’était plus à ces jouissances délicates, à ces réunions mélodieuses. Les spectateurs se faisaient de plus en plus rares, et souvent en sortant d’une représentation[143] où La Cenerentola, Don Pasquale, Il Matrimonio segreto avaient été joués dans le désert, il se demandait si son cher théâtre n’allait pas, d’ici à peu de temps, fermer ses portes pour ne plus les rouvrir, si les électeurs d’Eugène Sue et du citoyen de Flotte ne diraient pas bientôt aux dilettantes, comme la fourmi de La Fontaine:
Vous chantiez, j’en suis fort aise;
Eh bien, dansez maintenant!
Ses causeries sur le Théâtre-Italien, sur La Gazza ladra ou l’Elisire d’Amore, ont la tristesse d’une chose qui va finir et le charme mélancolique d’un adieu.
Le critique théâtral de l’Opinion publique était Alphonse de Calonne. S’agissait-il cependant d’une grande première, de la comédie ou du drame d’un poète, c’était Pontmartin qui en rendait compte. De là, plusieurs Causeries dramatiques, sur la Gabrielle d’Émile Augier[161], le Toussaint Louverture, de Lamartine[162], la Fille d’Eschyle, de Joseph Autran[163], le Martyre de Vivia, de Jean Reboul[164].
Pontmartin avait fait deux Salons à la Mode, celui de 1847 et celui de 1848. Dans l’Opinion publique, il donne, à l’occasion, des Causeries artistiques où il apprécie tantôt les Peintures du grand escalier du[144] Conseil d’État (Palais d’Orsay) par M. Chasseriau[165], tantôt les Peintures monumentales de M. Hippolyte Flandrin à l’église Saint-Paul de Nimes[166], ou encore la Nouvelle fontaine de Nimes et les statues monumentales de Pradier[167].
C’est le 1er octobre 1849 que Sainte-Beuve entreprit sa campagne des Lundis au Constitutionnel. Le 11 février précédent, Pontmartin avait inauguré ses Causeries littéraires à l’Opinion publique. Les principales sont consacrées à l’Esclave Vindex et aux Libres Penseurs de Louis Veuillot, aux Confidences et au Raphaël de Lamartine, à l’Histoire du Consulat et de l’Empire de M. Thiers, au Journal de la Campagne de Russie en 1812, par le duc de Fezensac, aux romans de Jules Sandeau et à ceux de Charles de Bernard. Les Causeries de 1851, écrites pour la plupart à Avignon et aux Angles, parurent sous le titre de Lettres d’un Sédentaire. Elles sont au nombre de seize et marquent un réel progrès dans le talent de l’auteur. Il a plus de loisirs qu’à Paris, et il en profite; il ne craint pas d’entrer, quand il le faut, dans de longs développements. Il a deux grands articles sur les Causeries du Lundi[168], et ce n’est point à ceux-là sans doute que pensait Sainte-Beuve quand il a reproché à Pontmartin de «ne pas se donner le temps d’approfondir». Il en a trois sur Béranger[169], qui soulèveront[145] des orages lorsqu’ils seront réimprimés en 1855. Il en a cinq sur les Mémoires d’Outre-Tombe[170], qui paraissaient alors pour la première fois en librairie. Les glorieux Mémoires eurent contre eux, au moment de leur publication, la critique presque tout entière. Vivant, Chateaubriand avait pour lui tous les critiques, petits et grands. A deux ou trois exceptions près, ils se prononcèrent tous, grands et petits, contre l’empereur tombé.
Sainte-Beuve attacha le grelot. Le 18 mai 1850, alors que les Mémoires n’avaient pas encore fini de paraître dans le feuilleton de la Presse[171], il publia dans le Constitutionnel un premier article suivi, le 27 mai et le 30 septembre, de deux autres, tout remplis, comme le premier, de dextérité, de finesse et, à côté de malices piquantes, de sous-entendus perfides[172].
Pontmartin ne céda pas à ce subit reflux de gloire, à cette réaction injuste et violente contre le grand écrivain. Il lui parut que le Testament littéraire et politique de Chateaubriand ne devait pas être cassé. Dans ses cinq articles, il établit avec force le mal fondé des moyens de nullité invoqués par les adversaires, et il n’hésita pas à dire que «les Mémoires d’Outre-Tombe étaient un des plus étonnants chefs-d’œuvre de notre littérature, ou plutôt de toutes les littératures».
Ce sera l’honneur de Pontmartin d’avoir mis ainsi à leur vrai rang les immortels Mémoires, d’en avoir parlé dès le premier jour comme en parlera la postérité, d’avoir eu raison, ce jour-là, contre Sainte-Beuve et contre tous les critiques de son temps.
J’avoue—cela tient peut-être à ce qu’elles sont enfouies au fond d’un journal depuis longtemps disparu et joignent ainsi à leur valeur propre l’attrait des choses rares—j’avoue que j’ai un faible pour ces premières Causeries littéraires. Ce qui me paraît certain, en tous cas, c’est qu’elles sont au moins égales à celles que l’auteur a réunies plus tard en volumes à partir de 1854.
Outre ces articles de critique, il donnait encore à l’Opinion publique des œuvres d’imagination, une Nouvelle: l’Enseignement mutuel[173], un Proverbe: Les Premiers fusionistes, ou A quelque chose malheur est bon[174]. Entre temps, il écrivait pour la Mode le deuxième et le troisième volume des Mémoires d’un notaire et le Capitaine Garbas[175]. A la Revue des Deux Mondes, il continuait de faire, d’une façon régulière, la chronique littéraire et théâtrale. Comme il n’était pas chez lui dans la maison de la rue Saint-Benoît, il faisait un peu plus de toilette qu’à la rue Taitbout; il mettait sa cravate blanche et passait son habit noir. Faut-il pour cela préférer[147] ses articles de la Revue des Deux Mondes à ceux de l’Opinion publique? Tel ne serait pas mon avis. A la Revue, Pontmartin était spirituel, élégant, correct; à M. Buloz, qui le payait, il en donnait pour son argent. A l’Opinion publique, il se dépensait tout entier; tout ce qu’il y avait en lui d’ardeur, de flamme, de passion, il le donnait à ce journal qui ne le payait pas.
IV
J’ai dû, pour ne pas interrompre le récit de la campagne de Pontmartin à l’Opinion publique, laisser un moment de côté les quelques épisodes qui marquèrent pour lui, en dehors de cette campagne, les quatre années de la seconde République, du 24 février 1848 au 2 décembre 1851.
En se mettant dans ses meubles, rue d’Isly, à la fin de décembre 1847, il était devenu tributaire de la garde nationale. Immatriculé dans la sixième du second de la première,—6e compagnie du 2e bataillon de la 1re légion,—il ne fit d’abord qu’en rire, croyant bien que ce serait là une simple sinécure. Il était loin de compte. Le 16 avril 1848, une manifestation populaire menaça l’Hôtel de Ville; le péril ne fut conjuré que par l’énergique intervention du général Changarnier, qui se trouvait alors à Paris sans commandement et sans troupes. Ce fut ce jour-là que Pontmartin débuta dans le noble métier des armes, avec une tunique,[148] extraite du magasin de la mairie, dont la taille trop courte lui remontait au milieu du dos.
Le 15 mai, un peu avant midi, on battit le rappel. La sixième du second se réunit à son rendez-vous habituel, au bout de la rue Tronchet, du côté de la rue Neuve-des-Mathurins. De la rue Tronchet au Palais-Bourbon, le trajet n’est pas long. De quinze pas en quinze pas, les gardes nationaux rencontraient des jeunes gens en blouse ou en bourgeron, très polis, très corrects, qui leur disaient: «Retournez chez vous, Messieurs, vous n’avez plus rien à faire. Le peuple a pris possession du Palais-Bourbon. Il est en train d’élire le nouveau gouvernement.» En l’absence de son capitaine, la sixième était commandée par son lieutenant, M. Paul Rattier, un très galant homme et très brave, qui ne se laissait pas retourner aussi facilement que le caoutchouc auquel il devait sa belle fortune. Il poursuivit sa route. Quand on eut atteint la grille du palais, Pontmartin, qui se trouvait à côté du lieutenant, chercha dans la foule une figure de connaissance, et il vit M. de Falloux monté sur une borne au coin de la rue de Bourgogne, et haranguant courageusement cette aveugle multitude qui aurait pu l’écharper et qui l’écoutait avec une certaine déférence. Cinq minutes après, la garde nationale avait pris sa revanche et expulsé les émeutiers.
Après l’émeute du 15 mai, l’insurrection de juin.
Le jeudi 22 juin, le Théâtre-Français donna la[149] première représentation d’Il ne faut jurer de rien, d’Alfred de Musset. Pontmartin y assistait. La pièce fut jouée en perfection par Provost, Brindeau, Got, Mirecourt, mesdames Mante et Amédine Luther. Les spectateurs étaient trop distraits pour écouter ce dialogue exquis, pour apprécier cette merveilleuse interprétation. La guerre civile était dans l’air, et le très spirituel Louis de Geofroy qui, en attendant d’être un diplomate d’une rare distinction, écrivait dans la Revue des Deux Mondes, dit à Pontmartin et à ses amis, en entrant dans leur loge: «Pardon! On peut jurer de quelque chose; c’est que, demain matin, on se battra dans la rue.»
Le lendemain matin, en effet, Paris commençait à se couvrir de barricades. Le rappel, battu à neuf heures pour la garde nationale, fut à onze heures suivi de la générale. Pontmartin s’empressa de se rendre à son poste. Dans cette première journée, la première légion subit des pertes sensibles à l’attaque d’une barricade élevée faubourg Poissonnière, à la hauteur de la caserne de la Nouvelle-France. Le soir, la sixième compagnie dut prendre quelques heures de repos dans la cour de la mairie du premier arrondissement. Le long de cette cour vaste et mélancolique, de grandes bottes de paille, étendues sur le pavé, s’étaient transformées en lit de camp où reposaient des rangs pressés de dormeurs; quand la couche de paille était assez épaisse, le lit avait deux étages, et chacun de ces deux étages un habitant. Sans distinction[150] de grade et d’épaulettes, le caporal ronflait sous le voltigeur, et le sergent sous le caporal. Pontmartin, et avec lui une vingtaine de gardes nationaux, écrivains, artistes, hommes du monde, veillaient, groupés autour d’un gigantesque bol de punch et devisant des événements. Il a décrit, dans le Capitaine Garbas, cette nuit du 23 juin 1848, qui précéda la plus sanglante des quatre sanglantes journées.
Ce n’était pas, dit-il, une de ces belles nuits d’été, où Dieu fait ruisseler sur l’azur du ciel des myriades d’étoiles, comme les seuls diamants dignes de sa puissance infinie; une de ces nuits limpides, douces harmonies de la vie des champs, poétiques compagnes de voyage, faites de vagues murmures, de vagues silences, de vagues parfums, des mille frémissements de la nature endormie: c’était une nuit sombre et troublée, où nos passions se faisaient sentir jusque dans le calme universel. Le ciel, pluvieux et froid malgré la saison, n’avait aucune des splendeurs de l’été; quelques rares étoiles, frissonnantes et mouillées, paraissaient et disparaissaient sous les nuages, comme nos débiles espérances sous le voile funèbre des calamités publiques. De temps à autre, un coup de fusil retentissait, isolé, perdu dans l’espace; puis à intervalles réguliers, on entendait le cri des factionnaires: Sentinelles, prenez garde à vous! s’élever, se répondre, se croiser, s’éloigner, s’affaiblir et se perdre dans les rues désertes. Ce qui rend les autres nuits si belles, c’est que l’homme s’y cache et s’y tait; ce qui rendait celle-là si sombre, c’est que l’homme y apparaissait partout, à l’imagination et à l’oreille, au regard et à la pensée.
La trève fut de courte durée; dès quatre heures du matin, le samedi 24, la lutte recommença.
A l’extrémité nord de la rue du Faubourg-Poissonnière,[151] près du jardin Pauwels[176], les insurgés avaient construit une barricade, précédée d’un fossé palissadé, et dont les assises de pavés s’accumulaient en montagne contre la grille de la barrière. Ils occupaient les bâtiments de l’octroi et quelques maisons voisines: plus loin leurs tirailleurs s’abritaient derrière les pierres du clos Saint-Lazare, où commençait à s’élever l’hôpital de la République, ci-devant Louis-Philippe, depuis de La Riboisière. Cette position était défendue de tous côtés par des barricades, rue Bellefond, rue des Petits-Hôtels, rue d’Hauteville, et se reliait avec la barrière Rochechouart et les barricades du faubourg Saint-Denis. C’était une véritable forteresse, contre laquelle vinrent se briser, jusqu’à trois heures de l’après-midi, tous les efforts du 2e bataillon de la 1re légion. A ce moment, il fut rallié par le général Lebreton, accompagné d’un parc d’artillerie. Au signal de trois coups de canon le bataillon s’élance. Une lutte furieuse s’engage. La 6e compagnie, toujours commandée par l’intrépide lieutenant Paul Rattier[177], voit décimer ses rangs. Aux côtés de Pontmartin le brave caporal Émile Charre, un caporal plusieurs fois millionnaire, tombe pour ne plus se relever. La barricade enfin est emportée. Restait le clos Saint-Lazare. Il fallut en faire le siège, qui absorba presque toute [152]la journée du dimanche 25, et auquel le 2e bataillon de la 1re légion, placé ce jour-là sous les ordres de Lamoricière, prit encore une part importante.
A la fin de juillet, Pontmartin partit pour les Angles, afin d’y prendre quelques vacances; mais la politique, qu’il avait peut-être cru fuir en quittant Paris, l’attendait en province. Depuis 1844, il représentait le canton de Villeneuve au Conseil général du Gard. Ses amis lui firent un devoir d’accepter la candidature, lors du renouvellement qui eut lieu au mois d’août. Il fut nommé, après une lutte très vive; mais son élection fut annulée pour erreur commise dans le compte des voix. Deux mois après, il lui fallait batailler de nouveau; cette fois du moins le succès fut complet.
V
«La France est une nation qui s’ennuie[178]», avait dit un jour Lamartine sous la monarchie de[153] Juillet. Elle n’avait plus maintenant le temps de s’ennuyer. C’était chaque matin une surprise nouvelle. Le 10 décembre, le prince Louis Bonaparte était élu à la Présidence: le 20 décembre, un légitimiste pur, l’alter ego de Berryer, M. de Falloux était nommé ministre de l’Instruction publique, et bientôt sa table et ses salons réunissaient la fine fleur de la réaction. Le 17 janvier 1849, il donna un grand dîner au prince-président. L’Opinion publique nous a conservé la liste des convives. La voici: le prince Louis Bonaparte, l’archevêque de Paris[179], le curé des Quinze-Vingts, qui avait recueilli Mgr Affre au 25 juin, MM. Thiers, Molé, Berryer, Victor Hugo, duc de Noailles, maréchal Bugeaud, Villemain, Cousin, Viennet, Saint-Marc Girardin, marquis de La Rochejaquelein, marquis de Maillé, Changarnier, marquis de Pastoret, général Baraguey d’Hilliers, marquis de Barthélemy, duc de Rauzan, duc de Mouchy[180]:
D’anti-républicains c’était un fort bon plat,
Grande fut la colère sur les bancs de la gauche. Armand Marrast surtout, le marquis de la République, ne pouvait digérer ce dîner où il y avait eu tant de marquis.—«Il n’y avait pas un républicain!» s’écria-t-il,—«Quoi! répliquait le journal de Pontmartin, pas même le Président de la République[181]!»
Si Pontmartin n’était pas des dîners de M. de Falloux, il lui arrivait fréquemment d’assister aux réceptions qui avaient lieu à l’hôtel de la rue de Grenelle. «J’y vis affluer, dit-il dans ses Souvenirs d’un vieux critique, tous ceux que le péril commun unissait dans une même pensée de salut—ou de sauvetage. Le général de Saint-Priest y amenait le comte d’Escuns; M. de Circourt y causait avec M. d’Andigné, les académiciens avec les douairières, Poujoulat, Nettement, Laurentie, Adolphe Sala, Lourdoueix, tous les députés royalistes, toute la rédaction de l’Union, de la Gazette de France et de l’Opinion publique, s’y rencontraient avec MM. Cousin, Mignet, Saint-Marc Girardin, Vitet, Patin, Marmier, et les universitaires. Si les titres n’avaient pas été abolis par la plus naïve des républiques, on aurait pu tapisser de parchemins authentiques toute la rue de Grenelle et tous les salons du ministère. Je me souviens même d’un petit détail assez curieux. Comme cette abolition des titres n’était pas prise au sérieux, le citoyen ministre avait recommandé aux citoyens huissiers d’annoncer chaque visiteur avec la qualification qu’il se donnerait; si bien que, un soir, les huissiers annoncèrent madame la baronne Durand et M. de Montmorency[182].»
Des liens d’amitié et de famille rattachaient à M. de Falloux le rédacteur de l’Opinion publique. Ce dernier eut l’idée d’utiliser ces bonnes relations[155] au profit de Jules Sandeau. En 1849, Jules Sandeau était pauvre. Il avait publié déjà le meilleur de son œuvre, Marianna, le Docteur Herbeau, Catherine, Madeleine, Mademoiselle de la Seiglière; mais, en ce temps-là, un roman rapportait mille francs à son auteur, et il lui fallait deux ans pour atteindre une seconde édition. Pontmartin demanda pour l’auteur de Marianna un emploi de bibliothécaire. Sa requête reçut un favorable accueil, et le ministre le pria de lui amener son ami. L’audience fut la plus satisfaisante du monde. M. de Falloux et Jules Sandeau étaient, dans un milieu bien différent, deux natures également fines et délicates; ils s’entendirent à merveille. En adressant au romancier de chaleureux compliments au sujet du Docteur Herbeau et de Catherine, les félicitations du ministre tombèrent si juste, qu’elles prouvèrent qu’il l’avait lu et ne l’avait pas oublié. Pontmartin avait donc lieu d’espérer une heureuse solution; mais le guignon s’en mêla; M. de Falloux tomba malade quelques jours après; lui-même partit pour le Midi, et, quand il revint, le ministre avait donné sa démission[183].
VI
Si chacune des œuvres de Jules Sandeau lui rapportait en moyenne un millier de francs, Pontmartin,[156] au mois d’avril 1849, publia un roman en trois volumes, qui, au lieu de lui être payé 3 000 francs, lui coûta précisément cette somme.
Le premier volume des Mémoires d’un notaire avait paru dans la Mode d’octobre à décembre 1847. Dès le mois de novembre, un des collaborateurs de la revue royaliste, très brillant officier et romancier de talent, M. de Gondrecourt[184], avait offert à Pontmartin de le présenter à son éditeur Alexandre Cadot[185], qui était le libraire en vogue, au moins pour les romans, lesquels paraissaient alors en volumes in-octavo, dits de cabinet de lecture. «Il paye peu, mais exactement», avait ajouté Gondrecourt. Pontmartin avait été obligé de décliner son aimable proposition. La veille, chez Véry, le vicomte Édouard Walsh lui avait dit, après force félicitations: «Il ne tient qu’à vous, mon cher ami, de faire une bonne œuvre et deux heureux: l’imprimeur et le metteur en pages de la Mode, tous deux chargés de famille, seraient bien reconnaissants si vous leur[157] accordiez la propriété de votre roman. Ils l’imprimeraient en volumes au fur et à mesure, ils n’auraient pas d’autres frais que leur travail, et ils toucheraient les bénéfices.» Pontmartin avait répondu oui, et c’est ce oui qui devait lui coûter mille écus.
Ravis de leur bonne fortune, le metteur en pages et l’imprimeur s’étaient hâtés de composer le premier volume; ils y avaient même ajouté, à l’insu de l’auteur, Napoléon Potard. Quand éclata la révolution de Février, qui fut meurtrière pour la Mode, pris de peur, ils vinrent dire à Pontmartin d’un air navré qu’ils n’avaient pas de quoi acheter le papier et payer les frais nécessaires et ils le supplièrent de se mettre en leurs lieu et place en se chargeant de tous les frais et en recueillant tous les bénéfices.—Soit, dit encore Pontmartin. Il s’était remis à son roman, et il en écrivit les deux derniers volumes à travers l’affolement des rappels, des émeutes, des rassemblements continuels, des nuits de corps de garde, et aussi au milieu des tracas et des soins de toute sorte que lui causaient la fondation et la rédaction en chef de l’Opinion publique. Ses deux persécuteurs imprimaient toujours, faisant les morceaux doubles et s’inquiétant très peu d’augmenter les frais, dès l’instant qu’ils n’étaient plus à leur charge. Le jour où ils lui présentèrent l’addition, le chiffre rond était de 3 000 francs[186].
Après s’être exécuté sans trop se plaindre, il fit, à ses risques et périls, paraître ses trois volumes.[158] qui arrivaient du reste en un mauvais moment, à la veille des élections de l’Assemblée législative[187], alors que la presse, les électeurs—et les lecteurs étaient tout entiers à ces élections. Dans les Épisodes littéraires, où il fait vraiment trop bon marché de lui-même, de son journal et de ses livres, il lui plaît de dire que son roman ne vaut pas le diable. Il est bien vrai que, conçu à une époque où Eugène Sue et Alexandre Dumas avaient mis à la mode les romans-feuilletons en huit et dix volumes, son livre repose sur une donnée étrange, invraisemblable, impossible. Les Mémoires de l’honnête Calixte Ermel, le notaire de la rue Banasterie, ne sont rien moins que le récit d’une vengeance avignonnaise, auprès de laquelle pâlissent toutes les vendettes de la Corse et qui se transmet, pendant quatre-vingt-dix ans, de génération en génération; vengeance surhumaine, armant les bras de meurtriers qui ne sont pas nés encore, contre des victimes que l’avenir verra naître. Encore une fois, cette donnée ne se peut admettre; cette vengeance, datée du 10 octobre 1756, qui ne doit finir que le 10 octobre 1846, nous nous refusons à y croire. Mais sur cette trame grossière, l’auteur a dessiné d’élégantes broderies; sur ce sauvageon il a greffé de gracieux épisodes. Deux surtout sont particulièrement remarquables, celui qui sert d’exposition à l’ouvrage, et celui qui a pour titre la Chasse aux Chimères. Dans le premier, l’auteur a tracé les[159] portraits de trois jeunes filles, Antoinette Margerin, Julie Thibaut et Clotilde de Perne,—la future vicomtesse de Varni, celle dont le testament donnera ouverture aux drames qui vont suivre. Sœurs d’amitié, types de trois classes: la bourgeoisie, le peuple, la noblesse, elles sont belles de beautés différentes, nobles également, mais différemment nobles d’esprit comme de cœur: trois délicieuses têtes baignées d’air et de lumière et encadrées dans un paysage plein de couleur et d’éclat. La Chasse aux Chimères est un joli tableau de chevalet, l’histoire du mariage de Delphine de Malaucène avec Raymon de Varni, la raison, la sagesse et la prose épousées devant notaire par l’imagination, le rêve et la poésie. Ces intermèdes, si réussis soient-ils, ne laissent pas du reste de désorienter un peu le lecteur, le spectateur, si vous l’aimez mieux. On lui parle de le mener à l’Ambigu, on lui promet un bon gros mélodrame, et chaque acte lui offre des scènes d’un sentiment très fin et très délicat. Il croyait aller au boulevard, et il se trouve qu’il est à la Comédie-Française. La désillusion après tout n’avait rien de pénible. Le public ne devait pas tarder à goûter ce livre où tant de qualités demandent grâce pour les défauts. Les Mémoires d’un notaire ont eu de nombreuses éditions.
VII
Ils avaient paru, je l’ai dit, en pleine bataille électorale, à la veille des élections de mai 1849. A[160] peine étaient-ils à la vitrine des libraires, que Pontmartin était obligé d’aller en Avignon, non pour y poser sa candidature, mais pour y soutenir celle... de M. Buloz.
M. Buloz, en apparence un des vaincus de Février, avait été en réalité un des vainqueurs. C’est de 1848, en effet, que date vraiment la fortune de sa Revue. Il comprit tout de suite qu’une réaction allait se produire, qu’elle grandirait de jour en jour et qu’elle compterait bientôt dans ses rangs tous les honnêtes gens et les gens d’esprit. Il fit résolument campagne contre les idées et contre les hommes du gouvernement nouveau. Sa haine contre la République égalait celle de Pontmartin lui-même, qu’il prit alors en particulière affection. Il confia la rédaction de sa chronique politique à un monarchiste, M. Saint-Marc Girardin. En attendant d’ouvrir la Revue des Deux Mondes à Louis Veuillot[188] et à M. de Falloux[189], il recommandait à ses lecteurs les Lettres de Beauséant, du baron de Syon, que ses liens de parenté avec les Lafayette n’empêchaient pas de préférer aux idées du héros des deux mondes les doctrines du comte Joseph de Maistre.
Devenu décidément homme politique, M. Buloz[161] voulut être député. Comme sa femme était de Cavaillon, il lui parut que sa candidature irait toute seule dans le Comtat, surtout si elle était patronnée par Pontmartin. Celui-ci ne pouvait lui refuser son concours, et il fut convenu qu’ils partiraient ensemble pour Avignon dans la seconde quinzaine d’avril.
Lorsqu’ils arrivèrent, deux listes étaient déjà en présence: la liste blanche, avec MM. d’Olivier, Bourbousson, Granier, de Bernardi et Léo de Laborde;—la liste rouge, avec les citoyens Alphonse Gent, Elzéar Pin, Eugène Raspail, Dupuy (d’Orange) et Dupuy (de Cavaillon). Une troisième liste fut formée, qui comprenait, avec deux des noms de la première, ceux de MM. Granier et Bourbousson, légèrement teintés de bleu, les noms de deux jeunes gens, Léopold de Gaillard[190] et Gaston de Raousset-Boulbon[191], qui venaient[162] de faire une magnifique campagne dans la Commune d’Avignon, journal royaliste et décentralisateur, M. Buloz fut admis à prendre place sur cette troisième liste, dite libérale.
Quelques jours avant le vote, Léopold de Gaillard, qui avait obtenu 28 000 voix aux élections d’avril 1848[192], et dont la popularité faisait toute la force de la liste libérale, retira sa candidature. Celle de M. Buloz n’avait plus dès lors aucune chance.
Le 13 mai, les candidats de la liste blanche eurent de trente-deux à vingt-sept mille voix, ceux de la liste rouge en eurent de vingt-six à vingt-cinq mille. M. Buloz recueillit 2 736 voix,—les plus littéraires sans nul doute; mais cela n’était pas pour le consoler.
Dans les Jeudis de madame Charbonneau, ou plutôt dans la Semaine des Familles, car ce chapitre n’a point été recueilli dans le volume, Pontmartin a raconté avec humour l’odyssée électorale du directeur de la Revue des Deux Mondes. Il termine ainsi son récit:
Ce triste résultat étant facile à prévoir, dès la veille du scrutin, je voulus en épargner à Strabiros[193] le déboire immédiat, et je l’emmenai chez moi, à la campagne, dans un[163] département limitrophe[194]. Mon hospitalité fut très simple, telle que la comportait la modicité de ma fortune, mais elle fut cordiale. On était en plein mois de mai, et le printemps eut, cette année-là, des magnificences charmantes. Partout des fleurs, des eaux vives, des oiseaux sous la feuillée, une verdure exubérante, de frais ombrages, de tièdes rayons, de splendides étoiles. En outre, pour adoucir les ennuis de Strabiros, j’avais invité les convives qui, par leurs goûts, leurs habitudes, leurs conversations, pouvaient lui être le plus agréables. Il se déclara content de mon accueil et émerveillé de ma maison de campagne; il admira surtout douze gros marronniers en fleurs, symétriquement rangés devant ma façade. Ces marronniers, comme ceux des Tuileries, ne produisent que des marrons d’Inde, que l’on n’avait pas encore songé à utiliser pour faire de l’amidon. N’importe! je vis que l’imagination de Strabiros en recevait une impression profonde, et plus tard, lorsque, au retour de son expédition aventureuse, il rentra dans sa spécialité et dans ses bureaux, cette impression se formula dans les paroles suivantes qui résumèrent toute sa reconnaissance et tous ses souvenirs:
«Comment, lorsqu’on a de si beaux marronniers, peut-on faire payer ses articles[195]»
Si M. Buloz n’avait pu devenir député, Pontmartin restait toujours conseiller général. Il eut, à ce titre, en 1851, à émettre un vote sur une question de laquelle dépendaient les destinées de la France.
Dès le mois d’août 1850, cinquante-deux conseils généraux avaient émis un vœu en faveur de la révision de la Constitution. En 1851, le mouvement[164] revisionniste s’accentua encore. L’échéance de mai 1852, à mesure qu’elle se rapprochait, rendait ce mouvement plus vif et plus général. C’était en effet à cette date que la Constitution de 1848 avait fixé l’élection d’un nouveau Président et la nomination d’une nouvelle Assemblée. Au commencement de juillet, les pétitions en faveur de la revision comptaient plus de treize cent mille signatures. Leur discussion s’imposait. Les membres de la Législative l’abordèrent le lundi 14 juillet. Le débat occupa la semaine entière. Le samedi 19, on vota à la tribune au scrutin public, et par appel nominal. Sur 724 votants, il y eut pour la revision 446 suffrages, 278 contre. La proposition avait donc obtenu une majorité de 168 voix; elle n’en était pas moins rejetée, la Constitution exigeant, pour l’adoption, les trois quarts des suffrages exprimés.
Cette majorité des trois quarts, elle existait dans le pays. On le vit bien quelques semaines plus tard, lors de la réunion des conseils généraux, 81 de ces conseils sur 89 se prononcèrent pour la revision.
Au conseil général du Gard, le 8 septembre, M. de Larcy proposa à ses collègues d’émettre un vœu en faveur du retour à la monarchie traditionnelle, héréditaire et représentative. Pontmartin et la majorité du conseil se prononcèrent dans ce sens. «Je me souviens, écrira-t-il trente ans plus tard, de cette séance et de ce vote. Nous fûmes[165] 27 contre 9[196]. M. de Larcy[197] déploya, dans cette discussion très courtoise où ses antagonistes n’alléguaient que l’inconvénient d’introduire la politique dans nos paisibles délibérations d’intérêt local, une éloquence tour à tour entraînante et attendrie, une émotion communicative, que l’on peut aujourd’hui appeler prophétique. Ah! quel cœur vraiment français ne saignerait en songeant à cette effroyable série de catastrophes, d’humiliations, de malheurs et de crimes que la France eût évitée, si ce vœu, exprimé dans une de ses assemblées départementales, fût devenu l’expression de la volonté nationale, parlant assez haut pour rendre également impossibles les violences d’un coup d’Etat et les criminelles entreprises de la République démagogique[198].»
Au mois d’octobre, Pontmartin ne partit point pour Paris, comme il était dans l’habitude de le faire depuis quelques années. Il venait pourtant[166] d’y arrêter, au numéro 10 de la rue Laffitte, un nouvel et plus grand appartement, avec l’espoir d’y faire enfin une installation complète en famille. Cette installation complète et définitive n’avait pu encore avoir lieu, madame de Pontmartin ayant été presque toujours retenue à la campagne par la santé de son fils[199]. Quand il était seul à Paris, Pontmartin pendant les années que nous venons de raconter, était obligé de prendre ses repas au restaurant, ce qui, après tout, pour un journaliste et un brillant causeur comme lui, n’était ni sans profit, ni sans agrément. Il déjeunait presque tous les jours, passage de la Madeleine, à la taverne de Richard-Lucas, où l’on mangeait à bon marché d’excellents rosbifs en excellente compagnie. Chaque matin, le rédacteur de l’Opinion publique avait le plaisir de s’y rencontrer avec plusieurs députés de la droite, MM. de Tréveneuc, de Belvèze, de Voisins, de Kerdrel, le général Lebreton, et aussi avec un amiral, l’amiral Coupvent des Bois, et un acteur du Gymnase, Bressant, le délicieux Bressant, alors dans tout l’éclat de sa seconde jeunesse. Ces convives, tout au moins les députés de la droite, il n’allait plus les retrouver, en rentrant à Paris. Il y arriva le 2 décembre 1851, le soir du coup d’État, ce qui lui valut, ainsi qu’à tous ses compagnons de voyage, d’être consigné à la gare jusqu’au lendemain matin. C’est du reste tout le dommage qu’il eut à subir.
Moins heureux, Alfred Nettement avait été arrêté à la mairie du Xe arrondissement et enfermé à Mazas. Par suite de cette incarcération, la direction de l’Opinion publique échut à Pontmartin; mais cette direction, sous le régime de l’état de siège, n’était et ne pouvait être qu’une sinécure. Le 2 décembre, à la première heure, les scellés avaient été mis sur les presses. Ils furent levés seulement le jeudi 11 décembre. Le vendredi 12, le journal reparaissait, mais sans qu’il lui fût possible d’insérer autre chose que des notes et des documents officiels sur les événements qui venaient de s’accomplir; il lui était interdit de les commenter.
Jusqu’au 31 décembre, l’Opinion publique se borna à reproduire les actes du gouvernement et à donner des variétés littéraires. Le 19 novembre, elle avait publié un article de Pontmartin sur les Chansons de Béranger. Le 19 et le 25 décembre, elle fit paraître la suite et la fin de cette étude[200], qui passa naturellement inaperçue au milieu des circonstances que l’on traversait.
Le 1er janvier 1852, le journal de Pontmartin et de Nettement[201] donna des étrennes à ses lecteurs—des[168] étrennes royalistes. En tête même de son numéro, il inséra une lettre du Comte de Chambord, écrite à la date du 1er décembre 1851—la veille du coup d’État—sur les Intérêts catholiques et français en Orient.
Louis Bonaparte se disposait à édicter une nouvelle Constitution, à demander au peuple de reconnaître en lui le légitime héritier d’une dynastie nouvelle. Le 6 janvier, l’Opinion publique publia—et c’était là son premier-Paris—une page de Joseph de Maistre sur les Constitutions faites de main d’homme[202] et, en même temps, une page—non moins belle—du Père Lacordaire sur la grandeur incomparable de la Maison de France[203].
Le numéro du 7 janvier commençait par un article d’Albert de Circourt sur la situation politique... en Autriche. L’article se composait de quelques lignes suivies de deux colonnes de blanc. Un peu plus loin venaient les Tablettes du mois. Ici encore, sous la date du 2 décembre, plusieurs lignes de blanc.
Le jour même, l’Opinion publique était supprimée.
CHAPITRE VIII
LA REVUE CONTEMPORAINE ET L’ASSEMBLÉE NATIONALE.—CONTES ET NOUVELLES.—CAUSERIES LITTÉRAIRES.—LA FIN DU PROCÈS.
(1852-1855)
Le marquis de Belleval ou un émule de M. de Coislin. La Revue contemporaine. Un mot d’Henry Mürger. Alphonse de Calonne.—L’Assemblée nationale. M. Adrien de La Valette et M. Mallac. Le fils de Paul et de Virginie.—Les Contes et Nouvelles. La Marquise d’Aurebonne et le Secret du docteur.—L’histoire d’Aurélie. Georgette ou une sœur d’Aurélie. Les Nouveaux Lundis. Où l’on voit Sainte-Beuve monter sur ses grands chevaux. Où l’on voit encore comment les petits pâtissent toujours des querelles des grands. Feu Edmond Dupré. Ma première rencontre avec Armand de Pontmartin.—Le premier volume des Causeries littéraires. Louis Veuillot et Cuvillier-Fleury.—Le Fond de la Coupe, l’Envers de la Comédie et la Fin du Procès.
I
L’Opinion publique n’existait plus. Restait à Pontmartin la Revue des Deux Mondes; mais y publier un article tous les mois, ou même tous les quinze jours, n’était pas pour lui suffire. Qu’une occasion d’écrire ailleurs se présentât, il ne la laisserait sans doute pas échapper.
Au mois de mars 1851, Alfred Nettement et Pontmartin avaient reçu la visite de M. L.-C. de Belleval[204]. C’était encore un de ces originaux dont l’espèce, j’en ai peur, est pour longtemps perdue. Très érudit, travailleur acharné, le marquis de Belleval s’engageait à fournir autant de copie qu’on le voudrait, à une condition cependant, c’est qu’on ne le paierait point. Et cela, sous le prétexte bizarre qu’il n’avait pas besoin pour vivre qu’on lui payât ses articles—ce qui d’ailleurs était vrai. Il était donc entré au journal et, jusqu’au jour de sa suppression, il y avait donné, trois fois par mois, sous le titre trop modeste de Bulletin bibliographique, de copieux feuilletons où il rendait compte de presque tous les ouvrages qui paraissaient, principalement de ceux qui avaient un caractère historique.
Au lendemain du coup d’État, la première pensée de ce galant homme fut pour les écrivains dont il avait été le collaborateur bénévole. Il se dit que bien des plumes allaient rester oisives, qui, la veille encore, faisaient tant bien que mal vivre leur maître. En même temps, l’union entre les deux grandes fractions du parti monarchique lui apparaissait comme plus nécessaire que jamais. En attendant que la fusion entre les princes devînt un fait accompli, ne convenait-il pas de travailler à un rapprochement entre les orléanistes centre-droit et les légitimistes purs? Et le meilleur moyen d’y[171] arriver ne serait-il pas de créer une publication périodique, hospitalière, indépendante, qui suppléerait aux journaux silencieux ou disparus et qui recueillerait les naufragés du 24 février et les épaves du 2 décembre[205]?
Créer une Revue n’est pas une petite affaire. Réunir des actionnaires en nombre suffisant n’est pas chose commode. Il y faut beaucoup de temps, et M. de Belleval estimait qu’il n’avait pas de temps à perdre. Donc, point d’actionnaires; il s’en passera; il puisera dans sa bourse, sans inviter ses amis politiques à y déposer leur obole; il tentera l’entreprise sans engager d’autre responsabilité que la sienne.
Les fonds ainsi faits, le titre trouvé: Revue contemporaine, restait la question des rédacteurs. Nature exquise et élevée, aussi distingué que modeste, type de gentilhomme et de lettré, le marquis de Belleval était l’homme le plus aimable qu’on pût voir, le plus sympathique, le plus généreux. Il groupa autour de lui, sans trop de peine, de nombreux écrivains, et non des moindres. Voici la liste de ceux qui, dès le premier moment, lui promirent leur concours: Guizot, Vitet, Salvandy, Berryer—qui devait écrire pour la nouvelle Revue ses Souvenirs personnels,—Prosper Mérimée, Viennet, le duc de Noailles, Villemain, soit huit membres de l’Académie française:—Adolphe[172] Adam, de Saulcy, Raoul-Rochette, baron Taylor, de l’institut;—Paul Féval, Léon Gozlan, Paulin Paris, Xavier Marmier, Reboul, Desmousseaux de Givré, comte Beugnot, Émile Augier, Méry, comte de Marcellus, Philarète Chasles, Edmond Texier, le Père Ventura. L’ancienne rédaction de l’Opinion publique n’avait pas, on le pense bien, été oubliée. Le premier soin de M. de Belleval avait été de s’assurer la collaboration d’Alfred Nettement et celle d’Armand de Pontmartin. L’excellent marquis préluda par quelques dîners; puis, il donna une soirée en habit noir, à titre de répétition générale, et comme moyen de se compter. L’état-major de la Revue était au complet; quelques hommes politiques, tels que M. Molé et M. de Falloux, ajoutaient encore à l’éclat de la réunion. M. Villemain s’approcha de Pontmartin, qu’il avait connu vingt ans auparavant, chez le docteur Double, et lui dit avec son sourire vengeur: «Je plains le futur empereur, s’il n’a, pour le servir, que ceux qui ne sont pas ici.»
Le premier numéro de la Revue contemporaine parut le 15 avril 1852. Il contenait deux articles de Pontmartin, un Bulletin bibliographique et, sous ce titre: Symptômes littéraires du temps, une étude critique sur les Mémoires et en particulier sur ceux d’Alexandre Dumas, alors en cours de publication dans la Presse.
Avec tout son esprit, Pontmartin, j’en ai déjà fait la remarque, avait un fond de naïveté. Il s’imaginait pouvoir collaborer à la Revue contemporaine[173] tout en restant un des rédacteurs de la Revue des Deux Mondes. C’était compter sans son hôte, c’est-à-dire sans M. Buloz. Il était pourtant facile de prévoir que l’irascible directeur, jaloux de la gloire de sa Revue, ne vivant que pour elle, ne se résignerait pas à voir un de ses principaux rédacteurs donner des articles à une revue rivale, à un recueil dont la maison n’était pas au numéro 20 de la rue Saint-Benoît. Ce qui devait arriver arriva. M. Buloz mit Pontmartin en demeure d’opter entre lui et M. de Belleval.
La Revue des Deux Mondes était à l’apogée de son succès; comme elle avait mis à profit la révolution de Février, elle avait également bénéficié du coup d’État de décembre. Elle était devenue une puissance; sa renommée était européenne. La Revue contemporaine naissait à peine; elle n’avait pas encore d’abonnés, elle serait peut-être morte dans six mois. Combien de Revues, qui semblaient appelées à réussir, que les bonnes fées, pressées autour de leur berceau, avaient comblées de dons et de mérites, et que la fée Guignon, cachée dans un coin, avait arrêtées dès leurs premiers pas! L’intérêt de Pontmartin était évident: il ne devait pas quitter le certain pour l’incertain, sacrifier à des chances problématiques une position assurée, brillante et déjà ancienne, une collaboration qui, au bout de quelques années, ne pouvait manquer de le conduire tout droit à l’Académie. Son choix fut bientôt fait. M. de Belleval était son ami; la Revue contemporaine était nettement et hautement[174] royaliste. Sans souci de son intérêt propre, il se sépara de M. Buloz[206] et alla chez M. de Belleval.
Sa collaboration fut très active, surtout au début. Il publia, en 1852, outre plusieurs revues littéraires, deux de ses meilleures nouvelles, Aurélie et la Marquise d’Aurebonne, une étude sur Joseph Autran et un très éloquent article sur le Louis XVII de M. de Beauchesne. En 1853, il donna un article sur la Poésie et la Critique en France au commencement de 1853, et, comme pendant à son chapitre sur Joseph Autran, un chapitre sur François Ponsard[207].
Il n’allait pas tarder cependant à quitter la Revue contemporaine. Que s’était-il donc passé?
La Revue du marquis de Belleval avait très vite conquis une place honorable. Elle avait eu des romans de Paul Féval, de Méry et de Léon Gozlan, des études historiques et littéraires de Philarète Chasles et de Prosper Mérimée. Des vétérans comme Villemain, Salvandy et Vitet y donnaient la main à des nouveaux tels que Caro, Guillaume Guizot, Edmond About. De temps à autre, un article à sensation venait réveiller la curiosité publique, qui ne demandait qu’à s’endormir. C’était, un jour, un article de M. Guizot: Nos[175] mécomptes et nos espérances. Une autre fois, c’était le Louvre, un chef-d’œuvre de M. Vitet.
Malheureusement, à côté de ces rédacteurs, il y en avait d’autres. Un jour que Pontmartin sortait des bureaux de la Revue contemporaine, rue de Choiseul, no 21, il rencontra Henry Mürger, qui lui dit, au cours de leur conversation: «Pour bien diriger un théâtre, il faut être un peu canaille; pour bien diriger une Revue, il ne faut pas être trop poli.» M. de Belleval était un émule de M. de Coislin: c’était l’homme le plus poli de France. Faire de la peine à quelqu’un, refuser à un galant homme d’insérer sa copie, fût-elle la plus ennuyeuse du monde, était pour lui chose impossible. Il se laissa ainsi aller à insérer des articles de M. Viennet (si encore ce dernier ne lui eût apporté que des Fables!), puis, ce qui fut plus désastreux encore, une certaine Histoire des Conseils du Roi, dont la publication dura plus d’une année. Le résultat fut que M. de Belleval, en réglant ses comptes, s’aperçut qu’il avait, en moins de trois ans et demi, perdu plus de quatre-vingt mille francs et—ce qui pour lui était plus grave—qu’il avait gagné une névrose. Sa famille le supplia de s’arrêter sur cette pente; il dut s’y résigner; seulement, il quitta sa chère Revue, comme il l’avait créée,—en grand seigneur. Il la céda pour rien à un de ses collaborateurs, qui était en même temps un de ses compatriotes, M. Alphonse de Calonne.
Au bout de peu de temps, il devint visible que[176] la Revue, depuis le départ de M. de Belleval, si elle n’était pas passée au gouvernement, du jour au lendemain, préparait cependant une évolution dans ce sens. Armand de Pontmartin, pas plus du reste qu’Alfred Nettement, n’eut pas une minute d’hésitation. Malgré les instances du nouveau directeur, tous les deux se retirèrent.
II
Avant sa séparation de la Revue contemporaine, Pontmartin avait trouvé un journal quotidien, très haut placé dans l’estime publique, qui lui avait proposé de faire, chaque semaine, dans ses colonnes une causerie littéraire.
Le 29 février 1848, M. Adrien de La Valette[208] avait fondé l’Assemblée nationale[209], journal de combat qui, sans mettre encore un nom en tête de son programme, se signala, dès le début, par la vivacité de ses attaques contre la République. Cette attitude répondait sans doute au sentiment[177] du pays; car, au bout de trois semaines, l’Assemblée nationale comptait plus de dix-huit mille abonnés, chiffre considérable pour l’époque. Elle ne tarda pas à prendre position sur le terrain monarchique et défendit la fusion avec une énergique sagesse. Au mois de février 1851, M. Berner, accompagné du duc de Noailles, du duc de Valmy, de MM. de Falloux, de Saint-Priest et Mandaroux-Vertamy, était entré dans le comité de direction, où figuraient déjà MM. Guizot, Molé, Duchâtel et de Salvandy[210].
Plus heureuse que l’Opinion publique, l’Assemblée nationale n’avait pas été supprimée après le coup d’État. Au commencement de 1853, à la suite du nouveau plébiscite qui rétablissait l’Empire, elle avait perdu du terrain, mais elle se soutenait encore. M. Adrien de La Valette avait cédé la direction à M. Éloi Mallac, ancien chef de cabinet de M. Duchâtel. C’était un petit homme sec, de tournure élégante, d’une politesse exquise et d’une figure encore charmante, avec de beaux yeux noirs, froids et pénétrants. On l’appelait le beau Mallac, et comme il était né à l’Ile de France, son ami Louis Veuillot le disait en riant «fils de Paul et de Virginie». Nature de créole, spirituel et nonchalant, il n’écrivait jamais dans son journal, mais il savait choisir ses rédacteurs. Amédée Achard était chargé du courrier de Paris, Édouard Thierry du feuilleton dramatique, Adolphe Adam de la[178] chronique musicale. Les questions qui touchent plus spécialement à la politique et à la philosophie étaient confiées à M. Nourrisson, à M. Lerminier et aussi à Léopold de Gaillard, qui, fraîchement débarqué du Midi, venait de publier dans la feuille de la rue Bergère une série d’articles où il prenait la défense de la Restauration contre le bonapartisme. Ces articles avaient été très remarqués. Ils étaient signés du nom de leur auteur; mais comme ce nom n’était pas encore connu à Paris, on y chercha le pseudonyme de tel ou tel illustre personnage. L’engouement des salons s’en mêla, et des noms célèbres furent prononcés. Celui de M. Guizot fut même mis en avant. M. Mallac était ravi, si bien qu’il dit un jour à Léopold de Gaillard: «Décidément, il n’y a que vous autres Méridionaux pour réussir ainsi à Paris. Amenez-moi donc votre ami Pontmartin.»
A quelques semaines de là, le 23 janvier 1853, l’Assemblée nationale insérait un article de Pontmartin, Considérations humouristiques sur la critique. Le 8 février suivant, paraissait sa première Causerie littéraire, consacrée à Mme Émile de Girardin et à son roman de Marguerite ou Deux amours. Pendant cinq ans, jusqu’à la suppression du journal fusionniste, il lui donnera chaque semaine son feuilleton, sans le suspendre jamais, même à l’époque des vacances.
III
Au mois de mai 1853, il réunit, sous le titre de Contes et Nouvelles, les récits qu’il avait publiés dans la Mode et l’Opinion publique, dans la Revue des Deux Mondes et la Revue contemporaine. Ces récits sont au nombre de cinq: Albert[211], Aurélie, le Capitaine Garbas, la Marquise d’Aurebonne, l’Enseignement mutuel. Balzac, le 3 décembre 1832, écrivait au directeur de la Revue de Paris, M. Amédée Pichot: «Quant à n’écrire que des contes, quoique ce soit, à mon avis,—autre hérésie peut-être,—l’expression la plus rare de la littérature, je ne veux pas être exclusivement un contier.» C’était une hérésie, à coup sûr; ce qui est vrai, c’est que des contes comme l’Interdiction, le Colonel Chabert, la Grenadière et le Message[212], sont d’un prix inestimable, et que des nouvelles sans défauts, comme Aurélie et la Marquise d’Aurebonne, valent plus que de longs romans.
Dans une lettre qu’il m’adressait le 4 décembre 1879, Pontmartin raconte comment fut écrite la Marquise d’Aurebonne:
J’avais rapporté aux Angles le manuscrit d’Aurélie pour y faire quelques légères retouches. Après l’avoir envoyé à[180] M. de Belleval, je tombai assez gravement malade, et il me fut impossible de corriger les épreuves. De là une grosse faute qui me consterna, et que vous retrouverez dans ce numéro pâli du 15 juillet 1852, dont vous me parlez si bien; le point enluminant, pour le point culminant. Heureux temps! J’étais presque jeune; l’isolement et le vide ne s’étaient pas fait autour de moi. Ma femme semblait destinée à me survivre un quart de siècle. Après la publication de ce numéro du 15 juillet, le bon marquis de Belleval m’écrivit une lettre si aimable, où il m’engageait si vivement à une récidive, que, allant passer une quinzaine chez mon oncle[213], à la campagne, dans un site assez pittoresque, j’emportai un cahier de papier et un crayon. C’était dans la plus belle saison de l’année, et, cette année-là, ma convalescence me rendait plus doux les rayons du soleil, les beaux soirs de septembre, les senteurs variées des peupliers, des aulnes, des érables, des vignes sauvages, l’air balsamique de nos collines couvertes de thym, de romarin et de lavande, et le
Mitis in apricis coquitur vindemia saxis.
Je vois encore le joli coin de paysage où j’allais chercher la solitude: un groupe d’ormeaux et de chênes; à leurs pieds, un gazon encore vert, entretenu dans sa fraîcheur par un ruisseau virgilien; sur ce ruisseau un grand tronc d’arbre. Je m’y asseyais tant bien que mal, et j’ébauchais au crayon la nouvelle qui devint, deux mois plus tard, la Marquise d’Aurebonne...
La donnée de cette nouvelle était à la fois très neuve et très dramatique. La marquise s’est installée avec son fils Raoul à Hyères, dans la maison du docteur Assandri. Raoul a vingt et un[181] ans, il est beau, bien portant, riche; il aime Suzanne, la fille du docteur, et il en est aimé. Le mariage, ardemment désiré par la marquise, se ferait tout de suite si Raoul ne reculait pas lui-même devant le bonheur, s’il n’était pas, à mesure qu’il approche de sa vingt-deuxième année, hanté de plus en plus par des idées noires, par une idée fixe, celle de sa mort prochaine. Depuis plusieurs générations, les chefs de la famille d’Aurebonne sont tous morts de la poitrine à vingt-deux ans. Raoul le sait, il se croit condamné, il attend l’échéance fatale. En réalité, pourtant, rien ne le menace; sa santé est parfaite; il a pris le sang riche et pur de sa mère. Mais si la phthisie ne fait pas son œuvre, l’idée fixe fera la sienne. Poitrinaire ou fou, Raoul mourra au terme précis. On le sent, on le voit; le docteur lui-même n’ose pas dire non.
Mme d’Aurebonne, alors, a une idée terrible, une idée affreuse, qu’elle aura le courage de mettre à exécution. Pour sauver son fils, elle ne reculera pas devant le plus douloureux des sacrifices. Femme, épouse, mère irréprochable, elle s’accusera d’une faute qu’elle n’a pas commise. Elle dit à Raoul qu’il n’est pas le fils de celui qu’il a cru son père, mais le fruit d’un amour coupable, et qu’ainsi il n’a rien à craindre de la fatalité héréditaire, rompue par cette faute. A ce mensonge sublime, que Dieu a dû pardonner, Raoul relève la tête; il respire librement, il vivra. Il vivra heureux près de Suzanne; mais sa mère mourra,[182] et sur la tombe de la marquise d’Aurebonne, au-dessous de l’inscription mortuaire, le docteur—qui a tout deviné—écrira ces mots: «Martyre et Sainte.»
Le 31 janvier 1865, le théâtre Beaumarchais représenta le Secret du Docteur, drame en trois actes, en vers, par M. Jules Allevarrès[214]. C’était la Nouvelle de Pontmartin transportée à la scène. La pièce était habilement faite et remarquablement écrite; elle fut bien jouée et tint longtemps l’affiche. Théophile Gautier termine ainsi son feuilleton du Moniteur: «Le Théâtre Beaumarchais, en sa joie naïve, a pu inscrire sur son affiche: grand succès[215]!»
IV
Aurélie a toute une histoire.
Le 1er avril 1852, Pontmartin présenta à M. Buloz, sous le titre de Françoise, une Nouvelle qui fut reçue à corrections. Il croyait mériter mieux, et comme, à ce moment, la Revue contemporaine était à la veille de paraître, il porta sa nouvelle à M. de Belleval. Il avait seulement démarqué le trousseau de Françoise, qui, d’ailleurs, n’en avait pas besoin, puisqu’il ne la mariait pas. Il la débaptisa, il l’appela Aurélie, et c’est sous ce nom[183] plus romanesque qu’elle parut dans la nouvelle Revue.
Vingt-sept ans se passent. Le 1er octobre 1879, Pontmartin ouvre la Revue des Deux Mondes et, à son grand étonnement, il y retrouve cette même Aurélie que M. Buloz avait presque refusée,—Aurélie, un peu changée sans doute, grandie, développée, mais encore très reconnaissable, surtout pour l’œil d’un père. Elle ne s’appelle plus Aurélie d’Ermancey; elle s’appelle Georgette Danemasse[216]; mais ce changement de nom n’empêche pas les deux jeunes filles d’avoir la même physionomie et les mêmes traits, de se ressembler comme deux sœurs. Les détails varient, les incidents offrent certaines différences, le dénouement n’est pas le même. N’importe! les similitudes n’en sont pas moins frappantes, les situations principales n’en sont pas moins identiques. Les deux sujets sont exactement semblables, ou plutôt c’est le même sujet: une jeune fille pure, innocente, chastement aimante, sincèrement aimée, faite pour les honnêtes joies du pays natal et de la famille, victime des désordres superbes de sa mère.
Pontmartin va-t-il crier au plagiat? Il est bien trop galant homme pour cela. Pour rien au monde, il ne voudrait contrister une femme, et l’auteur de Georgette est justement une femme, qui a déjà fait ses preuves de talent et qui sans doute n’a jamais lu Aurélie,—Pontmartin en est persuadé.[184] Il se borne à sourire, et il écrit sur ce petit épisode une causerie charmante, qu’il termine ainsi: «Si Georgette était une pièce de théâtre, j’aurais prié Mme B..., de me donner un fauteuil d’orchestre pour la première représentation. Puisque Georgette est un roman, je me tiendrai pour très content, si Mme B..., en publiant le volume chez notre éditeur Calmann-Lévy, veut bien le faire précéder d’une page où elle mentionnera ma pauvre Aurélie, et ajoutera, non pas que les beaux esprits se rencontrent, mais que les vieux peuvent encore être bons à quelque chose[217].»
La pauvre Aurélie, du reste, n’avait pas trop à se plaindre. Est-ce qu’elle n’avait pas eu l’honneur, en 1862, d’être mise par Sainte-Beuve à l’ordre du jour des Nouveaux Lundis? Sainte-Beuve, à ce moment, était complètement brouillé avec l’auteur des Causeries littéraires. Voici pourtant comment il parle de la nouvelle de Pontmartin:
Aurélie est une nouvelle qui débute d’une manière agréable et délicate. Il y a une première moitié qui est charmante. Cette jeune enfant de dix à onze ans, amenée un matin au pensionnat par une mère belle, superbe, au front de génie et à la démarche orageuse, le peu d’empressement de la maîtresse de pension à la recevoir, la froide réserve de celle-ci envers la mère, son changement de ton et de sentiment quand elle a jeté les yeux sur le front candide de la jeune enfant, les conditions qu’elle impose; puis les premières années de pension de la jeune fille, ses tendres amitiés avec ses compagnes, toujours commencées vivement, mais bientôt refroidies et abandonnées sans qu’il y[185] ait de sa faute et sans qu’elle se rende compte du mystère; l’amitié plus durable avec une seule plus âgée qu’elle et qui a dans le caractère et dans l’esprit plus d’indépendance que les autres; tout cela est bien touché, pas trop appuyé, d’une grande finesse d’analyse. On devine bientôt le secret: la mère d’Aurélie, séparée de son mari par incompatibilité d’humeur et par ennui de se voir incomprise, est une personne célèbre qui a fait le contraire de ce que Périclès recommandait aux veuves athéniennes, qui a fait beaucoup parler d’elle, qui a demandé à ses talents la renommée et l’éclat, à ses passions les émotions et l’enivrement à défaut de bonheur. La pauvre enfant qui ne sait rien, qui ne voit que rarement cette mère capricieuse et inégale, pour laquelle, du plus loin qu’elle s’en souvienne, elle s’est pourtant autrefois prononcée dans le cabinet du magistrat, lorsqu’il lui fut demandé de choisir, entre elle et son père, la pauvre Aurélie arrive à l’âge de dix-sept ans sans s’être rendu compte des difficultés de sa destinée. Elle aime le frère de son intime amie Laurence, Jules Daruel, un gentil sujet, qui vient d’autant plus régulièrement visiter sa sœur qu’il ne la trouve jamais sans Aurélie. Ce jeune homme est avocat, il a des succès et voit déjà s’ouvrir devant lui une honorable et brillante carrière. Il a pour tuteur M. Marbeau, un grave conseiller à la Cour royale, celui même dans le cabinet duquel, bien des années auparavant, s’est consommée à l’amiable la séparation du père et de la mère d’Aurélie. Un jour, un soir d’été, que M. Marbeau est venu à la pension, il y rencontre Jules, son pupille, qui s’y trouvait déjà en compagnie de Laurence et d’Aurélie; ils sont tous, dans une allée du jardin, à jouir de la beauté et des douceurs de la saison en harmonie avec les sentiments de leurs cœurs. Aurélie n’a jamais été plus belle; Jules n’a jamais été plus amoureux; M. Marbeau semble lui-même sourire et prendre part à leurs espérances. Tout d’un coup, au tournant d’une allée, Aurélie pousse un cri de joie; elle vient d’apercevoir sa mère, qui, ne l’ayant pas trouvée au parloir, s’est dirigée [186]vers le jardin; mais la présence de Mme d’Ermancey apporte à l’instant du trouble dans tout ce bonheur. Elle a d’abord reconnu M. Marbeau, l’arbitre de la séparation conjugale, celui-ci a repris son front de juge; la contrainte succède, un froid mortel a gagné tous ces jeunes cœurs. Ce jour sera le dernier beau jour de la vie d’Aurélie.
Jusqu’ici, j’en conviens, la nouvelle est parfaite[218].
Autant Sainte-Beuve est élogieux pour la première moitié du récit de Pontmartin, autant il est dur pour la seconde moitié, dont il donne, il est vrai, une analyse qui n’est rien moins qu’exacte. Dans la nouvelle, M. d’Auberive, voisin de campagne et ami de M. d’Ermancey, vient lui demander pour son fils Emmanuel la main d’Aurélie. M. d’Ermancey commence par refuser. Il craint pour sa fille, pour le mari qu’elle prendra, les propos méchants, les calomnies, suites fatales des désordres de la mère et de son orageuse réputation; il soumet à son ami les scrupules que lui dicte une exquise délicatesse. «Si l’envie et la malice, dit-il à M. d’Auberive, se sont si aisément emparées de la réputation d’Aurélie, c’est qu’Aurélie n’est pas placée dans les conditions ordinaires; c’est que cette réputation leur était livrée d’avance par un implacable souvenir, par une tache ineffaçable...» Il finit cependant par céder aux instances de M. d’Auberive; il consent au mariage de sa fille. «J’y consens, dit-il à son ami... Emmanuel et toi, vous reviendrez dans deux jours. Si vous persistez dans votre demande, j’appellerai Aurélie, et elle prononcera.» Mais[187] Aurélie a tout entendu, et elle refuse d’épouser Emmanuel d’Auberive.—Dans l’analyse de Sainte-Beuve, les choses se passent autrement. L’auteur des Nouveaux Lundis,—après avoir solennellement déclaré qu’il ne montera pas sur ses grands chevaux,—néglige de mentionner le refus d’Aurélie, et il nous montre M. d’Ermancey refusant sa fille, faisant bon marché de son bonheur, la réduisant de gaîté de cœur à l’état de paria pour toute sa vie, faisant le mal par préjugé et par orgueil. Il s’exalte lui-même au tableau imaginaire de la conduite qu’il lui plaît d’attribuer à ce malheureux M. d’Ermancey, qui n’en peut mais, et tout à coup, dans un accès d’éloquence qui dut faire tressaillir d’aise les abonnés du vieux Constitutionnel[219], il s’écrie, non sans avoir préalablement comparé M. d’Ermancey à un «Appius Claudius»: «Odieuse et horrible moralité aristocratique! Pauvre Aurélie, qui devrait s’appeler l’Enfant maudit! La fatalité plane, en vérité, sur elle comme au temps d’Œdipe, la malédiction comme au temps de Moïse et d’Aaron. Dans quel siècle l’auteur croit-il donc vivre? Nous ne vivons plus sous la loi, mais sous la grâce. Le talion est depuis longtemps aboli. Bénies soient les révolutions qui ont brisé ces duretés et ces férocités antiques, sacerdotales, féodales et patriciennes[220]!»
C’était bien du bruit pour un mariage manqué. Je ne pus m’empêcher d’en faire la remarque. En ce temps-là, entre un achat de graines d’arachides et une vente de caisses de savons, je m’amusais parfois à publier dans la Revue de Bretagne et de Vendée des chroniques signées: Louis de Kerjean ou des causeries littéraires signées: Edmond Dupré. Sous cette dernière signature, je pris la liberté[221] de relever les inexactitudes contenues dans l’article de Sainte-Beuve. Dans mon audace juvénile, je me risquai jusqu’à dire, comme Marfurius: Il me semble qu’il n’est pas impossible qu’il puisse se faire que, par aventure, le célèbre critique ait commis un pas de clerc en montant sur ses grands chevaux. Ce diable d’homme lisait tout, même la Revue de Bretagne; il me le fit bien voir. Peu de temps après, réimprimant son article, il me consacra une note où il me reprochait d’épiloguer[222]. Un peu plus tard, le 28 juillet 1862, dans un nouvel article sur M. de Pontmartin, il me prit de nouveau à partie, citant même, pour me confondre, un passage de ma chronique, et m’accusant d’injurier l’Univers[223]! Je n’avais pas le droit de me plaindre, ayant eu le tort de me mêler de ce qui ne me regardait point et de ne pas me souvenir, avec La Fontaine, que de tout temps
Les petits ont pâti des querelles des grands.
Une riche compensation allait d’ailleurs m’indemniser des légères malices de Sainte-Beuve, lesquelles, après tout, étaient de bonne guerre.
Pontmartin, à qui j’avais envoyé mon article, me répondit, à la date du 5 mars 1862:
...Si vous m’aviez adressé un seul jour plus tard votre lettre et le numéro de la Revue de Bretagne, je n’aurais pas eu le vif plaisir de pouvoir terminer la dernière feuille des Jeudis de Madame Charbonneau par un hommage de reconnaissance à M. Edmond Dupré. Je n’ai pas osé écrire votre vrai nom, craignant de vous déplaire et n’ayant pas le temps de vous consulter là-dessus; car je suis déjà un peu en retard et nous ne pouvons paraître que le 4 avril. Ce qui vous paraîtra singulier (étant donnée la vanité proverbiale des auteurs et notamment la faiblesse paternelle des romanciers), c’est que j’avais si bien oublié Aurélie que j’acceptais non pas précisément l’arrêt, mais l’analyse de M. Sainte-Beuve. C’est vous qui m’avez remémoré le dénouement, et je me suis souvenu que Buloz, avec qui je me brouillai à cette époque pour l’amour de la Revue contemporaine (qui depuis... mais alors!), me dit: Votre première partie est très ennuyeuse, mais la seconde est excellente: or Sainte-Beuve dit tout le contraire...
Et voilà comment je figure, moi chétif, à la dernière page des Jeudis de Madame Charbonneau. Cette page est trop aimable à l’endroit d’Edmond Dupré pour que je puisse songer à la reproduire. Jamais depuis aucun de mes articles ne m’a été payé aussi royalement.
Si je me suis étendu, un peu trop longuement peut-être, sur les Contes et Nouvelles, c’est qu’à leur publication se rattache un de mes plus chers souvenirs[190] de jeunesse. Je faisais alors mon droit. Entre une leçon de M. Bugnet et un cours de M. Perreyve[224], j’écrivis quelques pages sur le volume acheté la veille sous les galeries de l’Odéon, et je jetai mon article dans la boîte de l’Assemblée nationale. Le lendemain, Pontmartin vint me demander à ma pension d’étudiant, rue du Petit-Lion-Saint-Sulpice, et, ne me trouvant pas, m’y laissa ce billet:
Paris, le 12 mai 1853.
Monsieur,
Le rédacteur en chef de l’Assemblée nationale me communique un article signé de vous, sur l’ensemble de mes ouvrages. Cet article me rendrait bien fier si je pouvais croire que je mérite les éloges dont vous me comblez; mais par cela même qu’il est trop bienveillant et trop flatteur, il y aurait peut-être quelque difficulté à l’insérer tel quel dans un journal dont je suis notoirement un des collaborateurs. Nous désirerions donc, Monsieur, en causer avec vous, et vous demander quelques légères modifications. Je serai demain vendredi, au journal, de midi à deux heures, rue Bergère, no 20, et si vous n’aviez rien de mieux à faire, je serais heureux d’offrir mes remerciements à mon bienfaiteur inconnu. S’il vous est plus commode que j’aille chez vous, veuillez m’indiquer l’heure où il vous plaira de me recevoir, et, en attendant, Monsieur, veuillez agréer l’expression de ma vive reconnaissance, de ma haute considération.
Armand de Pontmartin,
10, rue Laffitte.
Trente-cinq ans plus tard, Pontmartin a bien[191] voulu rappeler ces petites circonstances dans une page qu’on me pardonnera de citer:
Je n’ai jamais oublié, je n’oublierai jamais ma première rencontre avec Edmond Biré, dans les bureaux de l’Assemblée nationale, où il venait présenter un article sur mon premier volume, qui devait être, hélas! suivi de tant d’autres. Biré n’avait que vingt ans, et je n’étais déjà plus jeune; car une des singularités de ma vie littéraire aura été de débuter (à Paris, s’entend!) à un âge où la plupart de mes contemporains, de mes camarades de collège et de concours, Montalembert, Falloux, Nisard, Champagny, Nettement, Henri Blaze, Alphonse Karr, Paul et Jules Lacroix, Louis Veuillot, Théophile Gautier, Jules Sandeau, Victor de Laprade, avaient déjà marqué leur place, où Alfred de Musset tombait en ruine, et de n’être pas tout à fait mort, quand tous ou presque tous ont disparu. Certes, pour un débutant, presque un surnuméraire, il y avait, dans ce témoignage spontané d’un jeune homme inconnu, arrivant de l’autre extrémité de la France, plus Breton que je ne suis Provençal, tout ce qu’il fallait pour m’inspirer sympathie et gratitude. Cependant, un secret pressentiment m’avertit que nous n’en resterions pas là, que, malgré la différence de nos âges, ce serait la première étape d’une longue campagne où nous servirions, avec la même cocarde, dans le même régiment. Je ne me doutais pas que ce jeune homme, à qui je savais déjà tant de gré de s’être occupé de mon livre, avait lu tous les articles que, depuis 1845, j’avais publiés dans la Mode, la Revue des Deux Mondes et l’Opinion publique, et qu’il s’en souvenait mieux que moi[225]...
V
Pontmartin n’avait jamais songé à faire des livres avec ses articles de l’Opinion publique, de la Revue des Deux Mondes et de la Mode. Le succès de ses feuilletons de l’Assemblée nationale le décida à les réunir en volumes. La première série des Causeries littéraires parut au mois d’avril 1854.
Les Causeries ne réussirent pas moins que les Contes et Nouvelles. On y pouvait noter sans doute quelques négligences, relever ici et là des phrases écrites trop à la hâte, au vol de la plume, regretter trop de facilité et trop de complaisance de jugement; mais on oubliait vite ces défauts, tant il y avait dans cet aimable et ingénieux volume de vivacité et de bonne grâce, de raison et de bon sens, de malice et de belle humeur. Si les critiques sont les historiens de l’esprit, jamais écrivain, plus que Pontmartin, ne fut plein de son sujet. Ses chapitres sur Mme Émile de Girardin, sur Jules Janin et son Histoire de la littérature dramatique, sur le Constantinople de Théophile Gautier, sur le docteur Véron et ses Mémoires, sont en leur genre de petits chefs-d’œuvre.
Louis Veuillot consacra aux Causeries littéraires un de ses premiers Paris de l’Univers:
Les Causeries de M. de Pontmartin, disait-il, ont déjà paru dans les journaux, et leur réputation est faite. Elles gagneront cependant à être relues. On pourra mieux en[193] apprécier la finesse, le bon sens, l’allure vive, quoique prudente. M. de Pontmartin a sa manière de voir, de sentir, de parler; une mesure très heureuse le garde en tout du commun et de l’extraordinaire. C’est vraiment une causerie. Il ne bavarde pas, il ne professe pas. Bavarder, il ne saurait, c’est le lot de M. Janin; professer, il ne voudrait, c’est le ton de M. Planche. Les bavards et les professeurs abondent; les causeurs sont rares. Il faut des idées et de l’esprit pour causer. Voilà le charme de ce volume, seulement trop discret. Point d’appareil d’érudition ni d’éloquence, point d’esthétique; un peu de recherche, une certaine toilette de salon, jamais d’attitude, surtout jamais d’effort. Nous avons donc là mieux qu’un docteur qui donne des consultations, et bien mieux qu’un homme de lettres qui fait des grâces: nous avons un homme d’esprit fort au courant de tout. On parle du livre nouveau. Il connaît le livre et il donne son avis; l’avis d’un galant homme très indulgent[226]...
Un peu plus loin, après avoir reproché à Pontmartin d’être trop bienveillant, de ménager trop certains écrivains dont la religion et la morale avaient à se plaindre, Louis Veuillot ajoutait:
Par les noms des auteurs, il avait sous la main à peu près toute la littérature du temps. Elle venait à lui telle qu’elle est, sceptique, incohérente, mercantile, sensuelle, débauchée, affolée, pleine de mépris pour toute chose au monde, et pour elle-même; un négoce, rien de plus; et quel négoce, en certains quartiers! Certes, c’était un tableau à nous donner; et pour le tracer M. de Pontmartin a tout ce qu’il faut, un talent précieux d’analyse, un sens droit, une plume ferme et fine comme le burin, une pointe d’esprit très pénétrante, le don de n’enfoncer cette pointe qu’autant qu’il veut.
Louis Veuillot, s’il eût été de ceux qui prennent un blason, n’aurait sans doute pas choisi celui que l’on rencontre dans les Devises du P. Bouhours, une abeille avec ces mots: Sponte favos, ægre spicula, le miel de bon gré, le dard à regret. Il prodiguait d’habitude le blâme plus que la louange. Pontmartin avait donc lieu d’être fier des éloges qu’il ne lui avait pas ménagés; il estimait même que le rédacteur de l’Univers l’avait loué au delà de ses mérites. A la même heure pourtant, M. Cuvillier-Fleury trouvait que Louis Veuillot, qui était, il est vrai, sa bête noire, n’en avait pas dit assez. Le 8 avril 1854, il écrivait à Pontmartin.
Par le côté religieux et un peu trop contre-révolutionnaire (peut-être) sous lequel vous vous montrez à lui, Veuillot vous a flatté. Par ce côté d’homme du monde qui cache un écrivain supérieur et qui se trahit sans cesse dans l’originalité élégante et ferme, dans la causticité indulgente et dans le bon goût éloquent, on dirait qu’il ne vous a pas connu.
Pontmartin a doublement réussi comme romancier et comme critique. Le voilà devenu tout à fait parisien; aussi le voyons-nous, à la fin de 1854, faire un nouveau bail avec la capitale, et se transporter avec les siens au numéro 51 de la rue Saint-Lazare, dans un pavillon au fond d’une cour. Il y restera huit ans, jusqu’au mois d’août 1862.
VI
Le succès des Contes et Nouvelles était fait pour encourager Pontmartin à une récidive. Du 22 décembre 1853 au 2 juin 1854, il publia dans l’Assemblée nationale sous ce titre: Pourquoi nous sommes à Vichy, trois nouvelles, le Cœur et l’Affiche, le Chercheur de Perles, l’Envers de la Comédie. Elles formèrent le volume intitulé: le Fond de la Coupe.
L’Envers de la Comédie repose sur une donnée entièrement originale.
Le 23 mars 1847, le Théâtre-Français avait joué une comédie de Léon Gozlan, Notre fille est princesse, dont voici le sujet. M. Roger—qui s’appellera plus tard M. Poirier—est un bourgeois enrichi, trois ou quatre fois millionnaire,—en ce temps-là on ne connaissait pas encore les milliardaires. Il n’envie plus que ce qui lui manque: la noblesse, et il donne la main de sa fille au prince de Charlemont, le plus affreux vaurien qui se puisse imaginer. Une fois marié, Charlemont se ruine sans esprit: il ruine sa femme qui est charmante; il ruine son beau-père dont les yeux ne se dessillent qu’au cinquième acte, au moment où le gouffre qu’il a creusé sous ses pas est prêt à l’engloutir, lui et les siens. Heureusement, l’auteur a inventé un autre abîme à l’usage des gentlemen-riders du Théâtre-Français. C’est un étang glacé[196] que le prince veut franchir dans l’entraînement d’un steeple-chase... et crac! glace, étang, cheval, gendre, principauté, tout disparaît à la fois; il ne reste qu’un beau million que M. Roger sauve du naufrage et qui lui suffira pour faire honneur à ses affaires; sans compter qu’il y a là, tout à point, un petit cousin qui est fort amoureux de sa cousine et qui sera heureux comme un prince, le jour où notre fille ne sera plus princesse.
Appelé dans la Mode à rendre compte de la pièce[227], Pontmartin ne s’attarda point à en faire ressortir les défauts; il improvisa, à côté de la comédie de Léon Gozlan, toute une comédie nouvelle:
Un jeune homme, écrivait-il, entre dans le monde; il est beau; il a de l’esprit; il a du cœur; il a un grand nom; mais il est pauvre. Dernier rejeton d’une race illustre et ruinée, il ne sait que faire de ce nom qui lui pèse comme un fardeau... La richesse est devenue l’unique et suprême condition de bien-être, de considération et de plaisir: Le monde ne se divise plus en gentilshommes et en bourgeois, mais en riches et en pauvres: ceux-ci sont les parias; ceux-là sont les privilégiés.
Que fera, dans une société ainsi déclassée, mon prince de Charlemont? Égal aux plus grands par sa naissance, inférieur aux plus petits par sa fortune, désorienté par cette perpétuelle antithèse de sa destinée, il ne saura que faire de sa noblesse, de son esprit et de son cœur; rien de ce que lui offrira le monde ne sera ni assez élevé ni assez humble pour lui.
Sur ces entrefaites, il rencontrera M. Roger, dans mon histoire, est un bourgeois enrichi, intelligent, qui est de son siècle, qui ne s’amuse pas à copier M. Jourdain,[197] parce qu’il a mieux à faire, et qu’il sait qu’aujourd’hui un homme riche commande à tous, même aux princes qui n’ont pas d’argent. Sa fortune lui a depuis longtemps donné toutes les jouissances; il en est une, d’une nature plus exquise et plus raffinée, qu’il ambitionne, comme ces gourmets qui voudraient reculer les bornes du possible. M. Roger se souvient d’un certain George Dandin, qui fut martyrisé, du temps de Molière, par les Sotenville et les Prudoterie, parce que, riche et roturier, il avait épousé, comme on disait alors, une fille de condition. Ce George Dandin fut bien malheureux! M. Roger se propose de le venger; il veut pouvoir dire: Notre gendre est prince! non pas par gloriole de parvenu, mais pour se donner le plaisir d’écraser sous la toute-puissance de ses écus un George Dandin armorié: c’est pourquoi il marie sa fille à mon prince de Charlemont.
Vous voyez d’ici ma comédie: l’argent tyrannisant le blason! M. de Charlemont voudrait se plaindre de ce que sa femme met trop de diamants, achète trop de chevaux, découvre trop ses épaules qui sont blanches comme des épaules de vraie duchesse.—«Tout beau, monsieur mon gendre! oubliez-vous que ces diamants et ces chevaux, c’est notre argent qui les achète; que ces robes décolletées, c’est avec nos billets de banque que votre femme les paie à Palmyre!—Mais je ne voudrais pas aller tous les soirs dans le monde, traîné à la remorque par ma belle-mère! j’aimerais mieux lire, travailler, rêver, enseigner à ma femme cette vie d’intérieur que nous pourrions rendre si sereine et si douce!—Vous plaisantez, je crois! Pensez-vous que nous vous ayons épousé, que nous vous ayons tiré de l’indigence, pour vous mettre sous cloche et ne pas nous faire honneur de vos seize quartiers de noblesse?—Mais voici qui est plus grave; je crois m’apercevoir qu’il y a là un petit cousin, habillé par Humann, ganté par Boivin et doré par Jeannisset, qui, décidément, abuse de sa roture pour faire la cour à ma femme!—Eh! mon Dieu, simples représailles! George Dandin en a vu bien d’autres. Quoi! vous vous emportez pour une bagatelle! Ça, venez, notre gendre,[198] faire vos humbles excuses au cousin Octave, qui est trop riche pour exposer sa vie contre vous. D’ailleurs, ne savez-vous pas que le duel est défendu par les lois que nous avons faites? Souffrez donc patiemment de cette petite revanche des Dandin d’autrefois contre les Sotenville d’aujourd’hui.
Mais ici mon prince de Charlemont se relève de toute sa hauteur. Tant qu’il ne s’agissait que de ridicules, d’ennuis, de tracasseries domestiques, tant qu’il n’avait à craindre que de voir mener trop grand train cette fortune qui n’est pas à lui, il a souffert en silence; mais dès l’instant que l’honneur parle, Charlemont n’hésite plus; il fait un petit paquet de ses modestes hardes de gentilhomme ruiné; il tend, sans rancune, sa loyale main à cette famille enivrée d’argent; et adieu la richesse, les salons dorés, la soie et le velours! adieu la voiture de Clochez et le cheval de Stephen-Drake! Charlemont va quitter toutes ces récentes grandeurs et retrouver son pauvre manoir délabré où il vivra, s’il le faut, de pain et de cidre. Vous comprenez que je ne le laisse pas partir, et que sa femme qui n’est, après tout, ni dépravée ni méchante, et qui a oublié la querelle des Dandin et des Sotenville, se jettera dans ses bras en lui disant: Viens, mon ami, allons restaurer ton vieux château avec les jeunes écus de M. Roger! Allons faire souche de Charlemont, et apprendre à nos enfants à être à la fois, secret très rare, de bons riches et de vrais nobles!
Je ne sais si je me trompe, mais il me semble qu’une comédie, basée sur cette idée, serait plus neuve et plus vraie, plus paradoxale et plus réelle, plus gaie et plus attendrissante que celle qu’a inventée M. Gozlan[228]...»
Quelques années après, Jules Sandeau et Emile Augier portaient, à leur tour, à la scène cette question, si souvent controversée, de l’alliance entre[199] un gentilhomme ruiné par ses élégantes folies et une jeune fille d’opulente bourgeoisie. Le 8 avril 1854, le théâtre du Gymnase donnait, avec un éclatant succès, la première représentation du Gendre de M. Poirier.
La pièce ne versait pas dans le mélodrame, comme celle de Léon Gozlan; elle restait d’un bout à l’autre dans le ton de la comédie: la sensibilité délicate de Sandeau s’y mêlait heureusement à la verve gauloise d’Augier. Mais, au fond, c’était toujours la vieille histoire du gentilhomme pauvre épousant, pour ses écus, la fille du bourgeois gentilhomme... et millionnaire. Gaston de Presles est un marquis ruiné, dissipateur, paresseux, libertin, qui profite de son mariage pour continuer sa vie de garçon et renouer une liaison peu édifiante avec une femme de son monde d’autrefois. S’il se relève un peu à la fin, c’est parce que sa femme, la fille du bonhomme Poirier, a toutes les noblesses du cœur et toutes les supériorités de l’esprit. Tout en déployant dans leur pièce beaucoup d’entrain, de mouvement, de gaieté communicative, les deux auteurs n’étaient pas sortis du chemin battu: ils avaient, selon le mot de Montaigne, «vagué le train commun».
VII
Piqué au jeu par le succès du Gendre de M. Poirier, Pontmartin revint à son idée de 1847[200] et, dès le 10 mai 1854, il faisait paraître le premier feuilleton de l’Envers de la Comédie. Au risque d’être accusé de paradoxe, il traita le sujet tout à rebours de ceux qui l’avaient traité avant lui.
Georges de Prasly, marquis comme Gaston de Presles, est ruiné, comme lui; mais sa ruine n’a d’autres causes que le malheur des temps et les dissolvants révolutionnaires; peu à peu, la pauvreté rature ses parchemins, gratte les armoiries sculptées sur la porte de son château seigneurial: château si délabré, tellement hypothéqué, que, malgré le souvenir de vingt générations chevaleresques, leur dernier héritier, n’ayant pas de quoi le réparer, va être forcé de le vendre. Il sait que cette vente achèvera de tuer sa mère, veuve depuis plusieurs années et dont le cœur s’est attaché à ces vieilles pierres, comme ces lierres qui finissent par s’incruster dans les murs en ruine. Il se résigne à épouser Mlle Sylvie Durousseau, sa voisine de campagne, dont le père a fait dans l’industrie une colossale fortune. M. Durousseau est un habile homme et un homme d’esprit. Il ne rêve pas, comme son contemporain M. Poirier, d’être fait pair de France. Il n’a ni ambition ni vanité; il a mieux que cela: il a de l’orgueil. Il a la passion du commandement, et cette passion, il lui plaît de la satisfaire sur un homme ayant eu des ancêtres aux Croisades, et lui devant à lui, roturier, son bien-être, son luxe, son crédit, tout jusqu’au vieux château où ses pères ont vécu. Il lui semble original, grand, digne d’un homme profondément[201] pénétré de l’esprit et des progrès de son siècle, de prendre pour gendre un gentilhomme auquel il pourra rappeler, à chaque velléité de révolte, qu’il n’est qu’un zéro dont lui, Durousseau est le chiffre; que c’est lui qui l’a tiré du néant où notre siècle laisse tomber ceux qui n’ont rien; que ses chevaux, ses voitures, son hôtel, son mobilier, son argenterie, sa table, la toilette de sa femme et la sienne, sont autant de liens qui le font son obligé, son vassal et son esclave.—A ce jeu, il est vrai, M. Durousseau joue tout simplement le bonheur de sa fille. Mais il n’a sur ce point nulle inquiétude. Georges de Prasly est un timide, un faible,—il le croit du moins; fils pieux, il sera un mari soumis, un gendre docile, et ses révoltes, si par hasard il s’avisait d’en avoir, seraient faciles à dompter. Le mariage a lieu, et Georges, laissant sa mère à Prasly, s’installe à Paris, chez son beau-père, dans un des beaux hôtels de la rue Laffitte. M. Durousseau n’a de bourgeois que ses antécédents et son nom. Le pauvre descendant des Croisés se sent humble et petit dans ce magnifique hôtel, meublé avec un luxe inouï, plein d’artistiques merveilles. Il se trouve dépaysé dans ces salons où affluent les célébrités, où l’on entend des virtuoses à deux mille francs par soirée, où les reines de la mode rivalisent de somptueuses toilettes, où il se trouve entouré de parents, d’amis de la famille, qui n’ont pas besoin de titres et de particule pour se faire admettre au Jockey, briller au premier rang des sportsmen et rayonner, parmi les arbitres de l’élégance[202] et du goût sur les cimes du high life. Sylvie est une honnête femme, toute prête à aimer son mari; elle n’est pas coquette, mais elle aime le monde, et le monde la réclame. Elle ne manque ni un bal, ni un concert; elle est la reine de ces salons où Georges s’efface, se laisse oublier et souffre en silence. Une lettre du pays lui apprend que sa mère, dont le cœur est brisé et qui ne se peut consoler de son absence, est gravement malade. Au sortir d’une fête, où sa femme s’est vue plus courtisée que jamais, il la fait monter dans une berline de voyage, et, sans même prévenir M. Durousseau, il prend avec elle la route de Prasly. Ce brusque départ, cet enlèvement qui arrache Sylvie de ses rêves mondains et qui, au fond, l’enchante, pourrait être pour eux le point de départ d’une vie nouvelle et d’un bonheur dont l’un et l’autre sont dignes. Mais ils n’arrivent à Prasly que pour recueillir le dernier soupir de la vieille marquise. Georges se dit que c’est son mariage qui a tué sa mère; et quand Sylvie lui répète tout bas, avec une expression de tendresse timide: Elle m’a pardonné!—Oui, mais moi, je ne me pardonne pas, répond-il.
Après l’enterrement de la marquise dans le cimetière du village, il dit au plus vieil ami de sa famille, au confident de sa mère: «Il n’y avait qu’une marquise de Prasly... c’est celle que vous venez de conduire à sa dernière demeure; à la place de la dernière marquise de Prasly, il y a un tombeau; à la place du dernier marquis, il y a un soldat. Adieu,[203] mon ami, dites bien à cet homme et à sa fille qu’ils ont tué la mère et déchiré le fils, mais qu’ils ne les ont pas humiliés!»
Le lendemain, George de Prasly partait pour l’Afrique et s’engageait dans le 11e léger.
Là s’arrêtait le récit. Le roman était-il donc fini? De tous côtés, on demanda à l’auteur de donner une suite à l’Envers de la Comédie. Elle parut, dans l’Assemblée nationale, du 21 décembre 1854 au 2 février 1855, sous ce titre: Réconciliation.
Les suites, d’ordinaire, réussissent peu. Il n’en fut pas de même cette fois. La seconde partie du roman vaut la première. Si elle renferme quelques scènes un peu trop mélodramatiques, elle en contient d’autres, et en grand nombre, qui sont vraiment émouvantes. Lorsque Pontmartin, en 1856, réunit en un volume l’Envers de la Comédie et Réconciliation, il donna pour titre à son livre: La Fin du procès.
Des trois épisodes dont se composait d’abord le Fond de la Coupe, il n’en restait plus que deux. Pour remplacer le troisième, l’Envers de la Comédie, Pontmartin écrivit, en 1857, une autre nouvelle, l’Écu de six francs; ce qui le conduisit à changer le titre primitif du volume. Le Fond de la Coupe s’appela, dans les éditions postérieures, Or et Clinquant.
CHAPITRE IX
LE CORRESPONDANT, L’UNION ET LE JOURNAL DE BRUXELLES.—LES DEUX ÉROSTRATES.—LA MAIRIE DES ANGLES
(1855-1862)
Le second volume des Causeries littéraires. L’article sur Béranger. Lettre de Louis Veuillot à Pontmartin. Le 40 et le 44 de la rue du Bac. Le salon de Montalembert et les soirées de Veuillot.—L’entrée au Correspondant. Pontmartin et le théâtre.—Les deux Érostrates. Le Spectateur et la suppression de l’Assemblée nationale. L’entrée à l’Union.—La Mûre et le château de Gourdan. La mairie des Angles. Un préfet homme d’esprit. Lettre de Louis Veuillot.—Les Variétés du Journal de Bruxelles.—Biographie du Père Félix.—Rentrée à la Revue des Deux Mondes. Pontmartin en 1862.
I
Au mois d’avril 1855, en ayant fini avec l’Envers de la Comédie et Réconciliation, Pontmartin fit paraître le second volume des Causeries littéraires. Le premier, l’année précédente, avait obtenu un complet succès; aucune critique n’était venue se mêler aux éloges. Pontmartin croyait naïvement que la deuxième série aurait même fortune.
Il avait eu l’idée, pour corser le volume, d’y ajouter son étude sur Béranger, parue quatre ans auparavant, nous l’avons vu, dans l’Opinion publique, et qui n’avait pas soulevé le moindre orage. M. Mallac, sans le prévenir, inséra cette étude dans l’Assemblée nationale. C’était une démolition complète de l’Idole (car Béranger en était une à ce moment). Sans nier le mérite de ses «jolies chansons[229]», Pontmartin se refusait à voir dans le chantre de Lisette un poète lyrique, et à reconnaître dans le rival de Désaugiers un successeur et un rival d’Horace. Il ne cachait pas son mépris pour l’homme qui avait insulté l’Ange Gardien et la sœur de Charité, profané l’image sacrée de l’aïeule, bafoué le Jour des Morts, remplacé le Dieu des Chrétiens par le Dieu des Bonnes Gens, discrédité les Bourbons, glorifié le Bonapartisme, travaillé enfin—coup double dont la France mourra peut-être—à nous donner à la fois la République et l’Empire.
Louis Veuillot s’empressa de signaler ces pages vengeresses:
Les nouvelles Causeries littéraires de M. de Pontmartin, écrivait-il, contiennent une étude sur M. Béranger que nous signalons comme une bonne action et comme un chef-d’œuvre. Critique pleine, solide, lumineuse, entraînante, qui ne néglige rien, qui ne dit rien de trop, faite de main d’ouvrier. Le fameux auteur de Frétillon est jugé, pour le fond et pour la forme, comme la postérité le jugera. Ceux[206] qui ont senti l’odieux poids de cette gloire injurieuse, et ils sont nombreux, n’ont plus rien à désirer. Voilà M. Béranger mis à sa place... Fausse poésie, fausse gaîté, fausse bonhomie, patriotisme faux, immoralité sordide, impiété bête, tel est le bilan des «chansons nationales». C’était justice qu’il vînt une main ferme pour peser tout cela dans les balances d’or du talent; qu’un souffle puissant dissipât cette longue apothéose de la gaudriole, et que tant de choses saintes vilipendées pendant quarante ans par ces impurs fredons fussent enfin vengées. Le morceau suivant, détaché du travail de M. Pontmartin, permettra d’apprécier la saine beauté de l’ensemble...
Et après une longue citation, Louis Veuillot ajoutait:
Le critique va jusqu’au bout avec cette franchise, avec cette vigueur, avec ce fouet qui n’a pas un claquement inutile, et qui laisse partout où il tombe sa marque et son sillon. Et le public applaudit, parce qu’enfin c’est une belle et agréable chose que l’esprit au service du bon sens et de la justice[230].
Les journaux et les écrivains préposés à la garde de «nos gloires nationales» gardèrent d’abord le silence. Leur stupeur était plus grande encore que leur colère. «Parmi tant de fidèles dont les chansons de M. Béranger ont été le Coran, disait encore Louis Veuillot, personne ne se lève pour le prophète; le goum du Siècle lui-même et toute la tribu des Ben-Havin restent immobiles.» Force leur fut bien cependant de se mettre en campagne. Taxile Delord (celui qui plus tard, dans les Jeudis de[207] Madame Charbonneau, sera Porus Duclinquant), Émile de La Bédollière, Louis Jourdan, dirigèrent de furieuses attaques contre l’auteur des Causeries littéraires, transformé par eux, pour les besoins de la cause, en iconoclaste, en démolisseur et en Jésuite! Pontmartin ne répondit pas. Louis Veuillot d’ailleurs s’était chargé de ce soin. Le grand polémiste publia sur Béranger et ses défenseurs toute une série d’articles qui eurent vite fait de mettre en déroute les Ben-Havinites[231].
Presque au lendemain de cette brillante campagne, Louis Veuillot fut cruellement frappé: il perdit coup sur coup deux de ses filles[232]. Aux condoléances de Pontmartin, il répondit par une lettre admirable, l’une des plus belles qu’il ait écrites:
Paris, le 19 juillet 1855.
Cher monsieur,
Je savais combien vous avez pris part à mon chagrin; je vous sais gré de me fournir l’occasion de vous en remercier. Je suis de bronze à toutes les haines et à toutes les formes de la haine; mais toute sympathie m’émeut délicieusement, et c’est un bonheur dont j’ai beaucoup joui dans ma vie militante, parce que la sympathie n’est toujours venue du bon côté. Là où il y a de l’honneur, de l’amour pour le bien, du zèle pour la justice, du mépris et du dégoût pour le reste, là sont mes amis. Je n’ai pas traversé une circonstance[208] pénible sans qu’on m’ait tendu la main du sein de cette élite courageuse. C’est plus qu’il ne faut pour supporter les choses extérieures.
Quant à ces grandes douleurs du cœur et de l’âme, où nulle puissance humaine ne peut rien, Dieu qui les envoie a soin d’y pourvoir. Saint Bernard a une grande parole à ce propos.
Il dit: «Le monde voit la croix et ne voit pas l’onction.» Ce que Dieu met dans les cœurs qu’il déchire est inénarrable. J’en suis à m’étonner de mes pleurs. Je vois ces chers enfants dans le ciel, à côté de leur mère, comme elles étaient ici, mais à l’abri, mais immortelles. C’est un groupe d’étoiles qui luisent toujours et qui éclairent mon vrai chemin. De là tombe sur mon cœur une sérénité divine. Je me sens sous l’aile des Anges, et je remercie Dieu de m’avoir donné cette égide contre les traits et les attraits du monde.
Que de miracles Dieu fait pour nous, et que nous sommes ingrats! Que de miséricorde de nous faire trouver la plus grande paix dans la plus grande douleur! Ce sillon terrible, creusé au milieu du cœur, se remplit d’une semence de foi, d’espérance et d’amour.
Quand je venais à penser autrefois que je pourrais perdre un de mes enfants, c’était une angoisse inexprimable et il me semblait que j’entrerais du même coup dans des ténèbres aussi épaisses que celles du tombeau. Mais ces deux tombes, creusées presque au même instant, n’ont été que des jours ouverts sur l’Éternité. Je ne me lasse pas de le redire, comme je ne me lasserais pas de raconter un miracle dont j’aurais été le témoin et l’objet. Il n’y a pas de mort, il n’y a pas de séparation, il n’y a qu’une absence qui peut finir demain. Cette absence ne peut devenir éternelle que par notre faute, et Dieu prend un soin tendre d’allumer dans nos cœurs, par cette absence elle-même, toutes les lumières qui nous rendent quasi impossible de nous perdre et de nous égarer.
Songez à ce que je vous dis là, cher monsieur, si parfois les louanges que votre esprit vous attire vous paraissent[209] assez douces pour mériter quelque sacrifice, et vous engager à relâcher quelque chose dans le commerce du monde, sur les droits de Dieu. Il y a des moments où l’on voit avec la clarté de l’évidence qu’il faut tout faire pour Dieu et ne rien faire que pour Dieu. On sent que cela seul est fait, que tout le reste a été inutile ou criminel.
Si j’avais en ce moment tout ce que le monde peut donner de fortune et de gloire, je l’abandonnerais avec joie, non pas pour ravoir mes enfants, mais seulement pour les revoir. Aucune satisfaction ici-bas, aucune espérance de mémoire et d’honneur parmi les hommes ne pourrait m’être plus précieuse. Or, je ne les reverrai et elles ne me seront rendues que si j’aime Dieu et que si je le sers uniquement, et nous ne l’aimons ni ne le servons ainsi quand nous avons dans nos œuvres un regard et un désir pour ces misères humaines.
Voilà ce qu’il faut nous dire quand nous prenons la plume, quand nous ouvrons la bouche. Si nous songeons à nous-mêmes, si nous mettons Dieu de côté pour ne plus soulever le bruit des injures, pour exciter celui des louanges, alors c’est la séparation, c’est le commencement de la mort. Nous creusons entre Dieu et nous un abîme où notre âme languira longtemps et que peut-être elle ne franchira jamais.
Je me suis laissé aller bien loin; cependant je ne recommencerai pas ma lettre et je ne la supprimerai pas. Je vous l’adresse dans votre solitude comme le meilleur et le plus sincère témoignage que je puisse donner de toute mon amitié et de toute mon estime[233].
Pontmartin n’admirait pas seulement dans Louis Veuillot le puissant écrivain, l’incomparable[210] polémiste, l’homme aussi l’attirait; sa conversation le charmait plus encore que ses merveilleux articles. Ce lui était une fête de gravir, le soir, les trois étages du rédacteur de l’Univers, au 44 de la rue du Bac. En ces mêmes temps, il lui arrivait parfois d’entrer, le mercredi, au numéro 40, de monter au premier étage et d’assister aux réceptions de Montalembert; mais ce n’était plus la même chose. Au 40, il lui fallait se souvenir qu’il était Monsieur le comte et cela ne faisait pas du tout le sien. Sa verve se glaçait, ses meilleurs calembours se figeaient sur ses lèvres. Il a tracé quelque part une peinture, peut-être un peu trop poussée au gris, de ce salon où, malgré tant d’éléments de curiosité respectueuse, de sympathie, d’admiration, régnait un majestueux ennui. «Pris isolément, dit-il, chaque personnage était excessivement intéressant, l’ensemble était, comme disent les vulgaires loustics, à porter le Diable en terre; et, en effet, le Diable, dans cette société édifiante où il eût perdu son temps, n’avait rien de mieux à faire qu’à se faire enterrer. On eût dit des ombres chuchotant avec des fantômes, des revenants du parlementarisme, accourus pour donner des nouvelles du discours qui allait être prononcé, du projet de loi qui allait être voté, de[211] l’amendement qui allait être discuté, de la sous-commission qui allait s’organiser au moment où quatre hommes et un caporal avaient dispersé nos législateurs. Quelquefois,—les grands soirs,—apparaissait une célébrité britannique ou irlandaise, anglicane ou méthodiste, qui, pour éviter de choisir entre sa langue naturelle et le français, prenait le sage parti de rester muette, et contribuait à l’effet imposant plutôt qu’à la gaîté de la soirée[234].»
Au 44, quelle différence! Quelle simplicité! quelle bonhomie! Dans ces réunions charmantes, Pontmartin se sentait vraiment chez lui. Il s’y montrait tout simplement ce qu’il était en réalité, c’est-à-dire un bon garçon. Rien ne lui faisait plus de plaisir que de croire (comme cela lui arrivait en ces heureuses soirées) qu’il était, comme le maître de la maison, un parvenu de la plume, un enfant de la balle. Il s’abandonnait alors sans contrainte à toute sa verve; il prodiguait sans compter les traits les plus piquants et les aperçus les plus fins, les à-peu-près les plus impossibles et les calembours les plus détestables.
II
Si lié qu’il fût avec le directeur de l’Univers, Pontmartin se séparait cependant de lui sur le terrain[212] politique. Il n’allait pas tarder à devenir l’un des rédacteurs du nouveau Correspondant, dont Louis Veuillot était le plus ardent adversaire.
En 1855, Montalembert, privé de la tribune et ne pouvant songer à créer un journal, prit la direction de la Revue fondée par Edmond de Cazalès et Louis de Carné, et dans laquelle, vingt-cinq ans plus tôt, il avait publié son premier article. Depuis longtemps déjà, elle n’avait plus qu’une existence languissante et précaire; à peine lui restait-il quelques centaines d’abonnés. Le grand orateur crut qu’il était possible, dans les circonstances où l’on se trouvait alors, de la relever, d’en faire un organe d’opposition politique, en même temps qu’une arme de défense religieuse[235]. Il sollicita la collaboration d’Armand de Pontmartin. Celui-ci débuta dans la Revue renaissante[236], par un article sur le Correspondant et la littérature, qui parut le 25 février 1856. Jusqu’à sa mort, il ne cessa d’y écrire. Dans l’un de ses derniers articles[237], celui du 10 décembre 1889, revenant sur ces vieux et chers souvenirs, il dira:
...En février 1856, le comte de Montalembert me fit le très grand honneur de m’engager à collaborer au Correspondant[213] régénéré, renouvelé, rajeuni et agrandi. Il y a, de cela, trente-trois ans,—un tiers de siècle,—et voilà que, au bout de trente-trois ans, je me retrouve à cette même place, cherchant vainement du regard ceux dont la piété, l’éloquence, les écrits et les exemples devaient nécessairement m’inspirer l’émulation du bien. J’étais heureux et fier de redevenir soldat pour servir sous les ordres de pareils chefs. Aujourd’hui tous ont disparu. La France, profondément pervertie, révolutionnaire, athée, corrompue par la double complicité de l’impiété et du vice, d’une politique ignoble et d’une littérature infecte, s’efforce sans doute de les oublier. Les peuples déchus, par un juste châtiment, sont condamnés à avoir honte de ce qui fait leur gloire et à ne pouvoir songer qu’avec un remords à leurs sujets d’orgueil. Pour moi, ces hommes incomparables apparaissent d’autant plus haut que la société moderne est tombée plus bas, d’autant plus purs que nos politiciens sont plus vils. Montalembert! Augustin Cochin! Théophile Foisset! Armand de Melun! Falloux! Louis de Carné! Perreyve! Charles Lenormant! Lacordaire! Dupanloup! Ravignan! Gerbet! Vos noms bénis, vos noms illustres, doivent-ils éveiller les images funèbres que la mort offre à notre faiblesse? Je refuse de le croire. Pour des hommes tels que vous, la mort, c’est encore la vie; le deuil s’adoucit par la foi; le regret s’éclaire d’espérance. Aujourd’hui, en écrivant ces dernières lignes, je ne vous demande pas de me protéger en ce monde,—je ne suis plus de ce monde,—je vous demande de prier pour moi le Dieu de miséricorde et de bonté, afin qu’il m’accorde la faveur de bien mourir[238].
L’article sur le Correspondant et la littérature n’est pas, tant s’en faut, parmi les meilleurs de Pontmartin. Il vise à être un manifeste, une profession de foi, un programme. L’écrivain sans[214] doute était toujours élégant et spirituel; mais il traduisait sa critique en maximes et la condensait en formules. Il mêlait à sa grâce aimable et légère quelque chose de solennel et d’un peu apprêté. Même il lui arrivait, à lui si simple d’ordinaire, si éloigné de toute prétention et de tout pédantisme, il lui arrivait de prendre un ton dogmatique, d’employer de grands mots, des termes ambitieux, sesquipedalia verba. C’était toujours du Pontmartin, mais du Pontmartin endimanché. Ses amis, qui l’aimaient mieux en son habit de tous les jours, eurent d’abord un peu d’inquiétude. Allait-il donc changer son salon en une salle de conférences, monter à la tribune pour faire, lui aussi, sa Déclaration des droits de l’homme... et du critique? Est-ce que, par hasard, les lauriers de Gustave Planche l’empêchaient de dormir? Ces inquiétudes durèrent peu. Dès le 25 mai 1856, il publiait un article sur les Contemplations de Victor Hugo, bientôt suivi d’une étude sur Balzac[239] et d’une autre sur le Roman bourgeois et le roman démocratique[240]; et dans ces divers morceaux se retrouvaient ses anciennes qualités, auxquelles se venait ajouter parfois une sorte de divination. Telles, par exemple, dans son étude sur les Contemplations, les pages où il pressent, où il voit, où il décrit, dès 1856, les dernières œuvres, les dernières années du grand poète; où il nous montre Hugo[215] devenu Dieu, se contemplant, se souriant dans sa création, comme dans le miroir de sa grandeur et de sa divinité; se grisant d’infini, s’endormant dans cet enivrement olympien, au murmure des océans et des mondes... et se réveillant à Charenton[241]!—Pardon! c’est au Panthéon que je voulais dire.
Pontmartin était passionné pour le théâtre, et ce goût chez lui devait persister jusqu’à la fin. De 1873 à 1878, j’allais tous les ans passer avec lui, à Paris, une ou deux semaines. Nous dînions tous les soirs ensemble, et presque tous les soirs il me fallait l’accompagner à l’Opéra ou à l’Opéra-Comique, aux Français ou au Gymnase, où nous arrivions toujours avant le lever du rideau et où il s’amusait comme un enfant. Lorsqu’il était rédacteur en chef de l’Opinion publique, ce lui était un vif plaisir, nous l’avons vu, de prendre quelquefois la place de son lundiste,—Théodore Muret ou Alphonse de Calonne,—pour rendre compte lui-même de la pièce nouvelle. A l’Assemblée nationale, il lui avait fallu se cantonner dans son domaine propre, les livres, et laisser les théâtres à Édouard Thierry[242] ou à M. Robillard d’Avrigny. Au Correspondant, il allait trouver la place libre.
C’était l’époque où Dumas fils, Émile Augier, Octave Feuillet, Ponsard, Victorien Sardou triomphaient à la scène. Le Correspondant jusque-là n’avait guère eu de fenêtre ouverte sur le théâtre; mais force lui était bien maintenant de regarder aussi de ce côté. Il ne lui était plus loisible de tenir pour quantités négligeables des pièces dont le succès était éclatant, dont l’influence, salutaire ou funeste, était, de toute façon, considérable. Pontmartin fut chargé d’en entretenir les lecteurs de la Revue, de les apprécier au point de vue littéraire et surtout au point de vue social, de rechercher, non si elles étaient bien ou mal jouées, si elles faisaient ou non de grosses recettes, mais si elles élevaient ou abaissaient les intelligences et les cœurs. Ainsi se trouvait réalisée une de ses ambitions. Je lis dans une de ses lettres de cette époque: «Mon rêve a toujours été de généraliser et d’élever autant que possible les questions théâtrales et celles qui s’y rattachent, en dehors des commérages de foyer et des détails de coulisses. Que de choses par exemple à dire cet hiver sur le Fils naturel[243]: sur la Jeunesse[244] et sur les tendances que suppose dans la société le succès de pareilles pièces[245]!»
Les articles publiés par Pontmartin sur le théâtre feraient à eux seuls un volume, et il a eu bien tort[217] de ne pas en faire l’objet d’une publication spéciale. A la différence des courriéristes dramatiques,—ils s’appelaient alors Théophile Gautier, Jules Janin, Paul de Saint-Victor, Édouard Thierry, Francisque Sarcey,—il ne se borne pas à juger les pièces, abstraction faite de la société qui les produit, les accepte ou les explique. Il montre, au contraire, les rapports intimes et toujours croissants de cette société avec le genre de littérature le plus bruyant, le plus lucratif et le plus populaire. Ses articles ne sont pas de simples feuilletons, improvisés le lendemain d’une première; ce sont des études faites à loisir, qui embrassent parfois, à propos de la pièce nouvelle, l’ensemble même des œuvres d’un auteur. Cette suite de chapitres, s’ils étaient réunis, formerait une histoire de l’art dramatique en France de 1857 à 1866, c’est-à-dire pendant la période la plus brillante que le théâtre ait traversée au XIXe siècle. Voici la table des matières de ce volume, qui serait parfait... si on le pouvait trouver chez Calmann Lévy: La Question d’argent, M. Dumas fils[246].—La Société et le Théâtre, M. Dumas fils.—Un Père prodigue[247].—Octave Feuillet, auteur dramatique[248].—Eugène Scribe[249].—M. Victorien Sardou et le Théâtre en 1861[250].—Le Théâtre en 1863. Jean[218] Baudry, Montjoye, les Diables noirs, la Maison de Penarvan[251].—Le Lion amoureux et le Théâtre de M. Ponsard[252].—La Contagion et le Théâtre de M. Émile Augier[253].
III
Pontmartin collaborait toujours à l’Assemblée nationale. Ses Causeries littéraires paraissaient régulièrement chaque semaine. Sans les interrompre, il donna au journal de la rue Bergère un roman dont la publication dura du 21 mai au 9 août 1856. Il portait dans le journal ce titre: les Deux Érostrates, en attendant de s’appeler, dans les éditions postérieures, Pourquoi je reste à la campagne, puis les Brûleurs de Temples[254].
Le roman commence mal. Il s’ouvre par un long prologue qui ne se rattache en rien à l’action. Félix Daruel, ancien lauréat du Concours général et de l’École de droit, qui aurait pu être, s’il l’avait voulu, un éminent avocat ou un écrivain distingué, et dont la Revue des Deux Mondes a déjà publié un ingénieux récit: Eveline,—j’allais dire Octave,—habite depuis huit ans la province, où il[219] s’est marié, où il vit sur ses terres, et où rien ne manque à sa gloire et à son bonheur, puisqu’il est conseiller municipal de sa commune et marguillier de sa paroisse. Parfois pourtant il se demande s’il a eu raison de renoncer à la littérature. Un jour,—c’est au moment de l’Exposition universelle de 1855,—il se décide à louer un hôtel à Paris, à revoir ses anciens camarades, à reprendre pendant quelques mois, et qui sait? peut-être pour toujours cette vie brillante qui aurait pu être la sienne et à laquelle il n’a pas renoncé sans regret. Parmi les amis qu’il retrouve, il en est deux, Anselme Maynard et Julien Féraud, qu’il a perdus de vue depuis qu’ils sont entrés dans le journalisme. Partis de deux points extrêmes, et ayant employé des moyens contraires, ils se sont rencontrés, au bout, dans le même mécompte et dans le même malheur, Félix Daruel se fait raconter leur histoire,—et ce sera précisément là le roman. Il apprend d’eux comment la société peut repousser à la fois ceux qui l’attaquent et ceux qui la défendent. Leurs confidences l’éclairent sur l’imprudence qu’il commettrait, s’il cédait à l’envie d’entrer à son tour dans la lice et d’échanger contre une chance de succès et d’éclat le calme de son existence; elles lui apprennent à redouter l’épreuve, à retourner dans ses montagnes et à se contenter d’être heureux.
Ce prologue n’est pas seulement inutile; par son caractère factice et conventionnel, il met le lecteur en défiance. Le roman, qui est excellent et qui peut, certes, se suffire à lui-même, gagnerait beaucoup[220] à être débarrassé de ce cadre un peu vieillot.
La Révolution de 1848, survenant à l’heure où Pontmartin, après des débuts remarqués à la Mode et à la Revue des Deux Mondes, pouvait se croire assuré d’un succès brillant et d’une vie heureuse,—cette Révolution avait produit sur lui une impression qui ne devait plus s’effacer. Jeté soudain au fort de la mêlée, lui qui était fait pour le rêve plus que pour l’action, il avait vécu, pendant quatre ans, d’une vie ardente, fiévreuse, passionnée. Les spectacles et les émotions de ces quatre années, il les a retracés dans ce roman des Deux Érostrates, qui commence à la veille du 24 février 1848 et qui se termine au lendemain du 2 décembre 1851. Aussi bien son livre est-il moins un roman qu’une page de Mémoires. On éprouve en le lisant (pour peu qu’on oublie le fâcheux prologue) la sensation que donnent les choses vues et les choses vécues.
Sans renoncer à ces analyses du sentiment et de la passion dans lesquelles il excellait, l’auteur, cette fois, avait accordé à l’action et au mouvement du drame une part plus large; sans verser dans le réalisme, il avait donné à ses personnages une individualité plus forte et plus accentuée. M. Servais, le député, Julien Féraud, le journaliste, Nathalie Duvivier, la directrice des postes, sont des types saisis sur le vif, si réels et si vrais qu’après plus d’un demi-siècle nous les retrouvons, sous la troisième République, tels que l’auteur les avait représentés sous la seconde. Dans cette peinture de quelques-unes de nos plaies sociales, Pontmartin avait déployé[221] des qualités de vigueur et d’énergie qu’on ne lui soupçonnait pas et qui le plaçaient, au moins pour une fois, très au-dessus de son ami Jules Sandeau. Son ennemi Balzac, s’il eût vécu, aurait applaudi à ces scènes de la vie politique, à ce roman royaliste et catholique.
L’Assemblée nationale cependant n’avait plus longtemps à vivre.
Un bien averti en vaut deux. De ce proverbe, Pontmartin avait tiré une de ses nouvelles[255]; mais, sous l’Empire, au moins en matière de presse, le vieux proverbe avait cessé d’être une vérité. Un journal bien averti, loin d’en valoir deux, n’en valait plus même la moitié d’un. Il était comme un condamné mis en chapelle, et il n’avait plus qu’à attendre la venue de l’exécuteur. Ainsi en fut-il pour l’Assemblée nationale. Déjà frappée d’un double avertissement, elle fut, en juillet 1857, suspendue pour trois mois, avec défense, si elle reparaissait, de garder son titre qui avait trop l’air d’un défi lancé aux vainqueurs du 2 décembre. Lorsqu’elle reparut en octobre, elle s’intitula le Spectateur. Pontmartin y reprit ses Causeries littéraires, mais ce sera seulement pour quelques semaines. Le 14 janvier 1858, avait lieu l’attentat d’Orsini. Le lendemain, le Spectateur publia un article où il laissait entendre, en termes très légèrement voilés, que l’Empire, n’ayant pas de racines dans le pays[222] et ne tenant qu’à un homme, aurait cessé d’exister si les bombes d’Orsini avaient atteint Napoléon III. Vingt-quatre heures après, le Spectateur avait vécu.
Il ne se pouvait pas que les Causeries littéraires de Pontmartin cessassent de paraître, précisément à l’heure où il était devenu, sans conteste, le maître du genre. Plusieurs journaux sollicitèrent aussitôt sa collaboration. Celui qui était le moins riche et qui lui faisait les offres les plus modestes fut précisément celui dont il accueillit les propositions. L’Union ne peut lui donner que 75 francs par article; n’importe, il écrira dans l’Union. N’est-elle pas la feuille royaliste entre toutes, le journal de Laurentie et d’Henry de Riancey, l’ancienne Quotidienne, qui publia jadis ses Causeries provinciales?
Son premier article parut le 23 mars 1858. De même qu’il avait autrefois consacré sa première causerie de l’Assemblée nationale à Mme Émile de Girardin, de même il consacra sa première causerie de l’Union à M. Émile de Girardin, qui venait de perpétrer une comédie ridicule, intitulée la Fille du Millionnaire. L’article avait pour titre: le Fils du Millionnaire ou les Délassements d’un homme fort. C’est une des pages les plus spirituelles de Pontmartin[256].
IV
Si vifs qu’il fussent, ses succès parisiens ne faisaient point oublier à Pontmartin sa province natale, son petit village et la maison paternelle, sa maison des Angles. Il continuait d’y habiter la plus grande partie de l’année. Chaque année aussi, en août et septembre, il venait à la Mûre[257], avec son fils, passer les vacances chez l’aïeule maternelle. A vingt minutes de la Mûre se trouvait le beau château de Gourdan, appartenant au comte de Vogüé. L’intimité régnait entre la modeste villa et la demeure seigneuriale, où grandissait Eugène-Melchior de Vogüé, de trois ans plus jeune qu’Henri de Pontmartin. L’auteur des Causeries littéraires assistait avec bonheur aux jeux de son fils et du futur académicien, dont il pressentit de bonne heure le brillant avenir et dont il eut la grande joie d’être le premier à saluer les éclatants débuts[258].
Ainsi commencées dans l’Ardèche, les vacances se terminaient toujours dans le Vaucluse et dans le Gard, où de nouveaux devoirs allaient retenir de plus en plus Pontmartin. En cette année 1858, où nous a conduits notre récit, il devenait maire des[224] Angles. Comment la chose arriva, lui-même le raconte en ces termes dans une lettre à son ami Autran:
Les Angles, le 18 octobre 1858.
Voilà, cher et excellent ami, une bien longue lacune dans notre correspondance. Si je vous dis comment je l’ai remplie, il faudra ou que vous cessiez d’être poète, ce qui vous est impossible, ou que vous cessiez de m’aimer, ce qui, je l’espère, vous est presque aussi difficile. Depuis un mois, j’ai été absorbé par une crise municipale et rustique d’où je crois que je vais sortir... maire des Angles! Oui, mon ami, voilà comment finissent les ambitions humaines. On part, le bâton à la main, pour le pays de l’idéal. On rêve littérature, critique et roman; on détourne superbement sa pensée des vils intérêts de la terre. Mais les années passent; la lassitude arrive; on revient chez soi, l’aile blessée; et alors on s’aperçoit que, pendant que l’on courait le monde des idées et des songes, deux ou trois intrigants de village se sont complètement emparés du pays où l’on avait eu jadis de l’influence, et que, si on les laissait faire, ils mèneraient tout doucettement à sa ruine une fortune territoriale et riveraine sans cesse exposée et menacée. C’est ce qui m’est arrivé cette année, et il s’y est joint la conviction que, si cet état de choses se prolongeait, toute religion, toute morale, toute honnêteté étaient perdues dans cette pauvre commune que j’aime, et où j’avais toujours tâché de faire un peu de bien. Alors je suis allé me plaindre, j’ai eu affaire à un préfet[259], homme d’esprit, qui m’a dit en souriant qu’il y avait moyen d’arranger les choses, mais que quand on avait boudé pendant six ans, et que l’on demandait au gouvernement une marque de confiance, il fallait payer une petite rançon... Bref, mon cher ami, on m’a fait entendre poliment, et même avec quelques compliments fort bien tournés, qu’en acceptant la mairie des Angles, je lèverais[225] toutes les difficultés. Je me suis récrié d’abord, puis j’ai réfléchi, et j’ai fini par dire oui; si bien que j’attends ma nomination d’un moment à l’autre. Eh bien! cher ami, vous connaissez ma manie d’analyse. Je me suis convaincu, de visu, pendant toute la durée de cette tempête dans un verre d’eau du Rhône, que la chose à laquelle le cœur et l’esprit s’accoutumaient le plus aisément, c’était l’amoindrissement du cadre. Le fait est que j’ai fini par me passionner contre le sieur P..., mon féroce prédécesseur, comme je me passionnais autrefois contre feu Gustave Planche, ou contre Taxile Delord. Les marches et les contremarches de la troupe ennemie, leurs courses à Uzès et à Nimes, les péripéties de la lutte, les espérances des uns, les angoisses des autres, tout cela, mon cher ami, avait pris, à la longue, pour moi, les proportions d’un drame de la Porte-Saint-Martin ou du Gymnase, dont j’aurais été auteur et acteur. Enfin, pour passer du plaisant au grotesque, je vous dirai que tout mon sang, presque quinquagénaire, en a été tellement fouetté, agité, chauffé, que j’y ai gagné une série de clous horriblement mal placés, qui ont achevé d’accrocher ma littérature et ma correspondance. Je ne puis pas m’asseoir et, dans ce moment-ci, je vous écris sur une espèce de pupitre improvisé. Mais, grand Dieu! c’est assez vous parler de moi. Votre changement d’adresse me prouve que vous vous êtes établi à Paris, et que vous ne retournerez pas, cet automne, en Provence... Quant à moi, je suis retenu au rivage, non pas par ma grandeur, mais par mon écharpe. Je vais vous envoyer, comme précurseurs, ma femme et mon Bonapartiste[260], et j’irai vous retrouver dans le courant de décembre. Quand je songe que je perds une grande partie de votre séjour à Paris, que j’allais publier, le 1er novembre, mon cinquième volume de Causeries littéraires, que Lévy s’apprête sans doute à laisser tomber silencieusement dans son gouffre hebdomadaire; que j’aurais pu profiter à la fois de votre charmante et précieuse amitié, et[226] de cette espèce de trêve littéraire que votre salon m’a toujours offerte; quand je songe que je sacrifie tout cela au plaisir d’administrer un village de 400 âmes..., je me demande si on m’a tout à coup fait changer de nature, de goûts, d’idées, d’habitudes, en vertu de quelque avatar rustique oublié par Théophile Gautier[261]. Faut de la raison, mais pas trop n’en faut, et il me semble cette fois que les extrêmes se touchent, que jamais je n’ai été plus fou que depuis que je me crois plus sage... Adieu, je vous quitte pour mon adjoint, qui m’apporte à signer un devis des réparations de l’église; le malheureux! il a écrit réparation avec deux s, et comme je veux rester populaire, je respecte sa faute d’orthographe. Que les ambitieux sont lâches! Omnia serviliter faciunt pro dominatione.
Tout à vous; gardez-moi le secret de mes faiblesses grammaticales auprès des illustres gardiens de la langue française, et croyez-moi
Bien à vous de cœur,
Armand de Pontmartin.
P. S.—Ma nomination m’arrive à l’instant. Mon émotion m’empêche d’ajouter un seul mot[262].
L’installation de Môsieu le maire eut lieu le dimanche 24 octobre, avec accompagnement de salves, farandoles, bals rustiques, tonneaux en perce et feux d’artifice, telle à peu près qu’elle est décrite dans les Jeudis de Madame Charbonneau[263].
Ses amis de Paris raillèrent bien le triomphe rural et les lauriers villageois du Critique devenu[227] berger: quelques-uns cependant ne lui ménagèrent pas les félicitations, et Louis Veuillot joignit aux siennes de très nobles conseils. Il écrivait à Pontmartin, le 29 novembre 1858:
Mon cher ami,
J’ai reçu votre lettre par la poste d’Avignon, mais votre livre[264] n’est venu par aucune voie. Je le relirai, mais je ne veux pas l’attendre davantage pour vous remercier. Votre lettre est pleine de l’amitié que je désire de vous, j’en ai le cœur trop heureux.
Je vous loue sincèrement d’avoir permis qu’on vous fît maire. Votre curé et votre village y gagneront beaucoup, et j’ai la conviction que nous n’y perdrons point. Ce petit maniement des hommes et ce plus long séjour aux champs accroîtront votre force sans rien ôter à votre charmante et merveilleuse agilité. J’ai toujours cru et j’ai toujours un peu dit que vous étiez trop dans le monde. Vous avez été diseur de grâces, il faut devenir diseur de vérités. Tournez par là vos pensées, comme votre cœur y était dès longtemps. Vous voyez que les vérités adoucies ne convertissent guère ceux qui haïssent la vérité; elles énervent ceux qui l’aiment. A ce métier on se diminue, et l’on ne fait pas le bien que l’on pourrait faire. Il faut être ce que l’on est. Nous sommes des épées. Taillons, coupons, abattons, non pour le plaisir du carnage, mais pour protéger tant de belles et saintes choses que Dieu a voulu qui fussent derrière la beauté et la sainteté de l’épée. Opposons la noble épée au stylet. Ne rendons pas au monde l’arme que Dieu nous a donnée, mais à Dieu lui-même. Pour n’être pas accrochée dans les musées académiques, elle n’en aura pas moins son lustre, si nous aimons la gloire; et il y a une gloire qu’il faut aimer. C’est la gloire d’avoir défendu la vérité, non suivant nos intérêts ni suivant nos goûts, mais telle qu’elle est et contre[228] les amis tièdes autant que contre les ennemis. Si ce que je vous dis là, très cher ami, vous paraît encore un peu fanatique, attendez un peu, et songez-y la prochaine fois que vous irez à la messe. Voyez le temps, voyez les hommes, voyez s’il leur faut des vérités nouvelles, ou s’il y a quelque chose de trop dans la sève de la vieille vérité. Ensuite, pensez que Dieu vous a donné une voix, et qu’il ne donne rien qui ne doive servir à quelque chose. Or, il n’y a qu’une chose qui soit quelque chose, c’est la vérité. Dieu nous a confié à tous un travail à faire pour la vérité. Il nous interrogera et nous jugera là-dessus. On me reproche souvent de manifester cette pensée: vous ne me saurez pas mauvais gré de vous aimer assez pour vous la dire. Franchement, si nous ne pensons point à cela, nous ne nous distinguons guère des gens d’esprit qui font le Figaro.
Adieu, très cher ami, je désire bien que vous ne veniez à Paris que très tard ou très tôt. Je serai absent du 5 janvier au 15 ou 20 février, et je voudrais vous voir avant de partir, ou vous trouver au retour. Je ne vous dis pas où je vais. Où puis-je aller?
Votre bien dévoué en Notre-Seigneur,
Louis Veuillot.
29 novembre 1858.
Pardonnez-moi le retard de cette lettre que je viens de retrouver sur mon bureau lorsque je la croyais dans votre poche. J’ai vu votre jeune ami qui m’a paru fort bien. Il y a dans votre livre plusieurs chapitres que je ne connaissais pas. Je l’emporte à Rome[265].
L’auteur des Causeries littéraires n’eut point à regretter d’avoir accepté l’écharpe municipale. Elle lui permit de faire un peu de bien, et puis, outre[229] la belle lettre de Louis Veuillot, elle lui valut de recevoir, un peu plus tard, une épître en vers, de Joseph Autran, qui figure en bonne place sous ce titre: Mairie de village, dans les Épîtres rustiques du poète[266].
La mairie de Pontmartin devait durer six ans. Le 7 août 1864, après une longue maladie, suivie d’une interminable convalescence, il donna sa démission.
V
Pontmartin n’avait dans l’Union que deux causeries par mois[267]. Ce n’était là pour lui qu’une trop faible et trop courte besogne. Depuis longtemps il a pris l’habitude d’écrire au moins un article par semaine. Et c’est pourquoi, en même temps qu’à l’Union, il collabore au Correspondant, à l’Univers illustré, à la Semaine des Familles et au Journal de Bruxelles, la plus importante des feuilles catholiques de Belgique.
Les causeries du Journal de Bruxelles—la première[230] parut le 24 mars 1859—avaient pour titre général: Symptômes du temps. Elles étaient signées Z. Z. Z., comme l’avaient été, vingt-trois ans plus tôt, les premiers articles de Pontmartin dans le Messager de Vaucluse.
Pendant les années 1843, 1844 et 1845, Sainte-Beuve s’était fait, lui aussi, chroniqueur extra muros, hors frontières. Il envoyait régulièrement à Lausanne, à son ami M. Juste Olivier, directeur de la Revue Suisse, des articles qu’il ne signait pas[268]. Cela lui permettait de prononcer sur les hommes et sur les choses des jugements tout à fait libres et indépendants, dégagés de ces ménagements, de ces atténuations, dont souffrent la vérité et la justice. Il ne faisait ainsi qu’user de son droit. Malheureusement, il excédait toutes bornes quand, à la même heure, il couvrait le même écrivain, le même livre, à Paris de louanges publiques, et à Lausanne d’injures anonymes[269].
Avec Pontmartin, rien de pareil n’était à craindre. Il use largement, dans le Journal de Bruxelles, de son droit de dire sur les auteurs et leurs ouvrages la vérité tout entière, sans voiles et sans réticences; mais il ne se dédit pas d’un côté de la frontière à l’autre; ceux qu’il loue à Paris, il ne les dénigre pas à Bruxelles: ceux qu’il critique à Bruxelles,[231] il les critique aussi à Paris. Seulement, là-bas, les critiques sont plus vives, plus accentuées; dans ces libres causeries, l’auteur met tout son aiguillon.
Il s’attache moins, du reste, à l’examen et à l’analyse des livres, qu’à l’étude des mœurs littéraires. Les livres et le théâtre lui sont surtout une occasion de peindre la société de son temps. Ces pages où le critique cède le pas au moraliste formeraient, si elles étaient réunies, un bien curieux volume, d’une ingéniosité piquante, d’une information sûre et d’une observation malicieuse.
Dans cette chaire de Notre-Dame, illustrée par Lacordaire et le Père de Ravignan, le Père Félix[270], avec une éloquence simple et forte, avec une puissance de logique admirable, traitait, depuis plusieurs années déjà, la question du Progrès. Le progrès de l’industrie, de la science, de la machine, du bien-être, le progrès réaliseur des merveilles accomplies par l’homme seul, assez fort pour se passer de Dieu, est devenu le mot d’ordre, le symbole, le Credo d’une époque qui ne veut plus subir l’humiliation de croire, ni le chagrin de douter! A cette idole, dont le culte ne prétendait à rien moins qu’à remplacer les religions tombées, le P. Félix opposait le Progrès par le Christianisme. Il parut à Pontmartin[232] que ces belles conférences avaient plus d’importance et présentaient plus d’intérêt, même pour un simple critique littéraire, que les comédies de M. Dumas fils ou de M. Augier, que les romans de M. Feuillet ou de M. Mürger. Il leur consacra, non pas une ou deux causeries, mais tout un petit volume, qui parut en 1861 sous ce titre: Le Père Félix, Étude et Biographie[271]. C’est un de ses meilleurs écrits, celui peut-être, dont, en ses derniers jours, le souvenir lui était le plus précieux[272].
Depuis le 1er février 1855, Pontmartin avait cessé de collaborer à la Revue de M. Buloz. Celui-ci ne pouvait s’en consoler, et, toutes les fois que l’occasion s’en présentait, il essayait de ramener au foyer de la rue Saint-Benoît le chroniqueur prodigue. Il eût tenu pour une particulière victoire de le détacher du Correspondant; mais à cela il ne fallait pas songer. Il obtint seulement, dans l’été de 1861, que Pontmartin, tout en restant le critique en titre de la Revue de la rue de Tournon[273], donnerait de temps à autre des articles à la Revue[233] des Deux Mondes. Sa signature y reparut le 1er août 1861. Il m’écrivait le 14 janvier 1862:
Il est très vrai que j’ai été rappelé à la Revue des Deux Mondes avec quelque insistance par les maîtres du logis[274]; j’étais à la campagne à cent quatre-vingts lieues de la rue Saint-Benoît, et ils m’écrivirent à cette époque trois ou quatre lettres de rappel. Mais je ne m’y sens plus à mon aise; j’y perds, ce me semble, le peu d’originalité et de physionomie que je puis avoir. En outre, ma femme et mes[234] amis, sans me blâmer absolument, s’inquiètent pour moi de ces voisinages, de ces influences peu orthodoxes; aussi, sous ce rapport comme sous tous les autres, l’approbation d’hommes tels que vous m’est infiniment précieuse.
En 1861, Pontmartin publia successivement dans la Revue: les Poètes et la Poésie française en 1861[275];—Henry Mürger et ses œuvres[276];—Le Roman et les romanciers en 1861[277]; puis, le 1er mai 1862, le Théâtre contemporain.
A cette date de 1862, Pontmartin a conquis une[235] légitime et brillante renommée. Ses nouvelles et ses romans, d’une part, et ses Causeries, de l’autre, auraient suffi à faire la réputation de deux écrivains. Comme conteur et romancier, il n’est qu’au second rang; mais, comme critique, il est bien près d’être au premier. Sainte-Beuve sans doute est le maître incontesté de la critique; mais s’il n’occupe pas le trône, Pontmartin—selon le mot d’un spirituel écrivain de ce temps-là[278]—«Pontmartin est assis sur les marches, et c’est le premier de nos princes du sang». Il s’est d’ailleurs créé un apanage qui lui appartient. La Causerie littéraire est sa province, son domaine propre, que nul de ses confrères n’est en état de lui disputer. Il a l’honneur d’avoir des ennemis, mais il a l’amitié de Louis Veuillot, et aussi celle de Montalembert. Les grandes Revues lui sont ouvertes, la Revue des Deux Mondes aussi bien que le Correspondant. Les Guizot, les Cousin, les Falloux, les Villemain, les Noailles et les de Broglie, sont ses justiciables... et ses obligés. Il est sur le seuil de l’Académie; encore deux ou trois ans, encore deux ou trois volumes, et il sera l’un des Quarante.
Sainte-Beuve, qui ne l’aime pas et qui voudrait bien pouvoir faire le silence autour de lui, est obligé, précisément à cette date où nous sommes arrivés, de lui consacrer un de ses Lundis[279]. «J’ai eu, dit-il, il y a quelque temps, maille à partir avec M. de Pontmartin; je ne viens pas réveiller[236] la querelle; mais il m’est difficile d’éviter de parler d’un écrivain qui se fait lire du public et que nous rencontrons à chaque moment.»
Tout lui sourit donc; le succès lui vient de tous les côtés: mais la Fortune est traîtresse, et c’est à l’heure où il semble que Pontmartin va entrer au port, que la tempête s’élève, et va l’en éloigner. Au mois d’avril 1862, éclate la crise Charbonneau.
CHAPITRE X
LES JEUDIS DE MADAME CHARBONNEAU
(1862)
Jacques Lecoffre, Alfred Nettement et la Semaine des Familles.—Le maire de Gigondas.—Journal d’un Parisien en retraite.—Modifications et retranchements.—L’Odyssée électorale de Strabiros.—La mort de Raoul de Maguelonne.—Jules Sandeau et H. de Balzac.—MM. Taxile Delord et Ernest Legouvé.—La lettre au Figaro.—Léopold de Gaillard et Léo de Laborde.—Le Diogène et M. Jules Claretie.—Les Jeudis de Madame Martineau.—Philinte et Alceste.—Caritidès et ses Cahiers.—Où Sainte-Beuve adresse une invocation à Jupiter hospitalier.—La visite chez Marphise.—M. Ferdinand Brunetière.—Lettre de Jules Janin.—Les Vrais jeudis de Madame Charbonneau.
I
A la suite de la publication, au mois d’avril 1855, du second volume des Causeries littéraires, renfermant l’article sur Béranger, Pontmartin, nous l’avons vu, avait eu à subir un furieux assaut. Républicains et bonapartistes, libéraux et parlementaires plus ou moins victimes, cependant, du Deux-Décembre, tous avaient fait bloc contre le malappris qui, avec une telle irrévérence, parlait du[238] chantre de Frétillon et du Dieu des bonnes gens. Ce fut contre lui, dans toute la presse et sur toute la ligne, depuis le Charivari jusqu’au Siècle, un feu roulant d’imprécations et d’injures. Quand l’orage s’apaisait un peu, dans les moments d’accalmie, on se contentait de le traiter de triple jésuite et d’ennemi invétéré de «nos gloires nationales»!
L’année d’après, nouvelle bourrasque. En 1856, Balzac était passé à son tour à l’état de fétiche. Ceux mêmes qui l’avaient insulté vivant faisaient maintenant bonne garde autour de sa gloire. On ne l’adorait pas seulement pour lui-même, dans son génie et dans ses œuvres, on le saluait comme le précurseur, l’aïeul de l’école naturaliste, et les tenants de cette école, déjà toute-puissante, voulaient qu’on aimât Balzac, comme Montaigne aimait Paris, jusque dans ses verrues. Pontmartin refusa son encens à la nouvelle idole. Sous ce titre: les Fétiches littéraires, dans le Correspondant d’abord[280], puis dans le premier volume des Causeries du Samedi, il publia sur la Comédie humaine et son auteur une étude très éloquente, très vive, passionnée même, injuste par endroits, mais, par plus d’un côté, pleine de vérité autant que de courage. Et voilà que, après avoir protesté contre le fétichisme-Balzac, Pontmartin, dans le même temps, s’élevait contre le fétichisme-Hugo[281]. Cette[239] fois, la mesure était comble. La tempête de nouveau fit rage contre le malheureux critique. Il y eut, à ses dépens, redoublement d’injures et de quolibets, d’insinuations venimeuses et de gros mots. Pontmartin, très nerveux et très impressionnable, était extrêmement sensible à la critique, trop sensible même. Il ne songea pas pourtant à user de représailles. Ni en 1857, ni en 1858, l’idée ne lui vint de tirer vengeance de ses ennemis. J’ai sous les yeux sa Correspondance de cette époque, ses Lettres à Joseph Autran, à Alfred Nettement, à Victor de Laprade, celles, très nombreuses, qu’il m’écrivait et où il ne me cachait rien de ses sentiments et de ses projets. Nulle part on ne trouve un seul mot qui permette de supposer chez lui l’intention, le dessein de faire expier à ses adversaires les libertés qu’ils ont prises à son endroit, de leur rendre, sinon injure pour injure, du moins malice pour malice, ce qui lui était facile, puisque aussi bien nul n’avait plus d’esprit que lui, et de plus mordant.
Comment donc a-t-il été amené, deux ans plus tard, en 1859, à écrire les Jeudis de Madame Charbonneau? La solution de ce petit problème ne sera peut-être pas sans intérêt.
II
Au commencement de 1858, le chef d’une des plus importantes maisons de librairie de Paris,[240] M. Jacques Lecoffre, s’ouvrit à Alfred Nettement, dont il était l’éditeur et l’intime ami, de son désir de créer une Revue pour la jeunesse. Alfred Nettement en serait le directeur, et comme à l’Opinion publique, en 1848, il aurait pour principal lieutenant Armand de Pontmartin. Nettement accepta, Pontmartin, au premier instant, fit de même; mais, à la réflexion, estimant que la combinaison projetée n’allait pas sans de sérieuses objections, il en fit part aussitôt à Nettement dans la lettre suivante:
Mercredi matin (3 février 1858).
Mon cher ami,
Vous allez me traiter de girouette, mais la nuit porte conseil et je crois devoir vous soumettre quelques observations supplémentaires à notre causerie d’hier au soir: il me semble que nous nous lançons bien témérairement, en des circonstances bien défavorables, dans une entreprise bien hasardeuse...
A l’âge où nous sommes parvenus, au point de notre carrière où nous avons touché, nous ne devons pas nous dissimuler qu’un fiasco serait pour nous deux un désastre irréparable, et il pourrait y avoir un fiasco de bien des manières indépendantes de notre mérite. A quoi tient l’existence et le succès d’un journal qui repose sur deux personnes? Depuis un an, ma santé est chancelante et ma gastralgie me remonte de l’estomac à la tête. Vienne une indisposition, une inquiétude, et voilà le journal entravé et l’excellent M. Lecoffre perdant le fruit de ses sacrifices. Il y a dans ma vie des obstacles positifs et vous en avez ressenti les inconvénients dans l’Opinion publique. Ainsi, pour m’en tenir au plus prochain, je suis obligé d’aller passer huit ou dix jours à Avignon. J’ai mon syndicat des bords du Rhône,[241] dont je suis le président, et qui réclame ma présence tous les ans au mois de mai. Je vais à Vichy en juin, et à partir du 10 août, jour de la distribution des prix au lycée Bonaparte, nous nous enfuyons, ma femme, mon fils et moi, vers la montagne. Voilà quatre mois dont je ne puis disposer pour un travail régulier.
Maintenant, mon ami, voici, selon moi, la plus grande des objections. Que ferons-nous dans ce journal? Ici je ne parlerai que pour moi. Mes causeries littéraires, paraissant dans un journal quotidien[282], où il y avait mille autres choses, politique, agriculture, musique, faits divers, pouvaient suffire et même plaire: pourvu que mon lecteur y trouvât un peu de distinction et de grâce, un peu de malice, il se tenait pour satisfait. Mais essayez de transporter une de ces causeries courtoises, tempérées, louangeuses avec réserve, dans un journal paraissant tous les quinze jours et ne vivant que de cela, et ce plat bi-mensuel paraîtra fade. En d’autres termes, nous arriverons à éreinter. Qui éreinterons-nous? Les impérialistes?... Oh! la matière serait belle et riche, mais ceux-là seront protégés et nous serions arrêtés avant notre troisième numéro. Les écrivains des Débats, de la Revue des Deux Mondes? Ils y prêtent, mais, en ce moment-ci, ils sont menacés. Les écrivains de l’école révolutionnaire, démocratique, socialiste? Il y a beaucoup à dire, mais le gouvernement prendra peut-être telle ou telle mesure, d’après laquelle ceux-là aussi seront bâillonnés et proscrits. Nous ne voulons, nous ne pouvons, nous ne devons être ni des..., ni des... Ceux-là s’appuient sur le pouvoir. C’est du haut d’une citadelle qu’ils fusillent leurs adversaires. Nous, nous serions en rase campagne, à découvert, avec notre caractère naturellement poli et bienveillant que nous serions obligés de violenter. Encore une fois, la lutte ne serait pas possible, et cependant nos noms sont trop significatifs...
La fin de la lettre manque, mais la conclusion[242] se devine aisément. Pontmartin ne croyait pas devoir accepter. Quelques mois plus tard, sans revenir sur son refus de donner à la Revue projetée une collaboration régulière et suivie, il indiquait à Nettement dans quelles conditions il lui serait cependant possible d’y écrire:
Les Angles, 5 juin 1858.
Mon cher ami,
L’événement n’a que trop justifié les appréhensions qui m’empêchèrent en février dernier d’accepter les honorables offres de notre excellent ami M. Lecoffre. Il s’agissait, vous le savez, d’une publication dont l’avenir eût reposé presque tout entier sur la collaboration de deux personnes. Or, je me sentais dans une mauvaise veine; et, en effet, dès le mois de mars, j’ai été pris, sous le pseudonyme de grippe, d’une irritation du larynx qui m’a forcé de quitter Paris dans un assez triste état, le 20 avril. A présent, je vais mieux, mais mon médecin veut absolument m’envoyer aux Eaux-Bonnes, sous peine, me dit-il, de ne pouvoir, sans imprudence, affronter un nouvel hiver parisien. Je partirai donc pour les Pyrénées le 20 ou le 25 juin; j’y passerai un mois, puis je repasserai par Paris, afin d’assister à la distribution des prix du lycée Bonaparte et de rejoindre, pour les vacances, mon cher petit ménage, dont j’aurai été séparé bien longtemps. Il n’y a guère moyen de fournir, à travers toutes ces allées et venues entremêlées de verres d’eau chaude, un travail régulier et à jour fixe. Je viens d’écrire à M. de Riancey[283] pour le prier de me mettre la bride sur le cou à partir du 29 juin, et de m’autoriser à remplacer mes causeries littéraires par quelques articles de fantaisie, qui[243] pourront paraître irrégulièrement. Je vous en dirai autant pour M. Lecoffre. Du 15 juillet au 15 octobre, il me serait difficile de lui promettre des articles de critique. Je n’ai pas ici ma provision de livres, je mènerai une vie un peu nomade... Mais je ferai, dans ce genre, ce que je pourrai, et je suppléerai au reste par des articles qui me paraissent, soit dit entre nous, mieux convenir à un journal ou magazine illustré que des études purement littéraires. Ce seraient des récits de chasse, impressions de voyage, chroniques des eaux, scènes de la vie méridionale, en un mot de la littérature d’été. Si, à la rentrée des classes, M. Lecoffre persiste, je m’engagerai bien volontiers à lui donner, à son choix, une ou deux Causeries par mois...
Adieu, mon cher ami, que ne puis-je vous posséder ici quelques jours! Vous me consoleriez du mistral qui nous ruine et nous causerions de omni re scibili. Vous avez la bonté de me parler de mes articles sur M. Guizot[284]; ils m’ont donné plus de peine qu’ils ne valent, et l’illustre impénitent ne doit pas en être satisfait, car il n’a pas écrit, lui si exact en pareilles circonstances; et pendant ce temps beaucoup de royalistes me reprochaient trop de complaisance pour l’écrivain aux dépens de la politique et de l’histoire.
Comment faire? Adieu encore; pardonnez-moi tout ce verbiage; mettez-moi aux pieds de Mme Nettement et croyez-moi tout à vous de cœur.
La petite Revue cependant, le Magazine, comme l’appelait Pontmartin, achevait de s’organiser. Elle ne serait pas bimensuelle, comme il en avait été d’abord question, mais hebdomadaire; elle aurait pour titre: La Semaine des Familles, Revue[244] universelle sous la direction de M. Alfred Nettement. Le premier numéro parut le samedi 2 octobre 1858. Le 9 décembre, Nettement recevait la lettre suivante, qu’Armand de Pontmartin lui écrivait de sa maison des Angles:
Mon cher ami,
Je me bornerai cette fois à vous répondre quelques lignes, parce que je suis en train de faire mon article sur les Souvenirs de la Restauration[285] et qu’il faut que je sois prêt après-demain au plus tard. En lisant la Semaine des Familles, je me suis persuadé que le genre de travaux auxquels nous avions songé était tout à fait inapplicable à cette publication. Une causerie littéraire approfondie et détaillée, consacrée à un seul ouvrage, telle que je les écrivais dans la défunte Assemblée, telle que j’en écris encore dans l’Union, n’aurait pas convenu à votre public, ne se serait pas trouvée d’accord avec la physionomie du journal, et aurait fait, ce me semble, une singulière figure au milieu des articles signés Curtius[286], Félix Henri, Nathaniel[287], etc. J’avais cru primitivement que vous vouliez faire une œuvre analogue au Réveil[288]... Au lieu de cela, vous nous donnez un Musée des[245] Familles avec une nuance plus monarchique et plus chrétienne, mais dont le but paraîtra surtout d’intéresser les jeunes personnes et les jeunes gens. Dès lors, cher ami, je n’ai plus trop su ce que je pourrais faire pour ce journal. Des articles de théâtre ou de causerie mondaine, il n’y fallait pas songer, puisque je suis à deux cents lieues du centre. J’ai pensé à me rabattre sur la province, et je vous propose une série d’articles qui s’appelleraient les Jeudis de Mme Charbonneau. Ce serait un cadre élastique où je ferais entrer bien des choses ayant rapport à la littérature et à la société, sans trop appuyer, puis quelques courts récits, quelques détails de mœurs provinciales, quelques physionomies qui gardent leur couleur locale. Nous pourrions nous étendre et faire un volume. Sinon, au bout de quelques numéros, nous tournerions court. Qu’en dites-vous? En cas d’affirmative, écrivez-moi oui, et je vous enverrai mon premier article pour le jeudi 15 décembre...
Est-ce donc qu’enfin, à ce moment, en décembre 1858, l’idée lui est venue de mettre à mal ses ennemis littéraires et de venger ses vieilles querelles? En aucune façon. Seulement, il est arrivé ceci: le 15 octobre 1858, il a été nommé maire de son village, maire des Angles! Il peut bien avec ses amis plaisanter de sa nomination; au fond, il est véritablement et sincèrement ému, parce que ces modestes fonctions vont lui permettre de faire un peu de bien et d’empêcher beaucoup de mal dans ce village qu’il aime et où il est aimé. Et puis, à ce moment-là même, une illumination soudaine s’est faite en son esprit. Depuis un an, il se demande quel genre d’articles il pourrait bien donner à la Semaine[246] des Familles, au Magazine de M. Lecoffre. Plus d’incertitudes maintenant, plus de difficultés! Le Cadre, si vainement cherché, le voilà: Un écrivain de province, qui a eu des succès à Paris, mais que n’ont épargné ni les mécomptes ni les orages, quitte un beau jour la capitale et revient chez lui, l’aile blessée. A peine est-il de retour en sa maison, qu’on le bombarde maire du village; mais, au village, il retrouve ce qu’il vient de quitter, les passions, les ambitions, les intérêts, les ridicules, l’homme, enfin, à peu près le même partout. Pour se consoler de ses déceptions parisiennes, il lui suffira de se donner tour à tour le spectacle des scènes d’hier et de celles d’aujourd’hui, de mettre en regard les uns des autres les épisodes de sa vie littéraire et ceux de sa mairie de campagne. Sous des costumes et avec des acteurs différents, c’est au fond la même pièce, la même comédie,—la comédie humaine,—qui se joue sous ses yeux, à la ville et aux champs, à Paris et... à Gigondas!
Tel est le sujet que va traiter Pontmartin, et son dessein, à ce moment, est de ne pas appuyer sur «les choses ayant rapport à la littérature», et de développer surtout ce qui a trait aux «mœurs provinciales». Il a pour cela, d’ailleurs, deux bonnes raisons: d’une part, ses articles s’adresseront à de jeunes lecteurs, peu familiers avec les hommes et les choses littéraires, et, d’autre part, il se fait une fête de peindre avec toutes sortes de détails ces scènes villageoises si nouvelles pour[247] lui; il est encore dans sa lune de miel administrative, et il lui plaît d’en savourer les douceurs.
Nous connaissons maintenant la genèse des Jeudis de Madame Charbonneau. A l’heure où Pontmartin en jette sur le papier les premières pages, il ne se propose nullement de composer un pamphlet et de faire du scandale. Son unique but est d’écrire, en se jouant, quelques articles qui amuseront les jeunes lecteurs de la petite Revue de M. Lecoffre, et un peu aussi leurs parents.
III
Le 1er janvier 1859, la Semaine des Familles commença les Jeudis de Madame Charbonneau, avec ce sous-titre: Journal d’un Parisien en retraite. La publication dura près de deux ans. Le samedi 4 août 1860, elle n’était pas encore terminée. Ce jour-là, la Semaine contenait le chapitre sur l’installation de George de Vernay (aliàs Armand de Pontmartin) comme maire de Gigondas. La suite prochainement, lisait-on au bas de l’article. La suite, les abonnés de la petite Revue ne devaient pas la lire. Elle a pour titre, dans le volume: Comme quoi il n’est pas nécessaire, pour faire un FOUR, d’être auteur dramatique. C’est le récit des amours de Madeleine Tournut et du jeune et bel Hippolyte, le fournier de la commune. L’idylle villageoise se termine par un mariage... forcé. On[248] était, à bon droit, très rigoriste à la Semaine des Familles. Alfred Nettement mit son veto, et le chapitre ne passa pas. La fin des jeudis a paru dans l’Univers illustré.
En écrivant ses articles, Pontmartin s’était laissé aller peu à peu à modifier son plan primitif. Il comptait s’attacher surtout à la peinture des mœurs provinciales et glisser rapidement sur les scènes empruntées à la vie littéraire; mais, à peine a-t-il commencé de les esquisser que sa verve l’entraîne, que son esprit le grise, qu’il s’amuse tout le premier de ces scènes si amusantes, et qu’il ne résiste pas au plaisir d’ajouter chaque semaine à sa galerie quelque nouveau portrait. Lui qui d’abord ne voulait pas appuyer, il se trouve maintenant qu’il appuie trop. Il a tort assurément, mais de ce tort personne ne l’avertit; personne, sauf peut-être son jeune ami de Bretagne, qui ne compte guère, à coup sûr, et qui n’est, après tout, dans son coin de province, qu’un petit fabricant d’huiles et de savons. La publication, je l’ai dit, dura près de deux ans, et dans ces deux ans aucune plainte, aucune réclamation ne se fait entendre. Pontmartin en tire naturellement cette conclusion, que l’œuvre est innocente et la satire anodine. Il pourra m’écrire, en toute bonne foi, quelques années plus tard: «... Nettement me demanda quelques articles pour cette vertueuse Semaine. Pour me servir d’un mot dont on abuse, je fus d’abord tout à fait inconscient en écrivant ces chapitres qui me semblaient avoir assez peu de valeur. Ce qui contribua à me tromper,[249] c’est que la Semaine des Familles, s’adressant à un public spécial, faisait très peu parler d’elle dans la République des lettres[289]...»
Il avait si peu songé, en composant ses articles, à faire du bruit, à casser les vitres, que, les Jeudis une fois terminés, il les laissa dormir dans le petit Magazine de M. Lecoffre. Ils y restèrent en sommeil pendant près de deux ans. Bien des amis cependant l’engageaient à leur donner la publicité du livre, et lui disaient de temps en temps: «Vous avez là les matériaux d’un bien joli volume; quand le publierez-vous?» Le plus considérable de ces amis était Louis Veuillot; ses conseils finirent par l’emporter. Je lis dans la lettre que je citais tout à l’heure: «Ce fut Louis Veuillot qui me décida à publier les Jeudis...»
Ils parurent le 4 avril 1862. Les modifications que leur avait fait subir l’auteur ne laissaient pas d’être considérables; mais ces changements, bien loin d’ajouter aux malices premières, les avaient, au contraire, très notablement atténuées.
Il ne sera pas sans intérêt de relever ici les principales différences qui existent entre les articles et le livre.
Le chapitre II, dans la Semaine des Familles[290], se termine par l’indication, très sommaire, mais la plus suggestive et la plus piquante du monde, de quelques-uns des dossiers renfermés dans le portefeuille du terrible M. Toupinel: Dossier Jules[250] Janin;—dossier Alphonse Karr;—dossier Sainte-Beuve;—dossier des chroniqueurs: MM. Paul d’Ivoi, Henri d’Audigier, Eugène Guinot, Auguste Villemot, etc. Ces jolies pages ont été supprimées.
Au chapitre III, dans la lettre de Clérisseau à l’ami Toupinel, suppressions très nombreuses encore, et dont bénéficient cette fois Jules Janin et Auguste Villemot (déjà nommés), Ernest Feydeau et son roman de Fanny, Octave Feuillet et son Roman d’un jeune homme pauvre[291].
Lorsque George de Vernay retrace, au chapitre IX, ses souvenirs des premiers temps du second Empire, il parle assez longuement—dans la Semaine des Familles[292]—de la Revue contemporaine, de son directeur, le généreux Ariste (le marquis de Belleval), et du successeur de ce dernier, le jeune Cléon (Alphonse de Calonne). Tout cela est écrit de verve. Supprimé dans le volume.
Jusqu’ici cependant, tout se borne à des suppressions partielles. En voici de plus importantes.
Je trouve dans la Semaine du 10 décembre 1859, tout un chapitre sur le Figaro, sur Gorgias (M. de Villemessant), sur Mâchefer (B. Jouvin) et sur quelques autres. Figaro, ce jour-là, fut battu sur son propre terrain et avec ses propres armes; le spirituel barbier était rasé... gratis. De ces pages, pas une ligne n’a passé dans le livre.
Mais, de tous ces retranchements, les plus fâcheux, à coup sûr, portent sur les chapitres[251] parus les 2 et 16 juin 1860. Dans le premier, George de Vernay raconte avec humour l’odyssée avignonnaise de Strabiros, le directeur d’une Revue célèbre, candidat aux élections de 1849 pour l’Assemblée législative[293]. Tout ce chapitre, l’un des meilleurs du livre, a disparu.
Le chapitre suivant,—également supprimé dans le volume,—raconte la mort de Raoul de Maguelonne (Jules de la Madelène), l’auteur de cet admirable roman, le Marquis des Saffras[294]. A l’époque où Armand de Pontmartin était sorti du collège, le père de Jules de la Madelène, colonel du régiment en garnison à Avignon, logeait dans l’hôtel où habitaient ses parents, et les deux fils du colonel, Jules et Henry, tout enfants alors, étaient la joie de la maison. Après vingt-cinq ans, il se souvenait encore de leurs jolies têtes blondes, de leurs grands cheveux bouclés, de leurs frais sourires, et jamais leur nom n’était prononcé devant lui sans éveiller dans sa mémoire tout un cortège d’images riantes et printanières.
Un jour, un ami vint lui dire: «Jules de la Madelène se meurt.» Une heure après, il était[252] dans la chambre du malade, à un cinquième étage de la rue des Martyrs. Le récit des derniers instants du jeune et malheureux écrivain est d’une émotion d’autant plus poignante, qu’il contraste davantage avec les pages satiriques qui le précèdent. En voici la fin:
«Raoul! Raoul! calme-toi! Aie pitié de nous!» s’écriait son frère avec angoisse.
Cette voix fraternelle parut apaiser le moribond. Il nous regarda l’un après l’autre. La sœur de charité priait; elle avait allumé un cierge, et cette pâle lueur donnait à cette chambre un aspect plus désolé. Je pris la main de Raoul; il ne me repoussa pas, mais il me dit d’une voix qui s’éteignait de plus en plus: «Épargnez cette page... Je l’aime... d’ailleurs le papier manque... et puis... tout finit!»
Ses lèvres s’agitaient encore; mais le murmure qui en sortait n’était plus intelligible: bientôt ce murmure ne fut plus qu’un souffle; une heure après, Raoul expira.
Je me joignis à son frère, à ses amis, pour lui rendre les devoirs suprêmes. Un prêtre qui l’avait connu enfant et qui, par un coup de la Providence, avait été amené chez lui au commencement de cette maladie qui tourna si court, prononça les dernières prières. Pendant que nous pleurions notre ami en plaignant ses expériences déçues et son talent flétri dans sa fleur, il priait pour ce pauvre et faible cœur qui n’avait pas su résister à une déception littéraire, et recommandait à Dieu l’âme immortelle qui venait de briser ses liens. Le lendemain, à huit heures du soir, un fiacre nous déposait, ma sœur Ursule et moi, à la gare du chemin de fer, et je disais un adieu, éternel peut-être, à cette ville perfide et abhorrée où la mort de Raoul de Maguelonne venait de donner une consécration sinistre à mes déceptions et à mes souffrances[295].
Ce chapitre était le morceau capital des Jeudis; il était de plus le lien qui en reliait les deux parties. Il forme le nœud même de l’ouvrage, puisque c’est à la suite de la scène à laquelle il vient d’assister que George de Vernay se décide à quitter Paris et à regagner Gigondas. Pourquoi dès lors l’avoir sacrifié?
Les suppressions que je viens de signaler n’étaient pas seulement regrettables en elles-mêmes; elles avaient, en outre, cet inconvénient de créer, dans le livre, assez de vides pour que l’auteur n’eût plus la matière de ce que les anciens appelaient un juste volume, justum volumen. Ces vides, il les fallait combler. Pontmartin se trouva ainsi conduit à intercaler dans son ouvrage de véritables hors-d’œuvre, comme l’Homme bien informé et l’Invalide de lettres, et d’autres pages encore qui n’avaient vraiment rien à y faire.
En voulant «rajuster» les Jeudis, Pontmartin les avait gâtés. N’y aurait-il pas lieu aujourd’hui, dans une édition définitive, de les donner tels qu’ils furent primitivement composés, tels que Pontmartin les avait écrits de verve et de premier jet, tels enfin que les avaient publiés, en 1859 et en 1860, la Semaine des Familles et l’Univers illustré?
IV
Les Jeudis firent un bruit terrible, selon le mot de Sainte-Beuve lui-même[296]. Les amours-propres avaient été blessés, et les amours propres ne pardonnent pas. Ce fut un déchaînement général, une tempête furieuse, auprès de laquelle les orages qui avaient précédemment accueilli l’auteur des Causeries littéraires et des Causeries du Samedi n’étaient que des brises légères et de simples bonaces.
Seize ans auparavant, Pontmartin avait dédié à Jules Sandeau son premier ouvrage; il avait de même inscrit son nom à la première page des Jeudis. L’auteur de Marianna n’était pas un méchant homme, mais il était faible, et il y avait déjà longtemps que Balzac avait dit de lui, dans une de ses lettres à Mme Hanska: «Jules Sandeau a été une de mes erreurs... Il est sans énergie, sans volonté. Les plus beaux sentiments en paroles, rien en action ni en réalité. Nul dévouement de pensée ni de corps[297]...» Quand il vit Pontmartin attaqué de toutes parts, il écrivit aux journaux qu’il ne le connaissait plus. Ce fut le coup le plus cruel, le seul cruel, à vrai dire, que reçut Pontmartin au cours de cette longue et tumultueuse crise,—la crise Charbonneau. Il affectionnait sincèrement[255] Jules Sandeau; il se réconciliera bientôt avec lui et il lui donnera jusqu’à la fin de nouvelles et éclatantes preuves de sa fidèle amitié.
Balzac, en son temps, avait traversé une crise analogue. «Dans la lutte actuelle, écrivait-il en 1836, je suis seul... Je dois même rendre justice à la presse, il y a chez elle une quasi-unanimité contre moi[298].» Cela aussi, Pontmartin l’eût pu dire. Les injures pleuvaient sur lui comme grêle. Ceux qui étaient nommés dans son livre poussaient des cris de paon. Ceux qu’il n’avait pas nommés et qui se voyaient ainsi privés de leur part de célébrité, ne se montraient pas moins animés, et peut-être étaient-ils les plus violents. Ils prenaient des airs de mépris, et allaient répétant partout: Il n’a pas osé s’attaquer à moi! il eût trouvé à qui parler; il le savait bien et il s’est gardé des représailles! Mais si les attaques se multipliaient, les réclamations, en revanche, étaient rares. Il n’y en eut que deux. M. Taxile Delord et M. Ernest Legouvé demandèrent deux rectifications, portant sur deux erreurs de fait, d’ailleurs de médiocre importance. L’auteur leur donna aussitôt satisfaction, comme il convenait à un galant homme. Cela fait, et les attaques continuant, Pontmartin adressa au directeur du Figaro la lettre suivante:
Paris, le 8 mai 1862.
Monsieur,
Puisque vous ouvrez généreusement à un homme seul[256] contre tous la porte du Figaro, j’entre sans façon, et je vous demande une courte audience.
Que l’on attaque mon livre et son auteur, je serais très ridicule de m’en plaindre. Je n’ai fait qu’user du droit de représailles: qu’on en use à mes dépens sur une échelle plus grande que celle de Jacob! Liberté, liberté complète, pourvu que les blessures s’arrêtent là où l’amour-propre change de nom.
La réclamation de M. Taxile Delord a été accueillie par moi parce qu’elle portait sur un fait que j’ai reconnu vrai et qu’attestaient nos amis communs.
J’ai été mou, très mou, vis-à-vis de M. Jules Sandeau, parce qu’il me faut plus de cinq minutes pour m’accoutumer à voir dans un de mes amis les plus chers mon ennemi le plus cruel.
J’ai autorisé trois hommes particulièrement honorables à régler mon débat avec M. Legouvé, débat qui ne reposait que sur une erreur de date, étrangère à la sincérité du récit; ils avaient constaté d’ailleurs, sur des preuves irrécusables, que spontanément, sans y être invité, et pour une raison que dira ma nouvelle préface, j’avais fait, dix jours d’avance, trois fois plus que M. Legouvé ne me demandait.
Les amis de M. Taxile Delord et ceux de M. Legouvé savent et peuvent dire si je leur ai fait l’effet d’un homme qui recule devant la conséquence la plus extrême de ses actes ou de ses écrits.
En somme, pour expier mes excès de méchanceté, trois excès de modération.
Maintenant, à ceux qui seront tentés de m’en demander un quatrième, je répondrai ceci:
Voulez-vous attendre la seconde édition du livre? C’est l’affaire de quelques jours.
Êtes-vous pressé? Je le suis plus que vous; il serait inutile de réclamer d’autres explications que celles qu’on trouvera dans ma préface. Épargnez-vous donc la peine de prendre le plus long, et contentez-vous de me demander le nom et l’adresse des amis chargés de répondre pour moi: ils sont désignés d’avance et ils sont prêts.
Encore une fois, Monsieur, veuillez agréer mes remerciements et croyez à mes cordiales sympathies.
Armand de Pontmartin.
Les deux amis choisis par Pontmartin étaient Léopold de Gaillard et Léo de Laborde, ancien représentant de Vaucluse, l’un des plus énergiques députés de la droite à la Législative. L’honneur de l’auteur des Jeudis était en bonnes mains. Aucune réclamation nouvelle ne lui fut adressée, aucune demande d’explications ne se produisit.
Sa lettre du 8 mai lui avait valu parmi les jeunes de chaudes sympathies. Jules Claretie s’en fit l’interprète dans un petit journal qui ne laissait pas de tenir alors assez brillamment sa place au soleil, le Diogène. Très touché de son article, Pontmartin l’en remercia aussitôt:
Dimanche matin, 11 mai.
En toute circonstance, Monsieur et jeune confrère, je vous aurais chaleureusement remercié de votre article si bienveillant et si sympathique. Mais j’en suis particulièrement touché dans un moment critique où mes amis les plus dévoués me blâment, où les tièdes s’éloignent de moi comme d’un homme compromettant et où ceux que j’ai offensés se livrent à une irritation trop naturelle. Vous êtes jeune et courageux, mon cher confrère; vous vous êtes généreusement placé en dehors de ces colères pour juger un livre excessif, imprudent, qui peut même, çà et là, me faire passer pour méchant, mais où il y a, je crois, un fond d’honnêteté et de vérité. Si je sors intact de cette crise, j’espère bien, mon cher Confrère, que nos relations n’en resteront pas là, et vous verrez peut-être, à l’user, que je ne suis pas aussi[258] noir que j’en ai l’air. Agréez, en attendant, mon cher défenseur, avec mes remerciements bien sincères, l’expression de mes cordiales sympathies.
La petite guerre cependant continuait. Il m’écrit le 25 mai:
...Je me reprochais déjà mon silence comme une ingratitude; et voici que je reçois votre lettre, nouveau témoignage de vos attentives et fidèles sympathies. Je vous assure que j’ai bien besoin d’être ainsi soutenu par quelques amis; car ici chaque jour amène quelque alerte, quelque incident désagréable; hier soir, par exemple, on m’a annoncé que le théâtre des Variétés allait jouer, sous le titre des Jeudis de Madame Martineau, une parodie aristophanesque de mon livre, où je serai très maltraité. Ceci n’est rien, et me semble de bonne guerre; mais ce sera tout naturellement l’occasion d’un éreintement collectif dans les feuilletons du lundi suivant, et la crise Charbonneau, que je regardais comme arrivée à son terme, en sera peut-être renouvelée...
Je crains qu’il ne me soit maintenant comme impossible de faire de la critique sage et tempérée, de la littérature sérieuse, dans ces tons mixtes, fins, un peu gris, que je cherchais de préférence sur ma palette. Ce diable de petit livre rose (il est bleu à présent) sera toujours là, sur ma conscience, sinon comme un remords, du moins comme un regret, et aussi comme un de ces points lumineux et enflammés qui font paraître tout le reste froid et crépusculaire. Mais, pour le moment, je n’aspire qu’à une chose, à la campagne, au repos. Dès que je pourrai décemment quitter Paris, c’est-à-dire dans quatre ou cinq jours, j’irai, non pas chez moi,—j’y trouverais encore trop de mouvement et d’affaires,—mais chez ma belle-mère, où je tâcherai de vivre, pendant quelques semaines, d’une vie purement végétative et contemplative: car je suis exténué, accablé, brisé, à bout de forces... Quoi qu’il en soit, j’espère, mon cher ami, que cet orageux épisode resserrera encore nos[259] liens de bonne confraternité: ceux qui, dans cette circonstance, me sont demeurés fidèles, peuvent d’autant plus compter sur ma reconnaissance, qu’ils ont été plus rares. Léopold de Gaillard est à mes côtés, et m’a rendu de grands services. Nous dînons ensemble ce soir, et je m’acquitterai de vos commissions, ou plutôt je lui lirai votre lettre...
On le voit, Pontmartin, en face du prodigieux succès de son livre, au lieu d’en être enivré, en ressentait du regret, presque du remords. On le peignait comme vindicatif et méchant; il était, en réalité, l’homme le plus doux du monde, le plus bienveillant, le plus prompt à l’éloge. S’il avait mérité un reproche comme critique, c’était d’être trop indulgent, de se montrer trop coulant à dire: «Beau livre, charmant livre, excellent livre!» On l’appelait communément le Philinte de la littérature. Un jour, il est vrai, il avait remplacé ses rubans roses par les rubans verts d’Alceste; mais cela, en dépit des apparences, n’avait rien changé au fond, et le fond, chez lui, c’était la bonté.
Comme Philinte, du reste, ou, si on le veut, comme Alceste, Pontmartin était un gentilhomme. A la fin de son livre, laissant là tous les pseudonymes, à la La Bruyère ou par à-peu-près, dont il s’était servi au cours du volume, il avait mis sous chacun de ces noms de fantaisie le nom véritable.—Qui entendez-vous par Argyre? M. Edmond About.—Et Porus Duclinquant? M. Taxile Delord.—Et Polycrate? M. Gustave Planche.—Et Molossard? M. Barbey d’Aurevilly.—Et Caritidès? M. Sainte-Beuve.—Et ainsi pour tous les[260] autres. Après tout, c’était assez crâne, et on me permettra bien de mettre en regard de cette attitude les agissements de... Caritidès.
Il n’est pas un homme de son temps, illustre dans les lettres ou la politique, que Sainte-Beuve n’ait encensé, ou au moins ménagé. Il n’en est pas un qu’il n’ait dénigré, ridiculisé, criblé d’épigrammes. Seulement, les dithyrambes étaient publics, les épigrammes, les méchancetés restaient secrètes. Il les confiait prudemment à des cahiers, soigneusement renfermés dans ses tiroirs. Ainsi a-t-il fait pour Chateaubriand, Hugo, Lamartine, Alfred de Vigny, Alfred de Musset, Charles Nodier, Montalembert, Guizot, Cousin, Villemain, Thiers, Saint-Marc Girardin, Tocqueville et vingt autres. Ces notes clandestines devaient sortir de l’ombre, un jour venant, mais seulement quand leur auteur serait à l’abri de toutes représailles. C’est d’autre sorte qu’agissait Pontmartin. S’il a satirisé,—non pas ceux qu’il célébrait en public,—mais ceux qui étaient ses adversaires et qui, pour la plupart, ne lui avaient pas ménagé les attaques; s’il les attaquait à son tour, c’était en plein soleil, en face et visière levée.
Je viens de nommer Sainte-Beuve. Le 25 juillet 1862, alors que la querelle semblait enfin épuisée, il publia un grand article, dans lequel il s’efforçait de la raviver. L’article est très habile, très spirituel, très brillant, mais les accusations qu’il renferme ne sont rien moins que justifiées. Le célèbre critique insiste d’abord sur la préméditation,[261] qui ne lui paraît pas douteuse. «Il y a eu, dit-il, préméditation, s’il en fut jamais, et ruse; vous n’êtes pas un enfant, ni nous non plus; nous savons vos finesses... Vous aviez en portefeuille des portraits méchants, et, selon vous, jolis: comment les produire? C’était une affaire de tactique. Vous les avez fait d’abord filer un à un, presque incognito, sans le masque et sans clef, dans un journal honnête qui colportait vos brûlots ou pétards sans s’en douter[299]...»
Rien n’est moins exact. Pontmartin,—les faits que j’ai rappelés au début de ce chapitre, les lettres que j’ai citées, le démontrent sans réplique,—Pontmartin a entrepris son livre sans savoir quel livre il ferait, sans même savoir s’il ferait un livre. Quand il a commencé, il s’agissait tout simplement pour lui d’envoyer de la copie à la Semaine des Familles, qui lui en demandait: il ne s’agissait en aucune façon de mettre au jour des portraits qu’il avait en portefeuille. Il n’avait jamais rien en portefeuille, il ne savait pas ce que c’était que d’avoir une gardoire. Improvisateur merveilleux, il n’attendait jamais au lendemain pour produire l’œuvre de la veille. Envoyer sans retard à l’imprimeur la page dont l’encre était à peine séchée, c’était là toute sa tactique. Qu’il eût raison de toujours la suivre, je me garderai bien de le dire, mais enfin c’était la sienne. Il laissait à d’autres,—que Sainte-Beuve connaissait bien,—les[262] manœuvres savantes, les temporisations habiles et les longues préparations.
Le second reproche, ou plutôt la seconde accusation de l’auteur des Nouveaux Lundis n’est pas plus fondée que la première: «Les Anciens, honnêtes gens, écrit-il, avaient un principe, une religion: tout ce qui était dit à table entre convives était sacré et devait rester secret; tout ce qui était dit sous la rose, sub rosâ (par allusion à cette coutume antique de se couronner de roses dans les festins), ne devait point être divulgué et profané. Oh! que cela ne se passe pas ainsi avec M. de Pontmartin et sous ses marronniers[300]!» Et, continuant, il parle d’«abominable procédé», de «vraie traîtrise», de «manquement à tous les devoirs et à toutes les obligations envers Jupiter hospitalier». Et savez-vous pourquoi toute cette belle indignation, toute cette éloquente invocation aux Anciens et à Jupiter hospitalier; pourquoi Sainte-Beuve remonte, cette fois encore, sur ses grands chevaux[301]? Eh! mon Dieu, tout bonnement parce que Pontmartin a répété le joli mot de M. Buloz sur les marronniers des Angles, un mot d’homme d’esprit et qui n’était pas pour nuire à la réputation du directeur de la Revue!
Mais voilà qu’après avoir invoqué Jupiter, Sainte-Beuve invoque... le comte d’Orsay: «Un jour qu’il était ruiné, un libraire de Londres lui[263] offrit je ne sais combien de guinées pour qu’il écrivît ses Mémoires et qu’il y dît une partie de ce qu’il savait sur la haute société anglaise avec laquelle il avait vécu.»—«Non, dit le comte après y avoir pensé un moment, je ne trahirai jamais les gens avec qui j’ai dîné[302].» Ce que le comte d’Orsay n’avait pas voulu faire, Pontmartin ne l’a pas fait davantage. Le seul des personnages de son livre avec lequel il eût dîné, c’était «le célèbre conteur Eutidème»,—Jules Sandeau. Il n’en parle qu’avec la plus vive sympathie. «Dieu merci! dit-il, je suis heureux de commencer par celui-là; car, de toutes mes illusions provinciales à l’endroit de la littérature et des écrivains en renom, il en est peu qui me soient restées plus intactes. C’est une âme honnête et délicate qu’Eutidème[303]...»
Dans les Jeudis, Eutidème conduit un soir George de Vernay chez Marphise (Mme Émile de Girardin), qui est à la veille de faire représenter au Théâtre-Français sa tragédie de Cléopâtre, avec Rachel pour interprète. Nous assistons à la lecture de la tragédie, et ce n’est pas la moins jolie scène du volume et la moins malicieuse. Les juges les plus indulgents s’étonnèrent que Pontmartin eût persiflé M. et Mme Émile de Girardin après leur avoir été présenté et avoir passé quelques heures sous leur toit. La vérité est que l’auteur des Jeudis n’avait jamais mis les pieds dans le salon du petit[264] hôtel de la rue de Chaillot. «Jamais, dit-il dans ses Souvenirs d’un vieux critique[304], jamais je ne me serais permis ces railleries si j’avais été vraiment reçu par l’illustre Delphine, si j’étais resté cinq minutes dans son salon, si j’avais pris un verre d’eau chez elle! Dans mon récit, où la fantaisie alternait avec la satire, il m’avait semblé que je pouvais déplacer cette scène, qui avait eu réellement lieu le 12 novembre 1847, au foyer du Théâtre-Français, à la répétition générale de Cléopâtre. Là, j’étais strictement dans mon droit, puisque M. Buloz[305] m’avait amené pour me mettre en mesure de rendre compte de la tragédie nouvelle dans la Revue du 15.»
Au fond, dans tout cela, il y avait plus d’épigrammes que d’indiscrétions, plus de malices que de méchancetés, du sel à poignées, et souvent du plus fin, mais peu ou point de fiel. C’était une satire, très vive à coup sûr, ce n’était point un pamphlet. Un critique, qui ne pèche point par excès de faiblesse et d’indulgence, mais qui a un sens droit et une ferme raison, M. Ferdinand Brunetière, a pu dire, en toute justice et vérité, au lendemain de la mort d’Armand de Pontmartin: «Il fut de ceux à qui la vie littéraire n’a pas été clémente; et on ne peut s’empêcher de philosopher en songeant de quel prix ce galant homme, cet écrivain de race et ce critique de talent a payé[265] jadis les indiscrétions, qui paraîtraient bien innocentes aujourd’hui, de ses fameux Jeudis de Madame Charbonneau[306].»
En finissant, je ne veux retenir de cet orageux épisode des Jeudis qu’une très belle lettre de Jules Janin. Le lundiste des Débats avait été quelque peu égratigné dans le volume sous le nom de Julio; il n’en écrit pas moins à un jeune littérateur de province, M. Émile Fages, qui venait de publier un article sur le livre de Pontmartin:
Passy, 9 octobre 1862.
J’ai déjà lu, Monsieur, ces aimables pages, très ingénieuses, d’une critique indulgente et de la meilleure compagnie. Elles me sont arrivées hier; votre lettre arrive aujourd’hui comme une confirmation de vos déférences pour un bel esprit qui se trompe, et qui bien vite est revenu au respect de la profession.
Soyons des premiers, les uns et les autres, à honorer l’art de bien dire et de bien faire; et si, par malheur, quelqu’un des nôtres insulte à l’art même qu’il exerce, ayons soin de jeter sur sa faute un pan de notre manteau, gardant le reste du manteau pour nos jours de défaillance!
Et vous avez eu raison, même en lui donnant tort pour cette fois, de bien parler de M. de Pontmartin: son mérite et son talent, tout ce qu’il a fait, tout ce qu’il doit faire encore, plaident en sa faveur. C’est un grand esprit, mieux encore, un homme d’honneur, grand ennemi des forces injustes, grand partisan des libertés que nous avons perdues, opposé à toutes les usurpations de toute espèce. Les lettres françaises feraient une grande perte en perdant M. de Pontmartin.
Encore une fois, vous êtes dans les bons sentiers; vous y marchez d’un pas léger, et votre parole a l’accent vrai.
Soyez le bien remercié pour votre sympathie, et comptez sur toutes les déférences de votre ancien[307].
Toutes ces choses sont bien loin. Quand un combat s’émeut entre deux essaims d’abeilles, il suffit, pour le faire cesser, de leur jeter quelques grains de poussière. Cette bruyante mêlée, provoquée par les Jeudis de Madame Charbonneau, et à laquelle prirent part les abeilles—et les frelons—de la critique, a pris fin, elle aussi, il y a longtemps. Il a suffi, pour la faire tomber, d’un peu de ce sable que nous jettent en passant les années:
Hi motus animorum atque hæc certamina tanta
Pulveris exigui jactu compressa quiescunt.
De tout ce bruit, de cette querelle littéraire autrefois si fameuse, il ne reste plus aujourd’hui qu’un souvenir à demi effacé et un «diable de petit livre»,—non le volume rose ou bleu édité par Michel Lévy, mais celui qui parut dans la Semaine des Familles, où il faudra bien qu’on aille le chercher un jour,—un petit livre ingénieux, charmant, spirituel au possible,—et qui vivra.
CHAPITRE XI
LA GAZETTE DE FRANCE.—ENTRE CHIEN ET LOUP.—LES NOUVEAUX SAMEDIS.—LES CORBEAUX DU GÉVAUDAN.
(1862-1867)
L’Avenue Trudaine.—Frédéric Béchard et Amable Escande.—L’entrée à la Gazette de France.—M. Silvestre de Sacy.—Entre chien et loup.—La Revue des Deux Mondes et la signature F. de Lagenevais.—M. Challemel-Lacour et Mgr Dupanloup.—A Pradine, chez Joseph Autran.—Alexandre Dumas fils et les Idées de Mme Aubray.—Mort de Joseph d’Ortigue.—Aurélien Scholl, le Nain jaune et le Camarade.—Les menus de M. Bec.—Les Courriers de Paris, de l’Univers illustré.—Pontmartin est cité par le P. Félix en chaire de Notre-Dame.—Les Nouveaux Samedis, Arthur de Boissieu et les Lettres d’un Passant.—Les Corbeaux du Gévaudan.—Joseph Joubert.—Une lettre en vers.
I
Il faut bien croire que la Crise Charbonneau n’avait pas été trop meurtrière pour Pontmartin, puisque, dès le mois de juillet 1862, alors que les derniers bruits de la bataille n’étaient pas encore éteints, il publiait dans le Correspondant, sur les[268] Misérables de Victor Hugo[308], une longue étude qui est un de ses morceaux les plus achevés.
A la fin des Jeudis, George de Vernay, le maire de Gigondas, retourne dans la capitale, qu’il avait juré de ne plus revoir, et il reprend «cette vie littéraire contre laquelle tous les serments ressemblent à des serments d’ivrogne et de joueur». Ainsi fait également le maire des Angles. Il choisit même ce moment pour s’installer dans un coquet appartement, au no 8[309] de l’avenue Trudaine. Comme au 51 de la rue Saint-Lazare, il y habitera pendant huit ans, de 1863 à 1870.
L’avenue Trudaine était alors une oasis d’honnêtes gens et de maisons correctes à l’extrémité de cette montée des Martyrs, bruyante, tapageuse, mal famée, où se rencontraient, sur un trottoir étroit et boueux, toutes les variétés de vareuses rouges, de chapeaux mous, de barbes hirsutes, de chevelures en broussailles, de camisoles fripées, de pantoufles éculées, de corsages équivoques, de maquillages déteints, de chignons suspects; tout un monde de rapins, de modèles et de bohèmes, de rôdeurs de barrières et de piliers de brasserie, de déclassés, de fruits-secs et de ratés,—où la Commune recrutera plus tard ses colonels, ses chimistes et ses pétroleurs. Au haut de cette rude et orageuse montée, vous vous trouviez dans une large avenue, plantée d’une double rangée de platanes,[269] et aussitôt il vous semblait que vous respiriez un autre air:
A droite et à gauche, dit Pontmartin, une trentaine de maisons bourgeoises, régulières et proprettes. Peu de voitures. Sur de larges trottoirs, çà et là, un groupe de promeneurs; sur les bancs espacés entre les platanes, des arrière-neveux de Philémon et de Baucis, lisant tranquillement leur journal. Aux fenêtres entr’ouvertes, à travers de légers nuages de mousseline, des sourires de mamans, de fins visages de bébés agitant à la brise printanière les ballons roses des magasins du Louvre. Dans les jardins encore épargnés par la démolition universelle, dans l’épaisseur des marronniers de la cité Malesherbes, que n’habitait pas encore M. Henri Rochefort, un merle siffleur préludait aux sarcasmes du terrible lanternier. Derrière la grille des petits hôtels, on voyait des volées de moineaux se disputant les miettes de pain éparpillées par les élèves de l’École commerciale ou ceux du collège Rollin. A la sortie des classes, c’étaient des cris de joie, des gazouillements d’oiseaux délivrés de leur cage, d’amusantes poussées d’adolescents en belle humeur. Presque la campagne, au sortir du coin le plus tumultueux de la plus fiévreuse des villes; une miniature de l’Éden à vingt pas d’un diminutif de l’enfer; une vague sensation d’apaisement et de bien-être. J’ai passé là huit ans, et je dois croire que j’y étais à peu près heureux, puisque mes jours les plus néfastes étaient ceux où le Siècle me qualifiait d’idiot et où le Charivari me traitait d’imbécile[310].
En même temps qu’il quittait la rue Saint-Lazare pour l’avenue Trudaine, il transportait ses pénates littéraires à la Gazette de France.
Pontmartin se trouvait un peu gêné à l’Union,[270] où il était entré, nous l’avons vu, en 1858. Grave, solennel d’allure, souvent dogmatique, le journal de M. Laurentie n’était pas le cadre qui convenait à sa verve exubérante, à ses vivacités de plume, à ses boutades humoristiques. Dès qu’il put le faire honorablement et sans rupture, il cessa sa collaboration. Je ne lui cachai pas mon regret de le voir abandonner une feuille plus politique sans doute que littéraire, mais qui, la première parmi les feuilles parisiennes, avait accueilli ses causeries de province. Il me répondit, le 10 janvier 1863:
Ce qui m’a décidé, mon cher ami, c’est le désir de rendre service à mon compatriote Frédéric Béchard[311], qui m’avait donné des preuves de dévouement pendant la crise Charbonneau. Or, Béchard avait grande envie d’être mis en possession d’un feuilleton dramatique, ce qui est le hoc erat in votis d’une certaine catégorie d’écrivains parisiens. Nous ne voulions pas déloger le pauvre Escande[312], qui en serait mort[271] de chagrin, et Janicot[313] a mis pour condition que nous entrerions ensemble, l’un portant l’autre. Cela durera tant que je pourrai y suffire. Mais je sens que je vieillis. Je suis comme ces ténors fatigués, qui ne peuvent plus donner que certaines notes. Chose singulière! A mesure que je deviens vieux, les notes qui me resteraient, ce serait la charge, la caricature, la fantaisie en prose et même en vers, toutes choses qui ont besoin de jeunesse et qui, à mon âge, ressemblent à des anachronismes ou à des grimaces.
Sa collaboration à la Gazette de France devait durer vingt-huit ans. Il l’inaugura, le samedi 13 décembre 1862, par un article sur le roman de Sibylle, par Octave Feuillet.
Ses feuilletons de la Gazette—ils paraissaient sous le titre de Semaines littéraires—ne se ressentent aucunement—est-il besoin de le dire?—de la fatigue dont il se plaignait dans sa lettre du 10 janvier. Il est aussi en verve que jamais, qu’il parle de Louis Veuillot ou de Lamartine, de M. Ernest Feydeau ou de Mme Sand, de M. Guizot ou de M. Michelet. Il nous a dit tout à l’heure son goût, très vif en effet—et très ancien—«pour la charge, la caricature, la fantaisie en prose et en[272] vers». Son article sur la Sorcière de Michelet[314] est, en ce genre, un modèle qui sera difficilement égalé. Le jour où il écrivit ce feuilleton, il était en fortune, selon le mot de Mme de Sévigné.
Un jour que Pontmartin faisait visite à M. Silvestre de Sacy, celui-ci le gronda doucement de son engagement hebdomadaire. «Quand on écrit un article par semaine, lui disait l’académicien, c’est beaucoup s’il y en a un de bon sur quatre!» Pontmartin n’en demandait pas tant,—ce qui ne l’empêchait pas de mettre souvent quatre fois de suite dans le mille.
II
Au commencement de 1863, il écrivait encore dans le Journal de Bruxelles. D’une de ses lettres de cette époque, je détache ces lignes: «Le directeur du Journal de Bruxelles a soin de me relancer de temps en temps; les lettres que je lui adresse m’amusent, sauf à ne pas produire le même effet sur les lecteurs belges. J’y trouve une sorte de soupape pour les commérages parisiens qui ne peuvent trouver place dans ma Causerie littéraire, et j’y mêle des assaisonnements qui ne seraient pas toujours du goût de M. le comte Treilhard[315].»
Du 1er janvier 1863 au 9 juin, jour où prit fin sa collaboration au Journal de Bruxelles, Pontmartin n’envoya pas à la feuille belge moins de onze articles.
Sa grande affaire, au demeurant, était la publication de ses Causeries littéraires. Chaque année, il en donnait un nouveau volume. En 1862, 1863 et 1864, parurent les trois séries des Semaines littéraires. Pendant que s’imprimait la troisième série, il tomba très gravement malade et force lui fut d’interrompre ses Samedis. Le 27 février 1864, il fut atteint d’une fluxion de poitrine, qui mit ses jours en danger. Ce fut seulement le 10 mai qu’il put quitter Paris et se rendre chez sa belle-mère, à la Mûre, où il n’avait pas à redouter l’invasion des affaires et des visites qui, aux Angles, seraient venues contrarier sa convalescence. Celle-ci ne dura pas moins de quatre mois, passés dans l’Ardèche et coupés par une saison de trois semaines à Vichy.—«Vichy est le lieu le plus ennuyeux de la terre, m’écrivait-il le 12 juillet, et je déplore le sophisme médical qui m’a envoyé à des eaux digestives sous prétexte de réparer d’une pleuro-pneumonie l’irréparable outrage: je n’ai qu’une consolation, c’est de voir mon Empereur, dont l’état empire, plus affaissé et plus déjeté que moi...» Comme sa lettre renfermait deux ou trois calembours, j’en conclus que le mal était décidément conjuré. La rentrée aux Angles n’eut lieu qu’à la fin d’août, et il y resta six mois afin d’éviter l’hiver parisien.
Le 1er mars 1865, il réintégrait l’avenue Trudaine et préparait la publication de la première série des Nouveaux Samedis. Tandis qu’autrefois à ses volumes de critique se venaient joindre des volumes de contes et de nouvelles, depuis 1862 il semblait avoir renoncé à écrire des œuvres d’imagination. Il avait bien donné au Correspondant de 1863 un court récit, Un Trait de lumière[316]; mais c’était tout. En 1865, il revint au roman, et il y fut ramené, on va le voir, par des motifs qui n’avaient rien de romanesque.
Il m’écrivait, de Paris, le 27 avril 1865:
Laprade est parti vendredi; Gaillard annonce son départ pour mardi. Ces chaleurs si précoces et si extraordinaires mettent en fuite tous ceux qui n’ont pas à Paris une chaîne d’or, de fer ou de fleurs. Quant à moi, mes chaînes littéraires se sont multipliées et compliquées. Tous mes revenus méridionaux me manquant à la fois, je me suis effrayé, et j’ai accepté les offres de l’Illustration, qui désirait rompre avec le Siècle, son bateau remorqueur, et passer de gauche à droite. Mais je me suis embarqué dans une série fantastique qui m’effraye et où, comme Petit-Jean, ce que je sais le mieux, c’est mon commencement. Il me manque, pour y réussir, du poignet, une connaissance suffisante de l’ancien et du nouveau Paris, et une foule d’autres choses...
On était alors au plus fort des démolitions de Paris. L’œuvre était grande, utile, nécessaire même; mais les poètes, les rêveurs, les flâneurs n’y trouvaient pas leur compte. On leur donnait[275] une belle lampe toute neuve, propre et bien polie, en échange de leur vieille lampe, pleine de rouille et passée de mode; mais ils se rappelaient le conte des Mille et une Nuits, et ils se demandaient, comme Aladin, s’ils n’allaient pas perdre au troc et si cette vieille lampe, dont les débarrassait le Magicien africain,—c’est M. Haussmann que je veux dire,—n’était pas précisément la lampe merveilleuse. A mesure que le vieux Paris s’effaçait et que s’élevaient les nouvelles bâtisses, leur imagination réagissait contre cette immense débâcle de toutes les poésies du passé. Plus les boulevards s’allongeaient, plus les rues s’élargissaient, plus les façades neuves rivalisaient de monotonie et de blancheur, plus ils s’enfonçaient dans leurs souvenirs et leurs songes. C’est cet état d’âme dont la description avait tenté Pontmartin.
Il supposait un vieillard, poète ou artiste en son temps, contemporain des premiers récits d’Hoffmann et des promenades de Victor Hugo à travers la cité ou la cathédrale du moyen âge. Le chevalier Tancrède—ce sera le nom de son héros—revient à Paris après de longues années d’absence; il regarde autour de lui et se demande avec angoisse si l’âge a obscurci sa vue ou s’il est le jouet d’un cauchemar. Le berceau de son enfance, le théâtre de ses plaisirs, le nid de ses amours, le refuge de ses chagrins, tout a disparu; il ne sait pas même où loger ses regrets; il lui semble que son exil recommence sur les lieux mêmes où il vient de finir: c’était son corps qui n’avait plus[276] de patrie; maintenant, c’est son âme. Là où il ne se croyait qu’absent, il se reconnaît étranger. Bien des images perdues au fond de sa pensée s’y réveillent pour mourir encore; bien des liens qui s’étaient détendus se resserrent un moment pour se briser à jamais. Ce quartier, cette rue, cette maison, cet escalier, cette chambre, autant de figures aimées, devenues des visages indifférents; s’ils ont encore des larmes dans les yeux ou des sourires aux lèvres, ces sourires et ces larmes sont pour d’autres que lui.
Sombre, pessimiste, morose, refusant de subir le trop près et se rejetant sans cesse dans le lointain, le chevalier Tancrède vit moins avec les réalités du présent qu’avec les fantômes du passé. Les villes ont des âmes comme les hommes. Le vieux Paris a une âme; le chevalier la connaît, il l’aime, et c’est elle qu’il regrette et qu’il pleure. C’est elle qu’il essaie de retrouver dans ses longues flâneries du soir à travers un Paris bizarre, entre chien et loup, fantasque, paradoxal, humoristique, railleur, sinistre, imaginaire.
J’avais applaudi aux premiers chapitres qui avaient pour titre, dans l’Illustration, Paris fantastique, Pontmartin m’écrivit, le 9 juin 1865:
Je vous remercie de ce que vous me dites d’encourageant au sujet de Paris fantastique. Je ne savais pas trop bien, au début, où j’allais et ce que je pouvais faire; à présent, il me semble que mon idée se dessine un peu plus clairement, et j’y mets un peu de passion, ce qui est toujours une chance de réussir. Cela s’appellera, chez Michel[277] Lévy, Entre chien et loup, et si je ne m’essouffle pas trop vite, il est possible que cette série suffise au volume tout entier...
Ce fut seulement au printemps de 1866 que le livre parut. «Savez-vous, mon cher ami, me mandait Pontmartin le 8 avril, savez-vous de qui dépend la date précise de la mise en vente de mon petit volume? Des Apôtres; mais, hélas! des Apôtres revus, corrigés et naturalisés par Ernest Renan. En d’autres termes, Michel Lévy prétend que, dans mon intérêt même, je ne dois pas paraître dans la même semaine que ces nouveaux Apôtres qui absorberont, pendant huit jours, toute son activité commerciale. Soit; mais j’aimerais mieux céder le pas à un bon livre...»
D’une autre lettre, écrite quelques jours après la publication, qui eut lieu le 19 avril, j’extrais ce passage:
...Je n’ai pas du tout prétendu faire un roman. Vous avez d’assez bons yeux et vous êtes assez du métier pour avoir constaté, soit dans l’Illustration, soit dans le volume, que j’étais arrivé à la 79e page sans savoir où j’allais. Mon idée avait été d’abord de faire une série de tableaux ou de croquis où le vieux et le nouveau Paris auraient été mis en présence dans des cadres fantastiques. Je ne tardai pas à reconnaître que l’entreprise était au-dessus de mes forces, et que je n’avais pas d’ailleurs le pied assez parisien pour m’en tirer. C’est alors que j’employai le coffret d’Adolphine comme planche de sauvetage, et que je pus tant bien que mal arriver jusqu’au port. J’avais paru dans de si mauvaise conditions, mon récit avait été tellement haché et si peu remarqué dans l’Illustration, que, sans vous et Michel Lévy, je ne l’aurais peut-être pas publié en volume.[278] Vous voyez que les remerciements que je vous dois sont de plus d’un genre; certes, si j’avais reçu, l’an passé, le quart des encouragements que je reçois aujourd’hui, je puis dire que je n’aurais pas si souvent jeté le manche après la cognée et que le livre serait meilleur[317]...
L’apparition d’Entre chien et loup coïncidait avec les préliminaires de la guerre austro-prussienne. Le petit volume allait donc avoir contre lui, non seulement Renan et ses Apôtres, mais encore Bismarck et la bataille de Sadowa, Le chevalier Tancrède contre le comte de Bismarck, c’était le pot de terre contre le pot de fer. Le pauvre pot de terre ne fut pourtant pas mis en éclats. Il résista si bien que, peu de semaines après, il fallut procéder à une nouvelle édition. Ce fut, pour l’auteur, l’occasion d’écrire une très spirituelle préface. A ceux qui reprochaient à son livre de «n’être pas un roman dans l’exacte acception du mot», il répondait:
...Est-il bien nécessaire que toute œuvre d’imagination et de fantaisie soit un roman?... Faut-il croire, comme Sganarelle, que tout soit perdu si, de la première page à la dernière, ensemble et détails ne sont pas combinés, calculés, ficelés, serrés comme la cravate d’un garçon de noces, en vue du grand événement qui doit combler les vœux d’Arthur, punir les fautes de Rodolphe, châtier les faiblesses de Madeleine, et conduire le dénouement à la mairie ou au cimetière? Qui dit imagination, dit la plus indépendante des facultés humaines, et n’est-ce pas la condamner à une véritable servitude, que de la forcer à s’ajuster toujours aux[279] mêmes cadres, à entrer dans les mêmes moules, à passer par le même chemin, à trébucher dans la même ornière? Si vous aviez, comme moi, par goût de dix-huit à vingt-cinq ans, par habitude de vingt-cinq à trente, et par état de trente à cinquante-cinq, lu des myriades de romans, vous me pardonneriez d’avoir essayé de faire un roman qui n’en soit pas un.
La vérité est que le livre manque d’unité. La fin ne correspond pas au début. Commencé comme un conte fantastique, l’ouvrage se continue et se termine comme un roman: questa coda non è di questo gatto.
Ce petit volume d’Entre chien et loup n’en méritait pas moins son succès. Le chapitre sur Maria-Thérésa, sur la Malibran du Théâtre-Italien et sur la Thérésa du café Bataclan, eût suffi à le justifier. Ce n’est qu’un pastel, mais dont les couleurs n’ont point pâli, et que ne doit pas faire oublier l’eauforte glissée quelques mois plus tard par Louis Veuillot dans les Odeurs de Paris[318].
III
L’auteur des Causeries littéraires avait quitté la Revue des Deux Mondes en mai 1862. Buloz et Pontmartin ne pouvaient pas s’entendre et ils ne pouvaient pas non plus se passer l’un de l’autre. Ils ne se lassaient pas de se rechercher, de se brouiller[280] et de se raccommoder. Le 1er juin 1866, la Revue publiait un article intitulé: Symptômes du temps. La Curiosité en littérature. IDÉES ET SENSATIONS, par MM. de Goncourt. Il était signé: F. de Lagenevais. L’article était de Pontmartin; nul ne pouvait s’y tromper. Comme je lui en avais écrit aussitôt, il me répondit, le 7 juin:
...L’article sur les Goncourt est bien de moi, et vous le retrouverez probablement dans mon douzième volume. Comme j’avais été obligé de l’abréger pour des nécessités de pagination et comme je n’étais pas bien sûr que le ton général ne fût pas çà et là en contradiction avec quelques-uns de mes anciens articles sur les deux frères jumeaux de la sensation et de l’idée, j’ai accepté la proposition de Buloz, qui a été, pour la première fois, d’avis de recourir à cette élastique signature de Lagenevais. Le Lagenevais en chair et en os n’existe pas...
Le 1er juillet et le 1er août 1866, deux autres articles—l’un sur les Romans nationaux(?) de MM. Erckmann-Chatrian, l’autre sur le roman de Dumas fils: Affaire Clemenceau; mémoire de l’accusé,—paraissaient également sous la signature Lagenevais. Dans le tome IV des Nouveaux Samedis, à la suite de ces trois articles, on en trouve un quatrième, sur la Littérature pieuse, qui a son histoire. La voici, telle que l’a contée, dans une de ses lettres, Pontmartin lui-même:
Puisque vous aimez, m’écrivait-il, à connaître nos dessous de cartes littéraires, voici l’histoire de ce chapitre. Il devait paraître dans la Revue des Deux Mondes et faire suite, sous le titre de Symptômes du temps, aux trois morceaux qui[281] ouvrent ce nouveau volume. Quand je quittai Paris en juillet 1866, Buloz, qui désirait alors me rattacher tout à fait à la Revue, me demanda, presque en forme de gageure, si je me croyais capable de faire un article où, tout en restant chrétien bien sincère et bien net, je ne m’écarterais pas trop des traditions de la rue Saint-Benoît. Il paraissait y voir un moyen de conciliation; j’acceptai. D’autre part,—car je ne crains pas de me montrer à vous dans toutes mes faiblesses,—j’en voulais un peu à Mgr Dupanloup, qui, se donnant la peine de dresser un catalogue de bibliothèque à l’usage des gens du monde, y avait mis M. Roselly de Lorgues[319] (ma bête noire) et avait complètement passé sous silence mes Causeries littéraires. C’est sous cette double influence que j’écrivis mon article. Mais je perdis du temps; je fus surpris chez un de mes beaux-frères par les terribles inondations de septembre. Mon article ne partit des Angles que le 1er octobre. Buloz et ses fils étaient à la campagne; l’article tomba entre les mains de M. Challemel-Lacour[320], démagogue et voltairien pur sang, qui intercepta, pendant plus d’un mois, l’article et mes lettres, se bornant à dire à ses patrons que cela n’était nullement dans l’esprit de la Revue; si bien que M. Buloz m’a avoué en décembre ne m’avoir pas lu: mais dans l’intervalle, et à la suite des inondations, étaient arrivés les mandements et la brochure[321] de l’Évêque d’Orléans, et la situation s’était tellement envenimée, que Buloz voulait attaquer Mgr Dupanloup devant les tribunaux!!! Je repris mon manuscrit; j’aurais dû peut-être le jeter au feu; mais vous connaissez les secrètes faiblesses des auteurs; je le fis lire à mon fils, qui vaut mieux que moi. Il n’y trouva rien ou presque rien qui dût m’empêcher de le publier. Voilà toute l’historiette, mon cher ami, et maintenant vous voyez[282] combien je dois savoir gré à mes amis de laisser de côté ces questions délicates pour lesquelles je ne pouvais donner au public les explications que je vous donne. Ainsi donc, merci toujours! merci pour ce que vous dites, et pour ce que vous ne dites pas[322]!...
IV
Le 1er août 1866, nous venons de le voir, Pontmartin avait publié un article sur Alexandre Dumas fils. A l’automne, il devait se rencontrer avec l’auteur du Demi-Monde, à la campagne, chez leur ami commun, M. Joseph Autran. Le 15 octobre, ce dernier lui écrivait de La Malle, l’un de ses châteaux[323]; il en avait presque autant que le roi de Bohême:
...Dumas partira de Paris le 5 novembre et restera chez moi jusqu’au 20. Cette époque vous convient-elle, et puis-je espérer que vous serez aussi généreux que lui? Vous pourriez l’être davantage en arrivant plus tôt et en restant plus tard... Quelles intimes et charmantes réunions cela va faire! Figurez-vous que nous aurons la primeur de cette comédie que Dumas vient d’achever à peine. Il l’apporte dans sa valise. «J’ai hâte, m’écrit-il, de vous lire cette curieuse étude qui ne ressemble à rien de ce qui a été fait.» C’est à Pradine[324] que nous vous recevrons. Cela vous est égal, n’est-ce pas?...
Pontmartin n’avait garde de ne pas répondre à ce gracieux appel. La réunion eut lieu dans les premiers[283] jours de novembre, non à Pradine, mais à La Malle. L’auteur des Jeudis et des Samedis passa, dans l’hospitalière maison du poète, une délicieuse semaine[325]. Dumas lut sa comédie, les Idées de Mme Aubray. Il n’était pas seulement un habile dramaturge, c’était aussi un merveilleux causeur. Pontmartin fut charmé, mais il ne fut pas conquis. De retour aux Angles, il écrivait à Joseph Autran:
Les Angles, mercredi soir, 14 novembre.
Mon cher ami, figurez-vous que je n’ai quitté Marseille que mardi à onze heures, et encore ce diable de Dumas voulait m’emmener à Toulon, à Cannes, à Nice, à Hyères, et en mille autres lieux! J’ai triomphé de ce fascinateur et de ma propre faiblesse; je suis revenu ici, et, comme la vertu est toujours récompensée, j’ai trouvé au logis deux des plus ennuyeux visiteurs qui aient jamais franchi mon seuil... Je n’avais pas besoin, cher ami, de ce contraste pour me remémorer avec cette mélancolie inséparable de nos meilleures joies des journées trop vite écoulées et pleines de[284] votre image. Quelle semaine! quels sujets de réflexions de toutes sortes! Je ne puis, malgré mes sympathiques efforts, me rendre un compte bien net de l’impression qu’a produite sur moi le héros de la fête. C’est à peine s’il suffirait de me dédoubler pour faire le triage. L’esprit est ravi, le cœur est attristé, l’âme n’est pas satisfaite. Ce type si moderne, si profondément et si brillamment contemporain, intéresse et émeut par la peine même qu’il prend pour troubler ou tarir les sources les plus hautes et les plus pures d’intérêt et d’émotion. C’est un plongeur intrépide et robuste qui a touché du pied le fond de la mer, qu’un prodigieux élan a fait remonter à la surface, mais qui, au lieu de regarder en l’air pour jouir de la vue du ciel, des étoiles et de l’horizon, s’obstine à regarder, à travers cette onde perfide qui n’a plus de secrets pour lui, les plantes marines et le sable, le gravier et la vase où il a failli s’empêtrer et s’embourber. On lui sait gré de ce qu’il est en songeant à ce qu’auraient pu le faire sa naissance, son éducation, son premier entourage, les leçons qu’il a reçues, les exemples qu’on lui a donnés. On l’admire, on l’aime... et on le plaint... O mon ami! Nous à qui la vertu est apparue tout d’abord sous les traits d’un père et d’une mère, songeons à ce qu’il y a eu d’affreux dans cette situation où c’est une chose énorme, presque héroïque, d’être tout à fait un honnête homme, un galant homme selon le monde!
Victor de Laprade, invité lui aussi par Autran, n’avait pu se rendre à La Malle. Pontmartin lui fit part de ses impressions dans une lettre du 22 novembre:
Savez-vous ce qui m’a guéri... pour quelques mois? La société de M. Dumas fils... Voilà donc la perfection du bel esprit français de 1866, le produit le plus complet, le plus brillant, et, pour être juste, le plus propre de la société moderne, une intelligence d’élite, le Morny du coup de[285] théâtre et de la scène filée, auquel il ne manque plus que la patente et le brevet avec garantie du gouvernement! Et remarquez qu’il est charmant, que je crois même qu’il se calomnie quand il fait étalage de table rase et de matérialisme pratique; mais, grand Dieu! que sont donc les autres? Et nous, remercions le ciel de nous avoir fait naître loin de ces zones torrides, hors de portée de ces pommes d’or croissant sur les bords d’un lac empesté. Il a, lui, cinquante excuses pour une; nous, nous n’en aurions point.
Fils d’un père honnête homme et d’un fervent chrétien,
A ce Dunois du drame, ami, n’enviez rien!...
Le lendemain du jour où il écrivait cette lettre, un coup terrible venait atteindre Pontmartin et le frapper au cœur. Sans que rien l’y eût préparé, il apprenait la mort de Joseph d’Ortigue[326], l’éminent critique musical, son compatriote et son plus intime ami. Il m’écrivit le 28 novembre:
...Le 23, j’ai été foudroyé en ouvrant le Journal des Débats, par le plus grand des hasards, et en y lisant, sans préparation aucune, un article de M. de Sacy qui annonçait la mort subite de mon pauvre vieil ami d’Ortigue. Il y a de cela cinq jours, et je ne puis encore revenir de ma douloureuse stupeur, je ne puis m’accoutumer à l’idée que je ne reverrai plus ce compagnon si bon, si fidèle, si sympathique, de mes saisons laborieuses et de mes vacances, l’homme dont les sentiments, les goûts, les rêves s’accordaient si bien avec les miens qu’on nous appelait les inséparables. Vous lirez dans la Gazette de samedi prochain l’hommage que j’ai[286] essayé de lui rendre. Je n’ai pas dit la moitié de ce que j’aurais dû et voulu dire: il m’aurait fallu une feuille de Revue, et l’on m’aurait répliqué sans doute que d’Ortigue n’était pas assez célèbre pour justifier une si longue notice. Enfin, je suis allé au plus pressé.
Pardonnez-moi, mon cher ami, de vous parler si longuement d’un homme que vous ne connaissiez pas, et d’une douleur que vous ne pouvez partager. Je suis tellement plein de mon sujet qu’il m’arrive plusieurs fois dans la journée de sentir des larmes me venir aux yeux, de ne pouvoir les retenir et d’être obligé d’interrompre ce que j’écris ou ce que je fais. En face de cet avertissement, je suis bien peu tourné du côté des vanités littéraires, bien peu disposé à vous écouter lorsque vous me parlez de l’Académie, comme vous le faites encore dans votre dernière lettre...
Quelques jours après, je recevais l’article de la Gazette; je me reprocherais de n’en pas reproduire ici les dernières lignes, si vraiment belles et si touchantes:
...L’auteur de la Messe sans paroles, s’il a pu se reconnaître avant de mourir—ce que j’ignore encore en écrivant ces lignes!—aura eu le droit de se dire que, pendant trente-sept ans de journalisme, il n’avait pas publié un mot offensant. Rassurante pensée, appréciable surtout pour ceux à qui il sera impossible de se rendre le même témoignage! Pour moi, aussi faible qu’il était fort, aussi nerveux qu’il était doux, aussi mauvais qu’il était bon, sans renseignements sur sa mort, exilé à deux cents lieues de cette maison en deuil, je n’ose encore mesurer l’étendue de ma perte: je craindrais de le pleurer en égoïste, au lieu de le pleurer en ami. A Paris, nous nous quittions le moins possible, et ce que je connais le mieux dans la grande ville, c’est la rue qui mène de ma porte à la sienne. Ici, chaque année, aux vacances, il me devait une longue visite; il était heureux de[287] s’acquitter de sa dette, et, depuis ma vieille servante jusqu’à mon vieux chien, tout se mettait en fête pour le recevoir. Journées radieuses et charmantes qui ne reviendront jamais! Échange inépuisable d’idées, de sentiments, de récits, de confidences, de raison et de folie! Perdu tout cela, perdu pour toujours! Une mort comme celle-là, c’est un pas de plus que fait l’ombre de la nuit pour envahir l’ami qui reste. Bon et cher Joseph! «Je n’ai plus ni soir ni matin!» disait d’Alembert en perdant une de ses vieilles amies. C’est avec un autre battement de cœur, un autre déchirement d’amitié et un autre recours vers le ciel, que je te dis: «Sans toi, il me semble que la ville et la campagne, que Paris et la province vont me manquer en même temps[327]!»
V
Au milieu de décembre, Pontmartin regagnait Paris, où il ne devait plus, hélas! retrouver son cher d’Ortigue. Il reprenait ses chaînes et multipliait plus que jamais sa copie. On retrouvait un peu partout sa signature, même dans un petit journal dirigé par Aurélien Scholl[328], le Camarade. Autran ne laissa pas d’être surpris et quelque peu scandalisé. Une lettre de Pontmartin, du 20 février 1867, lui donna le mot de l’énigme:
Mon cher ami,
Tu quoque...et vous aussi, vous avez cru que j’écrivais dans le Camarade! Hélas! j’expie encore, en 67, mes sottises[288] de 62. Après cette crise, cherchant quelques appuis dans la petite presse dont les piqûres avaient fini par être pour moi ce que sont les tavans et les moustiques pour les rosses les plus paisibles, cédant d’ailleurs aux instances de Frédéric Béchard, je consentis à donner cinq ou six articles au Nain Jaune: quelques mois plus tard, la chose tomba d’elle-même. Mais M. Aurélien Scholl, que je n’ai pas vu depuis deux ans, et qui est devenu le fondateur ou le rédacteur du Camarade, trouve commode et économique d’y répéter, sans me consulter, les vieux articles du Nain Jaune; voilà toute l’histoire...
Le beau-père d’Autran, M. Bec, était célèbre sur tout le littoral de la Méditerranée par l’exquise finesse de son goût et le génie de son cuisinier; il aurait rendu des points à Brillat-Savarin et à Grimod de la Reynière, et c’est lui qui fut l’inventeur des trois côtelettes grillées l’une sur l’autre, et dont un gourmand ne mange que celle du milieu. Le poète avait hérité du Chef de son beau-père, et c’est sans doute en souvenir des plantureux menus de La Malle, de Pradine et de l’hôtel de la rue de Montgrand, que Pontmartin ajoutait, dans sa lettre du 20 février:
Là-dessus, cher ami, je vous quitte; voici, d’aujourd’hui au 20 mars, date mémorable! mon menu qui ne vaut pas ceux du baron Brisse:
Samedis de la Gazette, purée à la Chambord.
Mercredis de l’Univers illustré, sauce aux câpres, pointes d’asperges au gros sel.
Une notice sur M. Thiers pour l’Illustration; salade composée (se mange avec des oublis).
Un roman pour le Figaro, flanqué de petits fours!
Et tout cela parce qu’un chimiste a inventé la fuchsine, parce que pour moi fuchsine rime avec ruine, en ce sens que cette poudre tue à tout jamais nos garances.
Pontmartin parle ici de ses mercredis de l’Univers illustré, où il faisait à ce moment le Courrier de Paris, pour suppléer le courriériste en titre, M. Paul Parfait[329], absent ou empêché. Outre qu’il obligeait ainsi son éditeur et ami M. Michel Lévy, le propriétaire du Magazine, ces chroniques, où il excellait, l’amusaient. Trois ans de suite—1866, 1867, 1868—il lui arriva de faire, pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines, l’intérim de M. Parfait. Son nom, d’ailleurs, ne paraissait pas. Les Courriers de Paris étaient uniformément signés Gérôme. Mais quand Pontmartin tenait la plume, les lecteurs s’apercevaient bien vite qu’on leur donnait, non plus seulement du Parfait, mais du plus que parfait.
Les Idées de Mme Aubray, dont les hôtes de La Malle avaient eu la primeur, furent jouées au Gymnase le 16 mars 1867. Quelques semaines plus tard, Pontmartin rendait compte en ces termes, à Autran, de la première représentation et de ses suites:
...Vous parlez d’Alexandre Dumas fils et de sa pièce; ne croyez pas à un succès aussi complet que celui qu’on pourrait supposer d’après certains articles et d’après l’effet[290] voulu de la première représentation. La salle avait été admirablement composée; les deux premiers actes avaient charmé, mais les deux derniers rencontraient une résistance qui n’a cédé que lorsque le rideau s’est relevé et qu’on a nommé l’auteur. A dater de la quatrième représentation, la réaction a commencé et dure encore; l’impression du public raisonnable est celle que nous avions vaguement éprouvée et dont je vous faisais l’aveu, le lendemain de la lecture: un sujet impossible, révoltant même, traité avec une habileté prodigieuse. Si le rôle de Barantin n’avait pas été joué par Arnal, qui est merveilleux, et si la pièce avait été terminée, comme elle l’était en novembre, par le mot enfantin de Lucienne: «Mon bouvreuil est guéri!» je ne sais pas trop ce qui serait arrivé. Le: «C’est égal, c’est raide!» adopté à la dernière répétition générale, a tout sauvé; le public, voyant qu’Arnal était de son avis, s’est tenu pour satisfait.
Croiriez-vous, mon cher ami, que je n’ai plus revu le triomphateur? D’une part, j’ai eu honte de ne pas être chargé, comme il s’y était attendu, de rendre compte de Madame Aubray dans la Revue des Deux Mondes[330]; de l’autre, j’étais écrasé de travail pendant qu’il passait, du moins je le suppose, des fatigues du Gymnase aux émotions de sa nouvelle paternité; et puis l’avenue Trudaine est bien loin de l’avenue de Wagram; et puis les courants de la vie parisienne et littéraire nous entraînent en sens divers; le Père Félix vient de me citer en chaire dans la même conférence où il éreinte l’Affaire Clemenceau; et puis les vitrines des papetiers, sous ce titre ébouriffant: Menken, sa mère et Alexandre Dumas père, nous montrent une série de photographies d’une telle indécence, que ce nom populaire en est[291] encore compromis... Tout cela rend bien difficile ce qui nous semblait si simple sous le beau soleil de Provence, dans ce cadre offert par votre charmante hospitalité. Mais me voilà, mon cher ami, en plein bavardage, et j’oublie que vous aurez peut-être quelque peine à me lire[331]; j’ai tant de plaisir à vous écrire! Guérissez-vous vite, arrivez-nous! L’Exposition paraît mieux tourner depuis quelques jours et devenir intéressante; le temps s’adoucit; le soleil ne garde plus l’anonyme; Gaillard est ici jusqu’au 15 mai, et Laprade va revenir[332]...
Le Père Félix, en effet, dans sa quatrième conférence de 1867, qui fut prononcée le 31 mars et qui traitait des causes de la décadence artistique, avait cité Pontmartin et l’avait fait en ces termes: «Pour assurer ces succès deux et trois fois honteux qui humilient ensemble la littérature, l’art et l’humanité, vous savez les puissances qu’on invoque: entre toutes, ces quatre choses qu’un critique justement illustre[333] a si bien nommées ‘les quatre grandes puissances de la littérature contemporaine: l’Annonce, l’Affiche, la Prime et la Réclame[334]’».
Etre cité en chaire, devant un auditoire tel que celui de Notre-Dame, c’était pour l’auteur des Causeries littéraires, la plus enviable des récompenses.[292] Presque au même moment lui arrivaient d’autres éloges qui, pour venir de moins haut, ne laissaient pas d’être de quelque prix. Au mois de juin 1867, il publia le tome IV des Nouveaux Samedis. Le très spirituel Arthur de Boissieu[335] lui consacra une de ces Lettres d’un Passant qui obtinrent, à la fin du second Empire, un si légitime succès, si fines, si vivantes, si sérieuses sous leurs airs d’enjouement et de badinage. Il louait en Pontmartin «le goût qui choisit, l’esprit qui charme et l’art d’écrire aussi juste qu’il pense». Il vantait «son amour des lettres humaines, sa fidélité aux croyances embrassées, et cette noblesse native qui, dans le cours d’une vie honorable et longue, l’avait tenu à l’abri des défaillances et au-dessus du soupçon». Puis venait cette page:
M. de Pontmartin est un incomparable charmeur. Il prend le lecteur par la confiance qu’il inspire et le retient par la grâce qu’il déploie. Il a la force de se contenir et l’art de se diriger. Il se développe avec calme comme une rivière au long parcours qui ne retarde sa marche qu’afin de donner à ses flots plus d’espace pour féconder la terre et réfléchir les cieux. Il sait son chemin, et s’il s’en détourne parfois, c’est pour décrire plus de terrains et embrasser plus d’horizons. Sa critique observe, découvre, conclut et crée. J’oserais lui reprocher quelques faiblesses amicales et certaines[293] indulgences partielles qui partent de son cœur et non de son esprit; mais comme il revient vite à l’impartialité première qui est le fond de sa nature et le signe de son talent! En parlant de ses amis, il ne cesse pas d’être vrai, mais il devient prodigue; sans leur retrancher aucune des qualités qu’ils possèdent, il leur suppose celles qui leur manquent ou leur prête celles qu’il a. Même en supposant, il reste juste; même en prêtant, il reste riche[336].
VI
Dans sa lettre à Autran, du 20 février, Pontmartin lui parlait d’un roman qu’il écrivait pour le Figaro. Il s’agissait des Corbeaux du Gévaudan qui furent publiés en feuilleton, dans le journal de la rue Rossini[337], du 26 avril au 3 juin 1867.
Le 19 août 1858, dans son rapport à l’Académie française sur les prix de vertu, M. Saint-Marc Girardin avait raconté une touchante histoire:
En 1821, disait-il, un affreux assassinat fut commis à Joucas (Vaucluse), sur la personne de la veuve Boyer. Un paysan de ce village, nommé Durand, fut accusé d’avoir commis le crime.
Beaucoup de témoignages se réunirent contre lui; cependant, il fut acquitté à une voix de majorité. Durand, pendant les débats, avait toujours protesté de son innocence. Quand le verdict du jury fut prononcé, la femme de Durand, qui était convaincue que son mari n’était pas coupable,[294] s’avança devant le siège des magistrats, et, la main levée, prenant le Christ à témoin, elle s’écria:
«—Mon pauvre mari est acquitté, mais il n’est pas lavé; il est complètement étranger, je le jure, au crime affreux qu’on lui a imputé par suite de machinations infernales, et je prends ici l’engagement solennel, devant Dieu qui m’entend, et devant vous, messieurs, qui êtes les représentants de sa justice sur la terre, d’amener bientôt sur ce banc d’infamie les véritables auteurs de l’assassinat de madame veuve Boyer.»
...Pendant sept années entières, la femme Durand a partout épié et surveillé ceux qu’elle soupçonnait d’être les coupables, allant dans les foires, dans les marchés, causant, questionnant, interrogeant tout le monde, rassemblant patiemment tous les indices, et, chaque jour de marché, allant à Apt communiquer ses découvertes aux magistrats. Un jour enfin en 1828, ayant surpris par hasard un signe d’intelligence entre les nommés Chou et Bourgue, qui, plus tard, furent condamnés comme étant les vrais assassins de la veuve Boyer, elle les vit s’acheminer vers une maison isolée, près du village de Joucas; ils y entrèrent et s’y renfermèrent.
Madame Durand pensa que, si elle pouvait les entendre causer ainsi tête à tête, elle parviendrait à surprendre dans leur entretien le secret qu’elle poursuivait depuis si longtemps, le secret de l’innocence de son mari. La nuit arrivait. Madame Durand se glisse près de la maison, gravit un mur, arrive près de la chambre où se tenaient les deux hommes, se suspend à un treillage en fer qui montait près d’une croisée, et comme les contrevents n’étaient qu’à demi fermés, elle voit et elle entend Chou et Bourgue, qui avaient une de ces conversations qu’ont presque toujours entre eux les complices d’un crime. Bourgue accusait Chou d’être bavard et d’avoir trop parlé; Chou demandait à Bourgue de l’argent pour se taire, et Bourgue, qui était le plus riche des deux assassins et le gendre même de la victime, Bourgue payait cette fois encore le silence de son complice.
Enfin, madame Durand était maîtresse du secret des coupables; elle pouvait justifier de l’innocence de son mari. Dès le lendemain, elle allait à Apt tout révéler au procureur du roi. Une nouvelle instruction avait lieu, onze accusés étaient traduits devant la cour d’assises à Carpentras; deux de ces accusés, Chou et Bourgue, étaient condamnés à mort, et les autres à des peines plus ou moins fortes. Enfin, surtout, l’innocence de Durand, l’ancien acquitté, était hautement proclamée par le magistrat qui portait la parole au nom de la société.
L’acquittement de Durand était de 1822; la condamnation de Chou et de Bourgue était de 1829. Madame Durand avait mis sept ans à rechercher et à découvrir la vérité qui devait réhabiliter son mari; sept ans de peines, de fatigues, de dangers, de soins, d’intelligence, de courage, de dévouement,—et, au bout de sept ans, un jour de joie et d’honneur!...
Joucas n’est pas loin d’Avignon, et Pontmartin, dans sa jeunesse, avait entendu raconter bien souvent les péripéties de ce drame étrange, tous les détails de cette enquête de porte en porte, poursuivie pendant sept ans par une héroïque villageoise, ces nuits sans sommeil employées à épier les coupables, cette maison isolée, cette croisée entr’ouverte, ce treillage en fer. A ces détails romanesques, mais d’une stricte vérité, l’imagination ou la tradition populaire avait ajouté un détail plus extraordinaire encore que tout le reste, dont M. Saint-Marc Girardin n’avait pas parlé, et qui eût été cependant à sa place à l’Académie, puisqu’il était renouvelé des Grecs et rappelait l’épisode des grues d’Ibicus.
Lorsque Chou et Bourgue avaient assassiné, au[296] milieu d’un champ, la veuve Boyer, un vol de ces corbeaux de passage aux ailes grisâtres, qu’on appelle graïo dans le pays, avait traversé l’espace, au-dessus du champ maudit. La victime les vit:
—Li graïo lou diran[338], dit-elle d’une voix expirante, et ses yeux se fermèrent.—Plus tard, à la cour d’assises, ce souvenir avait arraché à l’un des assassins le suprême et décisif aveu. Tremblant la fièvre, les yeux égarés, la face déjà couverte des pâleurs de la mort, le misérable, fou de terreur, avait cru voir passer au fond de la salle le vol de corbeaux. «Je les vois, dit-il, ils passent, ils passent... Li graïo lou diran.»
Pontmartin avait un peu modifié le drame de 1821. Du paysan Durand, acquitté à une voix de majorité, il avait fait le garde-chasse Jacques Boucard, condamné aux travaux forcés à perpétuité; de la femme Durand, il avait fait Suzanne Servaz, la fiancée de Jacques. A cette transformation, certes, le roman n’avait rien perdu. Courageuse et touchante, sublimement sainte, pathétique et vraie, Suzanne rappelle, sans avoir trop à souffrir de ce voisinage, la Jeannie Deans de Walter Scott et la Colomba de Mérimée. Quand parut le volume, la critique lui fut indulgente: Dat veniam corvis nec vexat censura Columbas.
Les Corbeaux du Gévaudan sont dédiés à Frédéric Béchard. Béchard, qui possédait à un assez haut degré le sentiment dramatique et qui avait eu[297] des succès au théâtre, avait donné à Pontmartin d’utiles conseils; c’est un peu grâce à lui que l’auteur d’Aurélie et du Fond de la Coupe avait compris qu’il avait, cette fois, à sortir de ses habitudes d’analyse, qu’un pareil sujet ne comportait pas de subtilités psychologiques, qu’il fallait aller droit au but, montrer les événements et les personnages par le dehors; que c’était, en un mot, par l’action que devait se dessiner le caractère.
Il y avait eu, au début, entre les deux écrivains, une ébauche de collaboration, mais une ébauche seulement. Pontmartin m’écrivait, le 11 mai 1867: «Un mot, rien qu’un mot, car me voilà gagné de vitesse par le Figaro et ne sachant plus où donner de la tête. Ma collaboration avec Béchard n’a été bonne qu’à me faire perdre plus de temps, de papier et d’écritures. En réalité, c’est moi qui ai tout fait».
Un des principaux dramaturges de l’époque, M. Eugène Grangé[339], fournisseur attitré de la Porte-Saint-Martin et de l’Ambigu, qui avait déjà tiré d’une cause célèbre, celle de Fualdès, une pièce très réussie, avait été frappé des éléments de succès que les Corbeaux du Gévaudan pourraient trouver à la scène. «Les Corbeaux s’impriment, m’écrivait [298]Pontmartin le 1er septembre... Je ne sais si je vous ai dit qu’il est question d’en faire un drame, et que M. Eugène Grangé m’a demandé pour cela des autorisations que je me suis empressé de lui donner?»
Les Corbeaux avaient des ailes; ils franchirent la frontière, et il en parut des traductions en Espagne et en Allemagne.
L’année 1867 avait été bonne pour Pontmartin. Ses lettres de cette époque respirent un vrai contentement; celles à Joseph Autran sont particulièrement enjouées. Autran est à Vichy, où il voit tous les jours madame Vve Heine, qui lui parle souvent de Pontmartin, dont elle achète religieusement et dont elle fait magnifiquement relier tous les volumes. Le poète ne manque pas d’en informer son ami, qui est resté à Paris malgré l’Exposition, malgré le Grand-Turc qui vient d’arriver. Et Pontmartin de répondre aussitôt. Il date ainsi sa lettre: Paris-Byzance, je ne sais quelle date de l’Hégire, et, pour ces chiens de Chrétiens, le 1er juillet 1867. Après quelques détails sur la chronique parisienne, arrivant à madame Heine, il lance, sans crier gare, un des plus énormes calembours qu’il ait jamais risqués: «Que ne suis-je auprès de vous, dit-il, non loin de cette bonne veuve, qui me paraît avoir autant d’indulgence que de millions! Vous savez qu’elle a un intendant qui s’appelle Laroche. Si cet intendant lui fait attendre l’argent qu’il doit lui envoyer, on pourra dire: La Roche-tard-paie-Heine... Mais j’oublie que le Grand-Turc est dans[299] nos murs, et qu’on a étranglé des visirs ou jeté des femmes dans le Bosphore pour moins que cela! C’est in-sultant, un pareil degré de bêtise! donc, je me sauve, en vous remerciant encore...»
Joubert, l’ami de Chateaubriand, écrivait parfois ses lettres en vers, mais en vers libres[340]. Il arrive à Pontmartin, quand il est en belle humeur, de remplacer sa prose par des alexandrins auxquels la rime, et même la rime riche, ne manque pas plus que la mesure. Ainsi fit-il, par exemple, le 6 décembre 1867. Le 2 mai précédent, les cléricaux de l’Académie avaient préféré M. Jules Favre au royaliste Autran, et voilà que le nouvel élu venait de prononcer, au Corps législatif, un violent discours contre Pie IX et le pouvoir temporel[341]. Pontmartin en informe aussitôt Joseph Autran; il conserve à sa lettre la physionomie de la prose; il se trouve pourtant qu’elle est écrite en vers. En voici la fin:
...Comment rester fidèle à ma cause, à ma foi? On me parle de Dieu, du Pape et de mon Roi... Bien; mais voici venir un détail qui me navre: On nomma, l’an passé, le fameux Jules Favre. Qui le nomma? Falloux, Montalembert, Berryer, Laprade, Dupanloup, tressèrent son laurier. Aujourd’hui, son discours qui me froisse et me choque, du pouvoir temporel publiquement se moque. Préférer ce bavard à mon poète Autran, n’est-ce pas trop haïr l’infortuné Tyran, pauvre Machiavel compliqué de Gribouille, dont l’étoile pâlit, dont le cerveau s’embrouille, et qu’Arthur de[300] Boissieu, l’homme du vendredi[342], persifla récemment dans un conte hardi[343]? Pour notre âge de fer en contre-sens fertile, le mal seul est fécond, et le bien est stérile. Un mensonge s’accroche à chaque vérité. Vous êtes libéral... Vive la liberté!... soit; mais que faites-vous de certaine Encyclique qui de quatorze cent date sa politique? La Révolution vous blesse; ses abus vous semblent révoltants? Alors le Syllabus dit vrai; soumettons-nous, dépouillons le vieil homme, et que 89 aille le dire à Rome!—ô cercle vicieux, même pour la vertu! Dieu, que dois-je penser, et de moi que veux-tu?... Un sphinx chaque matin veille devant ma porte. Faut-il interroger l’énigme qu’il m’apporte? Il me dévorera, si je devine mal, dût ma vieille carcasse être un maigre régal. Si je devine bien, hélas! qu’y gagnerai-je? Pourrai-je triompher du trouble qui m’assiège? Si le mot est Peut-être, il vaut mieux l’ignorer; mieux vaut croire et bénir que maudire et pleurer. Plutôt que de hanter le dangereux dédale, mieux vaut s’agenouiller humblement sur la dalle, crier: Meâ culpâ! je suis un grand crétin, puis dire à mon ami: Tout à vous,
Pontmartin.
CHAPITRE XII
LA REVANCHE DE SÉRAPHINE
LES TRAQUEURS DE DOT
(1868-1870)
Élection d’Autran à l’Académie. Chasses dans la Crau et la Camargue.—Mlle Rachel et Ponsard, Pernette et Victor de Laprade.—M. Victorien Sardou et la Dévote. La Revanche de Séraphine.—Mort de Lamartine et de Sainte-Beuve.—Les Traqueurs de dot et le Figaro.—L’Empire libéral. Prévost-Paradol. La guerre et la Marseillaise, Paul Chevandier de Valdrôme. Histoire d’une décoration.
I
Au commencement de 1868, Pontmartin eut encore une vraie joie: elle lui vint de l’Académie. Il n’avait pas voulu s’y présenter; il avait repoussé toutes les avances que lui avaient faites les maîtres du logis. Mais cette immortalité dont il ne voulait pas pour lui-même, il la désirait ardemment pour un autre, pour son cher Autran, que minait depuis longtemps la fièvre verte et qui tenait pour rien et son hôtel de la rue de Montgrand[344], et La Malle et[302] Pradine, et ses autres domaines, tant qu’il ne serait pas assis sous la coupole du Palais-Mazarin. Pontmartin qui, depuis plusieurs années, multipliait en sa faveur les visites et les lettres, eut enfin la satisfaction de pouvoir lui adresser, le 24 février 1868, ce bulletin de victoire:
Je vous dirai que votre nomination est certaine, indubitable. M. Guizot lui-même l’a dit à Michel Lévy, en ajoutant que, cette fois, il était heureux de pouvoir se joindre à ses excellents collègues, Mignet, Thiers et Berryer. Ces deux derniers ont en ce moment une telle prépondérance, un tel regain de popularité et de gloire, que, s’ils le veulent bien, ce n’est pas la majorité que vous devez avoir, mais la quasi-unanimité. De cette façon, la réparation, quoique tardive, sera complète[345]...
Joseph Autran fut élu le 7 mai 1868 en remplacement de Ponsard.
A la fin de mai, après avoir publié la cinquième série de ses Nouveaux Samedis, Pontmartin quitta Paris pour le Vivarais, où l’appelait le mariage d’une de ses belles-sœurs. Les mariages de province ne se font pas aussi vite que ceux de vaudeville, et il resta près de deux mois, à la Mûre, aux environs d’Annonay. «Cette ville, écrivait-il à un ami, offre ce trait particulier que tous les habitants s’y occupent, jour et nuit, à manger du chevreau. Pourquoi? Parce que le chevreau, complet, se vend 2 fr. 75 centimes; quand on l’a mangé, la peau, si elle est réussie, se vend 3 francs: il y a donc un[303] bénéfice net de 25 centimes—le prix d’un londrès—à dévorer cet animal innocent, qui n’est pas beaucoup plus mauvais que le chat, et qui, en outre, rappelle une foule de souvenirs virgiliens, bibliques et bucoliques[346]...»
La vie lui était du reste très douce à la Mûre. «Ma femme et ses sœurs, écrivait-il encore, ont voulu me ménager ici un ou deux mois de repos, de laitage, de fruits rouges, de promenades ou de haltes dans les bois d’essences résineuses, et même d’installation dans une étable à vaches, assez helvétique, où on m’a posé, dans un coin, une petite table avec tout ce qu’il faut pour écrire. Je ne me plains pas; car la campagne est délicieuse, et je réalise ici l’idéal qui me manque complètement aux Angles: la vie rurale sans affaires.»
Il passa le mois de juillet aux eaux de Vals. Cette année 1868 paraît d’ailleurs avoir été pour lui une année de repos... relatif. Quand vint l’automne, il se livra tout entier à son plaisir favori. Chaque matin, avec ses deux chiens, Flore et Diavolo, il se lançait à la poursuite de lièvres invisibles et de perdrix absentes. «Les lapins se moquent de moi, écrivait-il, les tourdes se tiennent à distance, les pies me volent ma poudre et les merles me sifflent. N’importe, je poursuis, avec un courage digne d’un meilleur sort, ces promenades hygiéniques[347]...» Il rentrait, le soir, avec une mauviette dans son carnier, heureux du reste et répétant ce[304] mot de l’un des auteurs de l’Anthologie: «Je suis sorti ce matin pour chasser des sangliers et je suis rentré ne rapportant que des cigales.»
Il lui arriva, cette année-là, de pousser ses expéditions cynégétiques jusque dans la Crau et la Camargue. Au retour d’une de ces courses, le 29 septembre 1868, il écrit à Autran:
Mon cher ami, à qui le dites-vous? Il y a un mois que je suis ici[348], et il y a aujourd’hui 31 jours que je voulais vous écrire. Si vous n’avez pas de ma prose, c’est que je voulais faire quelque chose de mieux. J’étais invité par un de mes amis[349], en pleine Crau, non loin de la station de Raphèle; une fois là, je me disais, comme le Crevel[350] de Balzac, que je n’en ferais ni une ni deusse, et que j’irais vous faire une petite visite, soit rue de Montgrand, soit à La Malle. Vous ne devineriez jamais, mon cher ami, ce qui m’en a empêché; c’est le manque de linge, de chaussures, de bas et de pantoufles. Par suite d’épisodes aussi peu intéressants que peu prévus, ma malle était accrochée à la petite gare de Salaise, qui correspond avec Serrières. D’autre part, mon ami m’attendait à Arles, avec sa voiture, à jour et à heure fixes. Je suis donc parti avec le strict nécessaire pour trois jours de chasse; mais j’avais compté sans les instances d’un autre habitant de la Crau, un frère de M. Léo de Laborde. Or, sa Crau à lui est à celle des environs de Raphèle ce que les marais pontins sont à la rue de Rivoli. Vous figurez-vous votre longissime ami pataugeant dans des flaques d’eau, poursuivant des bécassines, ne rencontrant que des taureaux d’allure fort inquiétante, surpris par la pluie et n’ayant pas[305] de quoi changer de chaussettes et de souliers? Je suis revenu dans un piteux état, et je dois remercier le ciel de n’avoir pas attrapé une maladie.
Maintenant, je suis à votre disposition, où vous voudrez, quand vous voudrez, tant que vous voudrez...
La lettre à laquelle répondait le châtelain des Angles était de la main de madame Autran, ce qui inspirait à Pontmartin ces jolies lignes: «Vous ne me dites rien de votre santé; mais votre écriture a parlé pour vous, et, quoi qu’elle soit charmante, quoique la main qui a tenu la plume soit vôtre, j’ai le chagrin d’en conclure qu’il n’y a pas encore de mieux bien sensible. Puissions-nous au moins vous distraire!...»—Et plus loin, en terminant: «Ma femme et Henri sont à Évian depuis le 15 septembre; je suis seul ici, accablé d’affaires, me débattant avec des fermiers qui parcourent tous les degrés de l’insolvabilité, et n’ayant, pour me consoler, que le plaisir de vous écrire et le plaisir encore plus vif de songer que je vous verrai bientôt. Adieu, mon cher ami, je baise respectueusement la main qui écrit, et je réponds tendrement à la voix qui dicte, par l’expression d’une fidèle et inaltérable amitié.»
II
En novembre, eut lieu, à Pradine, la réunion annuelle. Pontmartin, cette fois, s’y rencontrait, non plus avec Dumas fils, mais avec M. Jules Claretie,[306] lui aussi futur académicien. Autran leur donna la primeur de son discours de réception, consacré à François Ponsard. Il n’y disait pas un mot de Mlle Rachel et du rôle de cette dernière dans la renaissance classique qui rendit possible le triomphe de Lucrèce. Cette lacune parut fâcheuse à Pontmartin, qui, en sa qualité de vieux romantique, était très rebelle au génie de Ponsard et se refusait à voir en lui un initiateur et un chef d’École. De retour aux Angles, il écrivit donc à Autran:
Vous êtes en veine, et quoique je ne sois ni sorcier ni prophète—dans mon pays ni ailleurs—je crois pouvoir vous prédire un brillant hiver, un glorieux prélude ou cortège[351] à votre discours de réception, que je regarde d’avance comme un succès infaillible. A ce propos, mon cher ami, permettez-moi une remarque d’après coup, qui n’a aucun rapport avec le mérite de l’œuvre, et dont vous ferez ce qu’il vous plaira. Une allusion de trois lignes à l’apparition de Mlle Rachel, qui précéda de cinq ans la tragédie de Lucrèce et lui prépara les voies, ne serait-elle pas tout ensemble un acte de justice et un moyen détourné, non pas de diminuer Ponsard, mais de rétablir ces proportions et ces nuances que le très spirituel public des premières représentations de l’Académie comprend à demi-mot? Il est certain que ce fut sous les traits de cette méchante fille[352] que Melpomène fit vraiment sa rentrée. Rachel fut la Muse, Ponsard ne fut tout au plus que le prêtre, arrivant au moment où l’autel et le temple étaient déjà relevés. Il vous suffirait, je le répète, de trois lignes pour indiquer ce sous-entendu, une date, un nom, une phrase, pas davantage[353]...
Ces trois lignes, Autran se décida à les écrire. Les voici, telles qu’on les trouve dans son discours de réception, prononcé le 8 avril 1869: «Qui ne se souvient de ces heureux débuts de Ponsard?... Quand il apparut, c’était son heure: la foule, ramenée aux anciens modèles par une tragédienne inspirée, commençait à se détacher de la poésie aventureuse et sans frein, du drame turbulent et audacieux.»
Pontmartin se défendait, nous venons de le voir, d’être «sorcier ou prophète». A ce moment-là même pourtant, il se laissait aller à faire une prophétie qui allait bientôt se réaliser. A l’occasion du poème de Pernette, par Victor de Laprade, il avait publié deux articles[354] où, tout en rendant justice aux beautés de l’œuvre, il ne taisait pas son regret de voir l’auteur mêler la politique à la poésie et faire de son héros l’interprète de ses haines contre le premier et, par ricochet, contre le second Empire. En envoyant ces articles à Laprade, il lui écrivait, le 1er décembre 1868:
Je n’aime ni n’estime le gouvernement actuel; mais je ne puis pas vous suivre, Léopold de Gaillard et vous, sur les roches escarpées de l’opposition quand même; je redoute plus que tout une Révolution; j’en ai trop vu! J’ai gardé un trop fidèle souvenir de l’incroyable sentiment d’humiliation et d’angoisse que je ressentis, le 25 février 1848, lorsque, après dix-huit ans d’une opposition furieuse et insensée contre Louis-Philippe, je me vis tombé dans les bras de Caussidière et de Louis Blanc! Si l’Empire tombe, sur vingt[308] chances il y en a trois ou quatre pour les d’Orléans et le reste pour une troisième République, moins formidable que la première, mais moins débonnaire que la seconde...
Dans cette étrange et douloureuse position, que faut-il faire? Se rallier? Nullement; mais revenir, tout en gardant le decorum, à un idéal plus désintéressé des incidents de la vie politique; les poètes à la poésie; les prosateurs à ces créations qui vivent d’une vie imaginaire, à mille lieues de nos tristes réalités...
Six jours auparavant, le 25 novembre, il avait écrit, sur le même sujet, à Joseph Autran:
...La haine contre le premier, c’est-à-dire contre le second Empire, finit par être, chez Laprade, une véritable obsession, et si elle lui vaut les applaudissements de quelques coteries, il y perdra toute l’élévation, toute la pureté, toute l’idéalité de son talent. Je ne suis ni fonctionnaire, ni courtisan ni journaliste officieux; mais je dis franchement aux poètes: Prenez garde! Un siècle ne défait pas dans sa seconde moitié la poésie qu’il s’est faite dans la première. Il y a des pourvois contre les surprises ou les erreurs de l’histoire; il n’y en a pas contre les créations, même mensongères, de l’imagination des peuples. Bonaparte, même condamné au nom de la vérité et de l’humanité, restera poétique. Si des génies ou des talents bien divers, Byron, Manzoni, Lamartine, Victor Hugo, Béranger, Casimir Delavigne, ont vibré presque en même temps, c’est que, depuis Brienne jusqu’à Sainte-Hélène, jamais destinée ne fut un plus riche texte de poésie. Si la légende de gloire napoléonienne a pu prévaloir à l’époque où les plaies de la France étaient encore saignantes, où retentissaient encore les sanglots et les imprécations des mères, ce n’est pas au bout de cinquante ans que vous effacerez ce prestige, sous prétexte que M. Rouher vous trompe, que M. de Morny vous vola ou que M. Haussmann vous démolit...
III
Le 29 décembre 1868, le théâtre du Gymnase représenta une comédie de M. Victorien Sardou, Séraphine, qui avait dû s’appeler d’abord la Dévote, titre que la censure avait refusé. Très habilement faite, renfermant deux ou trois scènes vraiment dramatiques, la pièce réussit. Quelques naïfs du parterre, qui ne connaissaient peut-être que de nom le Tartufe du grand Poquelin, avaient même crié: Bravo, Molière! Hélas! ce n’était pas Tartufe que rappelait la comédie de M. Sardou, c’était tout bonnement le Fils de Giboyer. Séraphine, la présidente de l’œuvre pour le rachat des petits Patagons, n’était qu’une copie, très poussée au noir, de la baronne Pfeffers, d’Emile Augier.
Rendant compte de la pièce dans Paris-Journal, Henri de Pène exprima le regret que l’auteur n’eût pas consulté un homme du monde—tel M. de Pontmartin—mis en contact par nécessité ou par goût avec de vrais dévots et de vraies dévotes.
L’auteur des Causeries littéraires était aux Angles. Piqué au jeu par ce gracieux souvenir, il lut Séraphine et improvisa en quelques jours une réplique, qui n’était rien moins elle-même qu’une petite comédie en deux actes et un prologue. Elle parut aussitôt dans Paris-Journal sous le titre de la Revanche de Séraphine.
Dans sa lettre d’envoi à Henri de Pène, Pontmartin disait:
...Séraphine m’a paru, comme à la plupart de ses juges, plus dramatique que juste, plus intéressante qu’impartiale. La véritable question demeure intacte: Sardou ne l’a pas vue, ou il l’a redoutée.
Il n’y a, selon moi, que deux manières de traiter ce sujet, si actuel, de la Dévote: ou le léger croquis à la plume qui nous montre une femme à la fois catholique et mondaine, allant le matin à l’église, le soir au bal ou au spectacle, se passionnant pour le prédicateur à la mode et inventant de bonnes œuvres pour le plaisir d’organiser une fête, où elle inaugure une nouvelle toilette: mais on ne fera rien de mieux, en ce genre, que la Vie parisienne; la veine me semble épuisée, et ce n’est d’ailleurs que la surface du sujet.
Ou bien—et c’est ici que le drame pourrait prendre de plus larges proportions—la Dévote vraie, sincère, émouvante et irritante tout ensemble: avec son bien et son mal, les embarras qu’elle entraîne dans la vie d’un homme d’imagination, mais aussi la sécurité qu’elle apporte au foyer d’un homme d’honneur. De là des conflits, des contrastes, des alternatives de comique et de pathétique, dont un maître tel que Victorien Sardou pourrait, je crois, tirer un grand parti.
Je me couvrirais de ridicule, mon cher ami, si je vous disais que, dans la Revanche de Séraphine, j’ai eu la prétention de faire ce que je viens d’indiquer. Déclarer que cette esquisse est injouable, ce n’est pas assez. J’ai voulu seulement répondre à votre appel, en écrivant une page de critique dialoguée, vivante, résumée en quelques personnages, ou mieux encore, comme dirait un joueur de whist, une invite à un véritable auteur dramatique—et pourquoi pas à Sardou lui-même?—pour s’emparer de mon germe d’idée et en faire une vraie pièce.
Pontmartin faisait trop bon marché de son esquisse.[311] La Revanche de Séraphine n’était pas si injouable que cela. C’est une vraie pièce, bien conduite, émouvante par endroits, toujours spirituelle. Peut-être, s’il l’avait voulu, s’il eût récidivé, s’il s’y était appliqué sérieusement et avec suite, peut-être l’auteur des Samedis aurait-il réussi au théâtre, comme il avait réussi dans le roman.
IV
Le 1er mars 1869, Lamartine mourait à Passy, pauvre, oublié, dans l’ombre et le silence,—heureux pourtant, car il avait à son chevet des amis véritables, une nièce, ou plutôt une fille, digne de porter son nom, Mme Valentine de Lamartine, un prêtre qui allait mériter bientôt la palme du martyre, celui-là même qui avait reçu le dernier soupir de Chateaubriand, l’abbé Deguerry, curé de la Madeleine. Il mourait fidèle au Dieu de son berceau, pressant sur ses lèvres ce Crucifix qu’il avait célébré, dans ses Méditations, en vers impérissables.
Quatre jours après, Pontmartin me mandait ce qui suit:
Paris, vendredi 5 mars 1869.
...Je reçois à l’instant votre lettre, et je vous écris ces quelques lignes pour me reposer le cœur et l’esprit. Je viens de passer trois jours écrasants pour un homme d’âge. Lundi, à cinq heures, mon fils, en rentrant, m’annonce la mort de Lamartine. A sept, visite du directeur de l’Illustration, qui me demande d’urgence un Lamartine pour mardi[312] soir; ce même mardi, à 8 heures du matin, lettre de Janicot, qui m’adjure de devancer de deux jours ma semaine littéraire et de faire mon Lamartine[355] pour jeudi soir. Engagement et promesse de ma part, que M. Janicot récompense immédiatement par l’envoi d’un fauteuil d’orchestre pour la première de Faust à l’Opéra. Cette brillante représentation, embellie, à ma gauche, de la présence de notre Empereur, à ma droite de celle de S. M. la Reine d’Espagne; nous applaudissions encore et nous rappelions mademoiselle Nilsson[356] à une heure 1/2 du matin. Hier j’étais moulu comme si on m’avait jeté du haut de la Gemmi dans une écritoire. Mais enfin me voilà sorti de ce coup de feu et rentré dans les conditions de la vie ordinaire...
...Quant à mon petit volume[357] (qui paraît jeudi prochain), c’est lui faire beaucoup d’honneur que de publier la petite note que je vous envoie. Tout l’intérêt et peut-être tout le péril de ce volume résideront, je m’y attends, dans l’étude de 55 pages sur Berryer[358]. Je ne suis pas tout à fait rassuré de ce côté-là. L’expression d’une tendre admiration obtiendra-t elle grâce pour les restrictions et les réserves? L’hommage chaleureux à la Restauration me fera-t-il pardonner certaines nuances de désabusement mélancolique?[313] Les anecdotes artistiques et les notes familières paraîtront-elles dignes de ce grave sujet? Je doute, et, dans le doute, je demande à mes amis de ne pas me juger avec trop de rigueur. Peut-être y a-t-il de la vanité dans mon inquiétude, et la solution de ce petit problème sera tout simplement qu’on laissera passer le volume sans y prendre garde:
Gresset se trompe, il n’est pas si coupable!
Pontmartin était coupable pourtant, et il avait raison de n’être point rassuré. Son chapitre sur Berryer est une erreur et une faute,—une faute qu’il aggravera encore quinze ans plus tard, en attendant de la réparer par un suprême et définitif hommage.
La lettre du 5 mars se terminait ainsi:
Je n’ai pas besoin de vous dire, mon cher ami, avec quelle impatience j’attends les bonnes et très bonnes feuilles de votre Victor Hugo[359]. Votre point de vue de l’éreintement dans l’admiration me semble excellent, et soyez sûr que vous aurez bien des gens de votre côté. La mort de Lamartine, sans être tout à fait un événement (car on le savait envahi déjà par les ombres de la mort, morte futurâ), a cependant attendri les imaginations et les âmes, ramené les souvenirs vers des époques où nul ne lui aurait disputé le sceptre de la poésie moderne, et j’aperçois çà et là des indices, des velléités de comparaison qui laisseraient l’avantage au poète des Harmonies. Quant à moi, je ne dissimule pas mes préférences lamartiniennes[360]...
S’il pleura Lamartine, je crois bien qu’il n’a pas[314] pleuré Sainte-Beuve, mort à quelques mois de là le 13 octobre 1869. Depuis longtemps déjà rien ne subsistait plus de leur ancienne amitié. Nul plus que Pontmartin ne prisait le talent de l’auteur des Lundis; mais il admirait Sainte-Beuve en le mésestimant. «En dehors des crises passagères, dit-il quelque part, des bourrasques et des gourmades de la vie littéraire, le sentiment dont j’ai toujours eu à me défendre à l’égard de Sainte-Beuve, ce n’est pas l’aversion, l’animosité ou le dépit; c’est, au contraire, l’irrésistible attrait qu’un homme rempli de bonnes intentions, mais faible et peccable, éprouve pour une splendide et spirituelle courtisane[361].»
Pontmartin était à deux cents lieues de Paris lorsque mourut Sainte-Beuve et que son corps, comme il l’avait demandé, fut transporté de son domicile au cimetière Mont-Parnasse, sans passer par l’église. Son article, publié dans la Gazette de France dès le 17 octobre, n’était forcément qu’une[315] première esquisse, un simple crayon; il se terminait par ces lignes:
Remarquez que j’ai fini, et que je n’ai pas dit un mot de religion. Au comble de ses vœux, sénateur, bien en cour, parvenu aux dignités et à la gloire, admis dans la plus intime familiarité des princesses, Sainte-Beuve était cruellement froissé de se sentir impopulaire; il s’est délivré du pli de rose du sybarite en embrassant la religion de l’épicurien. Il a fini par obtenir ce qui lui manquait: il est parvenu à la popularité par l’athéisme; désormais, il pouvait traverser sans crainte le Luxembourg; il aurait même pu remonter en chaire. La libre pensée est accommodante: elle permet de donner beaucoup à César, pourvu qu’on refuse tout à Dieu. N’importe! Cette mort serre le cœur: elle est effrayante et sinistre; cela vous fait froid dans le dos. Mais nous sommes encore trop près de ce cercueil sans consolation, de ces funérailles sans prières, de cette tombe sans espérance. Le chrétien aurait trop à dire; l’homme du monde doit se taire. A la religion du néant on ne peut opposer que le silence[362].
V
Quelques mois auparavant, en décembre 1868, M. de Villemessant avait annoncé à ses lecteurs la prochaine publication d’un roman spécialement écrit pour le Figaro par MM. A. de Pontmartin et Frédéric Béchard, et qui aurait pour titre: les Traqueurs de dot. J’avais aussitôt écrit aux Angles pour demander ce qu’il y avait de vrai dans cette[316] nouvelle, et Pontmartin m’avait répondu le 19 décembre:
Je regrette que vous ayez pris au sérieux ces Traqueurs de dot. Voici leur histoire. Au mois de septembre, Frédéric Béchard m’écrivit une lettre vraiment touchante, où il m’exprimait ses scrupules et ses remords sur ce qu’il y avait d’illusoire dans son semblant de collaboration aux Corbeaux, et il ajoutait que, pour s’acquitter envers moi, il me priait de consentir à une contre-partie exacte des Corbeaux, c’est-à-dire à un roman dont il serait l’auteur, et que je corrigerais en détail, avant qu’il le livrât aux imprimeurs. J’ai résisté, il a insisté, et nous avons fini par transiger. Il a été convenu qu’il m’enverrait le scenario, que je lui communiquerais mes idées, et que j’ébaucherais, à moi tout seul, la première partie (il y en aura trois). Mais surtout il avait été stipulé que mon nom ne paraîtrait pas. Malheureusement, M. de Villemessant, outre sa légèreté proverbiale, a des préventions contre le talent de Béchard, et celui-ci lui ayant demandé, comme une gracieuseté, d’insérer dans le Figaro la note relative aux traductions allemande et espagnole des Corbeaux, il a profité de cette occasion pour commettre cette première indiscrétion, qui sera probablement suivie de quelques autres. J’ai immédiatement écrit, et on m’a promis qu’il n’y aurait plus que des indiscrétions verbales, boulevardières, et que, dans tous les cas, mon nom ne figurerait jamais au bas des feuilletons. Quant à moi, je n’ai pas moins de deux romans et de trois nouvelles dans la tête.
Les romans: l’Épée à deux tranchants, l’Auberge du Vivarais.
Je n’ai pas encore trouvé le titre des nouvelles; dès que je serai à Paris, j’en écrirai une; car ici je perds un temps énorme, et dans des conditions hébétantes. Puis je verrai si, avec cette nouvelle, et les quelques esquisses que j’ai en portefeuille, je pourrai faire mon volume, les Miettes du pauvre. Mais, dans tout cela, je mourrai sans avoir réalisé[317] mon grand rêve: un livre gigantesque, une épopée intellectuelle qui se serait appelée les Mémoires de Figaro et serait allée de 1784 à 1851 (coup d’État).
Six mois après cependant, le 8 juin 1869, le Figaro publiait le premier chapitre des Traqueurs de dot, avec la double signature d’Armand de Pontmartin et de Frédéric Béchard. La veille avait paru, en tête du journal, la lettre suivante, adressée au rédacteur en chef:
Cher monsieur de Villemessant,
Voici nos Traqueurs de dot, vous vous étonnerez peut-être d’y trouver nos deux noms.
Lorsque nous avons publié, dans le Figaro, les Corbeaux du Gévaudan, signés d’un seul de nous, nous avons cédé, selon votre désir, au préjugé qui frappe de discrédit la collaboration. Cette fois, celui des deux auteurs qui avait gardé l’anonyme pour le premier roman était naturellement désigné pour assumer à lui seul la responsabilité du second. Mais nous avons fini par apprécier si bien les avantages du travail en commun que ces cachotteries nous ont paru puériles et que, bien loin de dissimuler notre collaboration, nous désirons l’affirmer.
Pourquoi n’en serait-il pas du roman comme du théâtre? L’essentiel, c’est qu’au fond les deux collaborateurs soient liés par la communauté absolue des idées générales. Nous comprenons que des écrivains, partant de principes contraires, n’obtiennent que des effets disparates. S’ils se trouvent placés, pour observer la société, au même point de vue, leur observation ne peut que se compléter au lieu de se contredire, et leur œuvre, en son ensemble, est forcément homogène.
Quant aux détails, la nature même du roman nous paraît la meilleure justification de ce procédé littéraire. Une fois[318] le plan bien arrêté, le champ y reste encore assez vaste pour que l’imagination des deux conteurs puisse s’y déployer librement.
Dans les Traqueurs de dot, par exemple, qui transportent tour à tour le lecteur des salons les plus parisiens sur les neigeuses Cévennes, et des étroits horizons de la vie de province dans les immenses et brûlantes savanes de l’Amérique du Sud, nous ne risquions ni l’un ni l’autre, avouez-le, d’être gêné par le voisin.
Au surplus, cher monsieur, vous restez absolument libre de maintenir la combinaison primitive. Nous vous soumettons seulement notre idée, justifiée d’ailleurs par d’illustres et heureux précédents. C’est à vous de choisir et de décider.
Tout à vous,
A. de Pontmartin,
Frédéric Béchard.
Pressé par Frédéric Béchard, traqué par Villemessant, Pontmartin avait fini par céder. Lourde était la faute, car ce roman médiocre, ces feuilletons auxquels il avait pris une si petite part,—quorum pars parva fuit,—ne pouvaient que nuire à son bon renom d’écrivain et de conteur. Il le sentait mieux que personne; à peine la publication fut-elle commencée qu’il s’en désintéressa complètement. Le 27 juin, il m’écrivait de Paris:
Un mot seulement, qui vous expliquera bien des choses. Ma femme est malade depuis la fin d’avril; il n’y a jamais eu de danger, mais elle est restée dans son lit près de six semaines, et nous n’en sommes pas encore, malgré un mieux décisif, à la promenade en voiture. Il en est résulté que j’ai complètement lâché les Traqueurs: je n’ai pas même revu le manuscrit; c’est Béchard qui a corrigé les épreuves...
Maintenant, au risque de vous trouver incrédule, je vous[319] dirai que je désire ardemment un fiasco, et que jusqu’à présent circonstances extérieures, public, administration du journal et imprimeurs me servent à souhait... La collaboration, chose désastreuse en elle-même, anti-littéraire, ennemie de toute inspiration franche et personnelle, ne peut avoir de prétexte ou d’excuse que lorsqu’elle est agréable. Or, pour moi, c’est un cauchemar et un supplice.
En dépit de ces tristes Traqueurs de dot, ainsi laissés pour compte par Pontmartin, sa campagne de 1869 n’en avait pas moins été très brillante, puisqu’elle avait eu à son actif la Revanche de Séraphine, une très remarquable nouvelle, Françoise, publiée dans le Correspondant[363], le Salon de 1869 à l’Univers illustré, le tome sixième des Nouveaux Samedis, et les Causeries hebdomadaires de la Gazette de France. Au mois de juillet, ignorant que l’auteur des Samedis était encore à Paris, où le retenait la santé de sa femme, Joseph Autran lui écrivait:
Est-ce aux Angles, ou à quelque port de l’Océan, est-ce à vos montagnes du Vivarais qu’il faut aller vous demander? ou plutôt n’est-ce point encore à cette avenue Trudaine où vous avez, ce me semble, poussé de plus fortes racines que vous ne pensiez? Je m’explique du reste à merveille cette recrudescence de tendresse pour Paris. Vous venez d’y faire une de ces campagnes qui sont tout un rajeunissement, et vous y avez cueilli de nouveau trop de charmants succès pour en quitter sans regret le cher théâtre. En vérité, cher ami, j’admire cette puissance de sève. Il n’y a que vous pour se renouveler ainsi de saison en saison et pour dresser[320] une tige toujours plus haute et toujours plus verte au milieu de tant de jeunesses déjà flétries...
Autran finira pourtant par retrouver son ami et par l’attirer, cette année encore, à Pradine, dans ce charmant pays que le Luberon abrite contre le mistral et qui réunit les pittoresques beautés de la montagne aux douceurs et aux agréments de la plaine. Pontmartin y passera tout le mois de novembre, et quand il sera rentré aux Angles, Joseph Autran lui écrira:
Mon cher ami, ce n’est pas à vous de m’écrire les souvenirs que vous emportez de Pradine. C’est à moi plutôt de vous dire ceux que vous y laissez. Croyez bien qu’une grande partie du charme de notre foyer vient de ce que vous y apportez, et quand j’ai appelé ces douces journées d’automne «l’été de la Pontmartin», je pensais moins à la sérénité des jours qu’à ce rayonnement du cœur et de l’esprit qui marque votre passage. Dieu nous accorde de les renouveler souvent encore et de vieillir dans cette chère amitié qui, depuis trente ans, n’a pas eu un nuage.
VI
L’année 1870 s’inaugura par la formation du ministère Ollivier. Ce coup de théâtre était presque un coup d’État. Napoléon III biffait, le 2 janvier, ce qu’il avait écrit le 2 Décembre; il brûlait ce qu’il avait adoré, il adorait ce qu’il avait brûlé. Le nouveau ministère, en effet, avait pour mission de transformer l’Empire autoritaire[321] en Empire libéral. Il y eut, dans le camp de l’opposition conservatrice, un applaudissement presque universel. Les hostilités s’arrêtèrent; à la guerre ouverte succéda l’armistice, prélude d’une réconciliation prochaine. M. Guizot reparut dans les salons officiels; M. Odilon Barrot présida la commission de décentralisation; le duc Albert de Broglie accepta d’entrer dans la commission de l’enseignement supérieur, où figurait également l’irréconciliable Léopold de Gaillard. Encore quelques semaines, et Prévost-Paradol deviendra ministre de France aux États-Unis, pendant que M. Émile Ollivier sera appelé par l’Académie française à l’honneur de remplacer Lamartine: MM. Thiers et de Falloux se chargeront d’aller annoncer à l’heureux élu le vote presque unanime de l’illustre Compagnie[364]. Pontmartin fut moins prompt à l’enthousiasme. Même au plus beau moment de cette lune de miel, il ne pouvait se défendre de répéter:
Ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille.
Le 25 février 1870, il m’écrivait des Angles:
...Je suis agacé de voir les choses tourner de façon à rassurer peut-être l’égoïsme bourgeois, mais à frapper de prescription indéfinie nos principes et nos espérances. L’Empire libéral, c’est un pommier produisant des pêches; c’est Guillot le sycophante ou le loup devenu berger. Ce n’est pas en greffant ainsi la liberté sur le despotisme, l’économie[322] sur la dilapidation, la justice sur l’arbitraire, l’honnêteté sur la rouerie, que l’on refait l’esprit public, le sens moral d’un peuple, ou, pour tout dire en un mot, son âme...
Il avait du reste, à ce moment, de nombreux sujets de tristesse. De cette même lettre du 25 février, je détache ces lignes:
Je lutte, depuis un certain temps, contre une jettatura que tout le corail napolitain ne réussirait pas à conjurer. Tombée malade au mois de mai, ma femme commençait à peine à se remettre lorsque j’ai été repris par cette gastralgie nerveuse qui m’a déjà fait de si fréquentes et de si désagréables visites. Plus d’appétit, plus de sommeil surtout. C’est comme un voile grisâtre, une brume de novembre répandue sur ma pauvre imagination et, tant que ma femme n’est pas tout à fait rétablie, nous ne pouvons pas songer à retourner à Paris, où il paraît que l’on n’échappe à la glace et à la neige que pour maudire le dégel, la boue et M. Chevreau[365]...
Le 1er mars, il conduisit sa femme à Cannes et l’y laissa avec son fils, pendant que lui-même revenait à Paris, comptant n’y rester que quelques jours, le temps seulement de donner congé à son propriétaire de l’avenue Trudaine et de publier le septième volume des Nouveaux Samedis. Les nouvelles de Cannes étant devenues meilleures, il prolongea son séjour de quelques semaines jusqu’au[323] milieu de juin, et, comme l’année précédente, il fit le Salon à l’Univers illustré. Il se disposait à retourner aux Angles, quand il rencontra, un soir, à l’Opéra, Prévost-Paradol, lui-même à la veille de partir pour Washington. Comme il regagnait sa place, Paradol l’arrêta amicalement au passage et lui dit: «Si votre modestie vous empêche de songer à la succession de M. Villemain[366], nous sommes menacés de perdre bientôt un autre de nos collègues, le pauvre Prosper Mérimée[367]...» L’ouverture qui commençait interrompit celle que l’auteur de la France nouvelle allait lui faire.
Un mois plus tard, la guerre éclatait. Pontmartin était aux Angles. Il n’eut pas un instant d’illusion; dès la première heure, il comprit l’immensité du péril. Tandis que les patriotes ou les dilettantes de la capitale, bien installés dans leur fauteuil d’orchestre, applaudissaient Faure ou Mme Marie Sass chantant la Marseillaise, il disait aux Parisiens, aux ministres, aux généraux, à l’Empereur lui-même: «Prenez garde, la Marseillaise ne vous portera pas bonheur!» Et peu de jours après, au lendemain de nos premiers désastres, il ajoutait: «Des invités de Compiègne, des familiers du Palais-Royal ont ouvert bravement le feu en attaquant les dieux et les demi-dieux de l’Olympe officiel. Nous qui sommes constamment restés à l’écart, loin des[324] grandeurs et des flatteries de ce monde, nous serons plus respectueux et plus humbles. Selon nous, si la fortune a paru d’abord infidèle à nos armes, la faute n’en est ni au chef suprême, ni au major-général, ni au Grouchy de 1870, ni au précepteur dans l’embarras. Le vrai coupable, ou, pour parler plus exactement, le véritable jettatore, c’est Rouget de Lisle; c’est l’hymne néfaste, trop connu sous le nom de Marseillaise.» L’article se terminait ainsi: «M. Émile Ollivier s’est écrié, du haut de la tribune: ‘Le plébiscite[368] est la revanche de Sadowa!’» Non: le plébiscite a été le prologue de Wissembourg, de Wœrth et de Forbach, ou, pour parler la langue des joueurs, cette campagne de Prusse en France est le paroli, le banco du plébiscite.—«Sire, répondait Michaud à Charles X qui lui reprochait son mutisme à la tribune, j’ai dit trois mots; ils m’ont coûté trois mille francs: je ne suis pas assez riche pour continuer.» La France n’a dit qu’un monosyllabe, et il lui a coûté beaucoup plus cher.
Ces lignes paraissaient dans la Gazette de France du 12 août. Deux jours après, Pontmartin recevait un pli officiel lui annonçant qu’il était nommé chevalier de la Légion d’honneur.
Voici ce qui s’était passé:
Lors de la formation du ministère Ollivier, M. Eugène Chevandier de Valdrôme, député de la Meurthe et l’un des chefs du tiers-parti libéral,[325] avait reçu le portefeuille de l’Intérieur. Pontmartin était lié de longue date avec le frère du ministre, Paul Chevandier de Valdrôme, peintre de talent, qui aurait peut-être été un grand artiste, un paysagiste de premier ordre, si les entraînements de la vie mondaine ne l’avaient trop souvent éloigné de son bel atelier de la rue de la Tour-d’Auvergne. Plus d’une fois, dans ses Salons de la Mode et de l’Univers illustré, il avait signalé à ses lecteurs, en termes particulièrement élogieux, les tableaux de son ami. Paul Chevandier avait une dette à payer. Sans en rien dire à Pontmartin, il demanda pour lui à son frère le ruban de chevalier. Le ministre n’éleva aucune objection. Pontmartin sans doute était un homme des anciens partis; c’était un adversaire, mais un adversaire courtois; souvent même il avait dénoncé le ridicule de la petite guerre d’allusions et d’épigrammes que ses amis de l’Académie faisaient à l’Empereur. Du côté de M. Émile Ollivier, qui prisait très haut le talent de l’auteur des Samedis, les choses allèrent toutes seules; il se montra plus favorable encore que son collègue de l’Intérieur. L’affaire une fois décidée, restait à obtenir l’adhésion du principal intéressé. Paul Chevandier, dans les derniers jours de juin, donna un dîner où son frère Eugène et Armand de Pontmartin se trouvaient tous les deux. Au dessert, le peintre dit au critique: «Pourquoi ne portez-vous jamais votre ruban rouge?—Mais je ne l’ai pas.—Impossible!—C’est pourtant vrai.» Alors le ministre, qui jusque-là n’avait rien[326] dit, prit la parole et déclara que si M. de Pontmartin s’engageait à ne pas refuser, lui-même se chargeait de mener l’affaire à bonne fin, sans que l’écrivain eût à faire la moindre démarche. Était-il possible de répondre par un refus à une offre faite de si bonne grâce? Pontmartin promit de ne pas se montrer intransigeant. Quelques jours après, il quittait Paris, pour apprendre bientôt la déclaration de guerre, nos premières défaites et la chute du ministère Ollivier[369]. Absorbé par ses angoisses patriotiques, il avait complètement oublié sa rencontre avec le malheureux ministre de l’Intérieur et le double engagement qui s’en était suivi, quand, le dimanche 14 août, au moment de se rendre à la messe, il reçut une grande enveloppe cachetée de rouge: c’était un brevet de chevalier de la Légion d’honneur, daté du 9 août 1870, signé par l’Impératrice-Régente Eugénie, et contresigné par le ministre des Lettres, Sciences et Beaux-Arts, Maurice Richard. Cette nomination qui, dans un autre moment, l’eût sans doute réjoui, lui causa plus de tristesse que de joie: elle coïncidait avec le deuil de notre armée; elle lui arrivait entre Reichshoffen et Sedan!
CHAPITRE XIII
LES LETTRES D’UN INTERCEPTÉ.—LE RADEAU DE LA MÉDUSE.—LE FILLEUL DE BEAUMARCHAIS.—LA MANDARINE.
(1870-1873)
La Gazette de Nîmes et les Lettres d’un intercepté. M. Gambetta. La Journée d’un Proconsul.—Cent jours à Cannes. La Décentralisation et le Radeau de la Méduse.—Mort de Mme de Pontmartin. Le Filleul de Beaumarchais. Un mot de Louis David.—Le comte d’Haussonville et Saint-Genest. Un Bûcheron qui ne débite pas de fagots. La souscription nationale pour la libération du territoire. Projet de Pontmartin. Le comte de Falloux.—Hôtel Byron, rue Laffitte. La Taverne de Londres. M. Thiers. L’Homme-Femme de Dumas fils. Au château de Barbentane. Le toast de Mistral. Entre voisins. L’inondation du Rhône en 1872.—Au Pavillon de Rohan. Une campagne au Gaulois. La Mandarine. Le 24 mai 1873, Si le Roi n’avait rien dit!
I
Après son article du 12 août, Pontmartin cessa ses envois à la Gazette de France. Continuer à écrire, comme autrefois en pleine paix, une Causerie littéraire, il n’y fallait pas songer. Les Prussiens, d’ailleurs, allaient se charger de trancher[328] eux-mêmes la question. Ils investissaient Paris, et entre la rue Coq-Héron et les Angles toute communication devenait impossible. Il écrira cependant; il publiera dans un journal du Midi, la Gazette de Nîmes, des articles où il essaiera une espèce de terme moyen entre le premier-Nîmes et la Causerie littéraire.
Ces articles parurent sous le titre de Lettres d’un intercepté. Il m’en parle en ces termes dans sa lettre du 5 novembre 1870:
...On a fondé à Nîmes un journal, pour lequel on m’a demandé ma collaboration. Il m’a paru que, dans un moment comme celui-ci, l’important n’était pas de rechercher un succès littéraire, qui d’ailleurs est impossible, mais d’exprimer rapidement quelques vérités utiles. La proximité m’assurait presque le bénéfice de l’à-propos, et, une fois en train, j’ai écrit seize articles presque sans interruption. Comme ils sont reproduits dans un journal d’Avignon, me voilà finissant par où j’ai commencé, et redevenant, après plus d’un quart de siècle, journaliste du Gard et de Vaucluse.
Les Lettres d’un intercepté sont au nombre de vingt-six; elles vont du 29 septembre au 23 décembre 1870.
Pontmartin les écrivait en plein pays rouge, dans ces départements du Midi où l’on menaçait—de loin—les Prussiens, et où l’on faisait—sur place—la guerre aux moines et aux prêtres, au Pape et à l’Église. Sous l’impression que lui causaient les scènes hideuses d’Autun, de Lyon, de Saint-Étienne, de Toulouse, de Limoges, de[329] Marseille, il lui est arrivé de se montrer très dur, un peu trop dur peut-être pour les hommes du 4 Septembre et en particulier pour Gambetta. Si le dictateur de Tours eut le tort, l’impardonnable tort, de mettre l’intérêt de la République au-dessus de l’intérêt de la France,—République d’abord!—il n’est que juste de reconnaître que son effort n’a pas été entièrement stérile, qu’il y a eu, à certaines heures, au milieu de ses hâbleries, un souffle de vrai patriotisme, et qu’il a su parfois, du haut de son balcon, esquisser de beaux gestes.
Ces beaux gestes, assez rares au demeurant, Pontmartin ne les a pas voulu voir. Comme George Sand[370] et Pierre Lanfrey, et avant eux, il a dénoncé sans ménagements, il a raillé, il a maudit la dictature de l’incapacité[371]. C’est lui qui a attaché le grelot à «cette faconde d’estaminet, à cette célébrité de carton, à cet héroïsme de clinquant, à cette dictature du balcon». Son livre se pourrait appeler l’Anti-Gambetta. Pontmartin n’en a pas écrit de plus éloquent. Avec quelle force il s’élève, au nom de la France de saint Louis, de Jeanne d’Arc, de Fénelon, contre l’appel fait par le gouvernement de Tours à ce fantoche italien, dont les mains étaient rouges de sang français, il signor Garibaldi[372]! A côté de ces pages vengeresses,[330] il y a des pages prophétiques, telles que la suivante, écrite le 23 novembre 1870:
Le caractère si profondément anti-chrétien de la révolution du 4 septembre est ce qui m’épouvante le plus pour l’issue de la guerre et l’avenir de mon pays. Ce pays a les reins solides. Quelle que soit l’incroyable série de ses revers, il reviendra peut-être de l’état désespéré où l’ont plongé les fautes de l’Empire, aggravées par ceux qui devaient les réparer; mais ce dont il ne se lavera jamais, c’est d’avoir laissé outrager cette chose sainte qu’on appelle la religion, sous prétexte de défendre cette chose sacrée qu’on nomme la patrie; c’est d’avoir permis qu’un vieux forban, justement exécré de tous les catholiques, à la tête de quelques bandes de mécréants et de coupe-jarrets, nous infligeât l’immonde parodie des interventions étrangères; c’est de n’avoir pas compris que déclarer la guerre à Dieu sous l’étreinte d’un ennemi vainqueur, c’était à la fois une honte, un crime, une bêtise et un suicide.
Le vent est aux prophéties, et je suis d’autant plus tenté de risquer la mienne que, depuis quatre mois, les événements ne m’ont que trop donné raison. J’écrivais, le 1er août: «Prenez garde! la Marseillaise ne vous portera pas bonheur.»—Et, six jours après, les sinistres échos de Wissembourg, de Forbach et de Reichshoffen répondaient au refrain de Rouget de Lisle.—Aujourd’hui, je dis: «Prenez garde! la guerre au bon Dieu vous portera malheur. Ne bravez pas Celui qui peut seul vous sauver par un miracle, vous qui n’êtes pas et qui ne faites pas des prodiges!»
Avec un écrivain tel que Pontmartin, l’esprit ne perd jamais ses droits. Vous venez de lire ces beaux chapitres: Après Sedan; Si Pergama! Garibaldi; le Talion; l’Ile d’Elbe et Wilhelmshœhe; les Honnêtes gens; Que faut-il croire? la Guerre au bon Dieu;—tournez le feuillet, et donnez-vous la[331] fête de savourer les pages sur les Préfets hommes de lettres,—MM. Challemel-Lacour et Alphonse Esquiros,—et surtout la Journée d’un Proconsul, fragment de manuscrit trouvé par un élève de l’École des Chartes dans la bibliothèque de Cahors.
II
Ses angoisses patriotiques, les victoires de la Prusse, aggravées et envenimées par les victoires de la démagogie, le mauvais état de sa santé, tout se réunissait pour accabler Pontmartin.
Il dut obéir à l’ordre de son docteur, qui voulut absolument le renvoyer à Cannes. Le 7 janvier 1871, il s’y installait, à la villa des Dames de la Présentation; peu de jours après, je recevais de lui une lettre où il me disait: «Nous sommes venus nous réfugier sur cette plage, presque déserte cet hiver, comme de véritables naufragés. Je sens que je ne résisterai pas à ces cruelles épreuves. A bout de forces, atteint d’anémie, le cœur déchiré par les malheurs de notre chère France, ayant vu sombrer tout ce qui fait le bonheur ou, du moins, le repos du père de famille et du citoyen, je me fais à moi-même l’effet de mon propre spectre, errant sur ce littoral où je retrouve les ombres de Cousin et de Mérimée[373]...»
Il devait y rester jusqu’au 17 avril 1871, ce qui lui permettra de dire plus tard: «J’ai eu, moi aussi, mes Cent Jours[374].»
Au commencement de mars, les Lettres d’un intercepté parurent à Lyon, chez les libraires Josserand et Pitrat. La vente avait lieu au bénéfice des blessés et prisonniers de l’armée française. Pontmartin écrivit, à cette occasion, au directeur du Figaro:
Cannes (Alpes-Maritimes), 12 mars 1871.
Mon cher chef,
La réapparition du Figaro, au cercle de Cannes, a été pour nous tous une joie, si toutefois ce mot est encore français. Je vois que votre journal se porte mieux que jamais: en quoi je ne lui ressemble guère. N’importe! mon indignation contre les hommes du 4 Septembre a suppléé à mes forces absentes, et il en est résulté, sous le titre de Lettres d’un intercepté, un volume que je vous recommande, parce que vous aimez à traduire en bonnes œuvres la popularité du Figaro, et que le volume se vend au bénéfice des victimes de la guerre. La succursale lyonnaise de la maison Hachette[333] a dû, sur ma recommandation expresse, vous en adresser deux ou trois exemplaires. Je n’ajoute rien; les grandes douleurs ne doivent pas être bavardes. Je me borne à vous demander la charité pour des blessés, des prisonniers et un malade, et je suis tout à vous.
Lorsqu’il revint aux Angles, le 18 avril, sa santé ne s’était guère améliorée, mais le courage et la force morale lui étaient revenus, comme en témoigne la lettre suivante, qu’il m’écrivait le 24 mai:
Mon cher ami, je n’attendais qu’un mot de vous pour renouer au plus vite une correspondance qui aura été une des joies et une des forces de ma vie littéraire. Commençons par un bulletin sommaire de nos tristes santés. Ma femme, après avoir été, vers le 10 avril, presque à l’agonie et avoir reçu tous les sacrements, va décidément mieux, et comme ce mieux dure depuis six semaines, je crois que l’on peut se reprendre à l’espérance. Quant à moi, j’étais revenu de Cannes dès qu’il m’a été prouvé que ma femme ne pourrait pas venir m’y rejoindre et que son état inspirait des inquiétudes. Nous étions assistés, mon fils et moi, par une de mes belles-sœurs, et la malade était bien soignée et entourée. Mais cette effroyable série de désastres, d’angoies, de calamités publiques, de douleurs privées, de souffrances physiques[334] et morales, coïncidant avec l’échéance prochaine de la soixantième année, a produit en moi un effet singulier. Je suis atteint d’une anémie qui n’a rien de douloureux, sauf que mes vieilles longues jambes ne peuvent plus me porter; et, en même temps, comme pour rétablir l’équilibre,—ou plutôt, hélas! achever de le rompre,—je me sens dans le cerveau, dans l’imagination, dans le cœur un redoublement d’ardeur et de vie, que j’attribue, pour une moitié, à l’excitation nerveuse, et, pour l’autre, à la grandeur même des événements. J’éprouve à la fois le besoin d’exprimer des idées que je crois vraies, et l’ardent désir de me dévouer à un idéal patriotique et monarchique. Aussi, M. Charles Garnier[375], à la suite d’un échange de lettres, m’ayant demandé ma collaboration, j’en ai immédiatement profité pour commencer, dans la Décentralisation, une seconde campagne, qui pourrait bien aboutir, en août, à un nouveau petit volume, si les Communards de Paris et de la province nous laissent un carré de papier et une bouffée d’air respirable. Ce qui m’attriste, c’est que, tout près de moi, un de mes meilleurs et de mes plus éloquents amis, Léopold de Gaillard, paraît avoir reçu de ces mêmes événements une impression contraire. Il m’écrivait avant-hier une lettre empreinte du plus morne découragement... Certes, à ne considérer que les apparences, la France ressemble à un malade incurable. Il faut qu’elle ait été mordue par un démadogue enragé pour remplir ses conseils municipaux d’hommes tarés, forcenés, incorrigibles, qui applaudissent tout haut ou tout bas aux crimes de la Commune; et cela au moment où cette insurrection communiste retarde la reprise des affaires, et où les Prussiens nous écrasent de leurs ruineuses exigences. Mais c’est justement le caractère surhumain des épisodes qui se succèdent depuis un an, qui m’a rendu ma force morale, et qui soutient mon courage.[335] D’une part, il y a dans ces épisodes quelque chose de si étrange, de si gigantesque, de si biblique, nous avons si brusquement passé d’Horace Vernet à Martin[376], qu’à moins de se déclarer athée, on ne peut pas ne pas s’incliner devant une intervention divine qui, seule, peut tout expliquer et tout réparer. De l’autre, je me dis qu’il faut que Dieu ait ses desseins, supérieurs à la méchanceté des hommes, pour que de pauvres âmes faibles et malades comme la mienne, en proie, pendant les dernières années de l’Empire, à une sorte d’atonie, tentées presque de traiter d’illusions leurs croyances et de se laisser envahir par le doute, aient été tout à coup ravivées, fortifiées, retrempées pour la lutte par des catastrophes qui semblaient devoir, au contraire, achever de les abattre. Ceci, mon cher ami, me ramène à mes moutons, interceptés une seconde fois par les Prussiens de Belleville et de la Villette. Mon éditeur lyonnais, en m’annonçant la 3e édition de mon volume, m’écrit que, contre son attente, les journaux du Midi—Nimes, Avignon, Montpellier, Marseille, etc.—ont accueilli le livre par un silence de glace, tandis qu’il a été énergiquement soutenu par les journaux de l’Ouest. Il ne m’a pas été difficile de deviner, dans ce bienveillant concours, votre amicale influence, et je vous en remercie du fond du cœur pour moi, pour Pitrat, notre ancien metteur en pages du Correspondant, et pour les trop nombreuses victimes de la guerre, auxquelles j’ai déjà pu donner 600 francs (j’espère que nous irons à mille, et nous y serions sans les événements de Paris)... Écrivez-moi de temps en temps, si vos travaux et vos affaires vous en laissent le loisir, et soyez sûr que le plaisir de vous lire et le soin de vous répondre compteront toujours parmi les consolations les plus douces d’un affligé qui vous aime, d’un obligé qui vous remercie, d’un malade qui se ranime pour vous serrer vigoureusement la main. Tout à vous.
Quelques jours après, le 7 juin, nouvelle lettre, mais toujours même ardeur, même résolution de combattre, avec ce qui lui restait de forces, la mauvaise littérature et l’esprit révolutionnaire:
J’ai eu hier la visite de Léopold de Gaillard, que j’ai réchauffé et rasséréné de mon mieux. Il était consterné, entre autres horreurs communardes et pétroliennes, de la mort du R. P. Captier, qui, après avoir commencé, à Arcueil, l’éducation de son fils, était devenu son ami. Mais je n’ai pas eu de peine à lui prouver que la douleur la plus légitime et la plus intense n’avait rien de commun avec le découragement et l’abandon de ce qui peut encore se tenter dans l’intérêt du vrai et du bien. Il doit partir lundi pour Paris, où il va reprendre la direction du Correspondant, qui reparaîtra le 25 juin. Je lui ai promis pour une des deux premières livraisons, un article où j’essaierai de profiter de mes tristes avantages et de déterminer la nouvelle situation faite à la critique par les calamités sans nom qui nous écrasent...
Après avoir rapidement esquissé le plan de l’article[377] qu’il projetait d’écrire pour le Correspondant, il terminait ainsi sa lettre:
...Le cadre est immense; c’est tout au plus si j’aurais la force de remplir un des coins; mais, mon cher ami, quel horizon pour un homme de trente ans, ayant le talent, la foi, le feu sacré! Exoriare aliquis!... Ce qui m’afflige et m’inquiète, c’est l’attitude de la jeunesse, du moins dans nos villes du Midi. Il y a eu de braves et intrépides jeunes gens qui se sont enrôlés sous les drapeaux de Charette et sont morts héroïquement en combattant les Prussiens. Y[337] en aura-t-il pour se roidir contre les humiliations de la Paix, s’associer à une restauration morale et sociale, travailler à une œuvre de réparation, chercher une revanche ailleurs que dans ces hasards de la guerre, qui nous ont si cruellement trahis, qui pourraient nous trahir encore? L’abominable épisode de la Commune, les nouveaux milliards qu’il nous coûte, les ruines qu’il nous laisse, retardent indéfiniment cette revanche militaire à laquelle je ne crois guère, et que je désire peu. Il ouvre, au contraire, la voie à tout homme de cœur qui recherchera les causes de nos désastres et les moyens de les réparer...
Pontmartin reprit donc sa tâche. D’avril à octobre 1871, il publia, dans la Décentralisation, une suite d’articles qui parurent en volume, au mois de janvier 1872, sous ce titre: le Radeau de la Méduse.
L’insurrection du 18 mars, l’assassinat du général Lecomte et de Clément Thomas, le renversement de la colonne Vendôme sous les yeux des Prussiens, les incendies de Paris, le massacre des otages: que de leçons à tirer de ces terribles événements! Pontmartin les fit ressortir avec force. La Prusse et la Commune, Paris, Cri de détresse, la colonne Vendôme, Sommations respectueuses à l’Assemblée nationale, autant de chapitres qu’il est impossible de relire aujourd’hui sans rendre hommage au bon sens de l’écrivain qui nous donnait de si fermes conseils, sans déplorer l’aveuglement qui nous a empêchés de les suivre.
En nous signalant toute l’étendue du mal et en nous indiquant le remède, Pontmartin n’avait eu garde de mettre en oubli le précepte du Tasse, qui[338] recommande d’enduire de miel et de sucre les bords du vase que l’on présente au malade:
Cosi all’egro fanciul porgiamo aspersi
Di soave licor gli orli del vaso.
Ici, le miel et le sucre, ce sont les traits charmants et les mots heureux. Rien de plus piquant que les Épaves académiques, et en particulier le récit de la réception de M. Émile Ollivier,—réception qui n’a jamais eu lieu[378].—Le discours du successeur de Lamartine est, comme il convient, écrit en vers, et, naturellement, les strophes du récipiendaire rappellent les strophes du Lac:
Un jour, t’en souvient-il? nous gardions le silence:
On n’entendait, au sein du Corps législatif,
Que le bruit des couteaux qui frappaient en cadence
Le pupitre plaintif...
Se non è vero... Les lecteurs du nouveau Lac durent se dire que rien n’était désespéré, puisque l’on pouvait trouver d’aussi bons morceaux sur le Radeau de la Méduse.
III
Les douleurs et les deuils se succédaient sans relâche au cours de cette horrible année 1871. En [339]avril, Mme de Pontmartin avait été presque à l’agonie; puis une apparence de mieux qui avait permis à son mari de reprendre sa vieille plume. Puis une rechute, six semaines de cruelles souffrances, et la fin. Mme de Pontmartin était morte le 19 août, à 51 ans, conservant jusqu’au dernier moment sa pleine connaissance et son courage: pas une plainte, pas un murmure, une foi ardente, une résignation incomparable. Son âme s’était élevée depuis longtemps vers cette vie surnaturelle qui, pour les chrétiens (et Mme de Pontmartin était une chrétienne des anciens temps), est la vie véritable.
Sous la deuxième République, Pontmartin avait représenté le canton de Villeneuve-lès-Avignon au conseil général du Gard. Au mois d’octobre 1871, ses amis lui firent un devoir de poser de nouveau sa candidature. Les chances de succès étaient nulles, puisque, le 2 juillet précédent, à une élection partielle pour l’Assemblée nationale, le canton de Villeneuve avait donné 400 voix de majorité aux candidats démagogiques. Il accepta sans enthousiasme, fit bravement campagne et obtint un demi-succès: le dimanche 8 octobre, la majorité ultra-républicaine du 2 juillet se trouva diminuée des trois quarts. Il n’en était pas moins battu, et, quelques jours après, il m’écrivait: «J’ai été, je l’avoue, navré de cet échec, non pas pour moi—j’y gagne de pouvoir rendre à la littérature un temps que m’auraient pris les attributions singulièrement agrandies du conseil général—mais[340] pour ce pays que j’aime malgré ses ingratitudes et ses folies[379].»
Les électeurs lui faisaient des loisirs; il en profita pour réaliser enfin un projet longtemps caressé, pour écrire ce Filleul de Beaumarchais, auquel il songeait depuis le 2 décembre 1851 et qui avait dû s’appeler d’abord les Mémoires de Figaro[380]. Il m’écrivait, le 6 novembre 1871: «Je commence ce soir»;—et, un mois plus tard, le 5 décembre: «En attendant, je me console avec le Filleul de Beaumarchais, dont la première partie sera expédiée aujourd’hui même au Correspondant[381]. J’ai fini par me passionner pour mon sujet au point de ne plus pouvoir songer à autre chose, et j’ai écrit à la Gazette de France que décidément je ne reprendrais mes articles qu’après le jour de l’an. Pourtant, mon cher ami, ne vous figurez pas que je vous prépare un récit de longue haleine, une page d’histoire; ce sera tout au plus un tableau de genre. Le colosse rêvé en 1852 s’est réduit peu à peu à des proportions de statuette...»
Né le 27 avril 1784, le soir même de la première représentation du Mariage de Figaro, le héros du roman, dans la donnée primitive, était[341] tué, le 4 ou le 5 décembre 1851, au cours de cette émeute plus ou moins factice qui suivit le coup d’État. Entre ces deux dates, qui ne lui donnaient en somme que soixante-sept ans, il allait d’étape en étape, personnifiant une sorte de Gil Blas sérieux, aux prises avec autant de déceptions qu’il y avait eu d’illusions à son baptême.
De cette donnée première, il reste peu de chose dans le roman de 1871, lequel finit en 1809, ou plutôt dès 1804. J’étais, pour ma part, quelque peu déçu: je ne le cachai pas à Pontmartin, qui me répondit le 19 janvier 1872:
Ce que vous me dites du Filleul de Beaumarchais m’a un peu étonné. Je vous avais averti que je ne prétendais faire qu’un tableau de genre, une esquisse, et non pas du tout une grande page historique et romanesque. Mes deux modèles ont été Paul et Virginie et Graziella; or ces deux récits ne mènent pas bien loin leurs personnages. Virginie et Graziella meurent à dix-sept ans; les deux romans finissent au seuil de la jeunesse, à l’aube de la vie. Je vous avoue d’ailleurs que je me suis attaché surtout aux caractères de Geneviève et du docteur Berval, qui, pendant cette phase terrible de 1784 à 1804, personnifiaient à mes yeux quelque chose comme le chœur antique,—la pitié, l’humanité, la vérité, la justice, s’efforçant de se faire leur part dans ce chaos de passions violentes et criminelles, dans ces alternatives d’anarchie et de dictature. Si j’avais réussi, c’est là ce qui donnerait une valeur un peu plus sérieuse à cette chaste et quasi enfantine histoire...
La chaste idylle de Pierre Goudard—le Filleul—et de Jeanne d’Erlange a pour cadre la Révolution, la Terreur, le Directoire et le Consulat de[342] Bonaparte. Il y avait là un premier péril. Louis David disait un jour: «Si je veux peindre deux amants dans les Alpes, je suis forcé ou de faire mes amants tout petits pour que mes Alpes aient une certaine grandeur, ou de réduire mes Alpes à l’état de miniatures, pour que mes amants soient grands comme nature.» L’écrivain a ici plus de ressources que le peintre, et Pontmartin a su très habilement vaincre la difficulté. Son récit côtoie l’histoire, sans jamais y verser, sans se heurter non plus à un autre écueil, qui était également à redouter. Puisque aussi bien son idée première avait été de montrer que la Révolution a fait banqueroute, qu’elle n’a ni tenu sa promesse ni rempli ses engagements, n’était-il pas à craindre que le roman ne souffrît du voisinage de la thèse? Il n’en a rien été. L’auteur a même eu le bon goût, dans ce récit franchement royaliste, de peindre sous les couleurs les plus sympathiques le docteur Berval, qui est républicain: il est vrai qu’il l’est si peu! En revanche, le romancier ne ménage guère l’oncle de Jeanne, un ci-devant pourtant, le marquis de Trévières. C’est que l’âme de son livre n’est pas l’esprit de parti, mais l’esprit de réconciliation, de justice, de concorde et de paix,—sans préjudice de l’esprit tout court, l’esprit qui ne pouvait pas ne point tenir une grande place dans un ouvrage en tête duquel figure le nom de Beaumarchais, et qui est signé: Pontmartin.
IV
Commencé aux Angles, le Filleul de Beaumarchais avait été terminé à Cannes, où Pontmartin s’était rendu dès le commencement de janvier 1872, et où il avait pris gîte au Pavillon des Jasmins. Il eut la bonne fortune d’y rencontrer M. d’Haussonville[382] et Saint-Genest[383], du Figaro, qu’il ne connaissait pas encore et qui allait devenir un de ses plus chers amis. Il m’écrivait, le 28 mars: «Saint-Genest (dont le vrai nom est Bucheron, mais qui ne débite pas de fagots) est ici pour quinze jours; nous avons fraternisé dès la première séance.»
C’était le moment où M. Paul Dalloz, directeur du Moniteur universel, proposait de payer les cinq milliards de notre rançon au moyen d’une souscription nationale. Si l’idée était peu pratique, elle était du moins généreuse et patriotique. Pontmartin l’adopta aussitôt avec enthousiasme. Seulement, sentant bien qu’elle ne pouvait réussir parce que[344] le chiffre était effrayant; comprenant que, pour obtenir le difficile, il ne faut pas demander l’impossible, il voulait que l’on se bornât à demander aux souscripteurs cinq cents millions, c’est-à-dire l’intérêt de la dette prussienne pendant deux ans.
Même avec cet amendement, le projet n’aboutit pas. Il en conçut un réel chagrin, dont je retrouve la trace dans une de ses lettres:
Forcé d’ajourner indéfiniment nos espérances légitimistes, m’écrivait-il le 13 mars 1872, je m’étais un moment rabattu sur la souscription nationale pour la délivrance du territoire. Cette noble idée m’avait passionné, bien moins à cause du résultat matériel, qui ne pouvait, hélas! qu’être incomplet, que parce que j’y voyais une revanche morale, une réhabilitation, un moyen de diriger vers une œuvre commune et indiscutable des milliers de volontés et d’intelligences, divisées sur tous les autres points. Inscrits sur les mêmes listes, associés à la même entreprise, nous ne pouvions plus nous haïr. Le peuple, voyant les riches se saigner aux quatre veines et le protéger, par ces nouveaux sacrifices, contre les chances d’une nouvelle invasion, y aurait perdu ou adouci quelques-unes de ses préventions et de ses haines. Que fallait-il, après tout, pour arriver à ce chiffre de 500 millions, qui eût paru suffisant aux plus pessimistes? 14 francs par habitant. En distribuant cet impôt volontaire sur un espace de dix-huit mois, c’est-à-dire de 550 jours environ, il eût suffi que les pauvres donnassent un sou par semaine, les familles aisées 25 centimes, et que les riches, les grands propriétaires, les grands industriels, les grandes compagnies eussent assez de patriotisme pour se charger du reste. Ce n’était ni impossible, ni même difficile. J’ai exposé tous ces calculs dans une réunion de la Colonie française au Cercle de Cannes, et ils ont paru limpides. Mais notre gouvernement de Gérontes parlementaires, de Mathusalem d’opposition dynastique, ne comprend et n’aime rien[345] de ce qui touche à la grandeur morale, à l’esprit de sacrifice. Il ne nous a pas même fait l’aumône d’une neutralité silencieuse, et maintenant, il faut renoncer à cette illusion—comme à toutes les autres...
Ses mécomptes et ses tristesses avivaient de plus en plus ses sentiments chrétiens, sa foi religieuse. A la veille des fêtes de Pâques, le 28 mars, il m’écrit:
...La Semaine sainte! que de devoirs elle m’impose, que de sentiments elle réveille, en cette lugubre et sinistre année 1872, où je suis seul, un pied dans la tombe, séparé par la mort de ma pauvre femme que j’avais cru destinée à me survivre un quart de siècle, séparé par l’absence de mon fils qui est à Rome! Comment, pendant ces jours de deuil, assombris par d’autres deuils, ne pas s’absorber dans des pensées de douleurs, de soumission et de piété, quand Dieu nous frappe, quand les hommes nous menacent, quand les événements les plus terribles semblent n’être que le prélude de calamités plus effroyables encore!...
Dans cette lettre du 28 mars, répondant à ce que je lui avais écrit de M. de Falloux, de la sagesse de ses vues, de l’habileté de sa politique, Pontmartin ajoutait:
Tout ce que vous me dites dans votre lettre est d’une grande justesse; oui, Dieu nous châtie, mais méritons-nous qu’il nous épargne? Les chefs nous manquent; mais sommes-nous dignes d’en avoir? L’esprit de parti, l’envie, la haine, notre manie d’opposition épigrammatique et frondeuse, n’ont-ils pas tour à tour appliqué leurs dissolvants aux gouvernements, aux hommes d’État, à toutes les garanties d’autorité matérielle et morale? Personne n’admire plus que moi M. de Falloux. Il est, depuis la mort de[346] Berryer, le représentant le plus élevé, le plus éloquent, le plus pur, le plus parfait des idées qui auraient pu nous sauver, et il possède en surcroît une sagesse, un esprit de conduite, une régularité de mœurs et d’habitudes que Berryer n’avait jamais eus. L’a-t-on assez calomnié! assez déchiré! Et moi-même, en un jour de folie bohémienne, ne l’ai-je pas bêtement égratigné; pourquoi? pour le plus misérable de tous les motifs; parce que, lors de son ministère, je l’avais trouvé ou avais cru le trouver trop froid, quand je lui adressais quelque demande!
Le 6 avril 1872, il quitta Cannes, où il avait fait un séjour de trois mois. La veille de son départ, il écrit à M. Jules Claretie:
Je quitte demain Cannes la pluvieuse, où habitent beaucoup d’Anglaises, entre autres Miss-tification. Figurez-vous, en trois petits mois, 49 grandes journées de pluie et d’innombrables rafales de vent d’Est. Aussi ma santé qui n’était que mauvaise est-elle devenue détestable. J’espère pourtant avoir la force et le courage de partir le 17 ou le 18 pour Paris, où je dois rendre compte du Salon dans l’Univers illustré. Jugez de mon empressement à aller me jeter dans vos bras. Hélas! quel abîme entre nos dernières causeries de mai 1870, et ce serrement de mains et de cœur... Aimons la France, mon cher ami, aimons-la avec une passion qui nous soutienne, nous réconcilie et nous console. Aimons-la une fois pour elle-même, dix fois pour ses fautes, cent fois pour ses malheurs. Unissons-nous dans cet amour, comme des enfants qui se seraient disputés pour des vétilles et qui s’embrasseraient en regardant leur mère en pleurs.
V
Le Filleul de Beaumarchais parut en volume le 9 avril, et Pontmartin en consacra le produit à l’Œuvre du Sou des chaumières. Il avait dû, d’ailleurs, laisser son livre aller seul à Paris, où il n’arriva lui-même que le 8 mai. Comme il n’avait plus son appartement de l’avenue Trudaine, il logea hôtel Byron, 20, rue Laffitte[384]. J’eus le plaisir d’y passer quelques semaines avec lui; nous prenions d’ordinaire nos repas, à l’angle de la rue Favart et de la place de l’Opéra-Comique, chez des restaurateurs qui s’appelaient, je crois, Édouard et Félix, et dont l’établissement était parfaitement français, quoiqu’il s’intitulât «Taverne de Londres». Là se rencontraient, presque tous les soirs, avec Pontmartin, des journalistes, des hommes de lettres et des artistes, Xavier Aubryet, Albéric Second, Alphonse Royer, Robert Mitchell, Mario Uchard, Nuitter, Mermet, Vaucorbeil. La vie d’hôtel et la vie de restaurant ne sont guère propices au travail, surtout lorsque l’on a soixante ans bien sonnés. Pontmartin pourtant trouvait moyen de travailler comme par le passé. «Je ne puis, disait-il, renoncer au travail qui me semble aussi nécessaire à ma vie[348] que le pain que je mange et l’air que je respire.»
Dès son arrivée, il avait repris à la Gazette de France sa collaboration hebdomadaire, suspendue depuis le 12 août 1870. Son article de rentrée parut le 15 mai 1872, avec ce titre: Notre conversion[385]. En même temps, il faisait, à l’Univers illustré, le compte rendu du Salon, auquel il ne consacra pas moins de neuf articles. Il fera encore chez Michel Lévy les Salons de 1873 et de 1874. Son dernier Salon, celui de 1878, paraîtra dans le Correspondant.
Littérature et beaux-arts sont bien loin, du reste, à ce moment, de l’absorber tout entier. L’avenir de la France, les périls qu’elle traverse, les calamités qui la menacent, voilà sa grande, presque son unique préoccupation; elle n’est absente d’aucun de ses feuilletons de la Gazette; elle le suit même au Salon, elle tient surtout une large place dans ses lettres. A de certaines heures, le découragement le gagne. Il m’écrit par exemple, le 15 juin 1872, après mon retour en Bretagne:
...A quoi bon combattre? Nous ressemblons à des naufragés, à des nageurs qui, d’une part, verraient s’éloigner de plus en plus le rivage ou le port, et, de l’autre, sentiraient la vague grossir, monter, d’abord sur leurs épaules, puis sur leurs têtes. Les quelques députés que j’ai vus depuis dimanche assurent que M. Thiers paraît enchanté des dernières élections[386]. Ah! si nous n’étions tous dans la poêle à[349] frire, comme je rirais le jour où cette miniature, cette contrefaçon de grand homme, ce Cromwell de Lilliput, ce Washington de buvette parlementaire sera avalé, d’une bouchée, par l’ogre démagogique! Vous pouvez aisément vous figurer, mon cher ami, ce que devient dans tout cela cette malheureuse littérature...
Le 12 juillet, il revenait aux Angles, juste à temps pour y recevoir, comme un dernier écho de Paris, l’étrange livre de Dumas fils, l’Homme-Femme, qui lui inspira aussitôt un très bel article[387], sans préjudice de cette vigoureuse page, que je détache de sa lettre du 21 juillet:
...C’est un mélange effroyable et incroyable d’aspirations chrétiennes et de malpropretés réalistes; l’Évangile annoté par le Dr Ricord, la pathologie expliquant le catéchisme, une goutte d’eau bénite dans une cuvette d’eau de lavande, Vénus et Lucine fraternisant avec sainte Anne et sainte Élisabeth. Si l’auteur a spéculé sur ce contraste pour avoir un grand succès de vente, il doit être content; mais quoi de plus triste et quel douloureux indice! Au fait, dans un temps et dans un pays qui falsifient tout, pourquoi l’auteur du Demi-Monde ne serait-il pas un père de l’Église et un prophète? S’il faut faire de la politique tarée pour être accepté comme grand citoyen et grand patriote, pourquoi serait-il défendu de passer par la littérature tarée pour arriver au rôle d’apôtre? M. Gambetta, grand homme de guerre et Washington de l’avenir; M. Hugo, poète national; M. Dumas, prédicateur d’une régénération sociale; M. de X., défenseur du trône et de l’autel, tout cela se tient, se ressemble, et, quoique peu enclin à la politique du surnaturel,[350] je commence à comprendre qu’une société favorable à de tels mensonges ne doit pas être modifiée par un expédient, améliorée par une transaction, mais transformée par un coup de foudre. On ne corrige pas un tonneau de vin sophistiqué en y versant une bouteille de médoc ou de chambertin, mais en vidant tout le tonneau. Adieu, mon cher ami; je tâcherai, sans préjudice de notre correspondance, de vous donner, chaque samedi, de mes nouvelles par la Gazette de France. Mes appréhensions, mes angoisses ne font que redoubler en moi la conviction que nous devons lutter jusqu’au bout, donner l’exemple du travail à bien des paresseux démocratiques et communards qui nous accusent d’être oisifs. Sous ce rapport, nos désastres m’ont rendu service—hélas! un service acheté bien cher.—Car, je dois vous l’avouer, trois mois avant la chute de l’Empire, je me voyais ou je me croyais au bout de mon rouleau de papier; énorme rouleau dont vous connaissez la première feuille sous forme de vers latins ou de version grecque (1826) et dont la plus récente (20 juillet 1872) s’achemine vers la rue Coq-Héron. Total, 46 ans, qui ont consommé deux Royautés, deux Républiques, un Empire et plus d’argent qu’il n’en faudrait pour que tous les Français missent au pot, non pas la poule, mais le faisan doré.
L’automne de 1872 fut marqué pour Pontmartin par une heureuse rencontre. Le 3 octobre, il était à la villa de Barbentane[388], chez le marquis Léon de Robin-Barbentane. Frédéric Mistral s’y trouvait en même temps que lui. A table, le chantre de Mireille porta un toast en vers, recueilli depuis dans les Iles d’Or, et dont voici la traduction:
ENTRE VOISINS
Pour faire bien ce qui est dû—comme au temps de la reine Jeanne—et de René le roi féal—aux nobles dames du château—je bois ce vin de Barbentane.
Je bois ensuite au marquis d’Andigné[389]—qui, dans la guerre âpre et farouche—lorsque s’éteignait toute gloire—sous le feu des canonniers,—lui, se ramassait une couronne.
Puis à Monsieur de Pontmartin—je porte un toast à coupe rase,—car il est le roi de ce festin,—et dans ses livres diamantés—sa plume d’or vaut une épée[390].
Entre voisins!... A peine Pontmartin était-il revenu de Barbentane, que son voisin le Rhône lui faisait la politesse de venir jusqu’au seuil de sa porte. Après quatre mois de sécheresse, on avait eu, depuis le 1er octobre, pendant plus de quinze jours, des pluies continuelles et torrentielles. On put craindre un moment une inondation plus terrible que celles de 1840 et 1856. Pontmartin dut faire transporter au premier étage de sa maison tout son mobilier du rez-de-chaussée. Il en résulta,[352] dans ses habitudes, durant quelques semaines, un bouleversement complet, et un vrai serrement de cœur, en face de cette plaine fertile, changée en un lac gigantesque.
Chose singulière, c’est au milieu de ces bouleversements et de ces ennuis qu’il a écrit quelques-uns de ses plus jolis articles, ces Fantaisies et Variations sur le temps présent[391], qu’il a placées sous le couvert de M. Bourgarel, ancien magistrat, et au milieu desquelles s’épanouit ce petit chef-d’œuvre d’humour et d’ironie, M. Gambetta, membre de l’Académie française[392].
VI
Ce fut seulement le 12 mars 1873, après un séjour de huit mois à la campagne, qu’il revint à Paris. Il prit, cette fois, un appartement rue de Rivoli, 172, au Pavillon de Rohan. Ce quartier lui convenait mieux que le boulevard des Italiens, trop brillant, trop bruyant et trop jeune pour son âge et pour ses goûts.
Le 5 avril, le Gaulois annonça qu’il publierait, chaque semaine, deux articles de l’auteur des Samedis. Pensant bien que cette collaboration à une feuille bonapartiste me causerait quelque[353] surprise et quelque contrariété, Pontmartin m’écrivit le jour même:
Vous verrez dans le Gaulois de ce matin l’annonce d’une collaboration qui vous surprendra. Voici l’explication pour mes vrais amis. En quittant les Angles, j’ai pu me convaincre que, grâce à nos quatre inondations,—il y en a eu une cinquième le 16,—la récolte de cette année serait à peu près nulle; sans compter les dégâts et les réparations urgentes. User de mon droit strict, c’est-à-dire obliger à me payer des gens qui ne récoltent rien, ce n’est nullement dans mes habitudes, et j’ajoute qu’au milieu de notre mal’aria républicaine et méridionale, ce serait très impolitique, si ce n’était très peu charitable. Or, M. Edmond Tarbé[393], gracieux et élégant gentleman, m’a offert un prix si nouveau pour moi, tellement hors de proportion avec mes honoraires habituels, que je n’ai pas cru devoir refuser. J’essaierai de faire, dans le Gaulois, quelque chose d’intermédiaire entre le premier-Paris et la Causerie littéraire; une variante des Lettres d’un intercepté sous une forme plus parisienne; je garde le droit d’y rester, si je veux, absolument légitimiste; mais, à tort ou à raison, je crois que nous touchons à une phase où il sera plus utile de démarquer le drapeau de la défense sociale contre les radicaux dont la victoire approche. Le comte de Chambord,—et c’est, j’en suis sur, l’opinion de M. de Falloux et la vôtre,—s’est arrangé de façon à simplifier notre tâche. Réfugié dans le surnaturel, dans le sentiment d’une mission providentielle qu’il croit être appelé à remplir tôt ou tard, il ne nous laisse plus d’autre champ de bataille que celui où peuvent s’unir tous les défenseurs de l’ordre, de la religion, des grandes vérités sociales et morales, pour conjurer le[354] péril urgent et combattre l’ennemi commun. Sous ce rapport, le Gaulois, qui tire à 25000 exemplaires et qui espère avoir, vers la fin du mois, 10000 abonnés de plus, m’est plus favorable que la Gazette de France...
Il n’abandonnait point, du reste, la Gazette, où ses Samedis ne subirent aucune interruption.
Les chroniques de Pontmartin au Gaulois parurent du 9 avril au 24 juillet 1873. Elles sont au nombre de vingt-trois. En voici les titres: La Première hirondelle;—Pilote habile;—Le Plat du jour;—Le Second Favre;—Héloïse et Abélard;—Le Rouge et le Jaune, ballade parisienne;—Le Secret des monarchistes;—Les Termites;—Leur Modération;—La Revanche;—La Vraie recette;—La Confession d’un... moine italien;—Les Hommes nécessaires;—Hé! donc?—Les Vieilles lunes;—Libérateur du territoire;—La Rosière de Draguignan, saynète;—Qui veut la fin veut les moyens;—Ce qu’ils auraient fait, ce que vous faites;—Le Pour et le Contre;—La Première du ROI S’AMUSE;—Lettre d’Usbek à son ami Rustan, à Téhéran;—Les Pèlerinages.
De ces vingt-trois chroniques, cinq seulement ont été reproduites par Pontmartin dans ses Nouveaux Samedis[394]. Ce sont celles qui ont pour titres: Pilote habile, le Plat du jour, leur Modération, la Confession d’un... moine italien, Qui veut la fin veut les moyens. S’il eût réuni en un volume spécial ces pages railleuses, fantaisistes, humoristiques,[355] ce volume eût été l’un de ses meilleurs. Les maîtres du genre, Prévost-Paradol, Arthur de Boissieu, J.-J. Weiss, n’ont peut-être jamais fait une campagne aussi brillante.
Au mois d’avril, précisément à l’heure où il commençait sa campagne du Gaulois, Pontmartin avait publié un volume de nouvelles, la Mandarine. La Mandarine, ce n’est pas ici cette espèce d’orange qui nous est primitivement venue de Malte; c’est la femme du mandarin. Rousseau demande quelque part à son lecteur ce qu’il ferait dans le cas où il pourrait s’enrichir en tuant en Chine, par sa seule volonté et sans bouger de Paris, un vieux mandarin. Sur ce thème, Pontmartin a brodé un petit roman d’une invention originale et d’une singulière vérité d’observation. Il nous a conté comment, dans un instant plus rapide que l’éclair—le temps qu’il faut pour avoir une mauvaise pensée—l’honnête et malheureux Albéric de Sernhac avait tué sa mandarine.
Cet ingénieux et dramatique récit[395] forme la pièce principale du volume, que complètent d’autres nouvelles, Françoise, Un Trait de lumière, Cent jours à Cannes, les Deux talismans et Une Cure merveilleuse.
L’Assemblée nationale s’était séparée le 8 avril 1873 pour ne reprendre ses séances que le[356] 19 mai. Le 27 avril, l’ex-instituteur Barodet, le maire révoqué de Lyon, fut nommé député de Paris, battant de 40,000 voix M. de Rémusat, ministre des Affaires étrangères. Cette élection démagogique était le coup de cloche qui annonçait la chute prochaine de M. Thiers. J’avais quelque désir d’assister de près à l’événement. Mes amis de Versailles m’engageaient à venir à Paris. Pontmartin me mandait qu’il m’avait trouvé au Pavillon de Rohan une chambre pas chère. Le 18 mai, je me décidai à l’aller rejoindre, et nous passâmes ensemble une dizaine de jours, dont le souvenir m’est resté très présent.
Je trouvai Pontmartin dans une véritable fièvre de travail. Il écrivait quatre grands articles par semaine, une Causerie du samedi à la Gazette, deux premiers-Paris littéraires au Gaulois et une Revue du Salon à l’Univers illustré. Joignez à cela une correspondance active, force visites, déjeuners fréquents à Passy chez Saint-Genest ou chez Cuvillier-Fleury, soirées passées tour à tour chez Jules Sandeau ou chez Joseph Autran, et vous aurez une idée de l’activité de ce sexagénaire qui se disait toujours mourant, rendu, fini! Il composait en général ses articles le matin en se promenant dans le jardin ou les galeries du Palais-Royal, alors à peu près désertes. L’article une fois fait, et quand il ne restait plus qu’à l’écrire, il l’écrivait de sa petite écriture fine et nette, sans ratures et sans retouches. Si, à ce moment-là, j’entrais dans sa chambre, et si je voulais prendre un livre ou[357] une Revue: «Pourquoi lisez-vous? disait-il; causons plutôt comme si de rien n’était. Ce n’est rien du tout que mon article.» Et ce rien du tout, qu’il jetait sur le papier tout en causant, c’était quelquefois une page exquise, un morceau achevé, un chapitre fait de main d’ouvrier.
Le 21 mai, j’étais à Versailles, Pontmartin n’avait pu m’accompagner, ayant à faire ce jour-là, pour la Gazette de France, un article sur les Sonnets capricieux, de Joseph Autran. «J’entreprends, disait-il, aujourd’hui mercredi, 21 mai, j’entreprends d’écrire une page à propos de ce livre, sans être bien sûr que mes écritures ne se heurteront pas en chemin à une révolution ou à un coup d’Etat[396].»
L’article parut le samedi 24 mai, à cinq heures du soir, au moment où l’Assemblée nationale, en retard de deux ans, renversait M. Thiers.
Ce même soir, l’Opéra-Comique donnait la première représentation de LE ROI L’A DIT, paroles d’Edmond Gondinet, musique de Léo Delibes. J’y assistais avec Pontmartin et Léopold de Gaillard. On se disait dans les entr’actes: «Thiers est battu, Mac-Mahon refuse, Mac-Mahon accepte.» Malgré les préoccupations politiques, la pièce obtint un éclatant succès. Hélas! quel succès plus éclatant, quel triomphe pour les honnêtes gens, pour la France, si cinq mois plus tard, le 27 octobre 1873, LE ROI n’avait RIEN DIT!
CHAPITRE XIV
LES ÉLECTIONS DE 1876.—L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878.—SOUVENIRS D’UN VIEUX MÉLOMANE.
(1874-1878)
L’Union de Vaucluse. La Politique en sabots. Mort de Jules Janin. Beati non possidentes!—Les Élections de 1876. Rue et hôtel de Rivoli. Le marquis de Besplas et le château de la Garenne-Randon. Léontine Fay et le THÉATRE DE MADAME.—Mort de Joseph Autran. Le Seize-Mai. Les articles sur M. Thiers.—Séjour à Hyères. Mgr Dupanloup. La villa de Costebelle. La Messe à bord du vaisseau-école le Souverain. Lettre de l’Évêque d’Orléans. L’Exposition universelle et la rue de Passy.—Promenade au Salon de 1878. Le Barabbas de Charles Muller et l’Apothéose de M. Thiers. Mlle Sarah Bernhardt et le buste de M. Émile de Girardin. Les Souvenirs d’un vieux mélomane. Article d’Henri Lavedan. Pontmartin quitte Paris pour n’y plus revenir.
I
Pontmartin, après le 24 mai, avait cru au retour prochain de la monarchie. La lettre du 27 octobre, qui détruisait toutes ses espérances, lui causa une inexprimable douleur. Sa santé même en reçut une grave atteinte. Il m’écrivait, le 4 novembre: «Depuis qu’a paru la lettre néfaste, mes insomnies,[359] qui n’étaient que fréquentes, sont devenues continuelles, et il en résulte, chaque lendemain, un assoupissement maladif, qui dérange même l’équilibre de mes facultés intellectuelles. J’ai dû m’interdire tout travail.»
Mais, pour lui, ne plus écrire, c’était la chose impossible. Là, d’ailleurs, était le devoir. Il me mandait des Angles, le 31 janvier 1874: «Je voudrais pourtant travailler encore; il me semble que, dans un temps comme celui-ci, un écrivain n’est tout à fait libéré que lorsqu’il est tout à fait mort.» Dès la fin de novembre 1873, sans reprendre encore ses Samedis de la Gazette, suspendus depuis le mois d’août, il avait taillé de nouveau sa plume. «Voici plus de trois mois, me disait-il, le 27 février 1874, que je me suis fait, non pas, hélas! prophète, mais journaliste dans mon pays. j’ai eu parfois envie de vous envoyer mes articles, mais il m’a paru qu’ils ne pouvaient intéresser que les Vauclusiens. Pourtant un des derniers, intitulé Honorum dehonestamentum, a eu quelque retentissement.»
C’est dans l’Union de Vaucluse que paraissaient ces articles; deux des plus réussis, les Fantômes et Marphurius ou les Superstitions, ont été recueillis dans le tome X des Nouveaux Samedis, où ils forment les chapitres VII et VIII de la série qui a pour titre: la Politique en sabots. Ils ont été écrits à l’occasion de l’élection partielle dont le département de Vaucluse fut le théâtre en février-mars 1874, et où se trouvaient en présence le citoyen Ledru-Rollin[360] et un ami de Pontmartin, le marquis de Biliotti[397].
Cette petite campagne de presse, dans sa ville natale, sur le terrain même où avaient eu lieu ses débuts, avait sans doute ranimé ses forces; il en profita pour envoyer au Correspondant deux grands articles, l’un sur Prosper Mérimée, à propos des Lettres à une Inconnue[398], l’autre sur le Quatre-vingt-treize de Victor Hugo[399], Autran lui écrivait, le 27 mars, après la lecture du second de ces articles: «Vous êtes vraiment un homme étonnant, vous qui trouvez ainsi ces flots d’une prose éloquente, toujours plus pure et toujours plus abondante. Il est des écrivains qui sont des sources vives, vous êtes un de ceux-là. Le Figaro disait, l’autre jour, par la plume de ce mystérieux François Duclos[400], que vous n’aviez rien à envier à Sainte-Beuve. Je le crois certes bien. Jamais, au grand jamais, Sainte-Beuve n’a eu cette ampleur de vue et cette maëstria de style qui vous appartiennent. Il avait sans doute des qualités de finesse incroyables; mais, si exquises qu’elles fussent, elles étaient certainement d’un ordre inférieur aux vôtres...»
Cette lettre d’Autran alla trouver Pontmartin à Cannes, d’où il m’écrivait à ce même moment:
Cannes, Hôtel de la Plage, 29 mars 1874.
Mon cher ami, si vous vous étonnez de mon long silence, ce seul mot, Cannes, vous répondra pour moi. J’allais partir pour Paris quand, tout à coup, un mistral furieux, imprégné de toutes les neiges du Ventoux, du Luberon et des Alpines, est venu fondre sur nos bords du Rhône, ménagés jusque-là par l’hiver 1873-1874. Je me suis enrhumé, et mon médecin m’a ordonné de faire mon pacifique 20 mars, non pas quai Malaquais ou sous le marronnier des Tuileries, mais sur le golfe de la Napoule, à 4 kilomètres du golfe Jouan. Il est permis d’être un peu girouette quand le vent est si violent, le terrain si peu solide et la politique si variable. Je suis donc venu à Cannes, et j’y resterai probablement jusqu’au 15 avril; un mois d’exil ou de vacances, suivant qu’on est plus épris des beautés de la nature ou du bel-esprit parisien. Au surplus, je dois vous avouer que, d’année en année, Paris m’attire moins et m’effraie davantage. Qu’irais-je y faire?... Le vrai nid, ou, hélas! pour parler plus exactement, la vraie retraite, quand on a passé la soixantaine et qu’on n’est guère valide, c’est le pays natal; c’est la maison des champs où l’on a grandi, où l’on a promené ses premiers rêves après avoir lu René et les Méditations, où l’on a vécu, prié, pleuré, souri, espéré, aimé sous l’aile maternelle, où, cinquante ans plus tard, on retrouve à chaque pas la trace des années heureuses. Sans considérer les vanités de ce monde avec le pessimisme hautain de Chateaubriand ou le dédain hiératique de Bossuet, y a-t-il quelque chose de plus misérable que le spectacle auquel nous assistons?
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Quel bon moment pour acheter des sabots et lire les Géorgiques! En attendant, mon cher ami, Cannes m’inonde de soleil et réalise à mes yeux ces deux lignes des Lettres à l’Inconnue: «Il y a tant de fleurs et de si belles partout,[362] que la verdure est une exception dans le paysage.» Pendant que je vous écris, je n’ai qu’à lever les yeux pour apercevoir, de ma fenêtre entr’ouverte, ces montagnes que l’imagination des Grecs aurait peuplées de faunes et de dryades, cette mer dont les vagues somnolentes viennent expirer sur la plage dans leur frange d’écume, avec un murmure monotone et mélancolique; c’est très beau et un peu triste; mais quoi de plus humain, de plus en harmonie avec les cordes mystérieuses de l’âme, que ce mélange de beauté et de tristesse? Tout ce qu’il faut pour charmer nos regards, et pour nous avertir qu’il existe encore quelque chose au delà?...
Dans les premiers jours de mai, Pontmartin revient à Paris et s’installe, comme en 1873, au pavillon de Rohan. Il publie le dixième volume des Nouveaux Samedis et fait sa rentrée à la Gazette de France, le 5 juillet, par un article sur Jules Janin, qui venait de mourir[401]. L’article est des plus élogieux, et c’était justice. Jules Janin était, lui aussi, un écrivain de race, et Pontmartin eut raison de célébrer sa verve intarissable, son amour sincère et constant pour la belle littérature, ses Lundis, qui avaient été, pendant quarante ans, une fête hebdomadaire. Lui-même, d’ailleurs, lors de la crise Charbonneau, avait eu grandement à se louer du critique des Débats. Il n’oubliait pas non plus qu’un jour Jules Janin, lui envoyant sa traduction d’Horace, avait écrit sur la première page du volume ces deux vers, délicate allusion aux opinions royalistes du critique de la Gazette:
Prenez-la, mon ami, vous qui valez mieux qu’elle.
Pourquoi? me direz-vous.—Vous êtes plus fidèle.
Au lendemain de son article, Pontmartin regagna les Angles. De loin, les Angles, c’était pour lui le repos, la tranquillité, le loisir, la rêverie sous les grands arbres, la promenade au bord du fleuve, le travail que rien ne trouble, sinon le chant des oiseaux dans le jardin et le murmure du vent dans les vieux marronniers: Angulus ridet. De près, ce n’est pas tout à fait cela. Il m’écrit, le 29 janvier 1875:
...C’est moi qui suis en retard, et je m’en accuse; mais je dois ajouter que je suis débordé, écrasé, englouti, submergé. Figurez-vous que ma littérature n’est que le très petit accessoire de mes journées; c’est ce qui devait nécessairement arriver dans un pays où personne n’admet que mon temps n’appartienne pas aux solliciteurs, aux fermiers, aux visiteurs, aux amis, aux affaires d’autrui surtout, exactement comme si je n’avais jamais touché une plume de fer ou d’oie. Tantôt c’est un syndicat que je préside, après avoir préalablement donné à dîner à quelques-uns de mes collègues; ce qui m’ahurit pour 24 heures; tantôt c’est l’ingénieur de notre chemin de fer, chez qui je suis obligé de courir pour lui démontrer, un plan à la main, que le tracé qu’il a choisi ruinerait notre malheureuse plaine...
Pour un peu, le pauvre propriétaire s’écrierait—ne fût-ce que pour n’avoir rien de commun avec le comte de Bismarck—Beati non possidentes[402]! Une ressource pourtant lui restait; c’était, après avoir fui Paris, de fuir les Angles, et de se réfugier sur le littoral de la Méditerranée. En mars[364] et avril, après quelques semaines passées à Cannes, il fit un assez long séjour à Marseille. «Vous me demanderez peut-être, m’écrivait-il de cette dernière ville, pourquoi je suis resté si longtemps à Marseille. C’est d’abord parce que j’espérais apporter quelque distraction à M. Autran, dont l’état m’attriste profondément; c’est ensuite parce que j’ai été comblé de politesses et de témoignages de sympathie. Sans le mistral, j’aurais pu me croire à Nantes, au milieu d’un groupe auquel vous auriez appris à m’aimer, et même à me lire. Invitations, déjeuners à la campagne, promenades sur mer, parties de pêche, c’est une série d’honnêtes plaisirs qui
Chatouillent de mon cœur la secrète faiblesse.
Cette bonne vieille radoteuse, qu’on appelle la littérature, peut donc servir à quelque chose? J’en avais douté bien souvent, mais non pas quand je vous lisais[403].»
Nombreux, en effet, étaient là-bas, à Marseille, les amis de Pontmartin. L’un des plus chers, après Autran, était un autre poète, le traducteur de Catulle, l’auteur des Poésies simples et des Sentiers unis, M. Eugène Rostand, qu’il appelle quelque part «un charmant causeur, un vaillant publiciste, un homme excellent, un poète exquis[404]». Quelle délicieuse maison que celle de M. Rostand! Pontmartin[365] y voyait le mélodieux frère d’Eugène, Alexis, et aussi le jeune Eddy[405], ses gentilles sœurs et leur aimable mère. Vingt-huit ans plus tard, Eddy, devenu membre de l’Académie française, se souviendra du vieux critique, de l’ami de son enfance, et il dira, dans son discours de réception: «C’est élégant comme du Pontmartin». Et Eugène-Melchior de Vogüé lui dira, dans sa réponse: «La demeure de vos parents était accueillante aux écrivains, aux artistes. Vous vous rappelez l’un de ces familiers, haute silhouette maigre, voix fluette et spirituelle: vous aussi, vous avez joué sur les genoux de mon cher maître, Armand de Pontmartin: donnons ensemble un souvenir respectueux au vieil ami qui eût dû nous précéder dans cette Compagnie[406].»
Toute cette année 1875 se passa sans que Pontmartin revînt à Paris; mais il n’interrompit pas pour cela ses Semaines littéraires[407], et il publia deux nouveaux volumes de Causeries: en mars, le tome XI; en octobre, le tome XII des Nouveaux Samedis.
II
Lorsque s’ouvrit l’année 1876, l’Assemblée nationale de Versailles avait vécu.
Le 31 décembre 1875, elle avait décidé que l’élection des deux cent vingt-cinq sénateurs, dont la nomination appartenait au corps électoral, aurait lieu le 30 janvier 1876, celle des députés le 20 février; que les nouvelles Chambres se réuniraient le 8 mars, et que ce serait ce jour-là seulement qu’expireraient théoriquement les pouvoirs de l’Assemblée. Mais, en fait, la séance du 31 décembre fut sa dernière séance. Elle se sépara le dernier jour de l’année 1875, pour ne jamais plus se réunir.
Les élections du 30 janvier et du 20 février allaient décider des destinées du pays; l’avenir, la prospérité, la vie même de la France était l’enjeu. Pontmartin n’avait jamais manqué au devoir patriotique; cette fois encore, il s’y dévouera tout entier. Vainement son médecin insiste près de lui pour qu’il aille passer l’hiver à Cannes. Il s’y refuse, et, le 6 janvier, il m’écrit; ou plutôt il dicte à son fils une lettre à laquelle j’emprunte ces lignes:
...Certes, mes yeux, mes nerfs et mes poumons préféreraient la plage de Cannes au pavé d’Avignon ou de Nimes; mais je ne crois pas devoir m’éloigner du théâtre de la lutte, quand même je n’y gagnerais que la douleur d’assister au[367] triomphe de nos adversaires. Dussé-je ne recruter qu’une voix pour le Sénat et vingt pour la Chambre, je resterais jusqu’à la fin sur la brèche; j’ai la tête pleine de petites vérités sociales, économiques, politiques, à l’usage de nos ruraux, et il est possible que j’en fasse une brochure de 64 pages in-32 que nous tâcherions de propager, surtout dans notre zone méridionale. La littérature a du bon, mais je dois vous avouer que, pendant toute cette crise électorale, il me semble bien difficile et bien inutile de s’occuper des défauts et des mérites d’un roman et d’un volume de poésie...
La brochure projetée parut en six fois dans l’Union de Vaucluse et, sous ce titre: les Élections de 1876, fut répandue dans les départements du Midi, de Toulouse à Marseille. Immédiatement après, vinrent six articles contre Gambetta; puis, un appel aux Conservateurs, en vue du scrutin de ballottage qui eut lieu le 5 mars. Et tout cela presque en pure perte! Des scrutins du 20 février et du 5 mars sortit cette majorité des 363, dont les exploits ne sont que trop connus. Pontmartin m’écrivit aussitôt pour me dire—ce sont les dernières lignes de sa lettre du 5 mars: «Serrons-nous l’un contre l’autre dans la mauvaise fortune. Courage, si c’est une crise! résignation, si c’est une fin! Notre Roi n’a pas voulu de nous; mais Dieu nous reste, et peut-être aura-t-il pitié de la France.»
Dans les premiers jours de juin, il revenait à Paris, après une absence de deux ans, descendait rue et hôtel de Rivoli, 203, et publiait la treizième série des Nouveaux Samedis, où il y avait heureusement[368] assez d’esprit et de talent pour conjurer les mauvaises chances du nombre 13.
En juillet, la chaleur étant devenue insupportable, il alla passer quelques semaines chez son cousin le marquis de Besplas, au château de la Garenne-Randon,—près de la station d’Épone-la-Garenne,—la bien nommée, disait-il; car, dans une seule allée du parc, il avait compté un matin 57 lapins. Jamais chasseur méridional ne s’était trouvé à pareille fête! La bibliothèque du châtelain était un gîte très commode pour ses écritures; c’est à peine cependant s’il pouvait, le mercredi soir, aller jeter à la boîte de la poste son article hebdomadaire. Aussi bien, la demeure de l’aimable M. de Besplas ne désemplissait pas de comtes et de marquis, de baronnes et de duchesses. Élégants et belles dames n’étaient point du reste pour effaroucher Pontmartin, aussi à son aise, en ce château de Seine-et-Oise, qu’au restaurant Caron ou à la Taverne de Londres. Il en était quitte, mélomane incorrigible, pour se chanter à lui-même, sous les arbres du parc, la romance du Pré-aux-Clercs:
Les rendez-vous de noble compagnie
Se donnent tous dans ce charmant séjour.
De retour aux Angles, il reprenait ses écritures avec une activité nouvelle. Le décès de Mme Volnys—la Léontine Fay du Mariage de raison—morte pieusement à Nice le 29 août 1876, lui inspirait un de ses meilleures feuilletons[408]. «Je vous recommande[369] ma Léontine Fay, qui vous intéressera, me mandait-il le 8 septembre. C’est encore un chapitre de mes souvenirs de jeunesse, et je reconnais, chaque fois que je touche à ces notes mélancoliques et vibrantes, que vous avez bien raison et que ce genre mixte entre la critique, l’histoire intime, l’impression personnelle et le roman, est peut-être ce qui me conviendrait le mieux. Mais n’est-ce pas trop tard? Et les triomphes de plus en plus décisifs de la démocratie radicale ne créeront-ils pas bientôt une société nouvelle où les souvenirs de l’ancienne ne trouveront plus d’écho?...»
Ces souvenirs, il y reviendra de plus en plus. Le moindre mot, le plus petit détail, suffisent à les réveiller. Un jour,—c’était à quelques semaines de la lettre qu’on vient de lire,—je lui annonce que j’ai trouvé chez un bouquiniste de Nantes, dans leur édition originale[409], la collection à peu près complète des comédies-vaudevilles de Scribe, du Scribe de la Restauration, de 1824 à 1829. Pontmartin me répond, le 15 décembre 1876:
...Si vous saviez quelles images évanouies, quel monde de souvenirs vous m’avez rendu en me parlant de cette jolie édition beurre frais, rose ou abricot du Répertoire du Théâtre de Madame[410]. C’était bien en 1829, et ce fut, après les austères[370] années de catéchisme, de collège et de lauriers bien éphémères au concours général, une de mes premières jouissances profanes, avec une légère saveur de fruit défendu. On en trouvait l’assortiment chez Masgana, galerie de l’Odéon, et j’échangeais—proh pudor!—mon dictionnaire grec de Planche contre quatre de ces élégantes brochures, la Demoiselle à marier, le Charlatanisme, l’Héritière et les Dernières amours. Est-ce assez loin? Étions-nous assez jeunes, et sommes-nous assez vieux? J’ai peine, cher ami, à retenir mes larmes en vous écrivant ces dernières lignes; c’est que je pense à la France de 1829 et à la France de 1876... Ah! l’abîme est encore plus large et encore plus sombre pour elle que pour moi...
III
Nous ne nous étions plus rencontrés depuis le mois de mai 1873. Dans ma dernière lettre de 1876, je le priai de me dire à quelle date nous pourrions, après une aussi longue séparation, nous retrouver enfin à Paris. Il me répondait, le 4 janvier 1877, au sujet de ce projet de réunion:
...ous rayons, n’est-ce pas, le mois de janvier? Me voici en plein dans ma 66e année; je m’enrhume facilement, et si j’arrivais à Paris pour le parcourir en tous sens (pardonnez-moi celui-là; il est d’une vieillesse qui a droit au respect), notre but ne serait pas atteint. Savez-vous quelle avait été mon idée? Louer à Versailles une petite maison meublée avec jardin, où j’aurais passé toute une saison, du 15 mars au 15 juin. Mon fils serait venu m’y retrouver un peu plus tard, et, en attendant, vous auriez occupé sa chambre. J’ai un domestique fort peu élégant, mais brave homme, qui nous aurait servis. Il y a un train du soir pour les gens qui vont au spectacle. Nous aurions pu passer à[371] Paris une partie de nos journées, et, quand nous aurions ressenti quelque fatigue, messieurs de l’extrême gauche ne nous auraient pas empêchés de jouir des magnifiques ombrages du parc, et de cette atmosphère de calme, de mélancolie, de majestueuse solitude, que les violences ou les niaiseries parlementaires[411] n’ont pas réussi à supprimer. Si cette idée vous déplaît, ne vous en effrayez pas trop. Elle n’a rien de précis, de positif; c’est plutôt la vague impression d’un vieux qui commence à se trouver un peu dépaysé au milieu des encombrements parisiens et du tapage des voitures...
Il était encore aux Angles, lorsque, le 7 mars, sans que rien l’eût préparé à cette nouvelle tristesse, il apprit la mort de son ami Autran, qu’il m’annonça, le jour même, en ces termes:
Mercredi matin. 7 mars 1877.
Je comptais ce matin vous écrire une longue lettre; mais je suis foudroyé par une nouvelle que, très probablement, vous connaîtrez déjà quand vous me lirez, la mort subite de M. Joseph Autran. Je l’apprends, à l’instant, par un télégramme, qui, grâce à un retard inexplicable, ne m’arrive qu’avec la Gazette du Midi, où ce malheur est annoncé. Rien ne m’y préparait. Atteint, depuis six ou sept ans, d’une cécité presque complète, le pauvre poète paraissait d’ailleurs jouir d’une bonne santé. Son père avait vécu jusqu’à 84 ans. Une maladie de cœur, que personne ne soupçonnait, l’a emporté en quelques minutes. Je vais partir pour Marseille, où j’espère arriver à temps pour ses obsèques. En dehors de mes profonds regrets, quelles douloureuses réflexions ne suggère pas cette mort si soudaine! Il y a un mois, je perdais un ami intime, non moins intime ami de Léopold de[372] Gaillard, M. Louis de Guilhermier[412]; dans l’intervalle, j’ai tremblé pour ce jeune homme[413] si bon, si pieux, si dévoué, dont je vous avais parlé dans ma dernière lettre, et que nous appelions ensemble le Biré de la onzième heure; il n’est pas mort, il est hors de danger; mais, pendant huit jours, on a cru qu’il serait impossible de le sauver, et sa mère m’écrit ce matin qu’il est encore si faible qu’elle me demande de retarder ma visite. Vous le voyez, mon cher ami, cette année 1877, si menaçante pour la France et pour tous les honnêtes gens, a pour moi des cruautés particulières, et ses coups de foudre ressemblent à des coups de cloche. Il faut que ces tristesses tiennent une bien grande place dans mon cœur, pour m’excuser de ne pas vous avoir encore remercié de l’envoi de l’Union de l’Ouest et de cet article[414] où je me suis retrouvé, comme toujours, embelli par votre amitié. Cette[373] amitié est infatigable depuis près d’un quart de siècle, et mon regret est de n’avoir pas un peu moins d’années et un peu plus de talent pour la suivre et la justifier jusqu’au bout. Mes remercîments, quoique vêtus de deuil, n’en sont pas moins sincères, et, quoique tardifs, seront toujours prêts à rattraper le temps perdu.
Mais, hélas! quel néant que la vie! quel néant surtout que nos glorioles! Hier, à propos de la Biographie d’Alfred de Musset par son frère Paul, je recueillais mes souvenirs, ces souvenirs qui vous intéressent. Je me voyais, à la première représentation du Caprice, puis, dix-huit mois après, au lendemain de la première de Louison (un petit four), quand nous nous demandions, Buloz, de Mars, Alexis de Valon et moi, comment on pourrait s’y prendre pour dire un peu de vérité sans offenser le poète favori de la Revue des Deux Mondes. En ce moment, la porte s’ouvre, et nous voyons entrer Musset nous apportant les Trois marches de marbre rose. Il y a de cela 28 à 30 ans; la chute de Louis-Philippe, la seconde République, le coup d’État, l’Empire, les désastres et les crimes de 1870 et 1871, les tentatives de Restauration monarchique, l’avortement de nos espérances, les victoires de la République radicale, nos humiliations du dedans et du dehors, ont passé sur ces souvenirs; Buloz, de Valon, de Mars, Alfred de Musset, sont morts; et pourtant il me semble que c’était hier! qu’est-ce que l’homme, ou plutôt qu’est-ce qu’un homme, un individu, un atome, un grain de sable, autour duquel tourbillonnent ces événements gigantesques, jusqu’à ce qu’il soit emporté lui-même et disparaisse! Et dire qu’il y a des gens qui bouleversent le monde, qui désolent leur pays, pour le plaisir de nous faire comparer leur petitesse à ces grandeurs! Voilà le triomphe de la Religion; elle agrandit et élève du côté du ciel cet horizon si étroit du côté de la terre. En nous prêchant l’humilité qui devrait nous être aussi naturelle que l’usage de nos cinq sens, elle nous rattache à la seule idée de durée que nous puissions conserver ici-bas. Si je ne craignais de commettre un paradoxe, presque une hérésie, je dirais que l’orgueil,[374] si anti-chrétien, le plus capital des péchés capitaux, ne pourrait pourtant et ne devrait chercher sa pâture que dans la foi qui lui promet l’infini. Pardonnez-moi, cher ami, ce verbiage qui n’est peut-être que du pathos et du galimatias; car ma pauvre tête subit le contre-coup de mes tristesses de cœur. J’y aurai du moins gagné de prolonger avec vous une de ces causeries que je voudrais multiplier sans compter, tant j’y trouve de consolation et de douceur! Adieu et au revoir! ne renonçons pas à nos projets de réunion parisienne. Votre poignée de main me sera plus nécessaire que jamais. A vous, bien à vous de cœur.
Le 3 mai, il arrivait à Paris et descendait, comme l’année précédente, à l’hôtel de Rivoli. Quelques jours après, éclatait le Seize-Mai, le renvoi par le maréchal de Mac-Mahon de M. Jules Simon et de ses collègues, et la constitution du cabinet de Broglie-Fourtou. J’allai, à ce moment, rejoindre Pontmartin. Il était attristé, peu confiant dans le succès de l’entreprise du maréchal: il n’avait jamais cru à la République conservatrice, et il ne voyait dans le nouvel essai qu’on en voulait faire qu’un acheminement plus prompt vers le triomphe de la République radicale. Il venait du reste de tomber assez sérieusement malade, et il dut, pendant deux mois, suspendre ses Samedis de la Gazette. En juillet, sa santé rétablie, il s’installa, pour quelques semaines, comme il l’avait fait en 1876, au château de la Garenne-Randon, où il se rencontra, cette fois, sans préjudice des grandes dames et des clubmen obligés, avec un héros, le général de Charette, et un grand compositeur, Charles Gounod.
La dissolution de la Chambre des députés avait été votée par le Sénat[415]. De nouvelles élections étaient imminentes, et elles emprunteraient aux circonstances une gravité exceptionnelle. Pontmartin ne voulut pas s’en désintéresser. Avant de quitter La Garenne, il publia, dans la Gazette de France, en août, une réplique au manifeste des sénateurs et députés républicains de Seine-et-Oise, réplique qui fut répandue dans tout le département par les soins de M. de Besplas. «Si tous les conservateurs, m’écrivait-il, suivaient l’exemple de ce vaillant octogénaire, nous aurions beaucoup plus à espérer et beaucoup moins à craindre. Le matin, dès 6 heures et demie, je le trouve dans sa bibliothèque, assis à sa table, écrivant aux maires de son arrondissement, abrégeant mon article pour qu’il puisse être propagé dans tous les cafés du pays, puis recevant quelques braves paysans qu’il associe à son œuvre et se concertant avec eux.»
Parti de La Garenne le 17 août, il prit le rapide jusqu’à Marseille pour éviter la fête votive de son village et une séance de syndicat, suivie d’un énorme dîner. A Marseille, il écrivit pour la Gazette du Midi un article électoral qui, dans sa pensée, devait être la contre-partie méridionale de sa Réplique au manifeste des sénateurs et députés de Seine-et-Oise.
Rentré aux Angles, il continuera la campagne. En dehors de ses Samedis, il envoie à la Gazette[376] de France quatre articles sur M. Thiers[416], écrits en vue des élections. Il me mande, à cette occasion, le 30 septembre: «J’avais pensé à faire de mon travail sur M. Thiers une petite brochure, et je vois que vous avez eu la même idée; mais je suis si peu secondé! si peu encouragé! Il y a six mille lieues de mon allée de marronniers au boulevard des Italiens... Je viens pourtant d’écrire quelques lignes à Léon Lavedan[417], qui dispose, m’a-t-il dit, de plus de deux cents journaux, et qui nous les a offerts, à Léopold de Gaillard et à moi, pour la période électorale. Je lui livre mon œuvre, soit pour en faire reproduire des fragments, soit pour la colliger en un format économique et portatif.»
Les élections, à ce moment, étaient proches; elles avaient été fixées au 14 octobre. Pontmartin ne s’illusionnait guère sur leur résultat. Sa lettre du 30 septembre se terminait par ces lignes: «Que le bon Dieu nous protège! Quel chaos, mon cher ami, et peut-être quelle débâcle si les élections sont encore radicales! N’importe! restons fidèles; restons sur la brèche! Faire son devoir, tout son devoir, c’est beaucoup, quand on réussit; l’avoir fait, c’est quelque chose quand on succombe.»
IV
Après les tristesses de 1877, l’année 1878 allait lui apporter une grande consolation, une des meilleures joies de sa vie. Au commencement de février, il s’était installé à Hyères, l’avait quittée pour Cannes, où l’appelaient Léopold de Gaillard et Victor de Laprade; puis, après quelques jours passés avec eux, était revenu à Hyères, où Mgr Dupanloup faisait un séjour, par ordre de ses médecins. Les relations de l’évêque d’Orléans et de l’auteur des Samedis n’avaient été jusque-là qu’intermittentes, mais l’entente ne fut pas longue à s’établir entre eux, grâce à leur attrait réciproque l’un pour l’autre et à une foule de souvenirs communs: «On écoutait, ravi, a dit un de leurs auditeurs, l’intarissable critique et le grave et souriant évêque, se laissant aller tous les deux au charme de ces souvenirs[418].»
Ils se voyaient chaque jour, soit chez le comte et la comtesse de Rocheplatte, soit chez le baron et la baronne de Prailly, en cette villa de Costebelle, où vivait la mémoire du P. Lacordaire.
Pontmartin accompagnait souvent l’évêque à quelques lointaines promenades. «C’est pendant ces promenades, écrira-t-il plus tard, au bruit de cette voiture alourdie sur un lit de poussière, avec[378] vingt minutes d’arrêt et de silence pour le bréviaire, que s’ouvrait pour moi ce livre vivant, cette inappréciable collection de chapitres d’histoire contemporaine, où je reconnaissais tour à tour la douceur de l’évêque, la sagacité du politique, la résignation du chrétien, l’enjouement du causeur, l’éloquence de l’orateur, le suprême langage de l’expérience et de la sagesse, l’âme du grand citoyen, la cicatrice des jours de désastres, la conviction que tout aurait pu être sauvé et la crainte que tout ne soit perdu. Je prononçais presque au hasard un nom célèbre, je rappelais une date mémorable: il ne m’en fallait pas davantage pour voir passer devant moi tel ou tel de ces personnages qui ont figuré un moment sur la scène du monde politique...»
Dans la rade d’Hyères stationnait, avec ses douze cents hommes d’équipage, le grand vaisseau-école le Souverain. Le commandant était un marin aussi chrétien que brave, M. Lefort, l’inventeur des torpilles, et le commandant en second, M. de Montesquiou, dont la belle-sœur, Mme Standish, née des Cars, appartenait à une famille depuis longtemps en relation avec Mgr Dupanloup. Tous les deux se rencontraient avec lui chez M. le comte de Rocheplatte. Ils eurent la pensée de lui faire les honneurs de leur bâtiment. Le dimanche 10 mars, la messe fut dite à bord du Souverain par l’évêque d’Orléans. Pontmartin y assistait. Il quitta Hyères quelques jours plus tard, non sans avoir envoyé à la Gazette de France le compte[379] rendu de cette cérémonie, si majestueuse à la fois et si émouvante. Sa Causerie, qu’il n’a pas reproduite dans ses Samedis et qui est pourtant une des plus belles pages qu’il ait écrites, n’arriva à Costebelle qu’après son départ. Il reçut de l’évêque la lettre suivante:
Hyères, 21 mars 1878.
Monsieur et bien excellent ami, il faut donc se résigner à ne plus vous voir à Hyères! C’est ce que je viens d’apprendre avec grande tristesse. Oh! le méchant homme! qui, comme le Parthe, lance en fuyant une flèche empoisonnée de toutes les douceurs les plus mortelles à l’amour-propre des pauvres gens, et ne leur laisse même pas le temps de protester pour la forme! C’est affreux de s’en aller ainsi, quand on vous aime. Mais, du moins, on est heureux de vous avoir vu, entendu, connu de près, et apprécié, comme le méritent votre charmant esprit et votre excellent cœur; et on espère bien vous retrouver quelquefois, à Paris: ce qui n’est pas la même chose que sur les bords de cette mer enchantée, que vous savez si bien peindre, et aux doux feux de ce soleil, dont votre style est un rayon. Mes hôtes, et tous ceux à qui ils vous ont lu, ont été émerveillés, éblouis. Moi, je garde, par-dessus tout, le souvenir de cette exquise bienveillance; et j’espère bien qu’il n’en sera pas de ces relations qui m’ont été si douces comme de ces brumes colorées qui flottent en ce moment sur les îles d’Hyères, et qui s’évanouissent. Je les redemanderai toujours[419].
A Hyères, où ses heures de travail lui étaient disputées par une foule d’aimables prétextes d’oisiveté, Pontmartin avait vite reconnu qu’il lui serait impossible de continuer sous leur forme habituelle[380] ses articles de critique qui n’allaient pas sans beaucoup de lectures. Il eut l’idée de composer de courts récits qu’il pouvait rêver pendant la nuit et improviser le matin. C’est ainsi que furent écrits l’Olivier qui parle, conte fantastique, le Pigeon qui parle, le Colonel Herbert[420].
Les Samedis cependant succédaient aux Samedis. Dès son retour aux Angles, il s’était remis à ses Causeries littéraires. Le 20 mai, il est à Paris. Trois ou quatre ans plus tôt, en 1874, il lui était arrivé d’écrire: «Voici bientôt trente ans que je rêve, comme le hoc erat in votis, un petit chalet à Passy, au milieu de cette colonie charmante où je compte des amis, non loin de mon cher Saint-Genest et de son adorable famille, à deux pas de Jules Janin et de Cuvillier-Fleury, dans cette oasis où je retrouve la trace des deux enchanteurs de ma jeunesse, Rossini et Lamartine. Il est infiniment probable que ce doux rêve ne se réalisera jamais; mais je le reprends avec un mélancolique plaisir, chaque fois que je reviens à Paris. Le latin n’est-il pas admirablement connaisseur du cœur humain, quand il exprime par le même mot désir et regret[421]?»
Son rêve se réalisa au mois de mai 1878. Il prit un appartement à Passy, dans une maison meublée de la rue de ce nom, au no 82, tout près de la gare de la Muette. Nos plus beaux rêves nous déçoivent, même quand ils semblent s’accomplir.[381] Celui de Pontmartin vint se briser contre la plus brutale des réalités. On était en pleine Exposition universelle. Logé à deux pas du Trocadéro et en face du Champ de Mars, il lui fallut vivre au milieu du tapage et de la cohue, assourdi par les tramways et les voitures, contemplant chaque jour cet incroyable fourmillement, cette foule inouïe qui semblait avoir fait de la curiosité sa religion, sa politique et sa littérature, et qui paraissait croire que tout était sauvé, si elle voyait le matin un tambour-major, à midi un shah, le soir une opérette.
Au milieu du tapage de l’Exposition de 1867, après l’audition de cette cantate du vieux Rossini, exécutée par mille musiciens, un orgue, deux pièces de canon et douze cloches, Augustin Cochin s’écriait: «O Mozart! O flûte enchantée!» Pontmartin, en 1878, songeait, lui aussi, au divin Mozart et au divin Racine. Une fois sur cette pente, obéissant à la loi des contrastes, il se revoyait en idée sur cette terrasse de Costebelle, où il était assis à côté de Mgr Dupanloup, et d’où ils contemplaient ensemble l’horizon merveilleux qui se déroulait sous leurs regards, le vaste ciel, la mer et les montagnes.
V
Heureusement pour lui, à côté de l’Exposition des machines, il y avait l’Exposition des Beaux-Arts.[382] Il y trouva le sujet de deux grands articles, publiés dans le Correspondant sous le titre de Promenade au Salon de 1878[422]. Dans la Mode, nous l’avons vu, et dans l’Univers illustré, il avait déjà fait plusieurs Salons. Celui de 1878 fut le dernier qu’il écrivit.
Les Salons de Pontmartin sont encore des Causeries. Il n’essaie point, comme Théophile Gautier ou Paul de Saint-Victor, de faire de sa plume un pinceau et de son encrier une palette; il se promène tout simplement le matin à travers les tableaux et les statues, et, le soir, dans son propre salon, il en parle avec goût, avec agrément, en homme du monde qui ne se pique pas d’avoir du métier. Que de jolis morceaux il y aurait à extraire de cette Promenade au Salon de 1878, qu’il n’a pas recueillie dans ses œuvres!
Le clou de l’Exposition était le Barabbas de Charles Muller, l’auteur de l’Appel des condamnés[423] et d’une Messe sous la Terreur[424]. Pontmartin lui consacre deux ou trois pages dont voici le début:
La physionomie de Barabbas est une vraie trouvaille: tout y est, sur cette figure, le vice, le crime, le cynisme, l’abjection gouailleuse, la joie de la délivrance, l’éblouissement du grand jour succédant tout à coup à l’obscurité de la prison, la stupeur d’une ovation aussi peu prévue que peu motivée, et aussi une forte envie de rire aux dépens de son cortège; car en sa qualité de brigand, Barabbas a un peu[383] plus d’esprit que ceux qui le portent en triomphe.—Il nous faut Barabbas! Entendez-vous bien?—Mais c’est un misérable, un gibier de potence: il a volé, il a assassiné peut-être et celui que vous lui sacrifiez ne s’est révélé à vous que par des bienfaits.—Il nous faut Barabbas!—Mais réfléchissez! voilà, d’un côté, la vertu, l’innocence, la bonté, la charité, le dévouement, la piété, l’honneur; de l’autre...—C’est tout réfléchi; il nous faut Barabbas!—Mais il a un dossier, un lourd dossier!—C’est justement pour cela que nous le voulons; s’il valait mieux que nous, où serait le plaisir de l’acclamer, d’en faire notre élu et notre idole?... Plus vous nous en direz de mal, plus nous nous obstinerons à le choisir... Un individu taré, flétri, dépravé, pourri jusqu’aux moelles, condamné pour inceste, exécuté à la Bourse de Jérusalem, qui nous donne la joie de le mépriser en le nommant, de chercher, pour le découvrir, au-dessous de notre niveau, de rester ses maîtres en le couronnant de lauriers et de fleurs, c’est ce qu’il nous faut! Mort à Jésus! vive Barabbas!—Pardon! je crois en vérité, que j’allais parler politique!
Le peintre Vibert avait exposé l’Apothéose de M. Thiers, et Pontmartin d’écrire, au risque de faire encore de la politique:
Rien ne s’accorde plus mal que ces allégories mythologiques et emphatiques avec la physionomie spéciale, typique, de cet homme illustre et discutable, dont le portrait, malgré Bonnat et Mlle Nélie Jacquemart, est encore à faire: figure essentiellement bourgeoise et moderne dans ses qualités comme dans ses défauts; intelligence merveilleusement douée, esprit alerte, souple, varié, dextre plutôt que droit, avisé, agile, ouvert, plus riche d’expédients que de principes, prêt aux éventualités, fertile en ressources; imagination sans élan, sans couleur, sans chaleur et sans style; rebelle à toute tentative d’idéalisation poétique ou fantasmagorique; patriote[384] avec économie et calcul, insensible aux joies sublimes du sacrifice; politique égoïste, parcimonieux et incomplet, dont l’art consista tout entier à tempérer la Révolution par la bourgeoisie, à réconcilier la bourgeoisie avec la Révolution, à neutraliser les partis les uns par les autres, à se créer une popularité tardive en persuadant tour à tour aux conservateurs qu’ils pensaient comme lui et aux républicains qu’il travaillait pour eux. En somme, le contraire d’un héros dans la moins héroïque des époques, avec un visage, une taille et une tournure de Joseph Prudhomme infiniment spirituel...
Avec Mlle Sarah Bernhardt, nous passons de la peinture à la sculpture. En 1878, sa célébrité comptait déjà plusieurs lustres. Elle avait exposé un buste de M. Émile de Girardin. Déployant vis-à-vis d’elle la politesse de l’ancienne cour, Pontmartin lui dédiait ces lignes:
Mlle Sarah Bernhardt est le contraire d’une académie de province (je ne cite que moitié du mot de Voltaire). Elle fait énormément parler d’elle. On vante les élégantes originalités, les raffinements merveilleux de son petit hôtel de l’avenue de Villiers, qui a eu, j’aime à le croire, Melpomène et Thalie pour seuls architectes. Nous savons en outre que, malgré ses talents et ses succès de toutes sortes, en dépit des rivalités de théâtre et d’atelier, la charmante artiste a été ciselée par la prodigue nature de façon à ne faire ombrage à personne. Ce qui désolerait ses nombreux admirateurs, c’est le bruit que l’on a fait courir, c’est la crainte de la voir renoncer à l’art dramatique, si elle réussissait assez sérieusement sa sculpture pour prendre définitivement un rang parmi nos statuaires illustres. C’est donc dans l’intérêt de sa gloire et de nos plaisirs, de la Comédie-Française et de ses habitués, que nous oserons lui dire: «Vous êtes adorable; vous jouez Zaïre mieux que la Gaussin, et Phèdre[385] mieux que Mlle Rachel. Mais nous vous devons une sensation bien plus extraordinaire. Vous aviez à perpétrer le buste de M. E... de G..., c’est-à-dire du plus laid, du plus sinistre, du plus odieux de tous les modèles. Eh bien! vous êtes parvenue à surpasser la réalité. Vous avez vengé du même coup toutes les victimes de M. E... de G... D’un masque effrayant vous avez fait une grimace simiesque; votre œuvre est à deux fins. L’original était bronzé; le buste est coulé!»
Les tableaux militaires avaient été exclus de l’Exposition: ils s’étaient disséminés sur plusieurs points, derrière les vitrines de nos marchands les plus accrédités: rue Taitbout, dans l’emplacement de l’ancien théâtre, et surtout chez Goupil. Pontmartin écrit à ce sujet cette dernière page, plus vraie encore après vingt-cinq ans qu’elle ne l’était en 1878:
Nous les avons revues, ces toiles de MM. de Neuville, Detaille, Dupray, Berne-Bellecour, Protais, Bellanger, Maigret, et nous avons éprouvé, en les revoyant, un sentiment étrange. Nous n’en sommes plus à compter nos humiliations; nous ne voulons pas savoir si cette mesure émolliente et lénitive nous protège, nous honore ou nous humilie. Non! une émotion plus douloureuse encore, une idée plus actuelle et plus poignante nous serrait le cœur devant ces tableaux où revivent les scènes sanglantes de l’invasion et de la guerre... Ces témoignages et ces souvenirs devaient nous rester présents, éternellement présents, non pas, à Dieu ne plaise! pour nous exciter à des haines stériles, à des représailles insensées, à des revanches impossibles, mais pour entretenir et renouveler sans cesse en nous le feu sacré du patriotisme, le dévouement à cette France mutilée, plus chère et plus aimée dans sa faiblesse que dans sa force, dans ses malheurs que dans ses prospérités. Ces souvenirs, qu’en avons-nous fait? Qui s’en occupe aujourd’hui? Dans[386] cette foule affolée de curiosité banale et béate, dans l’étourdissant chaos de cette Exposition universelle, de ce tournoi pacifique, qui nous fait—à nous et à bien d’autres—l’effet du sursis de quarante jours accordé jadis aux condamnés dont on avait rejeté le pourvoi, sur quels fronts ces navrantes images amènent-elles un pli? Dans quels yeux une larme? Qui songe à Reichshoffen et à Gravelotte, à Sedan et à Metz, à la Lorraine démembrée, à l’Alsace perdue, aux provinces envahies, au siège et à la Commune, aux otages massacrés, à Paris incendié? C’est tout au plus un songe de tragédie dont on se réveille pour aller parier aux courses, s’extasier devant une porcelaine anglaise ou un paravent japonais. Peu s’en faut que les républicains radicaux, les hommes du 4 septembre, désormais en pleine possession de leur victoire, ne transforment ces anniversaires néfastes en fêtes nationales et ne confondent le deuil de leur patrie avec la date de leur avènement. Ils s’y prennent si bien qu’ils réussissent à décourager, à pervertir ou à éteindre jusqu’aux sentiments qui nous avaient soutenus dans cette crise épouvantable, qui avaient donné à l’élite de la nation la force de résister, de souffrir, de mourir, de nous indemniser en détail de tant de calamités et de désastres. Ils énervent, ils flétrissent, ils dénaturent, ils suppriment tout ce qui est nécessaire à un peuple pour se relever quand on l’abaisse, pour se réhabiliter quand on l’outrage, pour se redresser quand on le menace, pour se maintenir ou se retrouver à la hauteur des grandes luttes, des grandes infortunes, des grands sacrifices et des grands périls. Ces coups de foudre de 1870, ces journées d’angoisses, de détresse et de désespoir, ils nous réduisent presque à les regretter. C’était la défaite, c’était l’écrasement, c’était l’agonie; mais c’était aussi le patriotisme, c’était l’honneur; c’était un même battement de cœur, une passion commune devant un SEUL ennemi. Aujourd’hui, si nous avions à subir une nouvelle épreuve, nous n’aurions plus même de quoi être vaincus.
Pour protester à sa façon contre cette Exposition[387] universelle, qu’il voyait peut-être trop en noir et qui lui apparaissait surtout comme le triomphe de la matière sur l’esprit et sur l’art, il publia, pendant qu’elle battait son plein, deux nouveaux volumes; au commencement de juillet, la seizième série des Nouveaux Samedis; à la fin d’octobre, les Souvenirs d’un vieux Mélomane. Ce fut un jeune, un très jeune dilettante, qui se chargea de présenter les Souvenirs aux lecteurs du Correspondant: «Pourquoi vieux? écrivait-il; l’auteur aura beau le dire; personne ne le croira, car il se dément lui-même par l’entrain juvénile et la verve chaude de tableaux et de récits où palpite l’enthousiasme d’un cœur de vingt ans. Vieux! qu’il accumule tant qu’il voudra les lustres sur sa tête; il ne le deviendra jamais! Ce n’est pas fait pour lui, heureusement pour nous... Mais s’il n’est pas vieux, comme il est mélomane! On devine, en le lisant, qu’il ne peut écrire le nom seul des divas qui l’ont enchanté naguère sans ressentir encore le frisson des représentations fameuses dont il réveille le souvenir. L’écho lointain du timbre d’or de la Malibran, de l’archet de Paganini, des accords passionnés de Duprez ou de Mario, le fait tressaillir et l’enflamme comme aux jours heureux où ils soulevaient les auditoires transportés!... En sa qualité de jeune, l’auteur a le premier don de cet âge heureux: la fantaisie, et c’est elle qui a surtout inspiré ce volume chatoyant où s’entremêlent le sourire et les larmes, la malice et le sentiment, où trouvent à se satisfaire tous les[388] goûts et tous les caprices...» Le jeune critique, qui devait revêtir un jour—s’en doutait-il alors?—le frac à palmes vertes, terminait ainsi son article: «On raconte que Brillat-Savarin ne s’asseyait jamais à un repas fin et succulent qu’après avoir endossé son habit le plus coquet et mis ses bas de soie les plus moelleux. Eh bien! les raffinés et les gourmets littéraires devraient aussi se mettre en habit et en cravate blanche pour savourer les Souvenirs d’un Mélomane[425]...»
A l’heure où parut son volume, Pontmartin avait regagné les Angles. Il était revenu si assourdi par le bruit, si fatigué par la cohue, qu’il se promit de ne plus retourner à Paris: il s’est tenu parole.
CHAPITRE XV
PONTMARTIN ET L’ACADÉMIE
(1868-1878)
La fièvre verte. Le fauteuil de M. Empis. Lettre au Figaro. Le fauteuil de Sainte-Beuve. Une page des Jeudis.—Lettres de M. de Falloux, de Cuvillier-Fleury et de Joseph Autran. Le Non possumus de Pontmartin.—Le fauteuil de Saint-Marc Girardin. Fantaisies et Variations anti-académiques de M. Bourgarel.—Nouvelle lettre de M. de Falloux. Où l’on voit que Pontmartin était moins fort en calcul que feu Barrême.—Le fauteuil de Jules Janin. La peau de chagrin... académique. Le fauteuil d’Autran. M. Émile Zola se met en marche vers le Palais-Mazarin. Mgr Dupanloup s’efforce de décider Pontmartin à poser sa candidature. Pourquoi il ne s’est jamais présenté.
I
Alors que Pontmartin abandonne Paris pour n’y plus revenir, c’est peut-être le moment de se demander s’il y a quelque chose de vrai dans l’opinion qui assigne pour cause à sa retraite définitive aux Angles le refus qu’aurait fait l’Académie de lui donner un de ses fauteuils. On le représente essayant d’entrer au Palais-Mazarin, grattant à la porte, et, dépité de ne pas la voir s’ouvrir, quittant[390] la capitale et jurant de n’y plus remettre les pieds.
C’est là une pure légende, que je crois être en mesure de combattre, pièces en mains.
Armand de Pontmartin ne fut point de ceux qui attaquent l’Académie et qui lancent contre elle des épigrammes, d’ailleurs faciles. Rien ne lui paraissait plus enviable que d’en faire partie. Toutes les fois que, pendant ses séjours à Paris, avait lieu une séance de réception, il ne manquait jamais d’en rendre compte, en toute liberté sans doute, avec une entière indépendance, mais aussi avec une réelle sympathie, comme quelqu’un qui n’est pas encore de la maison, mais qui, en attendant, se montre un bon voisin et un fidèle ami.
A fréquenter ainsi chez les académiciens, il était difficile que l’auteur des Samedis échappât complètement à la contagion, et qu’il n’eût pas, lui aussi, de temps à autre, un accès, plus ou moins fort, de cette fièvre qu’il nomme quelque part la fièvre verte, et qu’il a si bien décrite:
Savez-vous, écrivait-il un jour, ce que c’est que la fièvre verte? C’est une maladie bizarre que l’on risque d’attraper en se promenant, le jeudi, sur le pont des Arts, entre deux et cinq heures. On y rencontre, ce jour-là, des hommes vénérables que l’on peut, au premier abord, prendre pour de simples mortels, et qui ne sont pourtant ni mortels ni simples, car ce sont des académiciens.
Méfiez-vous! Si le manteau d’un de ces favoris des dieux effleure votre redingote, si son regard s’abaisse sur vous d’un air de bonhomie narquoise, s’il pousse encore plus loin la condescendance, si, pour imiter en tout les gracieux exemples[391] de son secrétaire perpétuel[426], il vous dit en vous montrant certaine coupole: «Quand donc serez-vous des nôtres?» vous voilà pris; les plus savants docteurs y perdraient leur latin et leur quinine; vous êtes livrés, plume et papier liés, aux tyranniques caprices de la fièvre verte... Je vous plains si la maladie est aiguë, et je vous plains encore plus si elle passe à l’état chronique[427]...
Il y a là, dans cette Causerie du 20 février 1864, cinq ou six pages d’une fantaisie charmante. Heureusement, quand on badine ainsi avec son mal, c’est que la fièvre est légère et l’accès passager. La «fièvre verte» n’a jamais été, chez Pontmartin, une fièvre continue, mais seulement une fièvre intermittente. Ses velléités académiques, nous allons le voir, n’ont jamais tenu bien longtemps. Plus d’une fois, ses amis ont obtenu de lui qu’il acceptât l’idée d’une candidature; jamais ils n’ont pu le décider à faire les démarches nécessaires, à se mettre officiellement sur les rangs: en réalité, il ne s’est jamais présenté.
J’en éprouvais, pour ma part, un réel chagrin. Bien souvent, avec une insistance qui allait parfois, je le reconnais, jusqu’à l’indiscrétion, je l’ai pressé de poser sa candidature. Rien ne m’est donc aujourd’hui plus facile que de tracer, à l’aide de ses lettres, et aussi un peu à l’aide des miennes, qu’il avait bien voulu conserver, l’odyssée académique—ou plutôt, hélas! anti-académique—de l’auteur des Samedis.
A la fin de 1868, il y avait trois fauteuils vacants: ceux de Viennet, de Berryer et d’Empis. Le 24 décembre, j’écrivais à Pontmartin: «Voilà trois places vacantes à l’Académie. Quand commencerez-vous vos visites? Je ne vous tiendrai quitte que le jour où vous me donnerez la joie de vous applaudir au palais Mazarin. Mais le sujet vaut qu’on y revienne et nous y reviendrons.»
Moins de huit jours après, en effet, le 31 décembre, je lui adressais ce nouvel appel:
Arrivons maintenant par le chemin le plus court à l’Académie. Depuis ma dernière lettre, j’ai lu dans le Gaulois,—qui n’est pas toujours Français,—et dans le Français,—qui est quelquefois Gaulois,—que vous étiez décidé à poser le pied sur le pont des Arts, qui vient d’inspirer à Sainte-Beuve un bien détestable sonnet. Il me tarde de recevoir de vous la confirmation de cette nouvelle. Je persiste à penser que le moment est venu pour vous de prendre rang. A la distance où je suis du champ de bataille, il m’est bien difficile d’apprécier quelles peuvent être vos chances actuelles; mais je tiens pour certain que, si votre succès n’est pas immédiat, il ne se fera cependant pas longtemps attendre.
Pontmartin était alors aux Angles, et c’est de là qu’il me répondit, le 2 janvier 1869:
Un mot seulement, mon cher ami, pour répondre à vos deux dernières lettres. La mienne vous a appris que j’étais encore aux Angles, à 180 lieues du pont des Arts, et beaucoup plus loin, je crois, de la salle des séances du palais Mazarin. Je ne pourrai partir pour Paris que le 1er ou le 2 février, et là seulement je pourrai savoir de quoi il retourne. La note du Français, si elle est, comme je le suppose, de Léon Lavedan, ne signifie pas grand’chose;[393] c’est son amitié qui a voulu risquer ce ballon d’essai. D’autre part, on m’écrit, au contraire, que les trois places vacantes sont déjà prises, que les politiques patronnent M. Duvergier de Hauranne, que Mgr l’évêque d’Orléans protège M. Franz de Champagny, et que, pour le fauteuil de l’insignifiant Empis, la majorité se décidera à faire une concession du côté des auteurs dramatiques ou autres candidats portés par la minorité. Vous voyez, cher confrère et ami, que, même sans tenir compte de mon penchant invétéré à l’abstention, la plus grande réserve est ici de rigueur, surtout si ceux que je dois regarder comme mes patrons naturels ont déjà jeté les yeux sur d’autres candidats...
La triple élection fut fixée au 29 avril; le 2, le Figaro annonçait, dans ses Échos de Paris, la candidature de Pontmartin au fauteuil d’Empis; il prit aussitôt la plume et rectifia en ces termes la nouvelle:
Vendredi, 2 avril 1869.
Monsieur et cher confrère,
Je lis à l’instant dans vos spirituels Échos de Paris: «Les autres candidats sérieux à l’Académie sont, en première ligne, MM. Duvergier de Hauranne et Armand de Pontmartin.»
J’ignore si je suis sérieux; mais je puis vous affirmer que je ne suis pas candidat. Pourtant je me serais contenté du plaisir de vous lire, sans vous donner l’ennui de recevoir ma réponse, si je n’avais deux motifs et deux excuses.
D’abord, si bien pensant, si catholique et si voltigeur de 1815 que je sois, mon abstention me donne le droit de ne pas servir de repoussoir à Théophile Gautier, dont j’ai pu quelquefois combattre les doctrines, mais dont j’appelle l’élection de tous mes vœux, et dont j’admire le prodigieux talent.
Ensuite, parce que mes parents et mes amis de province, ne voyant pas même figurer mon nom, escorté d’une minorité consolante, dans le scrutin du 29 avril, pourraient croire à la plus radicale et à la plus grotesque des défaites, là où il n’y aura pas eu même de lutte et de tentative.
Je vous saurai beaucoup de gré si vous voulez bien accueillir et publier ma réponse dans vos Échos de Paris, et je vous prie de croire aux cordiales sympathies de votre dévoué
A. de Pontmartin.
Comme il avait été décidé, il fut pourvu, le 29 avril, aux trois vacances. Le fauteuil de Berryer échut à M. de Champagny, celui de Viennet à M. d’Haussonville et celui d’Empis à M. Auguste Barbier. Ce dernier fut élu par 18 voix contre 14 données à Théophile Gautier.
Deux académiciens, et non des moindres, moururent en cette même année 1869, Lamartine le 1er mars et Sainte-Beuve le 13 octobre.
Le 16 octobre, j’écrivis à Pontmartin:
...Qui remplacera Sainte-Beuve à l’Académie? J’ai lu ce matin au cercle, dans le journal la France, une petite note où il est dit que l’hésitation n’est pas possible, et que l’Académie doit élire, à la place de Lamartine, M. Théophile Gautier, et à la place de Sainte-Beuve, M. Armand de Pontmartin. Si je puis, en sortant de chez moi, mettre la main sur ce numéro de la France, j’en détacherai l’entrefilet en question et le glisserai dans ma lettre. J’ignore si c’est Caro qui a rédigé cette note; qu’elle vienne de lui ou d’un autre, elle n’en a pas moins une valeur et une portée à laquelle vous ne sauriez vous soustraire. Il faut absolument que vous vous présentiez. Je ne sais si, ces années passées, il était trop tôt; ce qui est certain, c’est qu’aujourd’hui le moment est venu, l’heure a sonné, et il ne faut pas vous exposer à ce que[395] l’on vous dise ce que l’on a dit à Charles X et à Louis-Philippe, ce que l’on dira un jour, bientôt peut-être, à Napoléon III: Il est trop tard!...
Pontmartin était alors en Provence et songeait d’autant moins à rentrer à Paris que sa femme était gravement malade. Il ne se souciait d’ailleurs aucunement de succéder à Sainte-Beuve. Dans les Jeudis de Madame Charbonneau, n’avait-il pas tracé de lui ce portrait, sous le nom de Caritidès?
Caritidès a reçu du Ciel, auquel il ne croit plus, un goût exquis, une finesse de tact extraordinaire, de merveilleuses aptitudes de critique relevées et comme fertilisées par de rares facultés de poésie. Il possède et pratique en maître l’art des nuances, des sous-entendus, des insinuations, des infiltrations, des évolutions, des circonlocutions, des précautions, des embuscades, des chatteries, de la haute école, de la stratégie ou de la diplomatie littéraire. Il excellerait à distiller une goutte de poison dans une fiole d’essence, de manière à rendre l’essence vénéneuse ou le poison délicieux. Sa prose est attrayante et magnétisante comme une femme un peu compromise qui ne dit pas tous ses secrets et s’enjolive à la fois de ce qu’elle montre et de ce qu’elle cache. Caritidès a voulu être un pèlerin d’idées, moins la première des qualités du pèlerin, c’est-à-dire la foi. Il a fait, en amateur, le tour de toutes les doctrines de son temps sans s’y fixer jamais, et, en les abandonnant, il a eu l’air de les trahir. Accusé injustement de traîtrise et d’apostasie, il a tenu à justifier sa réputation et il a fini par devenir l’ennemi de ceux dont il n’était que le déserteur. Son erreur a été de sophistiquer ce qu’il aurait pu faire tout simplement, avec tant de grâce, d’esprit et de supériorité naturelle, de traiter la littérature comme une mauvaise guerre où il faudrait constamment avoir un fleuret à la main et un stylet sous ses habits. On assure qu’il passe son temps à colliger une foule[396] d’armes défensives et offensives, de quoi accabler ceux qu’il aime aujourd’hui et qu’il pourra haïr demain, ceux qu’il déteste à présent et dont il veut se venger plus tard. Caritidès aurait pu être la plus irrécusable des autorités, il n’est que la plus friande des curiosités littéraires[428].
Il parut à Pontmartin qu’il ne pouvait, en conscience, même avec les sous-entendus académiques, faire l’éloge de l’homme sur lequel il avait écrit cette page. Il avait raison, et je n’insistai pas.
II
Jules Janin fut nommé à la place de Sainte-Beuve le 7 avril 1870; son discours de réception ne devait être prononcé que le 9 novembre 1871. Dans l’intervalle, la guerre, la chute de l’Empire, le siège de Paris, la Commune, avaient comme suspendu la vie de l’Académie. Lorsque, dans les derniers mois de 1871, elle put enfin reprendre régulièrement ses séances, il se trouva qu’elle avait à pourvoir à quatre vacances: il lui fallait remplacer Montalembert, Villemain, Prévost-Paradol et Prosper Mérimée[429].
L’occasion, certes, était propice, et il convenait de ne la pas laisser échapper. Avant même d’agir auprès de Pontmartin, j’écrivis à M. de Falloux[397] pour m’assurer de ses intentions, et j’en reçus la réponse suivante, datée du 8 août 1871:
Je vous remercie, cher monsieur, de votre aimable souvenir et de l’appréciation, si juste à mon sens, de notre vraie situation. Du reste, si je suis affligé par la conduite de M. Thiers, je n’en suis plus surpris depuis un certain nombre de mois, et je puis dire loin de lui ce que je lui ai dit à lui-même: il se trompe aujourd’hui sur l’état de la France, comme il s’est trompé sur l’état de Paris avant le 18 mars. Ces illusions-là nous ont coûté déjà bien cher: elles peuvent entraîner encore de plus épouvantables catastrophes.
En attendant, l’Académie reste une de nos dernières épaves et je ne demande pas mieux que de me joindre à ceux qui essaieront de la sauver. On parle de M. le duc d’Aumale pour le fauteuil de M. de Montalembert; celui de M. Villemain irait parfaitement à M. de Pontmartin, et il sait d’avance que mon suffrage ne peut lui faire défaut. Plusieurs d’entre nous le lui avaient déjà fait dire, au triple scrutin d’il y a dix-huit mois[430], et, à cette époque, il résistait à toutes les instances. Si vous pouvez le décider aujourd’hui, vous obtiendrez un succès que n’ont pu remporter de très anciens amis, et cette difficulté est faite pour vous tenter. Recevez donc d’avance mes remerciements avec mes vœux, et pardonnez-moi leur trop brève expression. Malheureusement, ma tête revient bien surmenée par le spectacle et les tristesses de Versailles[431], et je paie aujourd’hui mon voyage comme s’il eût été un plaisir. Veuillez n’en pas moins[398] demeurer convaincu de mon très fidèle et très reconnaissant attachement.
Falloux.
Caradeuc, près Bécherel (Ille-et-Vilaine).
Pontmartin parut assez bien disposé. Il m’écrivait des Angles, le 6 novembre:
...Pour me consoler de mon échec[432], je suis allé passer, au pied du Luberon, chez M. Joseph Autran, huit ou dix jours qui se sont changés en trois semaines. Le pauvre-riche poète est presque aveugle, et d’une tristesse voisine du désespoir. Pour le tirer de cette prostration désolante, sa femme va l’emmener à Paris. Il est convenu entre nous qu’il arrivera vers le 15 novembre; que, sitôt installé, il s’assurera des dispositions de ses confrères, et m’écrira si je dois venir à Paris en décembre, ce qui serait académique, ou attendre la fin de février, ce qui serait hygiénique. En attendant, je vais me remettre au travail ou, comme vous le dites si bien, au devoir; le même mot pour les vieux journalistes qui finissent que pour les jeunes écoliers qui commencent!...
Les candidatures cependant commençaient à se dessiner. M. de Falloux m’écrivait, du Bourg-d’Iré, le 28 novembre: «Je ne crois pas que MM. Littré, Gautier et Dumas aient chance de succès; je n’ai entendu parler jusqu’ici, en dehors du duc d’Aumale,[399] qui paraît n’avoir pas de concurrent, que de MM. Camille Rousset, de Loménie, Wallon et Saint-René Taillandier. M. de Pontmartin va certainement prendre rang parmi les candidats les plus sérieux, et vous pouvez être bien sûr que mon concours ne lui fera pas défaut.»
Le mois de décembre arrivait, et Joseph Autran ne partait pas; Pontmartin, de son côté, restait aux Angles, et c’est de là qu’il m’adressait, le 5 décembre, la lettre suivante:
Hélas! fidèle ami, nous sommes loin de compte!
A se déterminer la Provence est moins prompte...
En d’autres termes, et en vile prose, je crois, sans en être positivement sûr, que M. Autran, intercepté par les rigueurs précoces de l’hiver, est encore à Marseille, en vraie marmotte provençale, et qu’il n’ose pas m’informer de ce retard indéfini. Autrement, comment expliquer son silence? Je l’ai quitté le 4 novembre; il comptait partir le 14 au plus tard, et il était convenu que, sitôt arrivé à Paris, il m’écrirait pour me donner son adresse, et commencer notre correspondance académique. Or, il m’écrit de Marseille, le 18, en me parlant d’irrésolution, de la peur que lui faisait un voyage de Paris dans cette saison, des bronches de Mme Autran, qui exigent les plus grandes précautions, etc. Depuis lors, rien, et nous sommes au 5 décembre! Et le froid, déjà fort vif il y a trois semaines, est devenu intolérable! J’en conclus que notre poète n’a pas bougé de son bel hôtel de la rue de Montgrand, qu’il y vit au jour le jour, plus indécis que jamais, et qu’il craint de me contrarier en m’apprenant que son départ est probablement retardé jusqu’au mois de février.
Voilà, mon cher confrère, à quel point nous en sommes!
Quant à moi, il m’est impossible, en ce moment, de me diriger vers le Nord et je me sentirais plutôt attiré vers la plage de Cannes. Quoique ma santé semble se rétablir, j’ai encore un reste d’anémie qui me rend horriblement frileux. Je m’enrhume à tout propos. Songez d’ailleurs que je serais obligé, en arrivant à Paris, de loger à l’hôtel, n’ayant plus d’appartement. Tout cela m’effraie, et, en attendant, je me console avec le Filleul de Beaumarchais, dont la première partie sera expédiée, aujourd’hui même, à M. de Gaillard. J’ai fini par me passionner pour mon sujet, au point de ne plus pouvoir penser à autre chose...
Après m’avoir entretenu de la situation politique, de ses inquiétudes et de ses craintes, de ses tristesses depuis la mort de sa femme, il ajoutait:
Voilà, mon cher ami, ce qui m’empêche d’attacher un bien vif intérêt à ce qui, dans une situation différente, aurait été l’objectif de ma vie littéraire. Je me dis: A quoi bon? Pourquoi introduire un nouvel élément de trouble dans une existence qui va finir et qui a eu à subir bien des épreuves? Acceptons la loi du travail que les progrès de la démagogie nous rendent plus obligatoire que jamais, et qui est pour les affligés une consolation, un devoir et un refuge; mais cessons d’y mêler une ambition qui pourrait amener de nouveaux froissements et de nouveaux mécomptes!... Il est bien entendu, mon cher ami, que tout ceci n’est pas définitif. Si, au lieu de sentir un commencement d’onglée et d’entendre le mistral mugir dans mon corridor, j’avais sur ma table une lettre de Joseph Autran et une lettre de Cuvillier-Fleury m’annonçant qu’ils ont préparé les voies et que l’enfant se présente bien, peut-être changerais-je d’avis et de langage. Quoi qu’il en soit, continuons ce doux échange d’idées, de sentiments, de projets, de conseils; chaque jour, j’y trouve plus de charme; quand le malheur[401] ne rend pas égoïste, il ajoute à cette faculté que nos pères appelaient la sensibilité, et que nous avons bien mal remplacée...
A peine en possession de cette lettre, j’écrivais à Cuvillier-Fleury, qui me répondait aussitôt:
...Il y a déjà bien longtemps, Monsieur, que notre cher, aimable, spirituel et loyal ami (en dirai-je jamais assez?) Armand de Pontmartin est mon candidat in petto pour l’Académie. Mais voici très exactement comment jusqu’ici les choses se sont passées. Nous avons passé par la phase de bon accord; il ne demandait pas mieux; on attendait les bonnes occasions; elles arrivaient, il n’était plus là; cependant, on était près de s’entendre; puis, de plus actifs que lui, plus Parisiens, plus près du Jeu, se produisaient, faisaient récolte et réussissaient. Ensuite,—tout ceci entre nous,—nous avons eu la phase de l’abstention, du renoncement absolu. Le candidat, non seulement ne voulait pas remuer un doigt à l’intention de l’Académie, mais nous écrivait (j’ai les lettres) qu’il se fâcherait et se brouillerait avec nous si nous faisions mine de remuer seulement une phalange. Nous nous résignons, les habiles se présentent et passent. Vient une série fatale de morts académiques, notre ami ne donne pas signe de vie; à peine si on le voit à Paris (ceci avant la guerre). Ses meilleurs amis, et les plus haut placés, nous disent à nous, invariables dans notre préférence: «Mais où est-il? Il ne se montre pas. Veut-il, ne veut-il pas?» Les intermédiaires les plus habituels, sans me compter, Léopold de Gaillard, Victor de Laprade, d’autres encore, sont réduits à attendre, à interroger la brise qui souffle de Vaucluse... «Ne vois-tu rien venir?» Depuis, Monsieur, et dans cette concurrence du moment très vive, et qui s’accroît chaque jour, le nom de notre ami n’a été prononcé par personne, parce qu’il n’a pas été mis en avant par lui-même. Je n’ose dire qu’il soit trop tard pour moi. Ce mot des révolutions n’a rien à faire dans nos paisibles rapports de confrères[402] entre eux, ou de candidats à pourvoir. Mais s’il n’a rien d’absolu, il peut se trouver sur le chemin des meilleurs et entraver la voie. C’est ma crainte en ce moment. Je me hâte de vous l’écrire, non sans vous prier de me garder le secret de cette confidence, sinon de mon entier dévouement à notre ami et de ma haute considération pour vous.
Rien ne vint de Vaucluse. Au lieu de partir pour Paris, Pontmartin partit pour Cannes. C’était tourner délibérément le dos à l’Académie: et pourtant, à cette heure-là même, si tardive qu’elle fût, il lui eût suffi de poser nettement sa candidature pour qu’elle eût encore chance de triompher. Voici, en effet, ce que m’écrivait Joseph Autran, le 10 décembre:
La lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser à l’institut, ayant fait plusieurs ricochets, me parvient à Marseille aujourd’hui seulement... Je suis heureux que nous nous rencontrions, vous et moi, dans un sentiment de commune amitié pour M. de Pontmartin. J’ai eu, en effet, le plaisir de le voir cet automne. Quand nous nous quittâmes il paraissait fort incertain entre le projet d’aller passer l’hiver à Cannes et celui de se rendre immédiatement à Lyon ou à Paris. Il acceptait bien l’idée d’une candidature à l’Académie; mais il avait, depuis nombre d’années, opposé aux plus vives instances de ses amis des refus si persistants que je doutais encore un peu de sa résolution. C’est dans ce doute que je vins à Marseille pour y faire mes préparatifs de départ. De tristes obstacles, sans compter les rigueurs excessives d’un hiver prématuré, m’y ont retenu plus longtemps que je n’eusse voulu. J’ignore, d’ailleurs, où se trouve en ce moment M. de Pontmartin. Une lettre que je lui ai écrite, il y a plusieurs semaines, étant restée sans réponse, je me demande s’il est encore aux Angles ou s’il est déjà à Paris et peut-être même à Cannes.
Vous me parlez, Monsieur, des titres de M. de Pontmartin. Est-ce à moi qu’il convient de les rappeler, à moi qui, depuis plus de vingt-cinq ans, n’ai pas cessé de suivre avec autant d’admiration que de sympathie les travaux de cette plume si facile, si élégante, si ingénieuse et souvent même si éloquente? M. de Pontmartin est un des brillants écrivains de ce temps. S’il n’est pas encore de l’Académie, c’est qu’il n’a pas encore voulu en être. Il n’avait qu’à se présenter depuis longtemps, les portes se seraient ouvertes devant lui. Aujourd’hui encore, quelle que soit la date des prochaines élections (et jusqu’ici j’avais cru qu’elles seraient ajournées au printemps), aujourd’hui encore, il n’aurait qu’à dire: Me voici, et je suis convaincu qu’il n’aurait pas à attendre.
Je vous parle sciemment, car je n’avais pas attendu jusqu’à ce jour pour sonder les dispositions de quelques-uns de nos plus éminents confrères. Tous ceux que j’ai interrogés m’ont répondu d’une façon qui ne laissait aucun doute et qui réjouissait la très ancienne et très vive amitié que je porte au célèbre auteur des Samedis...
La quadruple élection eut lieu le samedi 30 décembre. Pontmartin n’était pas au nombre des candidats. Le duc d’Aumale fut élu, au premier tour, par 28 voix sur 29 votants. Les autres fauteuils furent plus disputés. M. Littré fut nommé, en remplacement de Villemain, par 17 voix contre 9 données à Saint-René Taillandier et 3 données à M. de Viel-Castel. M. Camille Rousset et M. Louis de Loménie remplacèrent Prévost-Paradol et Prosper Mérimée. Au scrutin pour le fauteuil de Mérimée, Edmond About avait obtenu 14 suffrages.
Jusqu’à la dernière heure, Mgr Dupanloup avait combattu M. Littré, dans lequel il voyait «l’apôtre des doctrines les plus subversives de tout ordre religieux, moral et social». Il disait à ses confrères: «Quoi! vous voulez sauver la France, et c’est ainsi que vous vous y prenez! Une glorification solennelle du matérialisme et du socialisme, voilà ce que vous imaginez pour elle, en ce moment où elle penche au bord de tous les abîmes! On a tout enlevé à ce malheureux pays, la paix, la sécurité, les croyances, Jésus-Christ, la Rédemption, la croix; et le peu qui lui reste: Dieu, l’âme, la loi, la liberté morale, la vie future, vous le livrez? Que voulez-vous donc, et quels coups faut-il que vous receviez[433]!...»
Le soir même de l’élection, l’évêque d’Orléans écrivit au directeur de l’Académie ce simple mot: «J’ai le regret de ne pouvoir plus continuer de faire partie de l’Académie française.»
L’élection de Littré, la quasi-élection d’Edmond About, semblaient donner raison à Pontmartin. N’avait-il pas bien fait de ne se point mettre sur les rangs? Profitant de ses avantages, il m’écrivit, le 19 janvier 1872, de Cannes, du Pavillon des jasmins, où il était installé depuis quelques semaines:
J’admets parfaitement, avec Léopold de Gaillard et avec vous, que les catholiques laïques, qui sont de l’Académie, aient pu et dû y rester, malgré la splendide démission de l’évêque d’Orléans et le conseil de M. Veuillot; mais que[405] les catholiques, qui ne sont pas encore académiciens et qui n’ont même pas risqué une candidature, ne doivent pas être singulièrement refroidis par les élections du 30 décembre; que M. Thiers[434], s’il reste au pouvoir, ne soit pas à peu près sûr d’amener MM. Marmier, Janin, Camille Rousset et Littré à voter pour M. About; enfin, que l’Académie, en nommant successivement Émile Ollivier en avril 1870, Littré en décembre 1871, et en accueillant Edmond About à la meilleure place de son antichambre, n’ait pas affaibli pour très longtemps ce prestige, cette autorité morale qui l’avaient jusqu’ici placée au-dessus de toutes les critiques et de toutes les épigrammes, ceci est une autre question, et il n’y a pas d’illusion à se faire; ce qui est tout à fait positif, c’est que voilà six académiciens qui vont attendre leur tour de réception (j’oubliais M. Duvergier de Hauranne[435], tout acquis d’avance au candidat de M. Thiers); que, suivant toute probabilité, il n’y aura pas d’élection nouvelle avant avril 1873; que, d’ici là le Roi, l’âne ou moi, nous mourrons, ou, en d’autres termes, qu’il y aura de tels événements que cette pauvre Académie pourrait bien sombrer dans le naufrage universel; que, par conséquent, il y a lieu de la laisser provisoirement reposer, et d’en délivrer notre correspondance, où elle occupe, soit dit sans reproche, au moins une page sur quatre: moins d’honneur à en faire partie, moins de chance d’y entrer, plus de lointain et de vague dans les perspectives, en faut-il davantage pour nous décider à chercher d’autres sujets de causerie?...
III
Pontmartin, comme on le voit, m’avait donné poliment mon congé d’incitateur académique. Il l’avait déjà précédemment donné à Léopold de Gaillard, et aussi à Victor de Laprade, auquel il avait écrit:
Je suis à la fois, mon cher ami, profondément touché et sincèrement désolé de la façon dont vous avez pris, Léopold et vous, une confidence qui ne devait rien vous apprendre. Mon devoir est de trancher dans le vif ces illusions de l’amitié et de ne pas vous préparer, dans l’avenir des déceptions et des regrets. C’est une chose dite, arrêtée, irrévocable, et la meilleure marque d’affection que puissent me donner ceux qui m’aiment, c’est de ne plus m’en parler. J’écrirai dans ce sens à Autran et à Cuvillier-Fleury. Je résume dans le gnôthi séauton et dans le non possumus ce petit débat et je ne vous demande plus, cher poète, que la Voix du silence[436]...
Les Bretons sont têtus, et, dès la fin de cette même année 1872, je revenais à la charge.
Le P. Gratry était mort, à Montreux, le 7 février 1872. L’élection de son successeur devait avoir lieu le 16 janvier 1873. J’adressai un nouvel appel à l’auteur des Samedis. Voici sa réponse:
Les Angles, mercredi soir 25 décembre 72
(le beau jour de Noël).
Mon cher ami,
Vous avez compris que nos deux lettres s’étaient croisées[407] et que j’avais à peine eu le temps de vous remercier des deux journaux...
Passons maintenant, non pas au déluge,—il nous a noyés pendant deux mois,—mais à l’Académie. Je dois vous avouer que je n’y songeais plus du tout. Je savais mes principaux patrons dispersés, malades, réfractaires ou morts; Autran retenu à Marseille par une bronchite de sa femme; Laprade à Montpellier, entre les mains de la Faculté de médecine et dans un état à faire pitié; Mgr d’Orléans, démissionnaire; M. de Falloux sédentaire; Cuvillier-Fleury passé du centre droit au centre gauche; M. Guizot engagé avec M. de Viel-Castel, ainsi que les de Broglie, d’Haussonville, Saint-Marc Girardin, Vitet, etc. De tout cela, il résultait que mes chances me semblaient bien faibles, et j’en profitais pour continuer ma campagne dans la Gazette de France. J’ai fini par m’attacher à ce travail, plus honorable que brillant, que je serais forcé d’abandonner si je m’endormais journaliste, pour me réveiller candidat et me réendormir académicien. Vos deux lettres m’ont donc trouvé dans une espèce de laborieuse torpeur, oubliant le palais Mazarin, préparant mon neuvième volume[437], et me disant, avec une résignation philosophique ou une répugnance pour les raisins trop verts, que, depuis la chute de l’Empire, les désastres de la France, la nomination successive de MM. Jules Favre, Émile Ollivier et Littré, la démission de Mgr Dupanloup, l’Académie n’avait plus sa raison d’être, qu’elle serait emportée, un de ces matins, par le flot démagogique, que la majorité sur laquelle j’aurais pu autrefois m’appuyer est complètement désorganisée, et que, à dater du fauteuil du P. Gratry, que, par pudeur, on n’osera pas donner à un libre penseur, il faut s’attendre à l’invasion des Edmond About, des Taine[438], des Renan et des Dumas fils,[408] favorisés par le salon et l’entourage de M. Thiers. Sérieusement, mon cher ami, j’ai manqué le bon moment. Il fallait ne pas faire les Jeudis de Mme Charbonneau, me mettre en ligne immédiatement après Jules Sandeau et Albert de Broglie, et profiter de ces années où l’Académie servait de centre et de point de ralliement à l’opposition de bonne compagnie. J’avais alors mon intérieur et mon ménage à Paris, ma santé meilleure et un peu plus d’horizon. Un ou deux échecs, et même trois ou quatre avant le succès, n’auraient eu aucun inconvénient. J’étais Parisien, je ne changeais rien à mes habitudes, et il me restait assez de marge pour attendre. Aujourd’hui toutes ces conditions accessoires sont changées. Si je me décidais—bien tardivement—à être un des candidats du 16 janvier, je serais obligé de descendre ou de monter dans un hôtel, au milieu du brouhaha du Jour de l’An, dans une saison où Paris n’a d’autre alternative que la pluie ou la gelée. J’aurais à improviser mes démarches et mes visites, sans conviction, sans espoir, sachant que mes concurrents ont sur moi un trimestre d’avance. Je me connais, je sais avec quelle facilité je me décourage et jette, comme on dit, le manche après la cognée; surtout depuis que mes chagrins et nos malheurs m’ont fait prendre en dégoût les intérêts et les vanités de ce monde. Si ma défaite était trop complète, si je n’étais pas soutenu par la presse, si mes amis me conseillaient, au dernier moment, un désistement préventif, ce serait fini, et j’aurais le temps de mourir de vieillesse—ce qui ne peut pas être bien long—avant de risquer une seconde candidature.
Vous me dites, mon cher ami, qu’il y a là pour moi quelque chose comme un devoir. Je ne suis pas de votre avis. Si, contre toute vraisemblance, j’étais nommé, ce serait par quelques amitiés étrangères à l’ancienne majorité; Jules Sandeau, par exemple, et peut-être Camille Rousset. Mais je ne pourrais rien pour empêcher ou retarder la transformation de droite à gauche, qui s’opère à l’Académie depuis trois ans. L’élection de Littré, les 14 voix obtenues[409] par Edmond About, ne prouvent que trop où elle en est. Montalembert, le P. Gratry et Mgr Dupanloup ne sont plus là. Laprade se meurt; Autran n’est jamais à Paris; M. de Falloux se tient en dehors. Le duc de Noailles, MM. de Carné et de Champagny sont incapables de résister au courant contraire, du moment que le débat se pose sur un autre terrain et que les candidats catholiques et monarchiques sont condamnés désormais à avoir contre eux tout le centre gauche et tout le groupe bonapartiste. C’est pourquoi il me semble qu’au point de vue du devoir, je fais mieux de rester sur la brèche et de continuer ma littérature de combat.
Vous voyez, mon cher ami, que, faute de mieux, je trouve, comme vous, la question assez sérieuse pour lui consacrer mes quatre pages. J’étais si éloigné de penser à un départ pour Paris et à une candidature, que j’ai invité mes vieux amis d’Avignon à venir manger aux Angles la dinde de Noël. Seulement, comme chacun avait sa dinde, la mienne ne se mangera que le jeudi 2 janvier. Nous avons ici un temps chaud et pluvieux, qui ne sèche pas nos terres et retarde indéfiniment nos semailles. Que de soucis! que de tristesses à l’âge où l’on aurait le plus besoin d’avoir autour de soi un peu de gaieté et de soleil!...
Le 16 janvier, ce fut un ami de Pontmartin, M. Saint-René Taillandier, qui fut nommé au fauteuil du P. Gratry.
Presque aussitôt se produisaient deux autres vacances. Le général Philippe de Ségur mourait le 25 février 1873 et Saint-Marc Girardin, le 12 avril suivant. Pontmartin se trouvait alors à Paris, installé pour deux ou trois mois, rue de Rivoli, au pavillon de Rohan. Ses amis le pressèrent de se présenter, sinon pour remplacer M. de Ségur, dont la succession paraissait acquise à[410] M. de Viel-Castel, du moins pour remplacer Saint-Marc Girardin. Il entra dans leurs vues sans trop de difficultés et, le 18 avril, il m’écrivait:
Mon cher ami, pardonnez-moi ce retard; j’ai été souffrant: pas assez pour interrompre mon travail quotidien ou hebdomadaire; assez pour que mon fils, qui est arrivé mardi, me forçât de voir un médecin; ce n’est rien, un refroidissement que j’avais attrapé, jeudi soir, en sortant de chez M. Autran sans avoir pris, en fait de paletot et de cache-nez, toutes les précautions désirables; il n’en est pas moins vrai que ma pauvre santé exige les plus grands ménagements; qu’il m’est prouvé, pour la vingtième fois, que le climat de Paris ne me convient pas; que cette vie d’hôtel et de restaurateur finirait par me rendre tout à fait malade. Ce ne sont pas là, vous le voyez, des préliminaires bien favorables à une candidature académique; j’ai cependant causé avec plusieurs académiciens, Autran d’abord, puis Legouvé, de Carné, Sandeau, Cuvillier-Fleury, Marmier. Tous sont du même avis. Les démarches que je pourrais faire aujourd’hui seraient à peu près stériles. L’élection[439] devant avoir lieu dans douze jours, la plupart des académiciens étant engagés avec ou pour M. de Viel-Castel, c’est tout au plus si j’aurais trois ou quatre voix. Un pareil antécédent ne me créerait pas une chance de plus pour le fauteuil de Saint-Marc Girardin, et j’aurais en plus tout l’ennui matériel et moral à travers une existence déjà si encombrée que c’est à peine si je puis trouver un moment pour écrire à mes meilleurs amis. Mais voici une autre raison à laquelle je n’avais pas songé. J’étais arrivé ici avec ma naïveté provinciale et mon amour-propre d’auteur, contrarié que la Gazette de France n’eût pas, à Paris surtout, plus de publicité. J’avais donc cru pouvoir accepter sans inconvénient les propositions ou plutôt les instances de M. Tarbé,[411] décidé que j’étais à faire une campagne contre la démagogie. Or il se trouve, au dire de mes amis les mieux situés et les mieux informés, que ma collaboration au Gaulois[440] est prise en mauvaise part, qu’on me blâme, non seulement parce que le Gaulois reste bonapartiste, mais parce qu’il appartient, comme le Figaro, au demi-monde littéraire. Les plus sévères vont jusqu’à dire que, par mes relations avec ce journal, je me suis momentanément déclassé. Je dois maintenant songer à me tirer de ce mauvais pas; mais il serait très impolitique de brusquer la situation. Voici la marche que l’on me conseille: ne pas interrompre mes articles tant que je suis à Paris; le 6 mai,—mon premier mois fini,—annoncer à M. Tarbé que ce travail est au-dessus de mes forces et que je vais partir pour la campagne; retourner aux Angles, ce qui amènera une interruption toute naturelle; attendre là les renseignements que me donneront les trois ou quatre académiciens que je compte parmi mes amis, et, à leur premier signal, revenir à Paris. Ce programme, qui me paraît fort sage, est d’accord, d’ailleurs, avec mon état de fatigue, ma nostalgie champêtre et les crispations nerveuses que me cause cet abominable pavillon de Rohan, où il me faut cinquante coups de sonnette pour obtenir de l’eau chaude ou une serviette. Mon second mois finit le 12 mai; il est donc infiniment probable que je repartirai ce jour-là; car ce ne serait pas la peine de faire, pour une quinzaine, une nouvelle installation et un déménagement. Tandis que vous jouissez au Pouliguen d’une température admirable, nous avons ici, à la suite de quelques journées chaudes et malsaines, des pluies torrentielles. Les sombres tristesses de la politique ajoutent encore à cet ensemble qui me serre le cœur et me donne envie de m’enfuir, d’aller me cacher dans quelque solitude....
Il resta cependant à Paris, retenu par la gravité de la situation politique et par la publication de son[412] neuvième volume des Nouveaux Samedis. J’allai le rejoindre, le 15 mai, au pavillon de Rohan, et je passai avec lui quelques semaines, au cours desquelles se produisirent deux événements d’inégale importance, la mort d’un académicien, M. Pierre Lebrun[441] et le renversement de M. Thiers. A peine de retour à Nantes, je recevais de Pontmartin la lettre suivante, datée de Paris, le 6 juin:
...Je profite de mon premier moment de liberté pour vous dire que votre lettre m’a causé un vif plaisir, mais ne m’empêche pas de regretter les moments trop courts que nous avons passés ensemble et dont le souvenir restera lié, dans les archives de notre amitié, aux grands événements du 24 mai 1873. A présent, le calme dont nous jouissons ne me suffit pas; la hausse de la Bourse et le nom de Mac-Mahon devraient servir de prélude à une série de mesures contre-révolutionnaires; sans quoi le parti radical, revenu de sa stupeur, usera et abusera des ressources légales qu’on lui laisse. J’ai reçu plusieurs lettres de mon Midi. Le premier effet avait été excellent; d’autant meilleur que l’on savait, à n’en pouvoir douter, les projets de manifestations écarlates dans le cas où M. Thiers aurait triomphé. Mais déjà, me dit-on, reparaissent quelques-uns des symptômes qui inquiétaient les honnêtes gens. C’est tout simple. Les démagogues jugent d’après eux-mêmes le parti conservateur. Ils savent à quel point, quand ils sont maîtres du terrain, ils méprisent la légalité et se font un jeu d’opprimer ceux qu’ils signalent au peuple comme ses oppresseurs. Dans le premier instant, ils s’attendaient à tout ce qu’ils feraient s’ils étaient les plus forts. Puis, à mesure qu’on les laisse respirer, se reconnaître, échanger leurs mots d’ordre, ils reprennent leurs trames en attendant une nouvelle crise qui peut assurer leur revanche. C’est ainsi que les choses se[413] sont passées après les élections du 8 février 1871 et la chute de la Commune; c’est ainsi qu’elles se passeront, si l’Assemblée, satisfaite de sa victoire, se borne à prendre de nouvelles vacances, à prolonger son règne et à traiter des questions secondaires. Mais laissons là cette triste et maussade politique, qui multiplie les points noirs, alors même que le ciel semble éclairci et l’orage apaisé... Quant à l’Académie, voici ce qui s’est passé avant-hier soir, au Théâtre-Français (première représentation de l’Absent, d’Eugène Manuel). Cuvillier-Fleury y était avec le vénérable M. Patin. Je l’ai rencontré dans le couloir, et je lui ai trouvé un air pincé qui ne présageait rien de bon. Il a commencé par me dire: «Vous savez que M. Beulé se présentera, et qu’on le dit patronné par M. Guizot?» Puis, il a ajouté: «Il y a, dans votre nouveau volume, une page qui pourrait bien gâter vos affaires; c’est celle où, sous le pseudonyme de M. Bourgarel, vous vous moquez de l’Académie[442]. Vous êtes donc incorrigible?» Tout cela était dit d’un ton très amical; mais je n’en ai pas moins compris qu’il y avait là de quoi offenser les susceptibilités académiques. Décidément, mon cher[414] ami, je suis trop indépendant, trop fantaisiste, pour me plier à toutes ces diplomaties... Ici, mon cher ami, je m’interromps avec une très vive et très sincère douleur. J’apprends à l’instant la mort de M. Vitet. J’avais vu, samedi dernier, cet homme éminent et excellent à l’Exposition des portraits de Gustave Ricard. Je l’avais trouvé un peu sombre, un peu vieilli; mais rien ne faisait pressentir un dénouement si prompt et si funeste. O mon ami! qu’est-ce donc que la vie? Ils s’en vont tous; la France républicaine n’est pas digne de conserver l’élite de ses enfants. Vitet six semaines après Saint-Marc Girardin! Et pas un vide ne se fait dans les rangs de la gauche radicale! Soumettons-nous à la volonté divine, Dieu nous a protégés le 24 mai; il nous protégera encore...
Je partirai, suivant toute vraisemblance, lundi 16 juin... Il me tarde, je dois vous l’avouer, de retrouver à la campagne un peu de recueillement et de calme. Cette vie fébrile n’est bonne ni pour l’esprit, ni pour l’âme, ni pour la conscience, ni pour le corps. O ubi campi! N’est-ce pas dans les temps troublés que ces images virgiliennes nous reviennent avec le plus de mélancolie, de charme et de douceur?...
Au lieu de quitter Paris le 16 juin, Pontmartin ne le quitta que dans les premiers jours de juillet. Il me mandait le 17 juin:
...Je ne partirai qu’après avoir fait pour l’Académie plus que le nécessaire. J’ai suivi toutes les indications de[415] M. Cuvillier-Fleury. J’ai remis le Filleul de Beaumarchais[443], avec ma carte, à la porte d’une douzaine d’académiciens. J’ai revu ici Laprade, qui va mieux et qui se montre fort passionné pour ma candidature. Autran parle de moi à ses collègues, tous les mardis et tous les jeudis. J’ai vu Camille Rousset, Marmier, Sandeau, Camille Doucet, Legouvé, qui tous savent à quoi s’en tenir. Vous en conclurez, mon cher ami, que ces préliminaires suffisent pour le moment, que je puis m’accorder trois mois de vacances rustiques, et que, en revenant à Paris le 20 septembre, c’est-à-dire six semaines avant l’élection, je serai en mesure de faire les démarches décisives. Au surplus, si j’en crois toutes les personnes qui m’en parlent, la mort de M. Vitet et les désastres parlementaires de M. Beulé multiplient mes chances, à ce point qu’il suffira d’éviter soigneusement les imprudences et d’y mettre, pendant les dernières semaines, un peu de résolution et d’entrain...
Les choses paraissaient donc en bonne voie. Tout annonçait que Pontmartin, cette fois, y allait pour de bon. Et pourtant il n’avait pas encore fait la démarche décisive, la démarche nécessaire. Il n’avait pas envoyé au secrétaire perpétuel sa lettre de candidature: il n’avait pas brûlé ses vaisseaux, et besoin était qu’il le fît, prompt, comme il l’était, à se décourager, à abandonner la partie, à jeter les cartes au moment de tourner le roi, à dire à ses amis, quand ils insistaient: «Un fauteuil? Bah! à quoi bon? J’ai ma causeuse!»
Septembre arrive et, au lieu de m’annoncer son départ pour Paris, il me mande que son intention[416] est d’aller en Provence chez Joseph Autran. Il m’écrit, le 4 septembre:
...Je n’ai aucune nouvelle académique, malgré les promesses que j’avais emportées de Paris, et je me demande si l’inexplicable entêtement des Marmier, des Cuvillier-Fleury, des Legouvé, qui se rangent bénévolement parmi les vaincus du 24 mai, ne change rien à leurs bonnes dispositions pour l’auteur de certains articles contre M. Thiers et son groupe. Ce qui est positif, mon cher ami,—puisque vous avez la bonté de vous intéresser à ces petits détails,—c’est que, si ma santé me le permet, j’irai, vers la fin de ce mois, passer quelques jours chez M. Autran. Là, je me trouverai, pour ainsi dire, dans une succursale de l’Académie, en mesure d’abord de consulter le maître de la maison, puis de correspondre directement avec les gros bonnets de l’Académie. Je pense donc que, dans ma prochaine lettre, je pourrai vous renseigner d’une façon plus précise sur cet épisode de ma vie littéraire, auquel vous vous intéressez plus que moi; car, dussiez-vous m’accuser d’impénitence finale ou de rechute, je dois vous avouer que, quand je me retrouve dans ce pays-ci, en rase campagne, en pleine verdure, à mille lieues des échos du palais Mazarin, et en face de misères trop réelles, dont quelques-unes peuvent être atténuées par ma présence, je redeviens absolument indifférent à la question de savoir si je porterai ou ne porterai pas les palmes vertes. Mon moment est passé. Il fallait me présenter entre cinquante et soixante ans, lorsque l’Empire mettait d’accord la droite, le centre droit et le centre gauche. A cette époque, d’ailleurs, la gloriole personnelle n’était pas absorbée dans ce gigantesque ensemble de douleurs et d’inquiétudes publiques...
IV
Ce n’était pas encore une renonciation définitive, mais c’était déjà un mauvais son de cloche. Septembre, octobre se passent: Pontmartin est toujours aux Angles et ne donne pas signe de vie aux gros bonnets de l’Académie. M. de Falloux m’écrit, le 31 octobre: «Que devient M. de Pontmartin? Connaissez-vous ses intentions pour l’Académie? Les plus graves événements politiques ne font point trêve pour les candidats; je vois que les parties se nouent, que les engagements se prennent, et M. de Gaillard ne m’a pas répondu sur mes questions académiques. Le scrutin approche pendant ce temps-là, et l’on parle de nous y appeler pour la fin de décembre, immédiatement après la réception de MM. de Loménie, Taillandier et Viel-Castel.»
Je suppliai l’Ermite des Angles (s’il eût été l’Ermite de la Chaussée d’Antin, il aurait été académicien depuis longtemps), je le suppliai de sortir enfin de sa retraite. Mes lettres devinrent de plus en plus pressantes. Pontmartin répondit en ces termes à celle que je lui avais écrite le 22 novembre:
Les Angles, le 25 novembre 1873.
Je reçois votre lettre, mon cher ami, et je m’afflige sincèrement de dissonances auxquelles notre amitié, presque majeure déjà, n’est pas habituée. Ce n’est pas sur le fond[418] même de la question académique que nous pouvons être en désaccord; car j’y suis plus intéressé que vous, et je conviens de bonne ou de mauvaise grâce que ma longue et laborieuse vie n’a plus beaucoup de sens si elle n’aboutit pas à l’Académie. C’est donc tout à fait malgré moi que je vais vous opposer quelques raisonnements, d’autant plus sérieux et sincères que, croyant être dans le vrai, je désire pourtant me tromper.
D’abord, êtes-vous bien sûr de mes chances? Sont-elles aussi bonnes qu’elles l’auraient été si l’Empire avait duré quelques années de plus? Au premier plan je vois M. Thiers groupant autour de lui MM. de Rémusat, Duvergier de Hauranne, Dufaure, Mignet, Littré, Jules Favre et—ne vous récriez pas—Legouvé, Marmier et Cuvillier-Fleury. Je ne veux pas dire pour cela que ce dernier, mon ancien patron académique, soit désormais contre moi; non, mais il est singulièrement refroidi, et je n’en veux pour preuve que son silence absolu depuis les premiers jours de juillet. M. de Viel-Castel, dont la réception est annoncée pour jeudi, a contre moi des préventions inexplicables. Il prétend que j’ai éreinté son Histoire de la Restauration, tandis que je suis certain de ne pas en avoir parlé. Hostiles aussi MM. de Sacy, Émile Augier et Octave Feuillet. Absolument inconnus Claude Bernard, Patin, Auguste Barbier. Je ne dis rien de Victor Hugo, qui, si je me présente, est disposé, dit-on, à venir par extraordinaire à l’Académie, pour voter contre moi.
Maintenant, supposez que Jules Janin, de plus en plus cloué sur son fauteuil par la goutte, ne puisse pas venir; que Laprade soit retenu à Lyon par le déplorable état de sa santé; que Joseph Autran n’ait pas le courage de quitter sa chère Provence, que me restera-t-il? Assurés: Camille Rousset, Camille Doucet, Jules Sandeau, Guizot, le duc de Broglie, d’Haussonville, comte de Falloux, comte de Carné, qui ne peuvent pourtant pas, pour diverses causes, y mettre beaucoup de chaleur: 8.
Non moins probables, mais presque étrangers pour moi,[419] le duc de Noailles, D. Nisard, de Champagny, duc d’Aumale: 4.
Vous le voyez, les calculs les plus favorables ne peuvent me donner plus de 11 à 13 voix; car il faudrait admettre que, parmi les académiciens que je viens de nommer, aucun n’ait pris des engagements pendant ma longue absence et mon long silence.
Je ne vous parle plus de ma santé, puisque vous n’y trouvez pas un obstacle suffisant. J’aime mieux vous dire que, cédant à d’affectueuses instances, je vais partir après-demain pour Grambois, près Pertuis, résidence de M. Autran[444]. Laprade a promis de s’y trouver le 27, s’il n’est pas trop souffrant. Tous deux, à ma demande, se sont arrangés pour avoir des renseignements exacts. Nous travaillerons sur la liste des immortels, comme les courtiers électoraux sur la liste des électeurs. Nous examinerons le pour et le contre, les chances bonnes et mauvaises. Si la réponse des oracles est affirmative, je ne passerai à Grambois que cinq ou six jours et je tâcherai de me mettre en mesure de partir pour Paris le lundi 8 ou mardi 9 décembre. Quant à une candidature purement épistolaire, elle ne pourrait être sérieuse; mes titres ne sont pas assez éclatants pour me donner le droit de manquer aux traditions et aux usages et, d’autre part, mes juges auraient à me répliquer que, si je suis trop vieux, trop infirme ou trop malade pour faire ce trajet de dix-huit heures, c’est une bien triste recrue que j’offre à l’Académie.
Adieu, mon cher ami; si les choses tournent autrement que le désire votre amitié, je compte mériter votre indulgence en m’efforçant de faire ici un peu de bien et en dépensant, au profit des pauvres, ce que me coûteraient, à Paris, les hôtels, les restaurateurs et les fiacres. Notre malheureux pays est si cruellement éprouvé! La misère est si terrible! L’hiver sera si dur! Mais je ne veux pas ajouter un mot de plus, vous croiriez que je cherche déjà des fauxfuyants[420] et des prétextes, et mieux vaut vous répéter que je suis à vous de tout cœur.
Pontmartin, on le voit, réduisait à 12 les voix sur lesquelles il pouvait compter. Son pointage n’était rien moins qu’exact. Il mettait tout d’abord hors de cause trois de ses plus chauds partisans, Victor de Laprade, Joseph Autran, Jules Janin, sous prétexte qu’ils pourraient être malades. Sans doute, mais la maladie ne pouvait-elle sévir aussi dans l’autre camp? Il passait sous silence Loménie et Saint-René Taillandier, qui devaient prendre séance avant le jour de l’élection et qui lui étaient tout dévoués. Il tenait pour hostiles Cuvillier-Fleury et Marmier, qui avaient été les premiers patrons de sa candidature et ne pouvaient honorablement se tourner contre elle. En réalité, il y avait là 7 voix à ajouter aux 12 qu’il reconnaissait lui être acquises. Cela faisait, d’entrée de jeu, 19 voix à peu près assurées, ce qui était superbe, puisque les Quarante étaient réduits à 36, depuis la retraite de Mgr Dupanloup et la mort de MM. Pierre Lebrun, Saint-Marc Girardin et Vitet. J’ajoutais dans ma réponse à la lettre du 25 novembre: «Octave Feuillet vous a de très grandes obligations; Auguste Barbier est l’ami de Laprade, qui a sur lui une grande influence. M. de Viel-Castel suivra M. Guizot. J’écris aujourd’hui à M. de Falloux et je lui demande s’il ne pourrait pas agir auprès de M. Patin et de M. Claude Bernard.»
Pontmartin m’avait annoncé son départ pour Grambois, et c’est là que je lui adressais ma lettre. Il ne s’y était pas rendu. M. Autran, à qui j’avais aussi envoyé quelques lignes, me répondait le 4 décembre:
Mon cher monsieur,
M. de Pontmartin n’est pas auprès de moi, mais j’ai M. de Laprade et je ne vous étonnerai pas en vous disant que nous exprimons journellement le désir de voir notre ami se décider, enfin, à poser sa candidature. Malheureusement, M. de Pontmartin, vous le savez peut-être, est le plus fugitif et le plus détaché qui soit au monde. Quand on croit le tenir, il vous échappe; quand il vous a dit oui la veille, il vous écrit non le lendemain. Ce n’est ni à moi, ni à M. de Laprade qu’il convient de parler des titres de cet éminent écrivain, et la plupart des membres de l’Académie partagent là-dessus l’opinion de ses meilleurs amis. Il entrera quand il voudra, mais encore faut-il qu’il ne se dérobe pas aux instances qui sont faites auprès de lui. C’est donc à lui, mon cher monsieur, bien plus qu’à nous, que vous devez vous adresser dans votre amicale entreprise...
Hélas! mon «amicale entreprise» était vouée au plus lamentable échec; au moment où je croyais enfin toucher au port, ma pauvre barque allait couler à pic. Le 12 décembre, je reçus cette lettre:
Mon cher ami,
Je m’étonne que M. Autran, à qui vous avez cru devoir écrire, ne vous ait pas purement et simplement envoyé ma lettre à M. de Laprade. Voici, en abrégé, ce que je disais à l’auteur de Pernette: Le samedi 22 novembre, j’ai fait une chute qui aurait pu être très grave, et comme, à mon âge, un accident de ce genre ne saurait être absolument insignifiant,[422] j’ai appelé mon médecin, qui est mon ami depuis trente ans. Il a constaté que ma chute n’était rien ou presque rien, mais que j’étais atteint d’une gastrite nerveuse passée à l’état chronique, à laquelle il fallait attribuer mes insomnies nocturnes et mes assoupissements diurnes. Mes violentes quintes de toux ont la même cause. Le vieil adage médical: Sanguis moderator nervorum, ne fut jamais plus applicable. Mon sang, appauvri en 1870 et 1871 par des misères et des chagrins de toutes sortes, ne modère plus mes nerfs et ils en profitent pour bouleverser ma pauvre machine. J’ajoute, pour en finir sur ce sujet, et afin qu’il n’en soit plus question, que, lorsque j’ai demandé à mon docteur s’il serait sage, dans ce triste état, de partir pour Paris et d’affronter les soucis d’une candidature, il m’a regardé avec stupeur et m’a répondu que, en pareil cas, je ne ferais pas mal de m’arrêter à la station de Charenton, pour ne pas arriver jusqu’au Père-Lachaise. Je crois même, en ma qualité d’incorrigible, avoir ébauché un pitoyable calembour sur la chaise et sur le fauteuil.
Voilà, mon cher ami, sinon le texte, au moins le sens de ce que j’ai écrit à M. de Laprade, en le priant de communiquer ma lettre à son hôte et collègue, M. Autran. Maintenant, toute insistance serait une véritable cruauté. Je ne puis même songer à des démarches qui engageraient l’avenir; car je veux rester libre de me soigner, d’acheter un petit chalet à Cannes, d’éviter tout ce qui pourrait me forcer de retourner à Paris, et de donner au recueillement, à la retraite et au repos le peu de temps qui me reste à vivre. J’ai à Avignon des amis d’enfance avec lesquels je pourrais célébrer la cinquantaine. Quelques-uns sont suffisamment lettrés, et désireraient, ne fût-ce qu’à titre de compatriote, me voir académicien. Pas un n’oserait, en ce moment, me donner un autre conseil que celui de mon docteur. Pas un n’oserait prendre une responsabilité qui se changerait en regrets et en remords si, en arrivant à Paris, je tombais tout à fait malade. Laissez-moi vous le dire avec la rude franchise d’une fidèle amitié. Votre acharnement[423] académique, vos persécutions incessantes, votre système de sommations directes, tantôt à M. de Falloux, tantôt à M. Cuvillier-Fleury, tantôt à M. Autran, tout cela m’attriste et finirait par m’exaspérer. Il y a des moments où je suis tenté de regarder comme une légende fantastique ce que je sais de vous, de votre famille, de vos enfants, du soin avec lequel vous dirigez leur éducation, de vos infatigables travaux, de vos patientes recherches, et où j’ai envie de croire que vous êtes un vieux garçon bien oisif, dont les vingt-quatre heures appartiennent à une idée fixe. D’ici à peu d’années, vous verrez l’Académie dégringoler d’une telle façon, tomber dans un tel discrédit, être entourée d’une telle indifférence (cela commence déjà), que vous serez tout étonné d’avoir attaché tant d’importance à faire de moi le collègue de MM. Jules Favre et Littré, en attendant Renan et About. Donc, n’en parlons plus; vous compromettriez notre amitié, vous me rendriez ridicule et vous atteindriez le but diamétralement contraire à celui que vous vous proposez. La question me semble tellement épuisée que, si vous y reveniez dans vos prochaines lettres, je ne vous répondrais plus. J’aurais dû peut-être m’expliquer plus tôt aussi nettement qu’aujourd’hui; mais, d’abord, j’étais moins souffrant; ensuite, j’espérais toujours que vous lâcheriez prise et que vous adopteriez ma méthode, que je crois bonne: quand je devine que quelque chose est désagréable à un ami, et quand ce quelque chose n’intéresse ni son honneur, ni sa vie, ni sa conscience, je ne lui en dis plus un mot, et, généralement, je m’en trouve bien. Être plus royaliste que le roi n’est bon ni dans la vie publique, ni dans la vie privée. Pardonnez, mon cher ami, à la liberté de mon langage; il fallait en finir, et cette fois je me flatte que c’est bien fini. Notre affection, soyez-en certain, n’en sera que plus vive et plus douce quand nous serons débarrassés de ces éternels tiraillements. Votre tout dévoué de cœur[445].
V
Ce petit dissentiment n’était pas pour altérer en rien notre vieille amitié. Lorsque mourut Jules Janin, au mois de juin 1874, Pontmartin me permit de lui reparler de l’Académie. Il persistait, il est vrai, à ne pas vouloir se présenter; mais sa réponse ne respirait, cette fois, aucune irritation. Dans une lettre qu’il m’adressait de Marseille, le 4 avril 1875, il me disait:
...Un mot encore sur l’Académie. Mes chances seraient aussi mauvaises qu’elles auraient été bonnes en 1873. Je n’ai plus M. Guizot[446]; M. Autran n’est pas en état de retourner à Paris; les apparitions de M. de Laprade parmi ses collègues sont trop rares et trop courtes pour qu’il puisse avoir la moindre influence. M. Thiers dispose de quatorze voix qui toutes me seraient hostiles. En fait de bonapartistes, je ne pourrais compter que sur Jules Sandeau. Vous le voyez, mon cher ami, la peau de chagrin s’est singulièrement amincie; ce chagrin-là est le moindre des miens...
Joseph Autran mourut le 7 mars 1877. Pontmartin paraissait si bien indiqué pour le remplacer, que ses adversaires eux-mêmes parlèrent aussitôt de sa candidature et la combattirent préventivement. Ainsi fit le Sémaphore, journal républicain de Marseille, qui avait pour correspondant parisien M. Émile Zola. Pontmartin était alors à Marseille;[425] il répondit sur-le-champ au rédacteur en chef du «Sémaphore»:
Monsieur,
Avant d’attaquer une candidature, il faudrait, ce me semble, s’assurer qu’elle existe. Depuis la mort de M. Autran, je n’ai quitté la campagne que pour venir à Marseille; je puis me rendre cette justice que, en pleurant mon illustre ami, en m’associant au deuil de sa famille et de sa ville natale, je n’ai pas mêlé à mes regrets la moindre arrière-pensée académique. Je défie que l’on cite un mot de moi, une démarche, une ligne d’écriture qui trahisse des velléités de candidat. Votre correspondant prétend que «j’en meurs d’envie». Je crois avoir prouvé le contraire. Cette envie, d’ailleurs, me paraît peu compatible avec l’épithète de provincial qu’il me décerne, dont je suis loin de me défendre, et qui, soit dit en passant, produit un singulier effet dans la correspondance d’un journal de province. Oui, depuis sept ans, depuis les désastres de la France, j’ai cessé d’habiter Paris; je suis redevenu, non seulement provincial, mais villageois. Est-ce là le fait d’un homme atteint de nostalgie académique? J’en appelle à votre justice.
Cette attaque m’étonne d’autant plus que mes relations avec le Sémaphore avaient toujours été fort amicales. Permettez-moi donc, monsieur le rédacteur, de l’attribuer ou aux inquiétudes d’un candidat pressé d’écarter même les concurrents imaginaires, ou peut-être aux rancunes d’un romancier désireux d’accaparer à lui tout seul les privilèges de l’Assommoir.
Comptant sur votre bienveillante impartialité pour l’insertion de cette lettre, je vous en remercie d’avance et je vous prie, monsieur le rédacteur, d’agréer l’assurance de ma parfaite considération, de mes cordiales sympathies.
A. de Pontmartin.
Marseille, 24 mars 1877
Cette lettre ne préjugeait rien sur le fond de la question. Il lui eût été doux de louer son ami, et peut-être n’était-il pas sans désirer qu’on le chargeât de ce soin. La veuve du poète, de son côté, souhaitait vivement que son éloge fût confié à l’auteur des Samedis, à l’écrivain qui, en tant de rencontres, avait si bien parlé de son mari. Ni son propre désir, ni les instances de Mme Autran, ni celles de M. Léopold de Gaillard, ne purent le faire revenir sur son parti pris d’abstention et d’absentéisme. Cette fois encore, il laissa aller les choses. Le 17 avril, M. le duc d’Audiffret-Pasquier posa sa candidature; celle de Pontmartin dès lors devenait impossible, puisqu’ils avaient, l’un et l’autre, mêmes amis et mêmes électeurs. M. de Gaillard, qui voulait bien me tenir au courant de la situation, m’écrivit de Paris, le 25 avril:
...Je vous aurais répondu depuis longtemps si j’avais eu à vous dire quelque chose de bon pour la candidature à l’Académie de notre ami Pontmartin. Trois fois, déjà, à ma connaissance, il a été l’objet d’avances aussi flatteuses que peu écoutées. Deux fois je lui ai écrit de la part de M. Guizot pour lui dire: Votre moment est venu; posez votre candidature, nous la soutiendrons. Cette fois encore, M. d’Haussonville lui a fait porter les propositions les plus séduisantes. Jamais notre cher indécis n’a daigné répondre: Je vous remercie, j’accepte et j’arrive.
Depuis plus de dix ans, il serait en possession du fauteuil qu’il mérite si bien, s’il avait voulu écrire sa lettre de demande et laisser agir ses amis. Il y a un mois, après une visite au duc de Broglie, je lui faisais connaître la situation d’alors: Sardou seul en avant; le duc Pasquier sollicité, mais refusant et préférant se réserver pour le prochain fauteuil[427] politique. Je ne mets pas en doute que si notre ami avait aussitôt pris son parti et posé sa candidature, jamais on n’eût parlé de celle du président du Sénat. Celui-ci, en effet, n’a écrit qu’à la date du 17 avril. Maintenant que l’occasion est manquée, je ne conseillerai pas à Pontmartin de se jeter en avant. Évidemment, la moitié des voix sur lesquelles il pourrait compter sont engagées au candidat politique. Si l’élection est renvoyée à l’hiver prochain, il faudra voir, et tout pourrait peut-être s’arranger comme nous le désirons, vous et moi, et même lui, en dépit de ses hésitations. Si l’élection a lieu tout de suite, on croit à deux ou trois voix de majorité pour le duc Pasquier. Je suis assez peu duc et assez peu homme de lettres pour avoir une opinion désintéressée sur la matière. Je suis hardiment pour l’Académie Salon politique et littéraire, contre l’Académie Société des Gens de lettres. C’est pour cela que notre ami qui est, par excellence, un gentleman et un écrivain devrait se décider...
Au commencement de 1878, Pontmartin passa deux mois à Hyères, où se trouvait l’évêque d’Orléans. Nous avons vu quel caractère de cordialité prirent bien vite leurs relations[447]. Il y avait alors trois vacances à l’Académie, par suite de la mort de MM. Thiers, Claude Bernard et Louis de Loménie. Le fauteuil de ce dernier semblait revenir de droit à Pontmartin. Mgr Dupanloup insista auprès de lui pour qu’il se mît sur les rangs. Seul, l’illustre évêque pouvait triompher de cette résistance que n’avaient pu vaincre ni M. Guizot, ni M. d’Haussonville, ni M. Léopold de Gaillard. Il put croire un instant qu’il avait partie gagnée. Le[428] 7 avril 1878, étant encore à Hyères, que Pontmartin venait de quitter, il me faisait l’honneur de m’adresser ces lignes:
Monsieur,
Tous mes vœux sont pour M. de Pontmartin, et je crois l’avoir déjà décidé à donner son consentement pour sa candidature. Je vais y travailler encore...
Rentré à Orléans, il voulut bien, le 18 avril, m’envoyer ce nouveau billet:
Monsieur,
Je suis l’admirateur et l’ami de M. de Pontmartin; et si cela dépendait uniquement de moi, il serait demain de l’Académie française.
J’ai quitté cette Académie, mais j’emploierai ce qui me reste de crédit auprès de mes confrères en faveur de M. de Pontmartin, et en le faisant, je croirai faire une œuvre également honorable pour l’Académie et pour M. de Pontmartin.
Mgr Dupanloup ne devait pas s’en tenir là. «Je ferai, m’écrivait-il quelques jours plus tard, je ferai pour M. de Pontmartin ce que je ne ferais pour personne autre. Je serai heureux de revenir à l’Académie le jour où il s’agira de voter pour lui.» Et cela, il le lui écrivit à lui-même. Être nommé dans de telles conditions, n’était-ce pas être nommé deux fois? Pontmartin refusa[448].
Cette fois, tout était bien fini. A peu de temps[429] de là, le 11 octobre 1878, l’évêque d’Orléans mourait, après une courte maladie, au château de la Combe[449], par Domène (Isère). Après lui, nul ne pouvait plus songer à parler encore de l’Académie à Pontmartin.
On a souvent répété que les Jeudis de Mme Charbonneau avaient jusqu’au dernier jour fermé à Pontmartin les portes de l’Académie. Rien n’est moins exact, nous venons de le voir. Il n’a tenu qu’à lui, et à plus d’une reprise, d’en franchir le seuil. S’il n’a pas été académicien, c’est parce qu’il n’a pas voulu l’être. Est-ce à dire qu’il dédaignait de figurer parmi les Quarante? Il était trop homme d’esprit pour avoir ce sot orgueil. Il eût été, au contraire, très heureux et très fier de s’asseoir auprès des maîtres et des amis qu’il comptait dans l’illustre compagnie. S’il s’est obstiné jusqu’à la fin à ne point poser sa candidature, ce n’est ni par excès d’orgueil, ni par excès de modestie. Faut-il chercher la cause de ses refus dans un détail minuscule qu’il se plaisait, il est vrai, à grossir, dans le petit volume et la petite portée de sa voix qui lui faisait peur d’avance? Je sais bien que dans ses Mémoires[450], c’est à cette malheureuse voix aigrelette qu’il attribue tout le mal. C’est derrière elle qu’il se retranchait, lorsque ses amis le pressaient de trop près et lui reprochaient[430] de se dérober, même quand l’occasion était propice et le succès certain: «Comment ne devines-tu pas, écrivait-il à Léopold de Gaillard, que le jour de la réception qui est, pour le nouvel académicien, le jour du triomphe serait pour moi le jour de la confusion? On viendrait à ma séance pour se moquer de moi!» Un autre jour, comme M. de Gaillard lui énumérait la majorité certaine qui l’attendait au palais Mazarin: «Oui, répondit-il, avec tristesse, il y aurait même une voix de trop, c’est la mienne!»
L’obstacle pourtant,—et Pontmartin le savait bien—était de ceux qui se peuvent tourner. Un académicien a le droit, comme un simple mortel, d’avoir la grippe et de faire lire son discours par un confrère. Ainsi avait fait Jules Janin dans la séance du 9 novembre 1871. Le comte d’Haussonville était un des plus chauds partisans de Pontmartin. Il lui fit dire par un ami commun qu’il se tenait à sa disposition pour se mettre en rapport d’abord avec l’Académie pour sa candidature, puis avec le public pour le jour de la réception. L’obstacle était ainsi levé, et dans les meilleures conditions, puisque aussi bien M. d’Haussonville était un admirable lecteur. Son offre pourtant ne fut pas agréée. C’est que le véritable obstacle était ailleurs; il était dans l’irrésolution et la nervosité de son caractère, dans son éloignement pour tout ce qui ressemblait à une compétition et à une lutte, dans la facilité avec laquelle trop souvent il jetait le manche après la cognée. Il était surtout[431] dans le sentiment qui, après les désastres et les deuils de 1870 et 1871, le portait de plus en plus à ne point avoir à Paris de résidence fixe, mais un simple campement, et qui le décida à finir ses jours à la campagne. Peut-être, après tout, choisissait-il la meilleure part, et je fus tout à fait désarmé, je l’avoue, le jour où je reçus de lui ces lignes, où le sourire se mouille d’une larme:
Si j’étais de l’Académie, il me faudrait habiter Paris une partie de l’année; force au moins me serait d’y aller aux époques d’élection ou de réception... Depuis la mort de ma pauvre femme et depuis les dates sinistres de 1870-1871, Paris ne m’attire plus, au contraire, je n’y arrive que pour m’enrhumer; le théâtre, dont j’ai conservé le goût, me fatigue et m’endort. Dans les maisons où je suis invité, on dîne trop tard pour ma gastrite et on veille trop pour mes soixante-trois ans. La campagne, mes vieilles servantes, mon vieux chien, un peu de travail, un peu de charité, quelques amis à mes dîners maigres du vendredi, quelques coups de fusil très peu meurtriers en septembre et en octobre, et, en perspective, le cimetière de mon village, voilà désormais, non seulement mon partage, mais mes préférences. Ce n’est pas vous, mon cher ami, qui aurez le courage de me blâmer.
CHAPITRE XVI
LES ANGLES.—MES MÉMOIRES.—SOUVENIRS D’UN VIEUX CRITIQUE.—LE MILLIÈME ARTICLE.—LES NOCES D’OR.
(1879-1887)
Description des Angles. Le cabinet de travail, les promenades, les visiteurs. Soirées d’hiver. Évocation du passé.—Delenda est res... punica. Pontmartin et la République conservatrice.—Mes Mémoires. Le chapitre sur Berryer. Les Souvenirs d’un vieux critique.—Le Millième article. L’Encrier de la Gazette de France. Les deux Bustes. Les souscripteurs. Lettres de Mgr de Dreux-Brézé, de Belcastel, Edmond Rousse, Désiré Nisard, Emile Ollivier. Lettre de Pontmartin au directeur de la Gazette de France.—Le critique et le romancier. La Correspondance de Pontmartin.
I
Pontmartin maintenant ne quittera plus les Angles. Loin, bien loin de Paris et de ses vaines rumeurs, il passera ses dernières années dans cette maison où s’est écoulée son enfance et où il lui sera doux de mourir.
L’heure est venue de la décrire.
Située sur la rive droite du Rhône, presque en[433] face d’Avignon, mais dans le département du Gard, la plaine des Angles, bornée d’un côté par le fleuve, est entourée de tous les autres côtés d’une chaîne de collines formant hémicycle. La maison est au fond de la plaine, à l’endroit le plus éloigné du Rhône, au pied de la colline, qui s’élève presque à pic derrière elle. C’est une construction à deux étages, à contrevents verts, datant du milieu du XVIIIe siècle, ainsi que le rappellent quelques ornements Louis XV. Logis modeste, en somme, et dont l’aspect n’a rien de seigneurial, bien que dans toute la région on l’appelle couramment le château. Ce qui en fait le charme, ce sont de nombreuses sources d’eau vive, de riantes prairies, de magnifiques arbres, parmi lesquels les marronniers célèbres et un platane qui n’est pas moins légendaire dans le pays. L’été, c’est un nid de verdure et une fraîche retraite; l’hiver, le soleil ne manque pas, et ses rayons ont encore un éclat et une tiédeur que la ville ne connaît pas. Derrière la maison, se dresse sur la colline calcaire dénudée, à une cinquantaine de mètres de hauteur, le village des Angles, avec son prieuré du XIVe siècle et son église du XVe. Vu du bout de l’allée des marronniers, il ressemble d’étonnante façon à ces nids d’aigle des environs de Nice et de Monaco, tels qu’Éza, que leurs habitants avaient bâtis sur des cimes presque inaccessibles, par crainte des Sarrasins. Tous ceux des visiteurs de Pontmartin qui connaissaient la Corniche étaient frappés de cette ressemblance. L’ascension du château à ce village[434] perché sur son rocher est très fatigante; mais, parvenu au sommet, on découvre une vue merveilleuse sur le Rhône, la Durance, la chaîne des Alpines, le tout inondé de cette lumière intense et douce à la fois, qui donne tant de charme aux paysages méridionaux.
Pontmartin avait fait du grand salon du rez-de-chaussée son cabinet de travail. C’était une très vaste pièce, percée de trois fenêtres donnant au midi. Aucune élégance dans l’ameublement, demeuré tel qu’il était au temps de M. Eugène de Pontmartin et de l’oncle Joseph: deux canapés[451] et six fauteuils Restauration garnis de toile perse assortie aux rideaux des fenêtres; deux fauteuils Louis XVI; deux chaises de cuir Louis XIII; deux fauteuils modernes plus confortables; quelques chaises de paille ou de canne; une vieille table de trictrac, supportant un plateau garni de porcelaines de Chine; entre les fenêtres, deux consoles surmontées de deux étagères-bibliothèques; sur la cheminée, une belle pendule Louis XIII de la forme dite religieuse, flanquée de quatre potiches et de deux bronzes de Chine. Aux murs, quatre grandes gravures d’Audran, d’après les tableaux de Jouvenet: la Pêche miraculeuse, la Résurrection de Lazare, les Noces de Cana, la Guérison du paralytique. Au milieu de la pièce, une grande table ovale, toujours submergée de papiers, de livres,[435] de journaux. C’est là que, tous les matins, assis en face de la fenêtre du milieu, il écrivait lettres et articles avec une régularité, une facilité et une abondance qui ne connaissaient pas la fatigue.
Après le déjeuner, il visitait son jardin, il franchissait son enclos et, quand ses forces le lui permettaient, il promenait ses rêveries dans ces champs familiers et ces sentiers connus, à travers ce petit coin de terre où s’étaient écoulées ses premières années. Il reprenait une à une les impressions de son enfance et de sa jeunesse. Ce chêne vert lui avait prêté son ombre quand il étudiait l’Epitome ou le De Viris. Sous cet ormeau, il avait lu pour la première fois Indiana, la Peau de chagrin, Barnave, Stello, le Rouge et le Noir. Il avait relu Lamartine, Hugo, Vigny, Musset, Childe Harold, Don Juan, Parisina, Faust, Hamlet, Roméo et Juliette. Si la chaleur n’était pas trop grande, il poussait jusqu’au Rhône, ce terrible voisin, dont il redoutait les visites, mais qu’il ne pouvait se défendre d’aimer, malgré ses débordements et ses colères.
Le printemps surtout lui était, chaque année, une fête nouvelle, et il se demandait alors comment il avait pu autrefois quitter sa maison quand Avril ramenait les beaux jours. Ce renouveau le rajeunissait. Comment eût-il regretté le boulevard ou même le jardin de la Revue des Deux Mondes, quand il passait la revue de ce petit monde—arbres, nids et fleurs—sur lequel il régnait et qui tenait à toutes les fibres de son cœur? «Pas un de ces[436] amis ne manque à l’appel, dit-il quelque part. Voici le cytise des Alpes, dont les grappes élégantes étalent plus d’or que notre budget n’en réclame. La pervenche se tapit entre les dernières violettes et les premiers lilas. Les églantiers s’entrelacent aux aubépines à fleurs roses. Les panaches des acacias, plus pressés d’habitude, ont attendu que les tilleuls fussent prêts. Les marronniers ont leurs aigrettes. Les clématites, aux vagues parfums, me sont dénoncées par un essaim d’abeilles, qui vont leur demander leur miel. Les plantes grimpantes montent à l’assaut de mon toit. Et les nids! Je les reconnais. On dirait que ce sont les mêmes. Les pères et mères ne se défient pas de mon hospitalité... Je les vois tous à leur place: le nid de tourterelles sur le grand pin; le nid de loriots sur le peuplier de Virginie. A une branche de l’érable, le nid de merles; dans le massif de noisetiers, le nid de fauvettes; dans une touffe de fusains, le nid de chardonnerets[452].»
L’hiver même n’interrompait pas tout à fait ses promenades, bien que l’anémie dont il avait été atteint en juillet 1870 et dont il ne s’était jamais très bien guéri, l’eût rendu extrêmement frileux. Il y avait, de sa maison au pont d’Avignon, un chemin abrité par une colline boisée de chênes verts, de micocouliers et surtout d’oliviers, en plein midi, en plein soleil. Il l’appelait le Cagnard, et, même en décembre, même en janvier, il allait[437] y faire concurrence aux lézards et y rêvasser à ses articles.
Hiver comme été cependant, la plupart de ses après-midi se passaient dans son salon, où il lisait le livre du jour et d’un crayon rapide l’annotait pour le mieux juger à l’occasion. Le vendredi seulement, laissant là livres et crayon, il recevait ses amis. Dans ces réunions, qui étaient une fête pour la société avignonnaise, il déployait toutes les grâces de son esprit. Aux Angles, comme autrefois à Paris, on lui pouvait appliquer le mot de Montaigne: «Il n’est rien à quoy il semble que la nature l’aye plus acheminé que pour la Société.»
Les autres jours de la semaine, d’ailleurs, les visiteurs n’étaient pas rares, et pas n’était besoin qu’ils portassent un nom connu dans le monde ou dans les lettres, pour qu’ils fussent assurés de recevoir un gracieux accueil. Je laisse à l’un de ceux qui l’ont vu alors le plus souvent et de plus près le soin de nous dire ce qu’était Pontmartin dans ce salon des Angles, où il avait désormais renfermé sa vie:
...Dès qu’on entrait, quel cordial accueil, quelle poignée de main bien franche et bien sincère, et comme il était facile de lire sur cette physionomie intelligente et fine, dans cet œil souriant presque avec gratitude: Soyez le bienvenu. Il jetait le livre commencé, semblant dire: A demain les affaires sérieuses, et venait invariablement se placer dans son grand fauteuil adossé au mur et au coin de la cheminée. Il affectionnait cette place, d’où son œil pouvait embrasser le parc merveilleux qui se déroulait sous ses fenêtres, les[438] vertes pelouses baignées par l’ombre des marronniers séculaires. Peu à peu la conversation s’engageait à bâtons rompus, comme une de ces parties de chasse où on jette une pierre dans les touffes que l’on rencontre. C’était l’événement du jour, l’actualité, une anecdote du temps jadis à propos d’un souvenir évoqué par une ligne de journal. Puis la conversation s’élevait peu à peu, elle gagnait les hauteurs par des méandres capricieux, par des chemins détournés, s’arrêtant dans une clairière pour y cueillir un mot, un trait d’esprit, comme une fleur aux chatoyantes couleurs, s’enfonçant sous bois et arrivant enfin sur un plateau découvert, d’où l’on pouvait voir de vastes horizons. L’éminent écrivain jugeait alors d’un mot ou d’un aperçu une œuvre, un auteur, une époque littéraire, mais brièvement, sans tirades, d’un trait, sans la moindre pédanterie. Car Armand de Pontmartin était un merveilleux causeur. Il déployait dans la causerie les grâces naturelles de son esprit si fin et si primesautier. Il avait beaucoup vu et beaucoup retenu. Sa mémoire était des plus fidèles, et il y puisait comme dans un inépuisable répertoire. Il avait connu presque toutes les illustrations littéraires du siècle, et un sténographe n’eût pas perdu son encre à recueillir les anecdotes et les menus faits qu’il égrenait au cours de la conversation. Il a comparé lui-même la causerie de certaines grandes dames des salons qu’il avait fréquentés, à de la dentelle fine. La sienne était bien de la dentelle, mais une dentelle tissée d’un fil aussi solide que délié et où il laissait percer la grâce aristocratique du gentilhomme unie à la finesse du lettré. C’était, en un mot, le plus séduisant des causeurs. Et ce qui ajoutait plus de charmes à la séduction qu’il exerçait sur l’esprit de son interlocuteur, c’est qu’on n’y apercevait pas la moindre trace de coquetterie. La grâce était toute naturelle et sans le moindre effort[453].
Longue serait la liste des visiteurs, des amis, pour qui c’était une fête de faire le pèlerinage des Angles.
L’évêque de Nîmes, Mgr Besson, lui-même écrivain très distingué[454], était particulièrement fier de son diocésain; toutes les fois que s’offrait à lui l’occasion de l’aller voir, il était heureux de la saisir. Quand Pontmartin avait l’honneur de recevoir son évêque, il ne manquait jamais de me l’écrire et de m’associer—de loin—à sa joie. Elle était complète lorsqu’il pouvait faire asseoir à sa table, le même jour, Mgr Besson et son vieil ami Léopold de Gaillard.
Par une heureuse fortune pour Pontmartin, en même temps qu’il abandonnait définitivement Paris, M. de Gaillard renonçait également à la capitale; le 25 février 1879, il donnait sa démission de conseiller d’État et venait habiter son château de Bellevue, près Bollène (Vaucluse), à quelques lieues seulement des Angles. Si les deux[440] amis, retenus chez eux par des occupations diverses, n’allaient guère qu’une fois ou deux par an l’un chez l’autre, dans l’intervalle de ces visites, que de bonnes rencontres à Avignon! Une ou deux fois au moins chaque mois, jusqu’à la fin de 1887, époque où la fatigue de Léopold de Gaillard devint trop grande, on se donnait rendez-vous à l’Hôtel de l’Europe. A ces déjeuners mensuels, à ces «rendez-vous de l’omelette», ajoutez des lettres sans nombre, si bien qu’en réalité leur amitié ne connais-pas l’absence.
Dirai-je maintenant tous ceux qui, habitant à Avignon ou dans le voisinage, étaient les hôtes habituels du salon des Angles? Je n’en veux citer que quelques-uns, parmi les plus fidèles: le docteur Cade, M. Augustin Canron, un journaliste et un érudit (ceci n’est point un pléonasme), le bon poète Roumanille, M. de Roubin, M. Alfred Coulondres, ancien magistrat, homme grave, spirituel et savant, M. François Seguin, imprimeur et directeur de l’Union de Vaucluse, pour lequel Pontmartin, qui avait tant fait gémir la presse, éprouvait une particulière sympathie, en raison surtout de sa fidélité à des principes héréditaires dans sa famille, on pourrait dire sa dynastie; car il y a deux siècles que les Seguin pratiquent l’art de Guttemberg, et toujours pour en faire un usage bon et sain.
Le soir venu, quand ses hôtes étaient partis, Pontmartin éprouvait un charme mélancolique à évoquer les jours évanouis, ses souvenirs de jeunesse,[441] et surtout ces deux dernières années de la Restauration, dont rien n’égala jamais la douceur et l’éclat. Il se reporte par la pensée à ses promenades sous les arbres du Luxembourg ou sous les galeries de l’Odéon, aux leçons de Villemain ou de Cousin, ou encore à cette soirée de novembre 1829, où il alla, avec un de ses camarades de collège, entendre Guillaume Tell à l’Opéra. Il revoit le rideau qui se lève sur le chœur Quel jour serein pour nous s’apprête! Il croit entendre encore l’exquise romance du pêcheur, Accours dans ma nacelle! puis le foudroyant appel de Guillaume: Il chante et l’Helvétie pleure sa liberté! Et le lendemain, il écrit:
Doux et lointain souvenir! Il y a de cela cinquante-huit ans. Depuis longues années, je n’entends plus d’autre musique que celle de mes rossignols et de mes cigales. Mais souvent, le soir, dans ce demi-sommeil où l’âme se détache des choses présentes, où ne veillent plus que les songes, j’évoque ces images du passé. Plongé dans mon vieux fauteuil, je me chante à moi-même, sans ouvrir la bouche, ces airs, ces duos, ces cantilènes, dont se berça ma jeunesse. On me croit endormi, tandis que défilent devant moi les créations pathétiques ou riantes, tragiques ou bouffonnes, mais toujours mélodieuses, de Rossini, de ses émules et de ses meilleurs disciples: Sémiramide et Desdemona, Ninetta et Rosine, Assur et Otello, Figaro et don Magnifico, Edgardo et Lucia, Norina et don Pasquale, Elvino et Amina, Alice et Robert, Valentine et Raoul, Fidès et Sélika; et, avec eux, leurs interprètes, Rubini et Lablache, Ronconi et Mario, Tamburini et Julia Grisi, Mme Malibran et sa sœur Pauline Viardot, Garcia et Alboni. Si la musique était belle, les auditoires n’étaient pas moins beaux. Où sont-elles, les célébrités de l’élégance, de l’art, de la poésie, du théâtre, du[442] blason, de la richesse? Dans quelle nécropole faut-il les chercher? Les robes de soie et de velours sont devenues des suaires; les figures sont des fantômes, les fantômes sont des spectres, les spectres sont des squelettes, les squelettes sont des ombres. C’est à peine si les petites-filles savent les noms de leurs aïeules, qui inspirèrent les poètes, les romanciers et les artistes, qui eurent elles-mêmes leurs romans, qui firent battre les cœurs des dandys les plus éblouissants, des plus brillants officiers de la garde royale et de l’armée, et qui constellaient les loges de leur beauté, de leurs sourires. Où sont les fleurs de leur corsage, les diamants et les perles de leurs colliers? O vanité! ô néant! C’est triste; ce serait lugubre et navrant, si, au bout de ces mélodies profanes, on ne récitait un Pater et un Ave, si, après ces litanies mondaines, on ne répétait les véritables: «Rosa mystica! Rose mystique, qui fleurit dans le ciel, et ne se fanera jamais! Stella matutina! Étoile du matin, d’un matin qui n’aura pas de soir, d’un jour qui n’aura pas de nuit[455]!»
II
Pontmartin avait soixante-sept ans quand il se retira ainsi aux Angles. L’âge est venu, mais non la paresse de la vieillesse, celle dont Tacite a dit: Invisa primum desidia postremo amatur. Avec une régularité plus grande encore que par le passé, il enverra à la Gazette de France sa causerie hebdomadaire. S’il lui arrive parfois d’avoir une heure de découragement, ce ne sont pas seulement ses amis les plus anciens, ses vieux coreligionnaires et à leur tête Léopold de Gaillard, qui lui demandent[443] de ne pas interrompre ses Semaines littéraires; c’est Cuvillier-Fleury, qui lui écrit: «Non, vous ne renoncerez pas à cette tribune littéraire, bien souvent politique de la Gazette, où vous vous honorez si grandement par le talent, la vivacité et la sincérité de l’esprit, l’originalité souvent familière, toujours spirituelle[456].» Et Cuvillier-Fleury ajoutait, à propos d’un article de Pontmartin en réponse à une attaque de M. Émile Zola[457]: «Vous avez traité Zola avec une douceur féline qui a dû faire sortir toutes ses griffes, suaviter in modo, fortiter in re. Voilà le Figaro qui vous complimente après vous avoir immolé. C’est le Capitole après la Roche Tarpéienne. N’importe, j’aime mieux cela.[444] On vous a beaucoup lu, et on a beaucoup admiré cette grande possession que vous avez montrée de vous-même. On attendait de vous un éreintement de première grandeur; vous avez préféré un enterrement de première classe.»
C’est précisément parce que la Gazette de France était une tribune politique, ainsi que l’écrivait Cuvillier-Fleury, que Pontmartin ne pouvait pas, ne voulait pas la déserter. Il combat la République depuis le jour où elle est née; il la combattra jusqu’à la fin. Il continuera donc de parler encore littérature, roman, poésie, mais à la condition de terminer chacun de ses articles par un mot, par un cri, toujours le même: Delenda est res... punica. Même quand la République se présente sous des apparences modérées, il refuse d’être dupe; ni la houlette et la panetière, dont parfois elle s’affuble, ne le trompent, et sous le déguisement de ce faux berger il a vite reconnu Guillot le sycophante. Quand des Religieux, comme le Père Didon ou le Père Maumus, prêchent le ralliement et annoncent le prochain avènement d’une République chrétienne, il leur répond:
C’est là un beau rêve, qui pourrait être, au besoin, contresigné par M. de La Palice, mais c’est un rêve. La République ressemble à ces vins frelatés qui s’aigrissent en vieillissant... L’expérience prouve que la République est forcée de marcher toujours, soit à reculons, pour refluer vers la dictature, soit en avant pour verser dans le radicalisme et le jacobinisme. Je me souviens d’une très amusante pièce de M. Labiche, où Hyacinthe jouait le rôle d’un fabricant de bougies de l’Aurore boréale. On lui faisait[445] observer que ses bougies coulaient et n’éclairaient pas.—«Si elles éclairaient et ne coulaient pas, répliquait-il avec un sang-froid superbe, elles ne seraient pas de l’Aurore boréale.»—Si la République pouvait se fixer dans un programme d’amabilité, d’honnêteté, de modération, d’équité, de tolérance, de libéralisme sincère, elle ne serait pas la République[458].
De telles pages, on en rencontre à chaque instant dans les Causeries de Pontmartin, et c’est pourquoi, bien loin d’avoir vieilli, elles sont plus actuelles que jamais.
De Semaine en Semaine, il semblait rajeunir, et ses amis, en présence de ce perpétuel jaillissement d’esprit et de talent, ne pouvaient croire qu’il eût définitivement renoncé à toute idée de retour à Paris. Pour ma part, toutes les fois qu’il m’arrivait d’y aller, je le suppliais de venir m’y rejoindre. Toujours charmantes, ses réponses étaient toujours négatives. Telle, par exemple, cette lettre du 21 avril 1880:
...Je n’ai pas le courage de me décider. Tout à l’heure, je me promenais seul dans mon allée de marronniers où je voudrais tant me promener avec vous. Je pesais le pour et le contre de ce voyage: d’un côté, le plaisir de rentrer un moment dans la vie littéraire, de retrouver quelques figures amies, de m’asseoir dans un fauteuil d’orchestre du Théâtre-Français, de faire quelques visites au Salon, dont je ne rends plus compte; de l’autre, la nuit en chemin de fer, la chance de tomber malade dans un hôtel comme en 1877, la difficulté de se procurer tous ces petits détails de[446] bien-être et de chez soi, dont on ne s’aperçoit que quand ils vous manquent. J’étais exactement comme l’âne de Buridan entre deux bottes de chardons d’égale grosseur. Tout à coup, j’ai entendu le premier rossignol de l’année, qui commençait sa mélodieuse chanson dans un massif d’érables; ce n’est rien, et pourtant le gazouillement de ce petit oiseau m’a presque décidé au parti le plus sage, c’est-à-dire le plus sédentaire. Ne vous semble-t-il pas qu’un poète pourrait rimer là-dessus quelques jolies stances ou un sonnet presque sans défauts? Mais la poésie, c’est la jeunesse; la jeunesse, c’est le vrai printemps; ce rossignol, dont j’ai probablement entendu chanter les ancêtres les plus lointains, n’avait pour moi que le charme mélancolique d’un fugitif retour au passé[459].
L’année suivante, je revenais à la charge, mais sans plus de succès. Il me répondait, le 7 novembre 1881: «Vous me demandez si je n’ai pas idée d’aller à Paris au mois de décembre. Hélas! j’ai l’idée contraire. Il ne faut pas que la surabondance de mes écritures vous fasse illusion sur mon âge et sur ma santé. Et puis, décembre est bien froid ou bien humide, avec des jours bien courts, des rues bien boueuses et des boulevards bien bruyants. Bizarre contraste! Le sage Biré m’engage à venir à Paris, et Ludovic Halévy, l’auteur d’Orphée aux Enfers, le boulevardier par excellence, m’écrivant pour me remercier d’un article, ajoutait récemment: ‘Ne venez pas à Paris! Vous ne le reconnaîtriez pas. Il n’est plus digne de vous.’»
S’il ne va plus à Paris, il y enverra du moins ses volumes, à raison de deux par an. En 1879, il publia la dix-septième et la dix-huitième série des Nouveaux Samedis; en 1880, la dix-neuvième et la vingtième.
Ce tome XX des Nouveaux Samedis n’était rien moins que le vingt-neuvième volume des Causeries. «Si nous adoptions un nouveau titre?» lui écrivit son éditeur, M. Calmann-Lévy. Pontmartin, légèrement piqué, proposa, un peu ab irato: Souvenirs posthumes, ou Causeries posthumes. Au fond, M. Calmann-Lévy avait raison, et, d’un commun accord, on adopta, pour les séries futures, le titre de Souvenirs d’un vieux critique.
Le premier volume des Souvenirs parut au mois de juillet 1881, avec cette dédicace:
A
MA CHÈRE FILLE
JEANNE D’HONORATI
VICOMTESSE HENRI DE PONTMARTIN
HOMMAGE
DE RECONNAISSANCE ET DE TENDRESSE
A. DE PONTMARTIN.
Le mariage de son fils avait eu lieu le 27 avril précédent. En me l’annonçant, le 16 avril, il terminait ainsi sa lettre: «Je vous embrasse de cœur dans toute l’effusion d’une honnête joie.»
III
Bien des fois, je l’avais engagé à écrire ses Mémoires. Il me répondait que ses vrais Mémoires, les seuls qu’il pût avoir la prétention de publier, il les écrivait au jour le jour dans ses Causeries. Tel était aussi, du reste, l’avis de Cuvillier-Fleury, qui, dans une lettre du 3 mai 1880, lui disait: «Vos feuilletons prennent figure de mémoires «pour servir à l’histoire de notre temps», presque aussi politiques que ceux de M. Guizot, et plus mêlés de littérature, de souvenirs personnels et de commérages friands. On les savoure et on en garde le goût comme d’un mets délicatement épicé. Tout est là, être délicat dans un siècle qui ne l’est plus.»
Un jour vint cependant où, se trouvant de loisir,—c’était au mois d’août 1881,—il prit une belle feuille de papier, inscrivit en tête ces deux mots: MES MEMOIRES, écrivit d’un trait le premier chapitre et l’envoya au Correspondant[460]. Au bout de quatre ou cinq mois, le volume était fait et conduisait le lecteur jusqu’à l’année 1832.
Critique, Pontmartin avait eu à juger les Mémoires et les Confidences de nos illustres, Chateaubriand, Lamartine, Alexandre Dumas, George Sand,[449] et il ne s’était pas fait faute de condamner chez eux l’abus de la personnalité, ces complaisances du Moi, qui les avaient conduits à entretenir le public de tout ce qu’ils avaient fait depuis le berceau, de leurs enfantillages, de leurs espiègleries, de leurs bonnes fortunes, de leur mérite, de leur vertu, de leur talent. Il ne les imitera donc pas; mais,
Souvent la peur d’un mal entraîne dans un autre.
Comme il est bien décidé à ne point se poser en héros de sa propre histoire; comme il s’efforce de se dégager de toute préoccupation d’amour-propre, il arrive qu’il s’en dégage trop. Il semble qu’il éprouve surtout le besoin de ne pas se grandir, de diminuer sa personne et ses succès. Au lieu de chercher seulement en lui-même les éléments d’intérêt, il les cherche volontiers ailleurs, et il est ainsi conduit à ne pas serrer la réalité d’assez près, à substituer son imagination à sa mémoire et à romancer ses souvenirs. Obligé de faire le départ de ce qui est exact et de ce qui a cessé de l’être, le lecteur, dépaysé, perd confiance, résiste à son plaisir et ne goûte plus, comme il le faudrait, tant de pages charmantes, où la modestie la plus sincère se relève de l’esprit le plus piquant.
Pontmartin avait terminé la préface de ce premier volume, en disant: «Je commence, au risque, hélas! de ne jamais finir.» Ce fut seulement quatre ans après, en 1885, qu’il se décida à donner[450] la suite: MES MÉMOIRES. SECONDE JEUNESSE[461].
Ce nouveau volume allait de 1832 à 1845, du retour à Avignon au départ pour Paris. Il renfermait, sur Berryer, un chapitre qui ne laissa pas de surprendre. Pontmartin autrefois, en 1837 et 1839, avait très bien parlé du grand orateur[462]. Plus tard, en 1869, sans renier sa première admiration, il avait atténué ses louanges et élevé quelques chicanes[463]. Cette fois, son jugement était d’une sévérité qui allait jusqu’à l’injustice. D’où était venu ce changement? Dans ce chapitre même, avec une entière franchise, avec cette bonne foi dont il ne se départait jamais, il en donnait la raison. Tandis que de grands artistes, des écrivains célèbres, des hommes d’État plus ou moins étrangers à la cause royaliste, Meyerbeer, Eugène Delacroix, Paul Delaroche, Berlioz, Molé, Cousin, Guizot, Villemain, Dupanloup, Montalembert, lui prodiguaient des marques de sympathie, Berryer le traitait en inconnu[464]. Le grief était mince et ne justifiait guère ces représailles contre le chef du parti que lui-même avait si persévéramment et si noblement servi, contre celui que Jules Janin avait si bien défini un jour: «Cet admirable et charmant Berryer[465].»
Je ne cachai pas à Pontmartin ma tristesse et[451] ma désapprobation. Je le suppliai de ne pas reproduire dans le volume les pages publiées dans le Correspondant[466], ou tout au moins de les modifier. Il me le promit. A quelques jours de là, parut une réplique de M. Charles de Lacombe[467]: elle eut pour résultat de décider Pontmartin à maintenir son premier texte. Il le fit suivre, dans son volume, d’une note ainsi conçue:
Cédant aux instances de mon ami Edmond Biré, j’allais retoucher, atténuer, adoucir, abréger ce chapitre, lorsque le Correspondant a publié le beau travail de mon éminent confrère et ami, Charles de Lacombe. Sans nul doute, ce travail, où Charles de Lacombe réfute la plupart de mes récits, paraîtra bientôt en volume. Dès lors, je craindrais de lui jouer un mauvais tour en supprimant les détails contre lesquels il proteste. Il aurait trop l’air de s’agiter dans le vide... J’ajoute que, bien différent des plaideurs ordinaires, je désire avoir tort.
Il avait tort très certainement. Encore un peu de temps, et il le reconnaîtra. Il confessera son erreur avec une générosité de cœur, avec une noblesse d’âme, qui ne laisseront rien subsister de la faute commise. En 1888, rendant compte, précisément dans le Correspondant[468], d’un livre où j’avais longuement parlé de Berryer, il écrira ces quelques lignes:
Le cœur! l’âme! qui en eut plus que Berryer, soit qu’il traitât à la tribune de la Chambre une question d’honneur ou d’intérêt national, soit qu’il plaidât un procès politique,[452] soit que, devant la cour d’assises, il se fît le défenseur d’accusés dont la tête était en jeu? Le cœur, l’âme, la conviction, la conscience, les plus nobles facultés qui puissent faire de la parole humaine, non pas un instrument merveilleux sous les doigts magiques d’un Thalberg ou d’un Paganini, mais l’expression d’un sentiment supérieur à toute pensée vulgaire, et en quelque sorte une délégation divine! N’a-t-il pas eu, en maintes circonstances, le droit de s’écrier: «Eh mon Dieu! on parle de fascination, de talent... Savez-vous ce que c’est que le talent pour un honnête homme? C’est d’étudier, c’est de sentir, c’est d’exprimer avec vérité ce qu’il a dans son cœur... Quand on sait rendre cela avec une émotion vraie, on est éloquent, on a du talent, et quelquefois on parvient à faire triompher la vérité dont on est convaincu.»
Berryer a porté bonheur à Edmond Biré. Pour ma part, je lui dois un remerciement. Son livre me fournit l’occasion de faire amende honorable à une illustre mémoire; de réparer les malencontreuses chicanes que m’avaient suggérées de misérables griefs personnels, aujourd’hui perdus comme des grains de poussière dans un rayon de soleil. Eh! n’est-ce pas le soleil ou plutôt l’immortelle lumière qui se lève lorsque toutes les autres s’éteignent[469]?
La rédaction de ses deux volumes de Mémoires n’avait pas interrompu ses Semaines littéraires. De 1881 à 1887, il publia huit volumes des Souvenirs d’un vieux critique. Il allait être bientôt octogénaire, et sa verve, son entrain ne faiblissaient pas. Décidément, Henri Lavedan avait eu raison de dire en 1879: «Vieux! il ne le deviendra jamais! Ce n’est pas fait pour lui...» Ses lecteurs étaient surpris autant que charmés de cette jeunesse sans[453] cesse renouvelée. Cuvillier-Fleury lui écrivait, le 30 mai 1883: «J’envie de plus en plus, quoique j’en profite tous les huit jours, cette jeunesse persistante de votre plume dont vos adversaires vous savent sans doute moins de gré...»
Un autre académicien, M. Camille Rousset, l’historien de Louvois, lui écrivait, de son côté, le 7 avril 1885: «Comment faites-vous, admirable magicien, pour rester toujours aussi jeune? En vérité, votre plume n’a jamais été plus vive, plus alerte, plus gracieuse et, dans l’occasion, plus acérée. Assurément, vous ne vous êtes pas donné au diable; mais à coup sûr, vous lui avez arraché le secret de Jouvence. Je vous en félicite et j’applaudis à votre bonne fortune qui devient celle de vos lecteurs.»—Il lui écrira encore, le 15 juillet 1889: «Vos deux articles sont magnifiques, pleins de choses, pleins d’idées, surtout pleins de cœur. Quelle variété! quelle verve! quel entrain! quelle jeunesse!»
IV
«J’ai commencé ce matin l’article numéro mille[470], auquel je désespérais d’atteindre; après quoi, nous verrons si je dois me reposer, ou continuer mon radotage sénile...» Ainsi m’écrivait[454] Pontmartin, le 31 janvier 1887. Comme il était toujours en avance à la Gazette, l’article ne fut publié que le dimanche 24 avril[471]. Il s’était amusé à en disposer ainsi l’en-tête:
M
| 1,000 | Mille |
J’ai mis dans le mille.
(Pomadour—Eugène Labiche.—29 degrés à l’ombre.)
Le jour même où paraissait le millième article, l’Ermite des Angles voyait entrer dans son salon deux rédacteurs de la Gazette de France, M. Louis de La Roque et M. Henri Poussel, qui venaient, au nom de M. Gustave Janicot et de son journal, lui offrir un encrier d’honneur. MM. de La Roque et Poussel s’étaient adjoint, pour remplir leur mission, deux vieux amis du vieux critique, le poète Roumanille[472] et M. Augustin Canron[473],[455] l’un des plus anciens journalistes de province.
En termes émus, M. de La Roque exprima les sentiments de M. Janicot et de ses collaborateurs envers le maître qui, depuis près de vingt-cinq ans, n’avait pas cessé de donner à tous l’exemple du travail; qui, depuis un quart de siècle, avait toujours été à la peine, et aussi, grâce au ciel, à l’honneur. «C’est l’amitié, dit-il en terminant, qui, en ce jour, rend hommage au talent, au caractère et à la fidélité.»
Pontmartin remercia par de touchantes paroles; puis, tout émerveillé, lui, l’infatigable écrivain que l’encre avait si souvent grisé, il se prit à contempler, avec une joie d’enfant, le magnifique encrier qui allait être désormais le sien.
Le sujet allégorique de cette belle pièce, en argent ciselé, représente une urne renversée sur laquelle s’appuient deux Amours et d’où s’échappe une nappe d’eau coulant dans une vasque, ornée de deux cartouches style Louis XV. Sur celui de droite, on lit l’inscription suivante: «La Gazette de France à Pontmartin, 24 avril 1887», et sur celui de gauche se trouvent gravées les armoiries de sa famille, qui sont: d’azur à une porte coulissée et renversée d’argent, mouvante du côté droit de l’écu et accompagnée d’un lion d’or armé, lampassé et couronné de gueules.
Cette fête du Millième avait eu un caractère intime. Dans les départements de la région du Sud-Est, où l’écrivain comptait tant d’admirateurs et d’amis, on décida de faire en son honneur une manifestation d’un caractère plus général et qui serait, d’ailleurs, exclusivement littéraire. L’Union de Vaucluse et les principales feuilles du Midi ouvrirent une souscription dont les fonds devaient être consacrés à l’exécution de deux bustes de M. de Pontmartin: l’un, en marbre, qui lui serait offert; l’autre, en bronze, qui serait placé dans le Musée d’Avignon.
Plusieurs journaux de Paris, de ceux-là mêmes qui combattaient les opinions de l’auteur des Samedis, envoyèrent leur adhésion. Sous ce titre: les Noces d’or de M. de Pontmartin, Francisque Sarcey rendit un complet hommage à son caractère et à son talent. «Ce n’est pas peu de chose, écrivait-il, d’avoir durant tant d’années dirigé l’opinion d’une foule d’honnêtes gens, d’avoir toujours témoigné[457] d’une justice, au moins relative, même envers des adversaires, d’avoir toujours respecté sa plume, aimé les lettres, et de se trouver encore, à l’âge où l’on a depuis longtemps pris sa retraite, à la tête du mouvement, entouré de la considération et de la sympathie universelles.»
En publiant, le 31 juillet 1887, sa première liste de souscription, l’Union de Vaucluse la faisait précéder de la lettre suivante, écrite au nom de Mgr Vigne, archevêque d’Avignon:
Cher monsieur,
Mgr l’archevêque me confie l’agréable mission de vous transmettre sa souscription au buste de notre cher et illustre compatriote, M. le comte Armand de Pontmartin, et de féliciter en même temps, en son nom, ceux qui ont eu l’inspiration et pris l’initiative d’élever un monument à la gloire de notre éminent critique.
Cet hommage ne s’adresse pas seulement à l’écrivain distingué dont l’incomparable talent a jeté un si vif éclat sur la littérature française, mais encore à l’homme de caractère et de cœur qui, constamment fidèle à toutes les grandes et saintes causes, n’a jamais cherché le succès que dans le culte de la religion, unique source du vrai, du bien et du beau, sans jamais rien demander à ces moyens dont tant d’autres abusent, et que sa plume éloquente et vengeresse flétrissait hier encore avec une si énergique indignation. A ce titre, votre entreprise doit trouver de l’écho dans toutes les âmes qui veulent honorer le talent et la vertu, et je lui souhaite un plein succès.
Veuillez agréer, cher monsieur, l’assurance de mes sentiments bien respectueux et dévoués.
L. Plautin,
Vic.-gén., secr. de Mgr l’archevêque d’Avignon.
Les souscripteurs atteignirent bientôt le chiffre de 580. Les fonds versés s’élevèrent à 6,768 fr. 25, somme qui dépassait de beaucoup celle demandée par le sculpteur.
Sur les listes, à côté du Chef de la Maison de France, Monseigneur le comte de Paris, figuraient de hauts dignitaires de l’Église, des académiciens, des notabilités de tout genre, et, auprès des principaux représentants de l’aristocratie, des commerçants et des industriels, des ouvriers de la ville et de la campagne.
On trouvera plus loin[474] les noms de tous les souscripteurs. Signaler ici les uns et laisser les autres dans l’ombre, serait mal répondre au sentiment éprouvé par Pontmartin: les témoignages de sympathie auxquels il se montra le plus sensible furent ceux qui lui venaient des petits et des humbles.
Beaucoup de souscripteurs accompagnaient leur cotisation dune lettre d’envoi; plusieurs de ces lettres méritent d’être reproduites.
Mgr de Dreux-Brézé, évêque de Moulins, faisait suivre son offrande de ces lignes:
Bien faible tribut des constantes sympathies de l’évêque de Moulins pour son ancien condisciple Pontmartin, alors concurrent désespérant, et depuis passé maître en tous les styles, hormis les styles académique et ennuyeux.
M. de Belcastel, l’ancien et vaillant député de[459] la Haute-Garonne à l’Assemblée nationale de 1871, écrivait:
N’étant pas à Toulouse lorsque le Messager de cette ville a ouvert sa petite souscription pour le buste de votre grand écrivain, Armand de Pontmartin, je n’ai pas eu l’occasion d’y prendre part. Mais j’aurais un trop vif regret de ne pas m’inscrire au nombre des admirateurs de ce beau talent, qui a tout à la fois la grâce des fleurs de la Provence, la force, la santé et la longévité du vieux chêne gaulois...
Voici quelques lettres d’académiciens.
De M. Edmond Rousse:
Le nom de M. de Pontmartin est assurément un de ceux qui honorent le plus la littérature de notre temps. Sa vie est un bel exemple de probité littéraire; et son œuvre atteste, avec le talent de l’écrivain, le courage de l’homme et du citoyen. Je suis très heureux de joindre mon modeste hommage à tous les témoignages d’estime et de respect dont les amis des lettres doivent entourer ce grand homme de bien.
De M. Désiré Nisard:
Je m’associe de grand cœur au sentiment qui a inspiré le projet d’offrir à M. de Pontmartin son buste en marbre comme un juste hommage rendu au talent, à la vieillesse si verte et si féconde, au caractère si honorable de l’illustre écrivain.
De M. Émile Ollivier:
Monsieur, j’éprouve pour la personne de Pontmartin une sympathie cordiale et bien ancienne, puisqu’elle date des réunions de 1849, chez Joseph d’Ortigue. J’admire son talent souple, varié, à la fois charmant et élevé, embaumé de poésie et, à l’occasion, vibrant d’éloquence, et dans lequel la pointe malicieuse n’est que la bonne humeur d’un esprit[460] sain, ou la mise en relief du bon sens, et non l’échappée d’une âme maligne.
J’aurais voulu contribuer à le faire un de nos confrères à l’Académie. C’est vous dire que j’approuve fort la souscription dont vous avez pris l’initiative, et que je m’y associe avec empressement.
Frédéric Mistral, qui est à lui seul toute une Académie, écrivait de Maillane:
GLORI A PONTMARTIN!
Pontmartin,—et ce n’était pas l’un de ses moindres titres d’honneur,—avait toujours défendu la Compagnie de Jésus. Un jésuite, le Père Victor Delaporte[475], le poète des Récits et Légendes, à défaut d’autre obole, lui envoya ce sonnet:
A L’ENCRIER DES 1000 ARTICLES
Encrier idéal, source de maint volume,
Fontaine de Vaucluse à la noire liqueur,
Le Maître, avec tes flots qui coulent de sa plume,
Laisse couler à flots son esprit et son cœur.
Tu bouillonnes toujours et tu n’as point d’écume;
Le Maître, juge, arbitre, artiste, chroniqueur,
Puise en ta profondeur claire et sans amertume
[461]Son style ferme et franc—malin, mais non moqueur.
Sous ses doigts l’encre tombe en gouttes de lumière,
Faisant éclore au jour toute fleur printanière,
Reflétant à la fois l’or et l’azur du ciel;
Qu’on grave sur tes flancs, merveilleuse écritoire,
Pour éloge, ou devise unique dans l’histoire:
Cinquante ans de critique! et... pas un jour de fiel.
Le vieux critique pouvait être fier de ces témoignages de sympathie. Il en fut surtout très heureux, et, pour remercier les souscripteurs, il adressa la lettre suivante au Directeur de la Gazette de France:
Mon cher ami,
Au moment où va se clore une souscription pour laquelle j’avais redouté un four, avec d’autant plus de vraisemblance que je posais devant mon artiste avec une chaleur de 38°, et qu’avant d’être fondu en bronze, je fondais en sueur, j’ai recours à la Gazette de France pour adresser mes remerciements à qui de droit.
A vous d’abord, et à la Gazette. On prétend que le contenant doit être plus grand que le contenu. Cette fois, ç’a été le contraire. Le buste était contenu dans l’encrier. C’est l’encrier qui a donné à mes amis de Provence l’idée dont ils ont poursuivi l’exécution avec un merveilleux entrain.
A Léopold de Gaillard, qui, dans une page charmante où il lançait l’affaire, a prouvé que l’amitié ressemblait à nos vins de France, d’autant plus généreux qu’ils sont moins jeunes.
Au Prince auguste que sa haute intelligence, son patriotisme,[462] son âme essentiellement française, élèvent au niveau de toutes les fortunes, depuis l’exil présent jusqu’au trône prochain.
A nos saints et vénérables Évêques, qui, au lieu de m’accueillir à coups de crosse, m’ont donné leur bénédiction.
Aux membres éminents de l’Académie française, qui ont voté pour moi sous forme de souscription, et que je ne pourrais remercier dignement que si j’avais de l’esprit comme quatre.
A mon éditeur Calmann-Lévy, qui a tenu à prouver que je ne l’avais pas ruiné.
Aux grandes dames, qui ont un moment abandonné en ma faveur les romans de M. Zola.
A tous mes amis, connus ou inconnus, lointains ou voisins, à qui je suis obligé d’adresser l’expression collective de ma reconnaissance, en ajoutant que chacun en a sa part, et que tous l’ont tout entière.
Mais surtout, et du fond du cœur, à ceux qui, moins riches de numéraire que de nobles sentiments et de dévouement invincible à toutes les bonnes causes, ont prélevé sur leur nécessaire pour donner un témoignage de sympathie au vieillard dont le seul mérite est de ne pas être tout à fait mort,—et de persévérer.
Si j’avais douze ou quinze ans de moins, je dirais que ces témoignages doivent m’encourager à mieux faire. Mais, à mon âge, quel mieux peut-on demander et attendre? Un seul: le silence, et vous ne le voulez pas.
Encore une fois merci, mon cher ami, tout à vous et à nos excellents collaborateurs.
Armand de Pontmartin.
Les Angles, 11 septembre 1887.
Le buste en marbre, œuvre de M. Bastet, fut remis à Pontmartin; le buste en bronze, fondu à Paris dans les ateliers de M. Thiébault, fut déposée[463] au Musée Calvet, à Avignon. L’excédent des recettes sur les dépenses ayant été de 2109 francs, ce reliquat, suivant le désir exprimé par Pontmartin, fut versé à Mgr Vigne pour des œuvres de bienfaisance.
V
Rarement hommage fut plus mérité que celui qui venait d’être rendu à Pontmartin.
Son œuvre critique était la plus considérable du siècle. Elle se composait, à ce moment, de trente-sept volumes[476], que cinq autres bientôt allaient suivre[477]; soit, en tout, quarante-deux volumes. En voyant ainsi, d’année en année, croître son œuvre, Pontmartin ne songeait nullement à répéter l’Exegi monumentum d’Horace, mais il se croyait le droit de lui appliquer le Vires acquirit eundo de son cher Virgile: «Je sens, m’écrivait-il le 28 juin 1868, que mes volumes de Causeries littéraires gagnent, à se multiplier, une sorte de valeur indépendante de leur mérite.»
Pendant plus d’un demi-siècle, Pontmartin a parlé de tous les écrivains et de tous les livres de son temps, non comme un bibliographe, non pas[464] même comme un critique de profession, mais comme un homme du monde, très mêlé au mouvement littéraire, et qui, sans avoir l’air d’y toucher, ajoute chaque semaine un chapitre à ses Mémoires—et à ceux du voisin. «S’il me fallait chercher dans le passé des comparaisons ou plutôt des analogies, dit très bien M. Léopold de Gaillard, je songerais à une sorte de Saint-Simon homme de lettres, vivant au milieu des auteurs comme l’autre vivait au milieu des courtisans, mêlé à tout, connaissant tout, racontant tout par le menu, non certes sans malice, ni sans parti pris, ni même sans une certaine pointe d’aristocratie, mais avec la bonne foi visible de la passion, avec une verve infatigable, et pour ses lecteurs avec l’heureuse surprise d’un esprit toujours en scène, et qui n’a pas l’air de s’en douter[478].»
Quarante-deux volumes d’extraits et de comptes rendus, c’est beaucoup, dira-t-on; j’ajoute, pour ma part, que ce serait trop, beaucoup trop. Mais les feuilletons de Pontmartin ne sont pas des extraits; il n’oublie jamais qu’il est un causeur, et un causeur, dans son salon, n’a pas un livre à la main et ne fait pas de citations. Ce ne sont pas non plus des comptes rendus, à proprement parler. Sans doute il a lu avec soin l’ouvrage dont il veut entretenir ceux qui l’écoutent; mais, sa lecture faite et le volume fermé, il ne l’analyse pas, ou très rarement; il en prend texte seulement pour développer[465] à son tour les idées que le sujet lui suggère. L’auteur lui a fourni le libretto, il se charge d’écrire la musique.
Combien de fois ne lui arrive-t-il pas, surtout lorsqu’il lui faut parler d’un roman, de le reprendre en sous-œuvre et d’ajouter au canevas des broderies nouvelles! A propos du roman par lettres de Mme Caro—Nouvelles amours de Hermann et de Dorothée,—il écrit: «J’en veux à l’auteur d’avoir manqué un délicieux sujet, où nos patriotiques rancunes auraient pu rencontrer un commencement de revanche. Ce sujet, voici, selon moi, comment elle aurait dû le traiter.» Et, en un tour de main, l’auteur et son roman se trouvent refaits[479].
La Veuve est un des meilleurs récits d’Octave Feuillet, Pontmartin ne lui ménage pas les éloges. Les dernières pages cependant n’ont pas laissé de le choquer. Un autre critique se fût borné à donner ses raisons, à motiver son jugement. Il fera mieux; il propose une variante, il imagine un autre dénouement[480].
Dans un de ses premiers romans, Mensonges, Paul Bourget avait développé avec succès toutes les délicatesses, toutes les subtilités de l’analyse psychologique; mais il y avait mêlé des peintures sensuelles, des pages où la psychologie se faisait plastique. Et Pontmartin de se demander: «Était-il donc impossible d’écrire un roman complètement[466] chaste avec le sujet choisi par M. Paul Bourget? Essayons.» Il essaie, et à la toile du jeune maître il apporte d’heureuses retouches[481].
Un autre jour, ayant à parler des Maximes de la vie, par Mme la comtesse Diane[482], il prend deux ou trois de ces maximes et il les illustre par des exemples, par deux ou trois saynètes du tour le plus piquant[483].
C’est ainsi qu’avec lui la critique est souvent une véritable création.
Ses confrères, même les plus justement célèbres, n’ont qu’un cadre, toujours le même, qui sert pour tous leurs articles. Rien de plus varié, au contraire, que les cadres de Pontmartin.
Une femme d’infiniment d’esprit, la comtesse de Boigne, publie en 1866 un roman—une Passion dans le grand monde—qu’elle avait composé... en 1816. L’article de Pontmartin revêt la forme d’une lettre à M. l’abbé de Féletz, à Paris, lettre datée du 12 janvier 1817, et qui dut faire les délices du très spirituel abbé, alors rédacteur au Journal des Débats, en attendant l’Académie française[484].—A-t-il à parler d’un poète, de François Coppée ou de Paul Déroulède, il écrit sa causerie en vers[485]. A propos de la Sorcière, de Michelet, il nous transporte sur une des cimes du Brocken,[467] avec une décoration dans le genre de celle de la fonte des balles, de Freyschütz, et il nous fait assister à un Ballet sur balai, moitié vers, moitié prose[486]. Ailleurs, à l’occasion du Lycée Condorcet (tour à tour Bonaparte, Bourbon, Fontanes, re-bonaparte, etc.), nous avons, non plus un ballet fantastique, mais de vraies scènes de comédie[487]. Jamais Lycée de la République ne s’était trouvé à pareille fête, et ce n’est pas ce jour-là qu’on aurait pu dire:
L’ennui naquit un jour... de l’Université.
Les Causeries ne renferment pas moins de neuf ou dix articles sur les romans de M. Zola. «Comment faites-vous, demandait-on à un vieux journaliste, pour faire votre article tous les jours? Quel est donc votre secret?—Mon secret est bien simple. Il tient en quatre mots: dire, redire, se contredire.» Pontmartin, dans ses dix articles sur Zola, ne se répète pas; encore moins, se contredit-il; seulement, sur ce fond invariable, il applique sans cesse une forme nouvelle. Tantôt, à propos d’Une page d’amour, pour ébrancher, ou plutôt pour couper par le pied l’arbre généalogique des Rougon-Macquart, le chevalier Tancrède déroule sur le tapis du salon l’arbre généalogique des Bougon-Jobard et en détaille toutes les beautés[488].[468] C’est de la parodie, mais c’est aussi de la critique, et de la meilleure. Tantôt, il commence un éloquent article sur Nana—Nana partout—par une désopilante fantaisie sur le naturalisme et la réclame, sur la ronde des affiches remplaçant celle du sabbat[489]. Une autre fois, quand M. Zola met en pièce le plus fameux de ses romans, Pontmartin nous raconte la première de l’Assommoir sur le Grand-Théâtre d’Athènes, et c’est merveille de voir quelle exquise poésie il a su extraire de l’argot de Coupeau et de Bibi-la-Grillade, et comme il a su changer le tord-boyaux de Mes-Bottes en vin de Chypre ou de Samos[490].
VI
Bayle a dit quelque part: «Combien y a-t-il de gens d’esprit qui s’ennuient à la lecture d’un ouvrage qui resserre leur imagination en la tenant toujours appliquée à un même sujet! Qui n’aime la diversité?» Ceux-là ne s’ennuieront pas avec les Causeries de Pontmartin. Où trouver plus de diversité? Diversité dans les cadres, nous venons de le voir, diversité aussi dans les sujets. D’habitude, les critiques littéraires ne parlent que des livres. Pontmartin parle de tout; il a des feuilletons sur les théâtres et sur les grandes premières; il en a sur les réceptions académiques—et ce lui est un jeu[469] de montrer que si les immortels ont, à eux tous, de l’esprit comme quarante, il a, à lui seul, de l’esprit comme quatre. A un article de critique succède un article de fantaisie: après une grande étude sur les Misérables, de Victor Hugo, vient une dramatique nouvelle intitulée le Vrai Jean Valjean[491]. A la suite de feuilletons sur les romans d’Alphonse Daudet ou de Georges Ohnet, viennent d’émouvantes pages sur les Invalides du Sanctuaire[492], l’Orphelinat d’Auteuil[493] et les Sœurs hospitalières[494].
Les autres critiques ne s’occupaient que des vers publiés à Paris. Pontmartin s’occupe volontiers des poètes restés fidèles à leur province, et en particulier de ceux qui n’ont pas voulu quitter, pour les rives de la Seine, les bords du Rhône et de la Durance, Roumanille, Mistral, Aubanel, Félix Gras, Anselme Mathieu. C’est lui qui a, dès 1854, bien avant l’apparition de Mireille, appelé l’attention sur ce réveil de la littérature provençale, qui contraste si singulièrement avec les tendances générales d’une société dont le génie centralisateur est encore secondé par la rapidité des communications, le mouvement des idées et l’inévitable abandon des mœurs, des traditions, des physionomies locales. C’est l’auteur des Causeries littéraires qui nous a fait connaître et aimer cet admirable[470] Roumanille, dont les œuvres en prose et en vers ont fait autour de lui tant de bien, ce vaillant et ce modeste qui, par ses efforts, sa persévérance, ses poésies charmantes, a créé le groupe dont, jusqu’à sa mort, il est resté le centre et d’où Mistral a pu sortir, son poème de Miréio à la main, sûr d’avoir un public et un auditoire.
Si la philosophie l’attire peu, et s’il s’obstine à trouver, ainsi qu’il le faisait au collège, qu’il y a là beaucoup de tintamarre et de brouillamini, il aborde volontiers, quand l’occasion lui en est offerte, les questions morales et religieuses. Ses articles sur les livres de Renan, et en particulier sur son volume des Apôtres[495], sont d’excellents chapitres d’apologétique chrétienne.
Romancier et poète, il a du goût pour l’histoire,—je veux dire celle de son temps et de son siècle; car, de l’histoire ancienne, il n’avait guère souci. En politique, comme en littérature, il a des principes, il a un criterium, qui lui permet de bien juger. Jeune, il avait été un carliste intransigeant, et il fût allé aisément aux extrêmes; mais les années, la leçon des événements, la connaissance des hommes, lui ont appris l’indulgence et lui ont rendu facile l’impartialité. Nul peut-être n’a mieux parlé de la monarchie de Juillet que ce légitimiste impénitent. Ses huit articles sur les Mémoires de M. Guizot[496] sont vraiment dignes de l’illustre[471] homme d’État. S’il est parfois obligé de le combattre, il n’engage avec lui qu’un duel à armes courtoises, et il met un crêpe à la poignée de son épée.
Pontmartin excelle encore dans ces études d’ensemble, dans ces portraits après décès, qu’il consacre à ceux de ses contemporains qui ont brillé dans la politique ou dans les lettres et dont la tombe vient de s’ouvrir. Il aurait suffi de les réunir en un ou deux volumes, pour avoir comme une annexe de l’Exposition des Portraits du siècle: Lamartine, Berryer, Thiers, Guizot, de Barante, Alfred de Vigny, Charles Baudelaire, Edmond About, Louis de Carné, Brizeux, Reboul, Charles de Bernard, Jules Sandeau, Mgr Dupanloup, le Père d’Alzon, François Buloz, Victor Cousin, Joseph Autran, Sainte-Beuve, Théophile Gautier, Jules Janin, Salvandy, Vitet, Saint-Marc Girardin, le baron de Larcy, Gustave Flaubert, Victor de Laprade, Alfred de Falloux, Paul de Saint-Victor, Charles de Rémusat, Villemain, Silvestre de Sacy, etc., etc.
Mais où il excelle surtout et se montre vraiment original, c’est dans ce genre qui lui est propre, qui donne un charme si particulier à ses Souvenirs d’un vieux critique, et qu’il a défini lui-même—on se le rappelle peut-être,—un genre mixte entre la critique, l’histoire intime, l’impression personnelle et le roman[497].
Rien n’égale donc la variété de ces quarante-deux volumes, de ces causeries ailées, fines, légères comme des abeilles, qui butinaient sur tous les livres, qui faisaient leur miel du suc de toutes les fleurs. Pontmartin aurait pu leur donner pour épigraphe ces vers de son poète préféré:
Illæ continuô saltus silvasque peragrant,
Purpureosque metunt flores, et flumina libant
Summa leves. Hinc nescio qua dulcedine lætæ
Progeniem nidosque fovent; hinc arte recentes
Excudunt ceras, et mella tenacia fingunt[498].
En même temps qu’une extrême variété dans les sujets et dans les cadres, les Causeries littéraires offrent un autre caractère plus rare encore et plus essentiel, l’unité. Un même souffle de spiritualisme chrétien anime ces chapitres sans nombre, où l’auteur, toujours fidèle à lui-même, n’a cessé, pendant un demi-siècle, de défendre le beau, le vrai, la vertu et le goût, la religion et la patrie. En publiant son dernier volume, au bas de la dernière page, il aurait eu le droit d’écrire: Qualis ab incepto.
Est-ce à dire que rien ne soit à critiquer dans ces Causeries? Assurément non. Soit dans le blâme, soit dans l’éloge, Pontmartin dépasse quelquefois la juste mesure. Il a ses bêtes noires: tel, par exemple, Barbey d’Aurevilly, pour lequel il se montre sans pitié. Barbey d’Aurevilly sans doute[473] eut l’impardonnable tort de vouloir fréquenter à la fois chez Joseph de Maistre et chez le marquis de Sade, de prendre l’attitude d’un ultra-catholique à l’heure même où il écrivait des contes qui relevaient de la police correctionnelle, les Diaboliques[499] et Une Histoire sans nom. Ces inconséquences, certes, il les fallait signaler; il fallait déplorer ces aberrations. Mais pourquoi ne pas reconnaître en même temps que les vingt volumes des Œuvres et des Hommes au XIXe siècle sont une œuvre maîtresse, et que notre littérature compte peu de romans aussi remarquables que l’Ensorcelée, le Chevalier Des Touches et le Prêtre marié[500]?
Trop sévère, injuste même à l’endroit de certains écrivains, Pontmartin est ailleurs d’une indulgence[474] parfois excessive. Avec ses amis (et, pour ma part, j’en sais quelque chose), il est volontiers prodigue de louanges. Les épithètes les plus flatteuses jaillissent alors de sa plume. Exquis! délicieux! charmant! balsamique! magnifique! adorable! admirable!—«Mais enfin, lui disais-je un jour, si vous donnez ainsi de l’admirable à X. et à Y. que vous restera-t-il pour caractériser les œuvres de Bossuet ou celles de Joseph de Maistre?» Pontmartin souriait: «Bah! me répondit-il, vous seriez bien attrapés, vous et quelques autres, si je n’avais toujours dans ma maison une ou deux chambres à offrir à mes amis.»
On n’écrit pas impunément quatre grands articles[475] par mois, et souvent bien davantage. Quoiqu’il en ait laissé un grand nombre en dehors de ses volumes, il en a pourtant conservé quelques-uns où la lassitude se fait sentir. Il lui arrive, en quelques rencontres, de sacrifier à l’éclat du mot la précision de la pensée, de préférer au feu qui couve et qui dure l’étincelle qui jaillit et brille un instant pour s’éteindre bientôt. Il lui arrive aussi de multiplier les épithètes, de redoubler les synonymes, de s’abandonner aux excès de sa verve et de donner à sa phrase, toujours cependant harmonieuse et pure, une ampleur démesurée.
Mais ces défauts—pouvait-il donc ne pas y en avoir dans une œuvre d’une si extraordinaire étendue?—ne sont-ils pas rachetés, et bien au delà, par tant de brillantes et durables qualités? Pontmartin a été l’un des meilleurs écrivains du XIXe siècle, l’un des plus éloquents et, en même temps, l’un des plus naturels. Le naturel, ce signe distinctif, cette grâce suprême des bonnes littératures et des œuvres dignes de vivre. Pontmartin l’avait au plus haut degré. Lui qui si facilement atteignait à l’éclat, il prisait par-dessus tout la simplicité. «Tâchez, disait-il souvent, tâchez d’être simples, sans être vulgaires.» Un bon juge, J.-J. Weiss, disait un jour: «Pontmartin est du petit nombre de ceux de notre temps qui écrivent naturellement en français.» Écrire naturellement en français, c’est peu de chose, semble-t-il, et pourtant rien n’est plus rare. Un autre bon juge, Cuvillier-Fleury, voyait également juste, quand il[476] écrivait à Pontmartin: «Ah! combien j’en ai vu mourir de jeunes et de vieilles réputations! La vôtre qui a le style vivra ce que le style vit, toujours, plus ou moins célèbre, mais toujours!
Vivunt commissi calores
Æoliæ fidibus puellæ[501]!»
VII
Les Causeries littéraires de Pontmartin ne doivent pas nous faire oublier ses romans. Dans le Correspondant du 25 octobre 1865, Victor Fournel[502] publia sur l’auteur des Samedis un article où il donnait le pas au critique sur le conteur. Pontmartin m’écrivit aussitôt:
Je veux maintenant, puisque votre amitié me tend ce piège, vous dire un mot de l’article de Victor Fournel. Assurément il y a, dans cet article, de quoi contenter dix vanités plus exigeantes que la mienne. Et cependant!... cependant de mon cœur de romancier l’orgueilleuse faiblesse eût mieux aimé peut-être voir sacrifier le critique, pourvu qu’une part un peu plus large fût faite au conteur. M. Victor Fournel, que je ne connais pas, qui ne peut pas savoir mes secrètes préférences, a suivi tout simplement l’opinion généralement adoptée par tous ceux qui veulent bien songer à moi: sous les formes les plus bienveillantes et avec de fort belles compensations, il a fait clairement entendre que, dans mon[477] bagage, la critique représente les malles, et le roman tout au plus le sac de nuit. Il ne s’est pas aperçu que, dans son système, le roman d’analyse, qui n’est souvent que de la critique animée, ne serait plus que le très humble serviteur du roman d’aventure, contre lequel nous n’avons, au contraire, cessé de protester et de réagir depuis trente ans; Eugène Sue, Alexandre Dumas, Frédéric Soulié, redeviendraient alors les souverains maîtres de ce romanesque empire d’où nous aurions à expulser les délicats, les analyseurs, tels qu’Octave Feuillet, etc., etc. Mais en voilà bien assez sur ce sujet où je devrais me récuser[503]...
Avait-il, comme il le croyait, une véritable vocation de romancier? Peut-être. Les Brûleurs de Temples, la Fin du Procès, les Jeudis de madame Charbonneau, Entre chien et loup, le Filleul de Beaumarchais ont de rares et précieuses qualités. Mais ce sont des livres mi-partie critique et mi-partie roman. La vigueur de la conception, la puissance et la fertilité de l’invention n’égalaient pas, chez Pontmartin, la finesse de l’observateur et la délicatesse de l’analyste. Il n’avait pas assez de poigne pour étreindre de fortes situations, pour soulever de lourds fardeaux. Le cadre de la nouvelle lui était plus favorable; nos meilleurs auteurs en ce genre, Nodier, Mérimée, Charles de Bernard, Jules Sandeau, ont dans leurs écrins peu de perles d’une plus belle eau que la Marquise d’Aurebonne, Aurélie et Marguerite Vidal.
Je ne finirai pas ce chapitre sans dire un mot de la Correspondance de Pontmartin.
Il écrivait ses lettres de prime-saut et avec une rapidité matérielle inouïe. Il ne soupçonnait pas d’ailleurs qu’aucun fragment pût en être jamais publié, et il n’y attachait pas plus d’importance qu’à des paroles qui volent et dont rien ne reste. Elles resteront pourtant, parce qu’elles sont les plus simples, les plus naturelles—et les plus spirituelles du monde.
Ses principaux correspondants furent Léopold de Gaillard, Joseph Autran, Cuvillier-Fleury, Victor de Laprade, Jules Claretie, la marquise de Blocqueville et la duchesse de la Roche-Guyon. Dans les dernières années de Pontmartin, la duchesse et lui s’écrivaient tous les trois jours en prose et en vers.
Les lettres à Autran, que la famille du poète a bien voulu me confier, vont de 1845 à 1875. Le châtelain de Pradine écrivait à son ami des Angles, le 23 octobre 1873:
Votre lettre, mon cher ami, est tout à la fois désolante et charmante.
Désolante, elle me donne de fâcheuses nouvelles de votre santé, et m’annonce des résolutions qui, je l’espère, ne sont pas irrévocables.
Charmante, elle est écrite dans ce style dont vous possédez seul le secret, et qui fait de vos lettres autant de perles fines. Laissez-moi vous dire quelque chose à ce propos, c’est que j’ai dernièrement recherché et retrouvé toutes celles que j’ai reçues de vous depuis l’origine de notre amitié. Je les ai réunies dans une vaste cassette, qui restera pour moi plus précieuse que la fameuse cassette d’Alexandre. Autrefois, je relisais de temps en temps les épîtres de Cicéron à Atticus. Je relirai maintenant celles d’Armand à Joseph, et l’amitié[479] ne sera pour rien dans la préférence très réelle que je leur donnerai.
La correspondance avec Cuvillier-Fleury s’étend de 1854 à 1886. «Savez-vous bien, mandait un jour à l’auteur des Samedis l’auteur des Portraits révolutionnaires, savez-vous qu’on ferait deux ou trois beaux volumes après notre mort—Dî talem avertite casum!—avec les lettres que nous échangeons depuis dix ans, vous fournissant l’esprit, moi le reportage parisien, vous la mélancolie de l’exilé, moi la fausse gaieté du citadin, celle qui court les rues, bien que je ne sorte guère de la maison; mais la rue nous arrive par tous les canaux de la publicité, par tous les bruits du boulevard qui semblent retentir dans nos solitudes suburbaines[504]...»
Un des rédacteurs du Journal des Débats, M. Ernest Bertin, a eu la bonne fortune de pouvoir lire les lettres de Pontmartin à Cuvillier-Fleury, et il ne cache pas qu’il en a été émerveillé. Il résume ainsi les impressions que lui a laissées cette lecture: «Près des lettres de Guizot j’en aperçois d’autres, rassemblées sous un cordon rose, et signées: Armand de Pontmartin! Quelle liasse volumineuse! Quelle écriture fine et serrée! Mais quelle facile et agréable lecture! C’est une heureuse fluidité de langage, qui touche à tout, en se jouant, à la politique, aux lettres, au monde, monde de Paris, monde de la province; c’est aussi une ironie brillante[480] et souple, qui tantôt s’échappe et se disperse en mille flèches légères, et pique à fleur de peau, tantôt se concentre, s’aiguise et s’enfonce en belle chair vive, avec une sorte d’allégresse cruelle; mais toujours et bientôt le sourire reparaît, la belle humeur, la gaieté, la joie du Midi surnagent. Il pense, il sent tout haut, librement, hardiment; mais il se fait pardonner ce qu’il ose, même les calembours les moins académiques, tant il y met d’abandon, de bonne grâce, d’imprévu. «Peu s’en est fallou, écrit-il à M. Cuvillier-Fleury, que je ne Montalember... cadère de la rue Saint-Lazare pour aller vous surprendre dans votre riante oasis», et son indulgent confrère reçoit cela en pleine poitrine sans crier, étant déjà aguerri par l’habitude.
«Il se moque de tout le monde et de lui-même, de lui-même un peu plus que de tout le monde, sur un ton, il est vrai, un peu différent. Il raille fort agréablement les Angles, près Avignon, où il a sa gentilhommière,—les Angles obtus, comme il date l’une de ses lettres,—les airs de grande ville affectés par ce maigre village, et lui, tout le premier, le dilettante de lettres, le critique attitré de la Gazette de France, mordu, sur le tard, de la passion des grandeurs municipales, et s’en offrant jusqu’à saturation les ineffables jouissances, organisant des courses locales, faisant épierrer et arroser la piste, signant des autorisations de buvettes, débattant le prix de location des écuries ou allant faire l’aimable chez les belles dames patronnesses d’une Société hippique fondée dans un pays qui ne[481] produit que des ânes!... C’est l’histoire du maire de Gigondas, dans les Jeudis de madame Charbonneau, moins les enjolivements et les hyperboles de la fiction. Et, tandis qu’il vaque à ces soins variés, il sent ou croit sentir son esprit se rouiller, s’empâter, s’amortir, et il demande grâce aux Athéniens de Paris pour la pesante rusticité de ses lettres béotiennes. Voulez-vous un exemple de sa rouille, de son empâtement épistolaires? Écoutez la façon dont il excuse sa lenteur à partir pour Paris, où il est impatiemment attendu:
Vous savez la vieille histoire de ces aimables affamés qui, dans une partie de campagne, au moment de se mettre à table, s’aperçoivent qu’ils ont oublié le pain. On envoie un domestique à franc étrier, à la ville voisine; on lui commande d’aller ventre à terre et l’on calcule le temps, la distance: il est ici, il est là; il achète le pain, il remonte à cheval, il est à tel endroit, il approche, il arrive, le voici!... En effet, le domestique, à ce moment, ouvre la porte et dit, d’un air bête: «Je ne puis pas trouver la bride!» La bride que je n’ai pas trouvée, ou plutôt celle qui me retient, c’est d’abord un rhume de ma femme au moment où nos malles étaient faites; puis la crise agricole qui nous ruine et m’a mis dans l’alternative ou de partir sans argent ou d’attendre indéfiniment celui de mes fermiers, encore plus pauvres que moi, etc.[505].
Les lettres à Jules Claretie, qui vont de 1862 à 1890 et que j’ai en ce moment sous les yeux, ne sont ni moins intéressantes ni moins spirituelles que celles à Cuvillier-Fleury.
Avec ces lettres de Pontmartin à ses amis, en[482] ne prenant même que le dessus du panier, on fera aisément un ou deux volumes exquis, qui seront un vrai régal pour les délicats,—s’il en existe encore quand ces volumes paraîtront.
Toutes les lettres qu’il recevait de ses amis, Pontmartin les conservait précieusement; c’était un trésor dont il ne voulait rien distraire. Il n’en allait pas de même de celles que, pendant près d’un demi-siècle de critique, il avait reçues de ses justiciables. Ces autographes, signés de noms illustres ou tout au moins célèbres: Guizot, Villemain, Montalembert, Mignet, Victor Cousin, Albert de Broglie et son beau-frère M. d’Haussonville, Vitet, Saint-Marc Girardin, Gaston Boissier[506], Octave Feuillet, Désiré Nisard, Caro, J.-J. Weiss, Ludovic Halévy, Paul de Saint-Victor, Paul Féval, etc., étaient faits pour flatter sa vanité, et d’autres les auraient collectionnés avec soin: il n’en gardait jamais un seul. Plusieurs fois il m’arriva de lui en demander. Il me répondait invariablement: «Hélas! mon cher ami, il ne m’en reste pas une bribe. Toutes les fois qu’il y a en Avignon une tombola, un bazar de charité, je me fais un devoir et un plaisir d’y envoyer quelques-uns de ces autographes: lorsqu’ils atteignent un haut prix, j’en suis fier pour mes auteurs; j’en suis surtout heureux pour nos pauvres.»
CHAPITRE XVII
LES DERNIÈRES ANNÉES—ÉPISODES LITTÉRAIRES
LA MORT D’ARMAND DE PONTMARTIN
(1888-1890)
La dixième série des Souvenirs d’un vieux critique et les Péchés de vieillesse. Une Revue qui paie royalement. M. Frédéric Masson et les Lettres et les Arts.—Vingt-quatre articles d’avance, Episodes littéraires.—Le dernier article, M. Emile Zola et la Bête humaine. Un souvenir de Virgile.—La dernière maladie. Visite de Léopold de Gaillard. Une mort chrétienne. Les obsèques d’Armand de Pontmartin.
I
Puisqu’il a maintenant un si bel encrier, il faut bien que Pontmartin écrive encore. En 1888, il publie la neuvième série des Souvenirs d’un vieux critique. La dixième paraît en 1889, suivie, la même année, d’un volume de Nouvelles, Péchés de vieillesse[507]. Jeune, il avait aimé ce genre si français; il[484] y revenait encore une fois, souriant à son dernier rêve, suivant d’un mélancolique regard l’étoile qui va s’éteindre, la dernière, dans le ciel assombri.
Deux de ces nouvelles avaient d’abord paru dans les Lettres et les Arts, que dirigeait M. Frédéric Masson, «une étrange Revue qui coûte 300 fr. par an, qui a beaucoup d’argent, qui paie royalement et qui n’a pas d’abonnés.[508]» La collaboration de Pontmartin à la Revue de M. Frédéric Masson ne fut du reste qu’une collaboration de pure fantaisie. Bien que le Correspondant et la Gazette de France payassent moins royalement, il leur resta fidèle. Sa collaboration au Correspondant ne fut même jamais plus active qu’en ces dernières années. De 1887 à 1889, outre sa nouvelle les Feux de paille, il y publia de nombreux articles de critique et d’histoire: Le cardinal de Bonnechose;—Honnêtes gens et livres déshonnêtes;—les Commencements d’une conquête: l’Algérie de 1830 à 1840;—Napoléon et ses détracteurs, d’après le livre du prince Napoléon;—les Causeries littéraires d’Edmond Biré;—une Légende mystique au dix-septième siècle (le duc et la duchesse de Ventadour);—Deux livres jumeaux (Remarques sur l’Exposition du Centenaire, par le vicomte Melchior de Vogüé; 1789 et 1889, par Émile Ollivier). Bientôt, ce ne sont plus seulement des articles, c’est tout un volume qu’il écrit pour la Revue de la rue de Tournon. Sous le titre d’Épisodes littéraires, il y donne[485] la suite de ses Mémoires et les conduit cette fois jusqu’au mois de janvier 1858[509]. Comment il fut amené à entreprendre cette nouvelle série, il me l’apprenait dans une de ses lettres:
...Puisque vous aimez les détails, je dois vous renseigner sur l’origine de mes Épisodes littéraires. J’en étais arrivé à avoir vingt-quatre articles d’avance dans les bureaux de la Gazette. J’ai compris tout ce qu’il y avait de déraisonnable à rendre compte par exemple d’un roman de M. Ferdinand Fabre ou de M. Georges Ohnet dans un article qui ne paraîtra que six mois après le livre. Je me suis souvenu de ce que vous m’aviez écrit au sujet de la première forme que j’avais donnée à mes Mémoires. Léopold de Gaillard m’avait exprimé la même opinion. J’avais trop versé dans la fantaisie et le roman. Cette fois, sauf quelques nuances très légères, je puis assurer que la plupart de ces pages sont d’une exactitude photographique et qu’elles serrent de beaucoup plus près les divers épisodes de ma vie littéraire...
Souvenirs de 1848. LE PUFF d’Eugène Scribe.—Le lendemain du coup d’État dans un salon littéraire. Émile Augier.—La Mort d’un journal. La Naissance d’une Revue. L’OPINION PUBLIQUE et la REVUE CONTEMPORAINE.—Le Suicide d’un Journal, l’ASSEMBLÉE NATIONALE: tels sont les titres des quatre chapitres qui forment le volume de Pontmartin. Ainsi qu’il me l’avait écrit, les Épisodes littéraires, sauf sur deux ou trois points, sont très exacts et cette exactitude ajoute singulièrement au piquant du récit. Les portraits,[486] très nombreux, sont très vivants. L’esprit et le style sont toujours jeunes. Je ferai cependant un reproche à l’auteur. Il fait vraiment trop bon marché de sa belle campagne à l’Opinion publique. Il parle d’Alfred Nettement et de lui-même, j’en ai déjà fait la remarque[510], de façon à laisser croire que ce journal n’a été qu’un journal pour rire, alors qu’en réalité l’Opinion publique a été l’un des journaux qui, de 1848 à 1852, ont le plus honoré la presse française.
Les Épisodes littéraires devaient être le dernier volume de Pontmartin. En voici les dernières lignes; elles sont du 10 janvier 1890: «Je dois désormais laisser reposer ma vieille plume qui n’a que trop couru et trop écrit. On a dit souvent que les vieillards doivent vivre dans le passé; oui, mais ils doivent aussi vivre dans l’avenir, et cet avenir-là n’a rien de commun avec les écritures et les vanités humaines.»
II
Jusqu’à la fin cependant il continuera d’écrire. Le 14 mars, il acheva un article sur M. Zola et son roman la Bête humaine, qui venait de paraître. C’était son dernier Samedi[511]. L’effort, un peu de[487] fatigue s’y font sentir. Ce n’est plus la verve étincelante, la merveilleuse facilité des beaux jours. Cette plume, qui allait hier encore la bride sur le cou, qui dévorait la route, qui brûlait le papier, va plus lentement, la main est moins légère; déjà la maladie pèse sur elle; mais la pensée n’a rien perdu de sa vigueur, l’âme a conservé toute sa noblesse, le cœur ressent toujours les belles indignations d’autrefois. Armand de Pontmartin a eu cette heureuse fortune, le jour où la plume allait tomber de ses mains vaillantes, de pouvoir la mettre une dernière fois au service de ses convictions, au service de la vérité, de la morale et du goût. Il s’est élevé une dernière fois contre le matérialiste en littérature et en politique, contre les naturalismes et les jacobins. Son article se terminait par ces lignes:
Voilà, en dehors de toute querelle d’école, le vice radical des romans de M. Zola. Il supprime le libre arbitre, la responsabilité humaine. Pour que son système fonctionne plus à l’aise, il l’a abrité sous l’arbre généalogique des Rougon-Macquart, qui l’aurait couvert de ridicule, si le ridicule pouvait atteindre le maître des maîtres. Par là, il détruit tout l’intérêt que pourraient inspirer ses personnages et toutes les leçons que renfermeraient leurs actes. Dans ces conditions d’anarchie ou de servitude morale (synonymes ici comme toujours), la vogue de ces romans devait s’accorder admirablement avec le règne de le république jacobine. Sans doute, MM. Tirard, Constans, Thévenet, Spuller, Fallières, ne seraient pas fâchés d’apprendre que, s’ils font[488] mieux leurs affaires que celles de la France, ce n’est pas leur faute, et que, en accaparant les ministères, en décrochant les portefeuilles, en absorbant les traitements, en trichant les budgets, en persécutant nos prêtres, ils obéissent, non pas à de mauvais penchants, mais à une loi d’hérédité transmise par l’âge de pierre où leurs ancêtres et leurs précurseurs vivaient dans les cavernes[512].
Un détail, purement littéraire, celui-là, me frappe dans cet article. Pontmartin était un amoureux de Virgile. Écoutez comme il en parle dans une de ses premières Causeries de la Gazette, à propos de Barthélemy et de sa traduction de l’Enéide. «Pour moi, disait-il, cet auteur préféré, ce poète par excellence, c’est Virgile, Horace est aussi exquis, aussi élégant, et, à coup sûr, plus original. Mais il y a, chez Virgile, un fond de mélancolie et de tendresse, une douceur pénétrante qui va à l’âme, et qui, sans compter certaines vibrations quasi prophétiques, signalées dans le Pollion, en fait le plus chrétien de tous les poètes du paganisme. Cette sorte de sécheresse didactique qui nous gâte souvent nos admirations d’humanistes, n’existe pas avec lui: il a été, dès le premier jour, l’ami, le consolateur, le confident, l’interprète délicieux des premières rêveries, des premières visions de l’adolescence. Pour ceux d’entre nous qui ont été d’abord élevés à la campagne, le charme est plus puissant. Telle image du poète, tel passage des Géorgiques, tel vers se détachant sur l’ensemble comme un point lumineux sur la brume lointaine,[489] s’unissent étroitement dans notre imagination ou dans notre mémoire aux vagues frissons, aux mystérieux tressaillements qu’éveillèrent en nos jeunes âmes les spectacles de la nature ou les scènes de la vie champêtre. Plus tard, lorsque arrivent les années de déclin et d’adieu, nous ne savons plus si c’est le poète qui nous a rendus sensibles aux douces harmonies de la campagne, ou si ce sont ces harmonies qui nous ont initiés aux ineffables beautés du poète. Pour tout dire, Virgile, c’est Racine et Lamartine en un seul génie avec un degré de perfection plus exquise[513].»
Ces impressions remontaient, pour Pontmartin, non seulement à sa jeunesse, mais à son enfance même. Dès l’âge de huit ans, avant le collège, il courait les champs, son Virgile à la main, le lisant déjà à livre ouvert. Il ne s’endormait pas le soir sans le mettre sous son chevet pour le retrouver au réveil. C’est pourquoi sans doute il n’a pas voulu écrire son dernier article sans y mettre le nom du poète qu’il avait le plus aimé, sans répéter une dernière fois quelques-uns de ces vers dont l’harmonieuse douceur avait été l’un des enchantements de ses jeunes années. Son article, je l’ai dit, est consacré à M. Zola et à la Bête humaine. N’importe! il y parlera de Virgile et de l’Énéide, il citera ces vers délicieux:
Purpureus veluti cum flos, succisus aratro,
Languescit moriens; lassove papavera collo
Demisere caput, pluviâ cum forte gravantur!
III
Le 23 mars, je recevais de son fils la lettre suivante:
Votre amitié m’en voudrait si je ne vous associais pas aux inquiétudes que nous donne depuis dix jours la santé de mon père. Il s’était à peu près relevé de sa pénible crise du mois de décembre, et en janvier et février il allait relativement bien, mais il s’alimentait peu et il ne reprenait pas de forces. Il y a aujourd’hui quinze jours, il s’enrhuma, et ce rhume qui, en lui-même, n’a pas été bien grave, a amené pour lui un effondrement de ses dernières forces. Depuis le vendredi 14 (jour où il a terminé son dernier article), il est dans son fauteuil, en proie à une grande faiblesse et à un assoupissement constant. Le pire, c’est qu’il est impossible de combattre cette faiblesse; car son dégoût pour toute nourriture est absolu, et à grand’peine on parvient à lui faire prendre un peu de bouillon. Il a du reste conservé toute sa lucidité, et hier il s’est un peu ranimé pour recevoir la visite de M. de Gaillard, qui est lui-même à peu près infirme et qui a fait le grand effort de venir jusqu’ici. Mon père est résigné et préparé à tout: ce sont les deux expressions qu’il emploie sans cesse. Il a reçu les sacrements, sauf l’extrême-onction. Je ne veux pourtant pas vous présenter son état comme désespéré; on a vu des vieillards subir de pareilles crises et se relever ensuite. Mais enfin la situation est grave, et je ne pouvais vous la laisser ignorer. Une lettre de vous serait une grande joie pour mon père; et je suis sûr qu’il sortirait un moment de sa torpeur pour y répondre. Bien entendu, vous ne lui parleriez pas de sa santé; mais vous lui écririez comme vous le faites d’habitude et, je suppose, comme pour répondre à sa dernière lettre. Votre amitié saura bien ce qu’il faut lui dire. Je vous sais si bien[491] de cœur avec nous que j’ai à peine besoin de vous dire combien je vous suis affectionné et dévoué.
Plus heureux que moi, Léopold de Gaillard avait pu aller aux Angles. C’était le 22 mars:
La dernière fois que j’ai vu mon vieil ami, écrit-il[514], il n’avait plus que sept jours à vivre. Sans maladie bien caractérisée, mais d’une faiblesse extrême et ne prenant aucun aliment solide, il n’était pas alité et se tenait dans le grand salon où sa vie s’est écoulée, en face de trois fenêtres qui donnent sur la riche vallée du Rhône. Son seul exercice se bornait depuis quelques jours à se traîner d’un fauteuil à l’autre. Quand il me vit, il vint le plus vite qu’il put s’asseoir à mes côtés. Il m’annonça avec une parfaite sérénité sa mort pour un des jours de la semaine qui allait s’ouvrir. «Je n’ai pas attendu, ajouta-t-il, le dernier moment pour me mettre en règle avec le bon Dieu. Le P. B.[515] vient me voir souvent et je me confie à lui avec délices. Ah! mon ami! quels hommes vraiment de Dieu! Quels consolateurs!...» Je le louai avec toute l’effusion d’une amitié chrétienne, puis j’essayai de lui parler de ses travaux, des livres nouveaux et du buste donné par souscription que je voyais en face de moi. Pontmartin redevint aussitôt le charmant causeur qu’il a toujours été. Je me souviens que m’étant plaint à lui d’une photographie aux traits durcis et de couleur très sombre qu’on envoyait à ses souscripteurs, il me répondit en souriant. Peu de temps après son éclatante disgrâce, on osa exposer au Salon un portrait de Chateaubriand signé par Girodet. Chacun craignait la colère du maître. Mais, cette fois, il sut se contenir et s’en tirer par[492] un bon mot. Comme le tableau était très poussé au noir: «Il ressemble à un conspirateur, dit un courtisan.—Oui, ajouta l’empereur, mais à un conspirateur qui serait descendu par la cheminée!»
Cette saillie et plusieurs autres me donnèrent l’espoir que le désastre de sa santé était encore réparable, et que cet entrain de conversation n’allait pas avec un épuisement complet. Illusion, hélas! Chez notre ami comme chez tous ceux qui ont surtout vécu par l’esprit, c’est l’esprit qui meurt le dernier. C’est sa flamme qui brille encore quand toutes les autres sont éteintes. Juste récompense d’une vie toute d’intelligence et vouée tout entière aux plus nobles occupations!
Le 28 mars, Henri de Pontmartin m’adressait ces lignes:
Merci de votre lettre, qui a touché mon père jusqu’aux larmes; il veut que je vous le dise. Depuis hier, il garde le lit, et en un sens cela vaut mieux pour lui donner des soins et l’empêcher d’user ses dernières forces dans l’effort inouï qu’il lui fallait faire pour se lever, descendre et monter l’escalier. Sa faiblesse est toujours extrême, et les moyens de la combattre toujours à peu près nuls. Pourtant, aucun organe n’est atteint, et sa lucidité est intacte. Plus que jamais il est préparé, et il se remet entre les mains de Dieu.
Le samedi 29 mars, à onze heures et demie du matin, Armand de Pontmartin s’endormit dans la paix du Seigneur. Puisque je n’ai pas eu la consolation d’assister à ses derniers moments, je tiens à laisser la parole à ceux qui en furent les témoins. Le docteur Cade, qui lui donnait ses soins, raconte en ces termes cette mort si doucement chrétienne:
A ceux qui l’entouraient, il parlait de sa mort prochaine comme de l’événement le plus ordinaire, réglant lui-même le détail de ses obsèques. A plusieurs reprises, pendant le cours de sa dernière maladie, il avait tenu à recevoir la visite de son Dieu. Il voulut recevoir la communion le jour de la Saint-Joseph[516] et le jour même de sa mort. Et alors que sa famille était dans les pleurs, prévoyant sa fin prochaine, lui était dans une admirable tranquillité, goûtant déjà la joie des élus. Ma profession m’a condamné à voir souvent mourir, mais je n’oublierai jamais les derniers moments d’Armand de Pontmartin. Il avait reçu la communion dans les plus vifs sentiments de piété, et, peu de temps après, avait dit à M. le curé des Angles qui l’assistait: «Oh! comme je suis bien!» Puis il s’était endormi doucement pendant qu’on lui donnait l’extrême-onction. Par les fenêtres entr’ouvertes, le soleil du printemps inondait la chambre de lumière. Au pied du lit, un fils, une belle-fille en pleurs, torturés par une émotion poignante, quelques serviteurs fidèles répondant, malgré leurs larmes, aux prières de l’Église, et sur son lit d’agonie Armand de Pontmartin exhalait son dernier soupir[517].
Un autre témoin adressait d’Avignon, le 31 mars, au rédacteur en chef de l’Univers, une lettre d’où j’extrais ces détails:
J’ai revu M. de Pontmartin le 12 mars: il avait sur sa table la Bête humaine, de Zola. Quoique souffrant déjà, il préparait l’article qui a paru dans la Gazette de France, et, malgré la faiblesse qui commençait à le gagner, il s’exprimait avec une véhémence peu ordinaire sur l’œuvre mauvaise du romancier.
Depuis cette époque, le mal a fait de rapides progrès, et[494] le grand écrivain, avec ce secret pressentiment de sa mort prochaine qui se faisait jour depuis quelques mois à travers ses écrits, s’est résolument et avec une piété touchante tourné vers le bon Dieu. Il a reçu trois fois la sainte communion.
Le matin même de sa mort, il avait reçu la suprême visite du divin Maître, et lui-même avait demandé le saint viatique; mais dans la délicatesse de sa conscience, il n’a voulu prendre ni potion ni aliment. Il avait toute sa connaissance, et à un de ses fidèles serviteurs qui l’aimaient comme un père, il disait après cette dernière communion: «Oh! mon ami, je suis si bien! Laisse-moi maintenant avec le bon Dieu!» La veille, il avait dit à sa belle-fille: «Sais-tu par cœur le Salve Regina? Récite-le avec moi.»
La visite du prêtre le comblait de joie; c’est avec effusion qu’il remerciait le modeste curé des Angles de ses encouragements et de ses prières. Depuis quelques jours, il avait coutume de dire: «Oh! les robes noires, quel bien elles me font! Ce sont elles surtout que je veux voir!»
Les derniers moments ont été calmes: rien n’a troublé la sérénité de cette âme unie à Dieu dans les luttes de la vie...
Et quelle charité pour les pauvres dans cette âme exquise! Le château des Angles était le rendez-vous de toutes les misères, assurées de trouver là, de la part de l’illustre défunt et de son fils bien-aimé, secours et consolation. L’aumône se faisait en grand dans cette noble demeure, et la mort de M. de Pontmartin, qui est un deuil si grand pour les lettres et pour la France, est encore plus un deuil pour les pauvres et les petits...
S’arrachant pour un instant à ses larmes, le fils de mon vieil ami m’envoyait ce douloureux et consolant bulletin:
...Je vous ai dit que, le vendredi matin[518], il avait lu sur son lit votre lettre si excellente, où il ne vit pas les allusions cachées à sa maladie, mais qui le toucha par l’effusion de votre amitié, et l’intéressa par le récit de tout ce que vous aviez fait à Paris. «Quel contraste, me dit-il, entre cette activité et l’état auquel je suis réduit!» La journée et la nuit se passèrent tranquilles, avec diminution des quintes de toux, sommeil; il semblait que le séjour au lit, en supprimant les terribles efforts qu’il devait faire les jours précédents pour rester debout, avait amené une détente, qu’il était moins fatigué, que les traits de son visage ne portaient plus la marque du même accablement. Le samedi matin notre curé lui apporta la communion, ainsi qu’il avait été convenu l’avant-veille avec son confesseur. Il la reçut avec sa connaissance, remerciant ensuite le curé, s’excusant de l’avoir dérangé et me recommandant de ne pas le laisser partir sans lui faire prendre un peu de café. Quand je remontai, dix minutes plus tard, après m’être acquitté de ce soin, je le trouvai endormi d’un sommeil paisible et qui paraissait réparateur. Une heure après, c’est-à-dire vers dix heures, nous nous aperçûmes que ce sommeil ne ressemblait pas aux autres. Au même moment, notre docteur arriva, et, après l’avoir examiné, fit un signe désespéré. Il envoya chercher de nouveau le curé pour l’extrême-onction, qui fut administrée pendant qu’il respirait encore, et, au moment où finissaient les dernières prières, il expira sans souffrance. On peut donc dire qu’il s’est endormi dans le Seigneur, surabondamment assisté et consolé par la religion, et conservant jusqu’à la fin sa lucidité intellectuelle, sauf pour les adieux, dont l’amertume lui a été épargnée[519].
Par une singulière coïncidence, Armand de Pontmartin est mort un Samedi, ce jour qui était devenu le sien. Dans ses dernières années, il se plaisait quelquefois à me dire dans ses lettres:[496] «Soyez tranquille, je prépare depuis longtemps, je soignerai par-dessus tout mon dernier article.» Et en effet celui-là, celui qu’il ne craignait pas d’appeler en souriant, au risque de faire un de ces jeux de mots qu’il affectionnait, «l’article de sa mort»—celui-là fut admirable.
IV
Les obsèques furent célébrées le mardi 1er avril. Ainsi qu’il l’avait demandé, elles furent très simples: nul apparat, nulle pompe extérieure. Mais cette simplicité même les rendait encore plus émouvantes. Elles eurent lieu dans la petite église paroissiale des Angles. La levée du corps fut faite par M. le curé des Angles, assisté de plusieurs de ses confrères du voisinage, MM. les curés de Villeneuve, de Domazan et de Pujaut, et de M. l’abbé Agniel, aumônier des victimes à Saint-André-de-Villeneuve. En tête du cortège marchaient les femmes et les jeunes filles du village, auxquelles s’étaient jointes des députations des œuvres de charité dont le châtelain des Angles était le bienfaiteur; les Petites-Sœurs des Pauvres, les Religieuses de la Grande-Providence et les Trinitaires de Villeneuve.
Le cercueil était porté sur un brancard par les hommes des Angles, fiers de donner à celui qui avait été leur ami ce témoignage de respect et d’affection.
Le deuil était conduit par le fils du défunt, le comte Henri de Pontmartin, par son beau-frère le comte de Montravel, par son neveu M. de Froissard-Broissia, et M. Théodore de Montravel, son cousin germain. Derrière venait toute la population de la commune, et, avec elle, la plupart des notabilités avignonnaises ou des environs, les représentants de la presse conservatrice régionale, un des grands-vicaires de Mgr Vigne, archevêque d’Avignon, et plusieurs membres du clergé régulier et séculier.
Le long et pieux cortège gravit lentement la pittoresque montagne, qui lui faisait un cadre merveilleux, avec ses chemins sinueux, avec sa verdure naissante, avec ses rochers aux plantes sauvages. Dans le ciel limpide brillait un soleil de printemps, qui donnait un air de fête à cette scène de deuil, mais d’un deuil chrétien tout rempli de saintes consolations et d’immortelles espérances.
L’église était trop étroite pour recevoir la nombreuse assistance; par une touchante attention, les habitants des Angles s’abstinrent d’y pénétrer, la laissant tout entière à la disposition des amis et connaissances du maître, venus du dehors pour assister à ses funérailles.
Le curé des Angles célébra le saint sacrifice; le curé de Villeneuve donna l’absoute. De ferventes prières s’étaient élevées de tous les cœurs quand le prêtre avait invoqué de Dieu les joies éternelles en faveur de celui qui l’avait fidèlement servi: ut quia in te speravit et credidit... Gaudia æterna possideat;[498] quand il avait dit à la Communion de la Messe: Beati mortui qui in Domino moriuntur!
Le cimetière du village est situé au sommet même de la montagne, avec une vue magnifique au nord et au sud sur tout le pays environnant, jusqu’au Ventoux, d’un côté, et, de l’autre, jusqu’aux Alpines.
Trois discours furent prononcés: par M. le baron de Roubin, au nom de la famille, au nom des habitants des Angles et du canton de Villeneuve; par M. Charles Garnier, rédacteur de la Gazette du Midi, au nom de la presse, et plus spécialement de la presse méridionale; par M. Rochetin, au nom de l’Académie de Vaucluse. Le talent et les œuvres de l’écrivain furent dignement loués; mais, au moment de fermer ces pages, je veux oublier l’auteur; je ne veux me souvenir que de l’homme et de l’ami, du royaliste et du chrétien. Je ne veux retenir de ces hommages funèbres que ces paroles de M. de Roubin, l’un des témoins de sa vie:
mand de Pontmartin a voulu passer ses dernières années, il a voulu mourir dans la maison paternelle... Il ne pouvait mourir ailleurs celui qui était aux Angles et dans son canton la providence de toutes les infortunes.
Heureux d’employer son superflu au secours des malheureux et de toutes les œuvres charitables,—ces sentiments qui lui avaient été légués par ses pères, il les a si parfaitement transmis à son fils, que les pauvres, à l’avenir, s’apercevront à peine que ce n’est plus la même main qui donne...
La foi vive et ardente qu’Armand de Pontmartin avait puisée au berceau l’a accompagné jusqu’à la tombe.—Oui,[499] il s’est vu mourir, il a suivi une à une la décroissance de ses forces physiques, et il a puisé dans ses croyances religieuses le soutien de ses derniers jours. Le Bon Dieu, qui est venu le visiter souvent dans sa dernière maladie, lui a accordé la faveur de s’éteindre sans souffrir, et de garder jusqu’à la fin les vifs rayons de ce charmant esprit qui a si longtemps brillé dans le monde.
Les plus belles vies sont celles que couronne une sainte mort. C’est pourquoi, malgré les épreuves qui ont traversé son existence, malgré les deuils qui l’ont assombrie, nous devons envier Pontmartin. Il n’a servi qu’une seule cause. Il a défendu jusqu’à son dernier jour les idées et les principes pour lesquels s’était passionnée sa jeunesse. Il a passé ses dernières années sous le toit qui avait abrité son enfance. Il est mort dans la maison de son père, assisté par le curé de son village, ayant au pied de son lit son fils, sa belle-fille et ses vieux domestiques.
APPENDICE[520]
LISTE DES SOUSCRIPTEURS
AU BUSTE
DE M. ARMAND DE PONTMARTIN
1887
| Francs. | ||
| L’Académie de Marseille | 100 | » |
| Adam (Antonius), a Paris | 5 | » |
| Vte O. d’Adhémar, a Avignon | 20 | » |
| L’abbé Agniel, aumônier, a Villeneuve | 5 | » |
| L. d’Albiousse, a Uzès | 5 | » |
| V. Alecsandri, ministre de Roumanie, a Paris | 50 | » |
| Ch. Alexandre, a Mâcon | 10 | » |
| S. Allemand, a Avignon | 2 | » |
| Henri Allemand, a Roquemaure (Gard) | 1 | » |
| A. d’Amoreux, ancien officier, a Uzès | 10 | » |
| Vve Louis André, a Marseille | 20 | » |
| André-Papuzeaud, a Avignon | 0 | 50 |
| Angevin, a Sauveterre (Gard) | 0 | 25 |
| Commandant d’Antreygas, a Avignon | 5 | » |
| Mise d’Archimbaud, a Avignon | 10 | » |
| Armand, relieur, a Avignon | 10 | » |
| François Armand, a Avignon | 0 | 50 |
| Gabriel Arnaud, a Caumont (Vaucluse) | 1 | » |
| Louis d’Athénosy, a Avignon[502] | 10 | » |
| Aubanel frères, imprimeurs, a Avignon | 5 | » |
| Mis d’Aymard de Chateaurenard, Paris | 20 | » |
| Mlle de Baciocchi, a Avignon | 5 | » |
| E. Baculard, a Roquemaure | 1 | » |
| Ctesse de Balleroy, a Balleroy (Calvados) | 20 | » |
| Barbantan, peintre, a Pernes | 0 | 30 |
| Barbeirassy, ancien directeur des Domaines | 20 | » |
| Lucien Barbeirassy, Avignon | 20 | » |
| Mce de Barberey, a Paris | 20 | » |
| Cte de Barbeyrac St Maurice, Avignon | 10 | » |
| Vtesse de Bardonnet, née Hyde de Neuville | 8 | » |
| Dr Barral, Avignon | 5 | » |
| Cte Hélion de Barreme, a Nice | 40 | » |
| Barrès, bibliothécaire, Carpentras | 5 | » |
| Mme Barretta-Worms (Comédie-Française) | 20 | » |
| A. de Barthélemy, romancier | 5 | » |
| Barthélemy, a Roquemaure | 5 | » |
| Ed. de la Bastide, a Avignon | 10 | » |
| Eug. Bastide, Avignon | 5 | » |
| Mis de Bausset, capitne de Vaisseau | 10 | » |
| Ctesse Marie de Bausset, Avignon | 10 | » |
| O. Baze, Avignon | 20 | » |
| Beillier, Avignon | 3 | » |
| G. de Belcastel, ancien député, Toulouse | 10 | » |
| Michel Bérard, Avignon | 5 | » |
| Béraud, profr de musique, Avignon | 1 | » |
| Berbiguier, serrurier, a Roquemaure | 0 | 50 |
| Henri Bergasse, a Marseille | 25 | » |
| Bernard, tailleur, Avignon | 1 | » |
| Mus Bernard, a l’Isle (Vaucluse) | 5 | » |
| Ch. Bernardi, a Avignon | 20 | » |
| L’abbé Bersange, a Bergerac | 5 | » |
| Horace Bertin, journaliste, Marseille | 10 | » |
| Bertin, clerc d’huissier, a Roquemaure | 0 | 50 |
| Berton père et fils, Avignon | 25 | » |
| X. Berud, au Thor (Vaucluse) | 1 | » |
| Monseigneur Besson, a Nîmes | 100 | » |
| Eug. Bezet, a Avignon | 0 | 50 |
| L’abbé Bidon, a Avignon | 2 | » |
| Bigot, coiffeur, Avignon | 1 | » |
| A. Biré, sénateur, Luçon | 10 | » |
| Ed. Biré, a Nantes[503] | 20 | » |
| Ch. Bistagne, Marseille | 20 | » |
| Jh Blanc, a Avignon | 0 | 50 |
| Blanc fils aîné, Avignon | 0 | 50 |
| Rd Père Jacques Blanc, S. J., Avignon | 2 | » |
| Boge, peintre, Avignon | 1 | » |
| G. Boissier, de l’Académie Française | 20 | » |
| Firmin Boissin, journaliste, Toulouse | 3 | » |
| Esprit Bonneau, a Sauveterre (Gard) | 0 | 50 |
| Bonnefille, marbrier, a Avignon | 5 | » |
| L’abbé Bonnel, curé, Lacoste (Vaucluse) | 10 | » |
| Julien Bonnet, avocat, Avignon | 10 | » |
| Léon Bonnet, id., Avignon | 10 | » |
| Justin Bonnet, a Sauveterre | 0 | 50 |
| Gustave Bord, a Nantes | 10 | » |
| Vte St-Clair de la Borde, Avignon | 10 | » |
| Borty, a Roquemaure | 5 | » |
| Vve Borty, a Roquemaure | 1 | » |
| Joseph Bosse, a Avignon | 3 | » |
| Félix Bouchet, a Thiers (Puy-de-Dome) | 5 | » |
| De Bouchony, Avignon | 5 | » |
| Marius Boulle, Avignon | 1 | » |
| Justin Bourget, a Beaucaire | 1 | » |
| B. Bourret, a Sauveterre | 0 | 50 |
| Bouvachon-Commin, Avignon | 5 | » |
| Henri Bouvet, Avignon | 1 | » |
| Marc Bouvet, a Pujaut (Gard) | 0 | 50 |
| Paul Bouvet (Gard) | 0 | 50 |
| Rémy Bouvet (Gard) | 1 | » |
| L’abbé Bouyac, a Avignon | 5 | » |
| B. Bouzon, a Sauveterre | 0 | 25 |
| Sébastien Bressy, Avignon | 5 | » |
| Eug. de Bricqueville, Avignon | 25 | » |
| Léon de la Brière, a Paris | 5 | » |
| Brochéry, a Avignon | 5 | » |
| Bruguier-Roure, a Pont-St-Esprit | 15 | » |
| Brulat, peintre | 1 | » |
| L’abbé Brun, curé, Vedènes (Vaucluse) | 1 | 50 |
| Lucien Brun, sénateur | 20 | » |
| Édouard Brunel, a Cavaillon | 1 | 50 |
| Dr Cade, a Avignon | 20 | » |
| Georges de Cadillan, a Tarascon | 20 | » |
| Calmann-Lévy, a Paris | 200 | » |
| Calla, ancien député, Paris | 20 | » |
| L. de Camaret, a Pernes (Vaucluse) | 10 | » |
| M. Cambe, a Pujaut | 0 | 50 |
| S. Cambe, a Sauveterre | 0 | 50 |
| Henri Campé, Avignon | 20 | » |
| Canonge, tourneur, a Villeneuve[504] | 0 | 25 |
| Capmartin, a Roquemaure | 1 | » |
| Ch. Cappeau, a Roquemaure | 0 | 50 |
| E. Cappeau, a Roquemaure | 0 | 50 |
| Paul Cappeau, a Roquemaure | 0 | 50 |
| Carabin, peintre, a Avignon | 1 | 50 |
| Mme de Carayon-Latour, a Virelade (Gironde) | 30 | » |
| Bon de Carmejane-Pierredon, a Avignon | 10 | » |
| Carnayon, a Roquemaure | 1 | » |
| Cte Jules de Carné (Indre-et-Loire) | 20 | » |
| Dr Carre, Avignon | 20 | » |
| L’abbé Carrier (Ardennes) | 5 | » |
| Le Duc des Cars | 20 | » |
| M. et Mme Louis Cartier, Avignon | 75 | » |
| Cartoux, a Sauveterre | 0 | 25 |
| J. de Cassières, président a la Cour, Amiens | 5 | » |
| Cavillon, épicier, Avignon | 1 | » |
| Cavoret, épicier, Avignon | 0 | 50 |
| Cercle de l’Agriculture, Avignon | 50 | » |
| Bne de Chabert, Avignon | 20 | » |
| Dr Chabert, Roquemaure | 1 | » |
| Calixte Chabrel, a Villeneuve | 0 | 25 |
| Léon Chabrel, a Villeneuve | 0 | 25 |
| Félix Chabrier, Avignon | 10 | » |
| Chaigne, a Bourg-St-Andéol | 5 | » |
| L’abbé Chaix, a Cannes | 20 | » |
| Chambon, a Pujaut | 1 | » |
| G. de Champvans, ancien préfet | 10 | » |
| Chansroux, a Roquemaure | 1 | » |
| Cte de Chansiergues, Avignon | 20 | » |
| Chantelauze, publiciste, Paris | 10 | » |
| Mise Dre de Charnacé (Maine-et-Loire) | 10 | » |
| Cte Guy de Charnacé, (Maine-et-Loire) | 10 | » |
| A. Charpentier (Calvados) | 5 | » |
| Dr Charruau, Nantes | 2 | » |
| L. Chauvet, au Tuor | 1 | » |
| Léon de Chênedollé (Calvados) | 10 | » |
| Jules Claretie, de l’Acad. française | 20 | » |
| Jh Clauseau, a Avignon | 20 | » |
| E. Clerc, a Roquemaure | 0 | 50 |
| Dr Clément, Avignon | 10 | » |
| Clérissac, a Roquemaure | 1 | » |
| Cochat, a Avignon | 0 | 50 |
| Joseph de Cohorn, a Avignon | 1 | » |
| Collège St-Joseph, a Avignon [505] | 40 | » |
| L. Collet, a Avignon | 5 | » |
| Chanoine Condamin, Lyon | 10 | » |
| Mise de Coriolis, Marseille | 20 | » |
| Cte de Cosnac (Corrèze) | 10 | » |
| V. Cottard, Avignon | 5 | » |
| Coulondres, ancien magistrat, Avignon | 10 | » |
| Courcelle, ancien député (Hte-Saône) | 5 | » |
| Crégut, a Roquemaure | 1 | » |
| Victor Crotat, tonnelier, a Roquemaure | 0 | 50 |
| Bon de Croze (Haute-Loire) | 10 | » |
| Cunin, a Avignon | 2 | » |
| L. Curnier, ancien député, Le Havre | 50 | » |
| Cuvillier-Fleury (Ac. Française) | 20 | » |
| L’abbé Daniel, Toulon | 5 | » |
| J.-S. David, a Sauveterre | 1 | » |
| Esprit David, a Sauveterre | 0 | 50 |
| J.-C. David, a Sauveterre | 0 | 50 |
| Sixte David, a Sauveterre | 0 | 50 |
| J.-L. David, a Pujaut | 2 | » |
| Dau, compositeur de musique, Avignon | 10 | » |
| Ch. Dayma, Avignon | 5 | » |
| Léonce Dayma, Avignon | 10 | » |
| L’abbé Delacroix, curé, Bagnols | 10 | » |
| R. Deleuze, Avignon | 10 | » |
| Delorme fils aîné, Avignon | 1 | » |
| Léon Delorme, Avignon | 1 | » |
| Deloye, conservateur du Musée, Avignon | 10 | » |
| Cte Roger du Demaine, Avignon | 20 | » |
| Gabriel Démians, Avignon | 20 | » |
| Desaide, graveur, Paris | 5 | » |
| Mce Desvernay (Loire) | 20 | » |
| Deville, phien, Saint-Saturnin (Vaucluse) | 2 | » |
| Deville, médecin, Saint-Saturnin (Vaucluse) | 3 | » |
| F. Digonnet, Avignon | 20 | » |
| V. des Diguères (Orne) | 20 | » |
| Dinard, Avignon | 3 | » |
| Ch. Domergue, Beaucaire | 20 | » |
| Donat-Darut, a Roquemaure | 1 | » |
| George Doncieux, Paris | 5 | » |
| C. Doucet (Académie Française), Paris | 20 | » |
| Vve Douladoure, Toulouse | 1 | » |
| Doutavès, maçon, Avignon | 2 | » |
| Mgr de Dreux-Brézé, évêque de Moulins | 20 | » |
| Commandant Dubois, Paris | 10 | » |
| Dr A. Dubourd, Roquemaure | 1 | » |
| Ducommun, horloger, Avignon | 10 | » |
| Commandant Ducos, Avignon[506] | 10 | » |
| Gilles Dufour, a Pujaut | 0 | 50 |
| Léon Dufour, a Avignon | 5 | » |
| Jh Dufraisse (Haute-Garonne) | 5 | » |
| L’abbé Dumas, curé de Saint-Pierre | 5 | » |
| Alexandre Dumas (Acadie Française) | 20 | » |
| Durand, libraire, Avignon | 1 | » |
| Édouard, a Roquemaure | 2 | » |
| Colonel comte de l’Église, Paris | 20 | » |
| H. Escoffier, Petit Journal, Paris | 20 | » |
| Bon d’Espalungue (Basses-Pyrénées) | 10 | » |
| Dr d’Espiney, a Nice | 10 | » |
| Mis de l’Espine, Avignon | 10 | » |
| De l’Estang, avoué, Brignoles | 5 | » |
| Mme d’Estienne de St-Jean, a Aix | 20 | » |
| Fr. Estournel, a Pujaut | 0 | 25 |
| V. Estournel, maçon, Pujaut | 0 | 25 |
| Bon d’Étigny, Avignon | 20 | » |
| D’Everlange, Nimes | 5 | » |
| Eyssette, contre-maître, a Roquemaure | 1 | » |
| Adr. Fabre, Avignon | 5 | » |
| Cl. Fanot, carillonneur, Avignon | 2 | » |
| Ctesse de Farcy (Mayenne) | 20 | » |
| A. Farget, a Avignon | 0 | 50 |
| Paul de Faucher, a Bollène | 3 | » |
| Th. Favier, a Avignon | 1 | » |
| Mise de Fayet, Ch. d’Aveny (Eure) | 10 | » |
| Cte Achille de Félix, Avignon | 5 | » |
| Jules Fénard, a Cherbourg | 10 | » |
| Th. Fénard, a Cherbourg | 10 | » |
| Octave Feuillet (Académie Française) | 40 | » |
| Mme Harold Fitch, Marseille | 40 | » |
| Mius Fléchaire, Avignon | 1 | » |
| Mlle Zénaïde Fleuriot (Morbihan) | 10 | » |
| Mis de Forbin, a Paris | 20 | » |
| Mis de Foresta, a Marseille | 20 | » |
| Antne Fortunet, Avignon | 5 | » |
| Jules Fortunet, Avignon | 20 | » |
| Eug. Fortunet, au Thor | 20 | » |
| F. Fourcade, arbitre de comce, Nantes | 2 | » |
| Mis de Fournès, Paris | 20 | » |
| Colonel Franchet d’Espérey, Avignon | 5 | » |
| François-Massart, a Sauveterre | 0 | 25 |
| Henri Franquebalme, Avignon | 5 | » |
| Mgr Fuzet, évêque de la Réunion[507] | 10 | » |
| L’abbé Gabriel, curé, Les Salles (Gard) | 0 | 50 |
| Léopold de Gaillard | 50 | » |
| Pierre de Gaillard | 10 | » |
| Henry de Gaillard | 10 | » |
| Denis Galet, a Amiens | 5 | » |
| Gallay, ancien maire du VIIIe, Paris | 20 | » |
| Mis de Ganay, Paris | 20 | » |
| Ch. de Gantelmi d’Ille, a Aix | 5 | » |
| Fr. Gard, a Uzès | 1 | » |
| Ch. de Gargan, a Luxembourg | 25 | » |
| Ch. Garnier, publiciste, Marseille | 5 | » |
| Pierre Gassin, a Avignon | 0 | 50 |
| Gaucherand, peintre, Avignon | 1 | » |
| La Gazette de France | 100 | » |
| La Gazette du Midi | 100 | » |
| Joseph Genet, a Pujaut | 0 | 50 |
| Geoffroy, a Tournay (Hautes-Pyrénées) | 10 | » |
| Ed. Geoffroy, Avignon | 10 | » |
| Le premier Président Germanes | 50 | » |
| Albert Gigot, ancien préfet | 10 | » |
| Gilles, a Eyragues (Bouches-du-Rhône) | 5 | » |
| Mme de Gilly, a Tain (Drome) | 20 | » |
| Cte De Ginestous, a Cavaillon | 10 | » |
| Girard, sculpteur, Avignon | 0 | 50 |
| Frédéric Giraud, Paris | 10 | » |
| L’abbé Giraud, aumonier, Avignon | 5 | » |
| L’abbé Giraud, vicaire a Saint-Didier, Avignon | 3 | » |
| Alfred Giraudeau, Paris | 10 | » |
| Fernand Giraudeau, Marseille | 10 | » |
| Jh Gontard, Avignon | 0 | 50 |
| Vte de Gontaut-Biron, Anc. Ambassadeur | 10 | » |
| Th. Goubet, avocat, Avignon | 5 | » |
| Albin Goudareau, Avignon | 20 | » |
| Émile Goudareau, Avignon | 20 | » |
| Jules Goudareau, Avignon | 10 | » |
| Goulet, banquier, Reims | 10 | » |
| B. Granet, a Roquemaure | 1 | » |
| Léonce Granet, a Roquemaure | 2 | » |
| Fr. Granier, anc. sénateur, Avignon | 50 | » |
| Amable Gras, Avignon | 2 | » |
| Félix Gras, Avignon | 5 | » |
| Mis de Grave (Haute-Vienne) | 20 | » |
| Ed. Grenier, poète, Paris | 20 | » |
| Mgr Grimardias, év. de Cahors | 25 | » |
| Emile Grimaud, Nantes | 5 | » |
| L’abbé Grimaud, Sorgues (Vaucluse)[508] | 5 | » |
| Grouion, a Roquemaure | 0 | 50 |
| Guérin, antiquaire, Avignon | 0 | 50 |
| Vv Guerchet, orfèvre, Paris | 10 | » |
| Guiberne, Avignon | 1 | » |
| Ctesse L. De Guilhermier, Avignon | 10 | » |
| F. Guillaumont, a Sauveterre | 0 | 50 |
| Paul Guillaumont, a Sauveterre | 0 | 25 |
| Guillaume Guizot, Paris | 20 | » |
| Ludovic Halévy (Académie Française) | 20 | » |
| Hébrard, a Roquemaure | 1 | » |
| Mme de Hennault, Avignon | 10 | » |
| Henry-Chrétien, Avignon | 0 | 50 |
| Ed. Hervé (Académie Française) | 20 | » |
| Heugel, éditeur de musique, Paris | 20 | » |
| Hostaléry père et fils, Caumont (Vaucluse) | 1 | » |
| Hugues, serrurier, Roquemaure | 0 | 50 |
| Mis d’Ivry (Côte-d’Or) | 20 | » |
| Président Jacques, Avignon | 5 | » |
| Claudio Jannet, Paris | 10 | » |
| Vtesse de Janzé, Paris | 40 | » |
| Ant. de Jessé-Charleval, Marseille | 50 | » |
| Eug. Johanys, Roquemaure | 5 | » |
| Joseph Joubert (Maine-et-Loire) | 10 | » |
| Lacour, Avignon | 2 | » |
| Mgr Labouré, év. du Mans | 20 | » |
| Lagier-Fornéry, Avignon | 5 | » |
| Alfred Lallié, Nantes | 5 | » |
| Lamaty, a Pujaut | 0 | 25 |
| Langlois, a Paris | 2 | » |
| Mme Victor de Laprade | 40 | » |
| G. de Laurens, Avignon | 10 | » |
| Bon Alfred du Laurens, Avignon | 10 | » |
| Bon Guillaume du Laurens, Avignon | 10 | » |
| Et. Laurent, Aureille (B.-du-Rh.) | 1 | 50 |
| Cte de Lavaur-Ste Fortunade (Corrèze) | 10 | » |
| Le Bourgeois, Bonsecours-Rouen | 10 | » |
| Ctesse de Léautaud, Paris | 20 | » |
| Levêque, a Roquemaure | 1 | » |
| Stéphen Liégeard, anc. député (Côte-d’Or) | 50 | » |
| Liffran, notaire, Roquemaure | 0 | 50 |
| Cte de Longpérier (Oise) | 10 | » |
| G. de Longchamp, Marseille | 20 | » |
| A. Magnan, Sauveterre | 0 | 25 |
| Eug. Magne, Avignon[509] | 5 | » |
| Mahur, a Roquemaure | 1 | » |
| B. de Malherbe, a Changhaï | 20 | » |
| Léon Maillé, a Castres | 1 | » |
| Albert Mallac, Bougival | 10 | » |
| Paul Manivet, Avignon | 10 | » |
| Manon ainé, Avignon | 0 | 50 |
| Jh Manon, Avignon | 0 | 50 |
| Elie Maria, Avignon | 5 | » |
| Paul Mariéton, Paris | 20 | » |
| Maurice Marin, Roquemaure | 2 | » |
| Ch. Marin, Roquemaure | 0 | 50 |
| Marin aîné, Roquemaure | 1 | » |
| X. Marmier (Académie Française) | 20 | » |
| Martin fils aîné, Rognonas (B.-du-Rh.) | 0 | 50 |
| Martin, typographe, Avignon | 5 | » |
| Martin-Four, Avignon | 20 | » |
| F. Mazet, a Roquemaure | 0 | 50 |
| Mercier, ancien sous-préfet, Avignon | 10 | » |
| Vte du Mesnil du Buisson (Orne) | 20 | » |
| Fr., Adr. et Auguste Meynadier, Avignon | 1 | 50 |
| Meynier, avocat, Marseille | 25 | » |
| L. Michel, médecin, au Thor | 1 | » |
| Michel-Béchet, Avignon | 10 | » |
| Mlle Marie Michel, Tarascon | 5 | » |
| Michel, Société Générale, Avignon | 10 | » |
| P. Michel, a Sauveterre | 0 | 50 |
| Michel-Bent, Avignon | 5 | » |
| Michelland, au Thor | 1 | » |
| Er. de Millaudon, Avignon | 20 | » |
| Mille, a Avignon | 0 | 50 |
| Mirandol, boulanger, Avignon | 0 | 50 |
| Frédéric Mistral | 20 | » |
| Mistral-Bernard, St Rémy-de-Provence | 40 | » |
| Monnier, Avignon | 5 | » |
| Aug. Monition, au Thor | 1 | » |
| Mis de Montalet-Alais, (Gard) | 20 | » |
| Bon de Montfaucon, Paris | 20 | » |
| Ctesse de Morangiès, (Lozère) | 20 | » |
| Moreau de Belley, Avignon | 1 | » |
| Motteroz, imprimeur, Paris | 50 | » |
| A. Mounet, Roquemaure | 1 | » |
| Jules Mouret, Avignon | 0 | 50 |
| Camille Moutin, Marseille | 5 | » |
| Alexis Mouzin, poète, Avignon | 5 | » |
| Émile Niel, ingénieur, Avignon | 5 | » |
| D. Nisard (Acadie Frse) | 20 | » |
| Ch. Nisard, de l’Institut[510] | 5 | » |
| M. et Mme Jacques Normand | 50 | » |
| G. Odoyer, a Sauveterre | 2 | » |
| Fr. d’Oléon, Avignon | 20 | » |
| Cte d’Olivier, Avignon | 10 | » |
| Émile Ollivier (Académie Française) | 20 | » |
| Louis d’Ortigue, Cavaillon | 5 | » |
| V. Paillet, au Thor | 1 | » |
| Auguste Palun, Avignon | 50 | » |
| Palun de Bésignane, au Thor | 1 | » |
| Mis de Panisse-Passis (B.-du-Rh.) | 25 | » |
| Chanoine Paranque, La Ciotat | 4 | » |
| Le Comte de Paris | 100 | » |
| Pasquier de la Gressière (Ardennes) | 10 | » |
| P. de Pélerin, Nimes | 25 | » |
| P. Pelletier, verrier, Paris | 20 | » |
| M. et Mme Pellissier, a Pujaut | 2 | » |
| Bon du Peloux (Ain) | 25 | » |
| Henri de Pène | 20 | » |
| Jules Pernod, Avignon | 20 | » |
| J.-L. Perrier, a Roquemaure | 0 | 50 |
| A. Perrin, a Roquemaure | 2 | » |
| Conseiller Perrot, Avignon | 20 | » |
| Louis Perrot, Avignon | 5 | » |
| J. Peyraque, Pujaut | 0 | 50 |
| Et. Philibert, Pujaut | 0 | 50 |
| Nicolas Philibert, Pujaut | 1 | » |
| Philibert, Sauveterre | 1 | » |
| Adolphe Pieyre, Nimes | 10 | » |
| G. Pijotat, Marseille | 5 | » |
| Mis de Pimodan, Paris | 20 | » |
| Aug. Planche, a Uzès | 1 | » |
| L’abbé Plautin, Avignon | 10 | » |
| Plauzoles, a Montfort-l’Amaury | 5 | » |
| Poirotte père et fils, menuisiers, Pujaut | 0 | 50 |
| Vte de Poli, Paris | 5 | » |
| André Pons, Avignon | 5 | » |
| Victor Pons, confiseur, Avignon | 5 | » |
| Benoît Pons, a Moulins | 20 | » |
| Cte de Pontevès-Sabran, Marseille | 50 | » |
| Clément Poulain, Nantes | 2 | » |
| Henri Poussel, publiciste, Avignon | 20 | » |
| Alexandre Poussel, Paris | 5 | » |
| Mlle Pouzol, a Pujaut | 2 | » |
| J.-B. Pouzol, a Pujaut | 1 | » |
| Prat-Noilly, Marseille | 50 | » |
| V. Prévot, Avignon | 2 | » |
| Proyart (Pas-de-Calais) | 20 | » |
| Vte du Puget (Somme) | 10 | » |
| Rabillon, cafetier, Roquemaure | 0 | 50 |
| Ctesse De Raousset-Boulbon, Avignon | 20 | » |
| Rastoul, Univers, Paris | 5 | » |
| Ravanis, curé doyen, Roquemaure[511] | 3 | » |
| Vicaire-Général Redon, Avignon | 5 | » |
| De Rémusat, Marseille | 20 | » |
| Renaudin, chapelier, Roquemaure | 0 | 50 |
| Renouard, employé au P.-L.-M., Avignon | 1 | » |
| Frédéric Ressegaire, Avignon | 1 | » |
| Isidore de Rey, au Thor | 1 | » |
| Reynard-Lespinasse (Et.), Avignon | 20 | » |
| Reynaud de Trets, Marseille | 20 | » |
| Charles de Ribbe, a Aix | 10 | » |
| Aug. de Ribbe, Avignon | 5 | » |
| Mme du Ribert et ses filles | 20 | » |
| Ch. Ricard, a Pujaut | 2 | » |
| Ricard, a Pujaut | 0 | 65 |
| Mgr Ricard, Marseille | 10 | » |
| Anselme Rieu, a Pujaut | 0 | 50 |
| Eug. Ripert, Avignon | 0 | 50 |
| Ad. Roch, banquier, Avignon | 2 | » |
| Rochat, a Nogent-sur-Marne | 5 | » |
| Louis Roche, Roquemaure | 0 | 50 |
| Duchesse de la Roche-Guyon | 200 | » |
| Mis de la Rochejaquelein | 20 | » |
| R. de Rocher, Bollène | 25 | » |
| Dr Rochette, Paris | 5 | » |
| Mme Rochetin, Uzès | 25 | » |
| Mme de la Rochethulon | 20 | » |
| Th. Rodde, Avignon | 1 | » |
| Jules Rolland, a Albi | 10 | » |
| Sincère Romey (Gazette de France) | 5 | » |
| Louis de la Roque, Montpellier | 20 | » |
| Rostan d’Ancezune, Marseille | 20 | » |
| Eug. Rostand, Marseille | 40 | » |
| Alexis Rostand, Marseille | 20 | » |
| L. Roubaud, au Thor | 1 | » |
| Bon Albert de Roubin, Villeneuve | 10 | » |
| Bon Armand de Roubin, Avignon | 10 | » |
| Famille Rouchette, a Pujaut | 4 | 50 |
| Joseph Roumanille | 25 | » |
| Gustave Roure, confiseur, Avignon | 5 | » |
| Ed. Rousse (Académie Française) | 10 | » |
| Ch. Rousseau, a Thouars | 10 | » |
| Camille Rousset (Académie Française) | 10 | » |
| Dr Roussillon, au Bourg-d’Oisans | 2 | » |
| Jules-Charles Roux, Marseille | 20 | » |
| Victor Roux, Marseille | 50 | » |
| Jules Roux, avoué, Avignon | 5 | » |
| Bon de Roux-Larcy | 20 | » |
| F. Royer, a Villeneuve | 0 | 25 |
| L’abbé Rouzeaud, Toulouse[512] | 3 | » |
| Cte de Ruffo-Bonneval, Marseille | 5 | » |
| Duc de Sabran-Pontevès, Marseille | 100 | » |
| Cte Emm. de Sabran-Pontevès, Marseille | 20 | » |
| Cte Guillaume de Sabran-Pontevès, Marseille | 25 | » |
| Alph. Sagnier, Avignon | 10 | » |
| St-Patrice (Triboulet), Paris | 20 | » |
| L’abbé Salla, Roquemaure | 2 | » |
| P. Salomon, a Villeneuve | 5 | » |
| Joannin Samuel, Avignon | 5 | » |
| Cte de Saporta, a Aix | 20 | » |
| Mis de Saqui-Sannes, Avignon | 10 | » |
| Vte Jules de Salvador, Avignon | 50 | » |
| Cte Henri de Salvador, Remoulins | 5 | » |
| L’abbé de Salvador, Avignon | 1 | » |
| Joseph de Salvador, Avignon | 1 | » |
| Saubot-Demborgez, Paris | 5 | » |
| Seguin frères, Avignon | 25 | » |
| Marc Serguier, a Roquemaure | 0 | 50 |
| Bon de Serres de Monteil, Avignon | 10 | » |
| L’abbé Seytre (Alpes-Maritimes) | 5 | » |
| Vte de Sinéty, Avignon | 20 | » |
| B. Soulier, ancien maire, Pujaut | 5 | » |
| Em. Soulier, ancien maire, Sauveterre | 2 | » |
| Fréd. Soulier, a Pujaut | 0 | 50 |
| Maxin Soulier, a Pujaut | 1 | » |
| Michel Soulier, a Pujaut | 1 | » |
| Michel Soulier, a Pujaut | 2 | » |
| Eug. Soustelle, Avignon | 5 | » |
| Ed. Stofflet, Le Mans | 5 | » |
| Colonel de Surville, a Nîmes | 5 | » |
| Jh de Talode du Grail, Mouilleron (Vendée) | 20 | » |
| Tastevin, publiciste, Valence | 5 | » |
| L. Taulier, a Pujaut | 1 | » |
| Teissère, a Marseille | 10 | » |
| Ant. Teissier, a Pujaut | 1 | » |
| Charles Teste, a Bagnols (Gard) | 10 | » |
| J. de Terris, notaire, Avignon | 5 | » |
| Joseph Thomas, Avignon | 40 | » |
| Paul Thureau-Dangin, Paris | 20 | » |
| Tollon père, Marseille | 10 | » |
| Mgr Tolra de Bordas, Nice | 10 | » |
| Cte de Toulouse-Lautrec, a Lavaur | 5 | » |
| Tracol, notaire, Avignon[513] | 10 | » |
| L’Univers, a Paris | 50 | » |
| Paul Vachier, peintre, Avignon | 2 | » |
| Jonathan Valabrègue, Avignon | 10 | » |
| Amédée Valabrègue, Avignon | 10 | » |
| Adr. Vallat, Roquemaure | 0 | 50 |
| Aristide Valette, Roquemaure | 5 | » |
| L’abbé Valette, curé, Pujaut | 5 | » |
| De Vatimesnil (Eure) | 10 | » |
| Blaise Velay, Pujaut | 2 | » |
| Gabriel Verdet, Avignon | 50 | » |
| Marcel Verdet, Avignon | 20 | » |
| Théodore Verdet, Avignon | 20 | » |
| L. Vernet, statuaire, Avignon | 1 | 50 |
| L’abbé de Vérot, Avignon | 10 | » |
| A. Veux, Roquemaure | 1 | » |
| Jh Vidal, Pujaut | 1 | » |
| Mgr Vigne, archevèque d’Avignon | 50 | » |
| Alfr. Viguier, Paris | 1 | 50 |
| Dr Villars, Avignon | 20 | » |
| Mis de Villefranche, Paris | 25 | » |
| Cte de Villeneuve-Bargemon, Avignon | 10 | » |
| Cte de Villeneuve-Esclapon, Avignon | 10 | » |
| Fréd. Villet, Avignon | 2 | » |
| Charles Vincens, Marseille | 25 | » |
| Ctesse Elzéar de Vogüé | 5 | » |
| Henri Yvaren, Avignon | 50 | » |
| Trois anonymes, Avignon | 1 | 50 |
| Deux anonymes, Marseille | 4 | » |
| Un anonyme, Avignon | 5 | » |
| Un anonyme (Haute-Saône) | 30 | » |
| Un Anonyme, officier, Avignon | 2 | » |
| V. D. S. J. | 20 | » |
| C. F., a Avignon | 0 | 50 |
| Deux félibres, Avignon | 1 | 50 |
| Deux charpentiers, Avignon | 1 | » |
| H. H. Y. (Côtes-du-Nord) | 5 | » |
| Un lecteur des Semaines, Avignon | 0 | 50 |
| Un moine de Lérins | 10 | » |
| Un petit belge | 1 | » |
| T., a Avignon | 2 | » |
| ————— | ||
| Total | 6,723 | 30 |
INDEX ALPHABÉTIQUE
DES
NOMS PROPRES CITÉS DANS CE VOLUME
A
About (Edmond), 174, 214, 259, 403, 404, 405, 407, 409, 423, 471.
Affre (Mgr), 153.
Agniel (l’abbé), 496.
Alboni (Marietta), 441.
Alembert (d’), 287.
Alexandre (Charles), professeur, 34.
Alibert (le Dr), 41.
Allan (Mme), comédienne, 121.
Allevarrès. Voyez Serravalle.
Alloury (Antoine), 233.
Alzon (Emmanuel d’), 24, 43, 44, 45, 471.
Ampère (André-Marie), 41.
Ampère (Jean-Jacques), 75.
Ancelot (Mme), 115.
Andigné (Auguste, comte d’), 154, 351.
Andigné (Léon, marquis d’), 351.
Angles (Monsieur des), 5.
Angoulême (duchesse d’), 19, 20, 21.
Anselme (H. d’), 84.
Appius Claudius, 187.
Arbouville (Mme d’), 115.
Archimbaud (Alphonse d’), 372.
Arnal, comédien, 290.
Arnault (Antoine-Vincent), 58
Athénosy (Isidore d’), 372.
Atticus, 478.
Aubanel (Théodore), 469.
Auber, 53.
Aubryet (Xavier), 347.
Audiffret-Pasquier (duc d’), 426, 427.
Audigier (Henri d’), 250.
Audran (Girard), graveur, 434.
Augier (Émile), 143, 172, 198, 199, 216, 218, 232, 309, 418, 485.
Aumale (duc d’), 397, 398, 403, 413, 419.
Autran (Joseph), 101, 143, 174, 224, 226, 229, 233, 234, 239, 267, 282, 283, 284, 287, 289, 293, 298, 299, 301, 302, 304, 306, 307, 308, 319, 320, 356, 358, 360, 361, 364, 371, 389, 398, 399, 400, 402, 406, 407, 409, 410, 415, 416, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 471, 478.
Autran (Mme Joseph), 305, 399, 426.
Averton (Frédéric d’), 91, 92, 93, 94, 95, 96, 105.
Averton (Guy d’), 94.
B
Baciocchi (Eugène de), 372.
Bailly de Surcy, 57.
Ballanche, 40.
Balzac (H. de), 54, 74, 116, 156, 179, 214, 221, 237, 238, 254, 255, 304.
Baragnon (Louis-Numa), 340.
Baraguey d’Hilliers (Achille, comte), maréchal de France, 153.
Barante (baron Prosper de), 471.
Barbentane (marquis Léon de), 350.
Barbey d’Aurevilly (Jules), 138, 233, 244, 260, 472, 473, 474.
Barbier (Auguste), 394, 418, 420.
Barni (Jules), 349.
Barodet, 356.
Barrême, calculateur, 389.
Barrot (Odilon), 321.
Barthélemy (Auguste), 488.
Barthélemy (marquis de), 153.
Bastet (Antoine), sculpteur, 434, 462.
Bastet (J.), 84.
Baudelaire (Charles), 471.
Bayle (Pierre), 468.
Beauchesne (Alcide de), 174.
Beausacq (comtesse Diane de), 466.
Beauvoir (Roger de), 114, 115, 156.
Béchard (Ferdinand), 270.
Béchard (Frédéric), 267, 270, 288, 296, 297, 315, 316, 317, 318.
Belcastel (Gabriel de), 432, 458.
Bellangé, peintre, 385.
Belleval (marquis de), 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 182, 250.
Belvèze (de), 166.
Bentzon (Mme Th.), 183.
Béranger (P.-J. de), 139, 144, 167, 204, 205, 206, 207, 237, 308.
Berlioz (Hector), 450.
Bermond (de), 72.
Bernard (Saint), 208.
Bernard (Charles de), 144, 471, 477.
Bernard (Claude), 418, 420, 427.
Bernardi (de), 161.
Berne-Bellecour, peintre, 385.
Bernhardt (Rosine Bernard, dite Sarah), 358, 384.
Bernis (comtesse René de), 16.
Bernis (Léon de), 43.
Berry (duc de), 17.
Berry (duchesse de), 60, 70, 71, 109, 369.
Berryer, 14, 54, 66, 73, 81, 82, 83, 91, 98, 99, 100, 101, 128, 153, 171, 177, 270, 299, 302, 312, 313, 346, 392, 394, 432, 450, 451, 452, 471.
Bert (Paul), 349.
Bertin (Ernest), 479.
Bertin (Jean-Victor), 10.
Berthoud (Henry), 114.
Besplas (marquis de), 118, 358, 368, 375.
Besson (Mgr), 439.
Beudin, auteur dramatique, 31.
Beugnot (comte Arthur), 172.
Bidault, peintre, 10.
Biliotti (marquis de), 360.
Biot, 41.
Biré (Edmond), 13, 131, 168, 191, 313, 372, 446, 451, 452, 484.
Bismarck (prince de), 278, 363.
Bitaubé, 40.
Blain, tailleur, 45.
Blanc (Louis), 307.
Blanchetti (Paul), 15.
Blaze de Bury (Henry), 76, 124, 191.
Blocqueville (marquise de), 478.
Boigne (comtesse de), 466.
Boissier (Gaston), 482.
Boissieu (Arthur de), 267, 291, 300, 355.
Bonington, 53.
Bonjour (Casimir), 98.
Bonnat, 383.
Bonnet (le P. Élie), 491.
Borderies (Mgr), 28.
Bosio, sculpteur, 53.
Bossuet, 15, 18, 41, 361, 474.
Boudin, cafetier, 69.
Boudin fils, 69.
Bouglé (Charles), 244.
Bouhours (le Père), 194.
Boulay de la Meurthe (le comte Joseph), 39.
Bourbousson, député, 161.
Bourdaloue, 15.
Bourmont fils (de), 72.
Brascassat, peintre, 53.
Bressant, acteur, 166.
Bridaine (le P.), 19.
Brière, imprimeur, 132.
Brindeau (Paul), acteur, 149.
Brizeux (Auguste), 471.
Broglie (duc Victor de), 48, 105, 397, 405, 407.
Broglie (duc Albert de), 165, 212, 235, 321, 374, 405, 408, 413, 418, 426, 482.
Brunetière (Ferdinand), 237, 264.
Bucheron (Arthur-Marie), connu sous le pseudonyme de Saint-Genest, 327, 343, 356, 379.
Bugeaud (le maréchal), 153.
Buloz (François), 77, 108, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 147, 160, 162, 163, 173, 174, 182, 183, 232, 233, 234, 262, 264, 279, 280, 281, 372, 373, 380, 471.
Buloz (Christine Blaze, dame), 124.
Bussières (de), 207.
Bussonnier, pâtissier, 39.
C
Cadot (Alexandre), éditeur, 156.
Calonne (Alphonse de), 135, 138, 143, 169, 175, 215, 250.
Calvière (marquis de), 16, 17.
Calvière (marquise de), 66, 71.
Cambacérès (le prince), 38.
Cambis d’Orsan (Henri de), marquis de Lagnes, grand-père maternel de Pontmartin, 12.
Cambis d’Orsan (Augustine de Grave, marquise de), grand’mère maternelle de Pontmartin, 12, 13, 16.
Cambis (Henriette de), 12, 14.
Cambis (Augustin, marquis de), pair de France, 12, 16, 23, 39, 40, 56, 59, 60, 81, 82, 117, 130.
Cambis (Henri de), 24, 43, 45, 56, 68, 82.
Cambis (l’abbé Adalbert de), 14, 27, 45.
Candolle (de), 72.
Candolle (Pyrame de), botaniste, 75.
Captier (le Père), 336.
Cardinal (Mme), 108, 112, 113.
Carné (comte Louis de), 49, 57, 59, 212, 213, 409, 410, 418, 471.
Caro (Edme), 174, 394, 423, 482.
Caro (Mme Edme), 465.
Caron, restaurateur, 368.
Carrel (Armand), 123.
Cars (duc des), 132.
Castil-Blaze (Henri-Joseph Blaze, dit), 76, 124, 234.
Caussidière, 307.
Cauvièrez, 72.
Cavaignac (général), 136.
Cazalès (Edmond de), 57, 59, 212.
Chaix (l’abbé), 332.
Chalenton (l’abbé), 6.
Challemel-Lacour, 267, 281, 290, 331.
Cham (vicomte Amédée de Noé, dit), 126, 140, 141, 142.
Chambord (comte de), 71, 91, 94, 168, 353.
Champagny (Franz de), 393, 394, 409, 419.
Champmartin, peintre, 76.
Changarnier (général), 147, 153.
Charette (général baron de), 374, 443.
Chasles (Philarète), 114, 172, 174.
Chassériau (Théodore), 144.
Chatham (lord), 100.
Chateaubriand, 39, 54, 130, 145, 230, 260, 299, 311, 361, 448, 491.
Chaudes-Aigues (J.), 86.
Chevandier de Valdrôme (Eugène), 324, 325, 326.
Chevandier de Valdrôme (Paul), 301, 325.
Chevreau (Henri), 322.
Cicéron, 478.
Circourt (Albert, comte de), 135, 154, 168.
Claretie (Jules), 237, 257, 303, 305, 314, 346, 473, 478, 481.
Condillac, 42.
Constans (Ernest), 487.
Coppée (François), 466.
Cormenin (vicomte de), 98.
Corneille (Pierre), 18, 40, 129.
Cornudet (Léon), 65.
Corot, peintre, 10.
Cortot, sculpteur, 53.
Coulondres (Alfred), 440.
Coupvent des Bois (amiral), 166.
Courier (Paul-Louis), 205.
Courtet (Jules), 84.
Cousin (Victor), 46, 47, 48, 50, 51, 54, 122, 153, 154, 232, 235, 260, 331, 441, 450, 471, 482.
Cuvier (Georges), 54.
Cuvillier-Fleury, 49, 62, 91, 98, 99, 100, 101, 169, 194, 356, 380, 389, 400, 401, 406, 407, 410, 413, 414, 415, 416, 418, 420, 423, 443, 444, 448, 453, 475, 478, 479, 480, 481.
D
Dabadie, chanteur, 42.
Dalloz (Paul), 343.
Dambray (le chancelier), 38.
Damiron, 49.
Damoreau-Cinti (Mme), cantatrice, 42, 47, 142.
Daudet (Alphonse), 469.
David d’Angers, 53.
Deguerry (l’abbé), 311.
Delaborde (vicomte Henri), 117.
Delahante (Adrien), 43.
Delalot (vicomte), 40.
Delaporte (le Père Victor), 460.
Delaroche (Paul), 41, 53, 75, 450.
Delibes (Léo), 357.
Delille (Jacques), 51.
Delord (Taxile), 206, 225, 237, 255, 256, 259.
Demante (A.-M.), 47.
Deplace (l’abbé Charles), 84.
Deregnaucourt, député, 348.
Deretz, journaliste, 91, 92, 93, 94.
Déroulède (Paul), 466.
Désaugiers, 205.
Descartes (René), 42.
Des Essarts (Alfred), 115.
Desmousseaux de Givré, 172.
Detaille, peintre, 385.
Didon (le Père), 444.
Dinaux, auteur dramatique, 31, 78.
Dorval (Mme), 31, 66, 78, 79, 80, 101.
Double (le Dr François-Joseph), 7, 23, 41, 172.
Double (Léopold), 7.
Doucet (Camille), 33, 415, 418.
Doudan (Ximénès), 99.
Dreux-Brézé (marquis de), 43.
Dreux-Brézé (Pierre de), évêque de Moulins, 43, 432, 458.
Dubois (P.-J.), 49.
Du Boys (Albert), 429.
Duboys d’Angers, 332.
Du Caurroy, 47.
Du Cayla (Ugolin), 43.
Duchesnois (Mlle), 41.
Duclos (François), 360.
Dumarsais (l’abbé), 26.
Dumas (Adolphe), 101.
Dumas père (Alexandre), 78, 79, 114, 156, 158, 172, 289, 290, 423, 448, 477.
Dumas fils (Alexandre), 156, 216, 217, 232, 267, 280, 282, 283, 284, 289, 305, 349, 398, 407.
Dumont, professeur, 34.
Dumont, statuaire, 53.
Dupanloup (Mgr), 27, 213, 267, 281, 299, 358, 377, 378, 381, 389, 403, 404, 407, 409, 420, 427, 428, 450, 471.
Dupaty (Emmanuel), 201.
Dupont (Alexis), 42.
Dupray, peintre, 385.
Dupré (Edmond), 169, 188, 189.
Duprez (Gilbert-Louis), chanteur, 142, 387.
Dupuy, de Cavaillon, 161.
Dupuy, d’Orange, 161.
Durand (baronne), 154.
Durand (Justin), député, 332.
Durand (Mme Justin), 332, 333.
Duranton, 47.
Durozoir (Charles), 34.
Du Theil, avocat, 115.
Duvergier de Hauranne (Prosper), 49, 393, 397, 405, 413, 418.
E
Eckmühl (Louis d’), 43.
Édouard et Félix, restaurateurs, 347.
Empis, académicien, 389, 392, 393, 394.
Erckmann-Chatrian, 280.
Escande (Amable), 267, 270, 271.
Esig (François), 72.
Esménard, 40.
Esquiros (Alphonse), 331.
Eugénie (l’Impératrice), 326.
F
Fabre (Ferdinand), 485.
Fages (Émile), 265.
Falcon (Mlle), 142.
Fallières (Armand), 487.
Falloux (comte Alfred de), 49, 126, 128, 148, 153, 154, 155, 160, 172, 177, 191, 212, 213, 235, 299, 321, 327, 345, 353, 389, 396, 397, 398, 407, 409, 417, 418, 420, 423, 471.
Faure, chanteur, 323.
Fauriel (Claude), 75.
Favre (Jules), 37, 299, 407, 413, 418, 423.
Fay (Léontine), voir Volnys.
Félix (le Père), 204, 231, 232, 267, 290, 291.
Ferdinand VII, 71.
Ferrar (Antoine de), 3.
Ferrari (Antoine), 72.
Ferville, comédien, 31.
Feuillet (Octave), 216, 217, 232, 250, 271, 418, 420, 465, 482.
Féval (Paul), 114, 172, 174, 482.
Fezensac (duc de), 144.
Flandrin (Hippolyte), 144.
Flotte (Paul de), 143.
Fonfrède (Henri), 98.
Foudras (marquis de), 114, 156.
Fournès (marquis de), 104.
Fourtou (de), 374.
Foyatier, 53.
Frédéric II, 363.
Froissard-Broissia (de), 497.
G
Gaillard (Léopold de), 161, 162, 178, 237, 257, 259, 274, 291, 307, 321, 336, 357, 372, 376, 377, 400, 401, 404, 406, 417, 426, 427, 430, 439, 440, 442, 461, 464, 478, 483, 485, 490, 491.
Gaillardin (Casimir), 43.
Gambetta (Léon), 327, 329, 349, 352, 367, 413, 473.
Ganail, 72.
Ganser (l’abbé), 26.
Garcia (Manuel), 441.
Garibaldi (Giuseppe), 329.
Gaussin (Mlle), 384.
Gautier (Théophile), 53, 56, 127, 182, 191, 192, 217, 226, 382, 393, 394, 398, 471.
Gay (Mme Sophie), 115.
Gay-Lussac, 41.
Genoude (Eugène de), 130, 135.
Gent (Alphonse), 161.
Genty de Bussy, 98.
Geofroy (Louis de), 149.
Gérard (le baron), 53.
Gilly (le général), 17.
Ginestous (comte de), 270, 271.
Girardin (Émile de), 130, 222, 263, 358, 383, 384, 385.
Girardin (Mme Émile de), 178, 192, 222, 263.
Girardin (Saint-Marc), 49, 130, 153, 154, 160, 260, 293, 295, 389, 407, 409, 410, 414, 420, 423, 471, 482.
Girodet, 491.
Gluck, 47.
Gobineau (Arthur de), 114.
Goncourt (Edmond et Jules de), 280.
Gondinet (Edmond), 357.
Gondrecourt (général de), 114, 156.
Gontier, acteur, 31.
Got (Edmond), 149.
Goubaux, auteur dramatique, 31.
Goupil, 385.
Gozlan (Léon), 114, 116, 172, 174, 195, 196, 198, 199.
Grandmanche de Beaulieu, 332.
Granet, peintre, 53.
Grangé (Pierre-Eugène Basté, dit), 297, 298.
Granier, sénateur, 161.
Granier de Cassagnac (Adolphe), 19, 244.
Gras (Félix), 469.
Grave (le chevalier de), 12, 13.
Grave (marquis de), 12.
Grimod de la Reynière, 288.
Grisi (Julia), 441.
Gros (Étienne), professeur, 23, 30.
Gudin (Théodore), 53.
Guerry (marquis de), 13.
Guilhermier (Louis de), 372.
Guinot (Eugène), 250.
Guizot (François), 41, 47, 48, 49, 54, 123, 171, 174, 177, 178, 235, 243, 260, 271, 302, 321, 407, 413, 418, 420, 424, 426, 427, 448, 450, 470, 471, 479, 482.
Guizot (Guillaume), 174.
Guyon (le Père), 19.
Guyot, éditeur, 140.
H
Halévy (Ludovic), 112, 446, 482.
Hamelin (l’abbé), 28.
Hanska (comtesse), plus tard Mme H. de Balzac, 254.
Haussmann (le baron), 275, 308.
Haussonville (comte Bernard d’), 327, 343, 394, 407, 418, 426, 427, 430, 482.
Heim, peintre, 53.
Heine (Henri), 122.
Heine (Mme), 298.
Hello (Ernest), 244.
Hoffmann (Théodore), 275.
Horace, 36, 205, 362, 463, 488.
Homère, 129.
Houssaye (Henry), 487.
Hugo (Victor), 18, 53, 54, 74, 78, 80, 85, 86, 87, 98, 123, 153, 214, 215, 238, 260, 268, 275, 308, 313, 349, 360, 418, 435, 469.
Hyacinthe (Louis-Hyacinthe Duflost, dit), 444.
I
Iawureck (Mlle), cantatrice, 42.
Ingres, 53.
Isabey (J.-B.), 53.
Ivoi (Paul d’), 250.
J
Jacquemart (Mlle Nélie), 383.
Janicot (Gustave), 271, 312, 454, 455.
Janin (Jules), 46, 52, 79, 116, 127, 192, 193, 217, 237, 250, 265, 358, 362, 380, 389, 396, 397, 405, 418, 420, 424, 430, 471.
Jonquières (le P. Amédée de), 372.
Josserand, libraire, 332.
Joudou, journaliste, 66, 77, 82, 83.
Jouffroy (Théodore), 48.
Jourdan (Louis), 207.
Jouvenet (Jean), 434.
Jouy (Victor-Joseph Etienne, dit de), 58.
Jussieu (Adrien de), 75.
Juteau (Emma), acrobate, 474.
K
Karr (Alphonse), 114, 191, 250.
Kerdrel (Audren de), 166.
Kergorlay (comte de), 72.
Kergorlay fils (de), 72.
L
La Bédollière (Émile Gigault de), 207.
Laborde (Léo de), 161, 237, 257, 304.
La Bouillerie (Charles de), 43.
Laboulie (Gustave de), 71, 91, 94, 95.
La Bourdonnaye (abbé de), 23, 27.
La Bruyère (Jean de), 41, 140.
Lacenaire, 112.
Lachaud (de), 72.
Lacombe (Charles de), 83, 451.
Lacordaire (le Père), 25, 168, 213, 231, 377.
Lacroix (Jules), 191.
Lacroix (Paul), 191.
La Ferrière (Hector de), 43.
Lafitte (Pierre), 78.
Lafond (Ernest), 332.
La Fontaine (Jean de), 188.
Lagrange (Mgr), 377.
La Madelène (Henry de), 251.
La Madelène (Jules de), 251.
Lamartine (Alphonse de), 52, 53, 54, 85, 86, 87, 108, 116, 130, 143, 144, 152, 260, 271, 301, 308, 311, 312, 313, 314, 321, 338, 380, 394, 397, 435, 448, 471, 489.
Lamartine (Mme Valentine de), 311.
Lamoricière (général de), 152, 443.
Lanfrey (Pierre), 329.
Lanjuinais (Victor), 156.
Laprade (Victor de), 191, 239, 274, 284, 291, 299, 301, 307, 308, 377, 401, 406, 409, 413, 415, 418, 419, 420, 421, 422, 424, 471, 478.
Larcy (baron de), 49, 73, 128, 164, 165, 471.
Laroche, 298.
La Roche-Guyon (duchesse de), 478.
Larochette (Mme de), 106.
La Rochejaquelein (marquis Henri de), 153.
La Roque (Louis de), 454, 455.
La Tour du Pin (Guy de), 43.
Laurentie (Pierre-Sébastien), 130, 154, 270.
La Valette (Adrien de), 169, 176, 177.
Lavedan (comte Léon), 376, 392.
Lavedan (Henri), 358, 388, 452.
Layet de Podio, 72.
Lebeschu (Mlle Mathilde), 72.
Lebrun (Pierre), 412, 413, 420, 423.
Lecanuet (le Père), 212.
Leclerc (Edmond), 117.
Lecoffre (Jacques), 237, 240, 242, 243, 246, 247, 249.
Lecomte (général), 337.
Lefêvre-Deumier (Jules), 234.
Lefort, 378.
Legallois (Mlle), 42.
Legouvé (Ernest), 33, 237, 255, 256, 410, 415, 416, 418.
Lemaître (Frédérick), 31.
Lemoinne (John), 130.
Lenormant (Charles), 213.
Lenormant (Mme Charles), 454.
Lerminier, 178.
Lévy (Calmann), 184, 217, 447, 462.
Lévy (Michel), 218, 225, 226, 277, 302, 348.
Libri (Guillaume-Brutus-Icilius), 7.
Liez, proviseur, 26.
Lireux (Auguste), 131.
Liszt (Franz), 76.
Littré (Émile), 398, 403, 404, 405, 407, 408, 413, 418, 423.
Loménie (Louis de), 399, 403, 417, 420, 427, 428.
Louis-Philippe Ier, 129, 132, 307, 373, 395.
Lourdoueix (Honoré de), 135, 154, 271.
Luce de Lancival, 40.
Lucrèce, 27.
Luther (Mlle Amédine), 149.
Luynes (Honoré-Théodore, duc de), 75.
M
Machiavel, 299.
Mac-Mahon (maréchal de), 357, 374, 412.
Maigret, peintre, 385.
Maillé (marquis de), 153.
Maistre (Joseph de), 139, 160, 168, 473, 474.
Malibran (Mme), 45, 142, 279, 387, 441.
Mallac (Éloi), 169, 177, 178, 205.
Mandaroux-Vertamy, 177.
Mante (Mlle), 149.
Manuel (Eugène), 413.
Manzoni (Alexandre), 308.
Marcellus (comte de), 172.
Mario (Joseph, marquis de Candia, dit), chanteur, 142, 387, 441.
Marmier (Xavier), 75, 154, 172, 397, 405, 410, 415, 416, 418, 420.
Marrast (Armand), 153.
Mars (Victor de), 123, 234, 281, 372, 373.
Martin (John), peintre anglais, 335.
Masgana (Paul), libraire, 54, 370.
Massillon, 15.
Mathieu, astronome, 41.
Mathieu (Anselme), 469.
Maumus (le Père), 444.
Melun (vicomte Armand de), 25, 26, 213.
Merlin (comtesse), 115.
Mérimée (Prosper), 54, 66, 76, 101, 122, 171, 174, 296, 323, 331, 360, 396, 403, 477.
Mermet (Auguste), 347.
Méry (Joseph), 75, 108, 115, 172, 174.
Mesnard (comte de), 72.
Meyerbeer, 450.
Mézières (Alfred), 423.
Michaud jeune, 66, 88, 98, 324.
Michelet (Jules), 271, 272, 466.
Mignet (François), 154, 302, 418, 482.
Mirbel (Charles-François), botaniste, 75, 76.
Mirecourt, acteur, 149.
Mistral (Frédéric), 327, 350, 351, 460, 469, 470.
Mitchell (Robert), 347.
Moczinska (comtesse), 7.
Mohl (Mme), 413.
Moisant (Constant), 111.
Moland (Louis), 138.
Molé (comte), 123, 153, 172, 177, 450.
Monnier des Taillades, 91, 95.
Montaigne (Michel de), 238.
Montalembert (comte Charles de), 49, 54, 65, 191, 204, 210, 212, 213, 235, 260, 299, 396, 397, 409, 450, 482.
Montépin (Xavier de), 136.
Montessu (Mlle), 42.
Montesquiou (de), 378.
Monteynard (Raymond de), 43.
Montfaucon (baron de), 66, 68.
Montgrand (marquis de), 73.
Montmorency (duc de), 154.
Montravel (M. de), beau-père de Pontmartin, 106.
Montravel (Mme de), belle-mère de Pontmartin, 106.
Montravel (comte de), beau-frère de Pontmartin, 497.
Montravel (Théodore de), 497.
Mozart, 381.
Mouchy (duc de), 153.
Muret (Théodore), 114, 131, 132, 133, 134, 137, 215.
Mürger (Henri), 169, 175, 232, 234.
Musset (Alfred de), 49, 53, 66, 74, 85, 86, 87, 121, 122, 127, 149, 191, 260, 373, 435.
Musset (Paul de), 373.
N
Nanteuil (Charles-François Lebœuf, dit), sculpteur, 53.
Napoléon III, 153, 168, 222, 320, 395.
Napoléon (le prince), 484.
Nettement (Alfred), 115, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 154, 167, 172, 176, 191, 216, 237, 239, 240, 242, 243, 244, 248, 486.
Nettement (Mme Alfred), 167, 243.
Neuville (Alphonse de), peintre, 385.
Nicole (Pierre), 18.
Nicolle (l’abbé), 25.
Nicolle (Henri), 25.
Nilsson (Mlle), 312.
Nisard (Désiré), 49, 191, 419, 432, 459, 482.
Noailles (duc Paul de), 48, 153, 171, 177, 235, 409, 414, 419.
Noblet (Mlle), 42.
Normand (Jacques), 226.
Normand (Mme Jacques), 226.
Nourrisson (Félix), 178.
Nourrit (Adolphe), 42, 47, 142.
Nuitter (Charles), 347.
Numa, comédien, 31.
O
Olivier (Juste), 230.
Ollivier (Aristide), 270.
Ollivier (Émile), 14, 320, 321, 325, 326, 338, 397, 405, 407, 432, 459, 484.
Ollivier (d’), 161.
Orsay (comte d’), 263.
Ortigue (Joseph d’), 113, 267, 285, 286, 287, 459.
P
Pailhès (l’abbé), 299.
Palikao (comte de), 326.
Parfait (Paul), 289.
Paris (Mgr le comte de), 458.
Paris (Paulin), 172.
Patin (Guillaume), 154, 413, 414, 418, 420.
Paul, comédien, 31.
Pelletan (Eugène), 115.
Pellico (Silvio), 74.
Pêne (Henri de), 126, 138, 309, 310, 353.
Perreyve, professeur de droit, 190.
Persiani (Mme), 142.
Pichot (Amédée), 179.
Pie IX, 299.
Pin (Elzéar), 161.
Pingard, 413.
Pitrat, libraire, 332.
Planche (Gustave), 79, 108, 121, 125, 193, 214, 225, 260.
Planche (Louis-Augustin), 370.
Plantier (Mgr), 439.
Plautin (l’abbé), 457.
Poisson, géomètre, 45.
Polignac (Jules de), 6, 16, 60, 99.
Polignac (Melchior de), 6.
Polignac (comtesse Diane de), 6.
Poncelet, professeur de droit, 46, 47.
Ponsard (François), 55, 141, 174, 216, 218, 301, 302, 306, 307.
Ponson du Terrail, 126, 137, 138.
Pontmartin (Joseph-Antoine de Ferrar, comte de), grand-père de Pontmartin, 3, 4, 5, 8.
Pontmartin (Jeanne-Thérèse Calvet des Angles, dame de), grand’mère de Pontmartin, 4, 5.
Pontmartin (Mme de), seconde femme de Joseph-Antoine, 5, 8.
Pontmartin (Eugène de), père d’Armand de Pontmartin, 5, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 26, 46, 60, 434.
Pontmartin (Émilie de Cambis, dame de), mère d’Armand de Pontmartin, 11, 14, 15, 18, 26, 67, 71, 72, 103, 108, 118.
Pontmartin (Joseph de), oncle de Pontmartin, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 21, 27, 30, 46, 47, 60, 61, 434.
Pontmartin (Cécile de Montravel, comtesse Armand de), 106, 107, 327, 338, 339.
Pontmartin (Henri de), 166, 223, 225, 305, 447, 497.
Pontmartin (Jeanne d’Honorati, comtesse Henri de), 447.
Portal (le docteur), 38.
Potocki (comte Vincent), 6.
Prailly (baron de), 377.
Prailly (baronne de), 377.
Prévost-Paradol, 301, 321, 323, 355, 396, 403.
Protais, peintre, 385.
Proudhon (P.-J.), 130.
Provost, comédien, 149.
Pougeard-Dulimbert, 224.
Poujoulat (François), 88, 154.
Poussel (Henri), 454.
Q
Quélen (Mgr de), 28.
R
Rachel (Mlle), 263, 301, 306, 384.
Racine (Jean), 18, 40, 381, 489.
Ract-Madoux, professeur, 23, 26.
Raoul-Rochette, 171.
Raousset-Boulbon (Gaston, comte de), 161.
Raphaël, 474.
Raspail (Eugène), 161.
Rattier (Paul), 126, 148, 151.
Rauzan (duc de), 153.
Ravignan (le Père de), 213, 231.
Récamier (le docteur), 41.
Redon père, avocat, 94.
Redon fils, avocat, 94.
Regnard, 140.
Régnier (François-Joseph), acteur, 127.
Reichemberg (Mlle Suzanne), 474.
Rémusat (Charles de), 49, 116, 356, 418, 471.
Renan (Ernest), 277, 278, 407, 423.
Renduel (Eugène), 81.
Renoard (Ulric de), 91, 94, 95, 96, 105.
Renouvier (Charles), 40.
Renouvier (Jean-Antoine), 40.
Renouvier (Jules), 40.
Retouret (Léonard), 43, 46, 63, 77.
Riancey (Henry de), 222, 229, 242.
Ricard (Gustave), 414.
Richard (Maurice), 326.
Richard-Lucas, restaurateur, 126, 166.
Rigaud, procureur du roi, 91, 95.
Rigaud (Hippolyte), 233.
Rigaut-Palar (Mme), 41.
Robert (Léopold), 53.
Robillard d’Avrigny, 215.
Rochefort (Henri), 269.
Rocheplatte (comte de), 377.
Rocheplatte (comtesse de), 377, 378.
Rochetin, 498.
Rohan (l’abbé duc de), 28.
Rolle (Hippolyte), 127.
Roselly de Lorgues, 281.
Rossini, 42, 47, 53, 381, 441.
Rostand (Alexis), 365.
Rostand (Edmond), 365.
Rouher (Eugène), 308.
Roumanille (Joseph), 440, 454, 469, 470.
Rousseau (Jean-Jacques), 355.
Rousset (Camille), 399, 403, 405, 408, 415, 418, 453.
Rouzeaud (Auguste), 312.
Royer (Alphonse), 347.
Royer-Collard, 98.
Rude (François), 53.
S
Sacy (Silvestre de), 49, 130, 267, 272, 285, 413, 418, 471.
Sade (marquis de), 473.
Saint-Mart (de), 19.
Saint-Priest (comte Armand de), 40.
Saint-Priest (Emmanuel-Louis Guignard, vicomte de), 66, 71, 72, 132, 154, 177.
Saint-Simon (duc de), 464.
Saint-Victor (Paul de), 217, 382, 471, 482.
Sainte-Beuve, 23, 36, 48, 53, 54, 70, 74, 85, 108, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 144, 145, 169, 184, 186, 187, 188, 189, 230, 235, 237, 250, 254, 260, 262, 263, 301, 313, 314, 315, 360, 389, 392, 394, 395, 396, 397, 471.
Sala (Adolphe), 72, 131, 134, 136, 154.
Salacroux (l’abbé), 26.
Salinis (Mgr de), 25.
Salvador (vicomte Jules de), 91, 92, 93, 94, 95, 96, 108, 304.
Salvandy (comte de), 171, 174, 177, 471.
Sand (George), 74, 85, 121, 122, 156, 271, 329, 448.
Sandeau (Jules), 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 119, 126, 144, 155, 191, 198, 199, 221, 237, 254, 256, 263, 356, 357, 408, 410, 415, 418, 424, 471, 477.
Sandeau fils (Jules), 110.
Sarcey (Francisque), 217, 456.
Sardou (Victorien), 216, 217, 301, 309, 310, 426.
Sass (Mme Marie), 323.
Saulcy (de), 171.
Schnetz (Jean-Victor), 53.
Scholl (Aurélien), 267, 287, 288.
Scorbiac (abbé de), 25.
Scribe, éditeur, 140.
Scribe (Eugène), 120, 121, 127, 217, 369, 485.
Second (Albéric), 347.
Seguin (François), 440.
Ségur (général Philippe de), 58, 409, 410.
Sémonville (marquis de), 38.
Serravalle (Jules de), 182.
Serre (comte de), 98.
Sibour (abbé Léon), 26.
Sigalon (Xavier), 53.
Sigoyer (Antonin de), 84.
Simon (Jules), 374.
Soulié (Frédéric), 78, 156, 477.
Souvarow, 7.
Souza (Mme de), 113.
Spuller (Eugène), 487.
Standish (Mme), 378.
Stern (comtesse d’Agoult, dite Daniel), 116.
Sue (Eugène), 101, 143, 158, 477.
Syon (baron de), 160.
T
Tacite, 442.
Taillandier (Saint-René), 122, 399, 403, 409, 417, 420.
Tarbé des Sablons (Edmond), 138, 353, 410, 411.
Taylor (baron), 171.
Teste (Adolphe), 94.
Teste (Jean-Baptiste), 94.
Texier (Edmond), 172.
Thalberg, 452.
Thénard (baron), 41.
Thérésa (Emma Valadon, dite), 279.
Thévenet, 487.
Thibault (abbé), 26.
Thiébault, fondeur, 462.
Thierry (Augustin), 69, 122, 217.
Thiers (Adolphe), 144, 153, 200, 288, 302, 321, 327, 348, 356, 357, 358, 376, 383, 397, 405, 408, 412, 416, 418, 424, 427, 471.
Thomas (Ambroise), 312.
Thomas (Clément), 337.
Thureau-Dangin (Alfred), 64.
Thureau-Dangin (Paul), 46, 64, 65.
Tirard, 487.
Tocqueville (Alexis de), 260.
Torcy (Féodor de), 43.
Treilhard (comte Achille), 272.
Tréveneuc (de), député, 166.
Troubat (Jules), 230.
U
Uchard (Mario), 347.
V
Valette, professeur, 23, 34, 42.
Valmy (duc de), 177.
Vaucorbeil, 347.
Vendel-Heyl, professeur, 23, 30, 34.
Ventura (le Père), 172.
Véra (Mlle Sophie), 142.
Verdi, 312.
Véron (docteur), 192.
Vertpré (Jenny), 31.
Veuillot (Louis), 130, 144, 160, 162, 169, 177, 191, 192, 193, 194, 204, 205, 206, 207, 209, 212, 227, 228, 229, 235, 244, 249, 271, 279, 404.
Viardot (Pauline Garcia, dame), 441.
Vibert, peintre, 383.
Viel-Castel (baron Louis de), 403, 407, 410, 417, 418, 420.
Viennet (Jean-Pons-Guillaume), 101, 153, 171, 175, 392, 394, 414.
Vigny (Alfred de), 53, 74, 78, 122, 260, 435, 471.
Villelume-Sombreuil (comte de), 19.
Villemain (Abel), 41, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 153, 171, 172, 174, 235, 260, 323, 391, 396, 397, 403, 441, 450, 471, 482.
Villemessant (Hippolyte Cartier, dit de), 136, 250, 315, 316, 317, 318.
Villemot (Auguste), 250.
Virgile, 21, 27, 463, 483, 488, 489.
Vitet (Ludovic), 49, 122, 154, 171, 174, 175, 407, 414, 415, 420, 423, 471, 482.
Vogüé (comte de), 223.
Vogüé (vicomte Eugène-Melchior de), 223, 365, 484.
Voillet, dit Voillet de Saint-Philbert, 132.
Voisins (de), 166.
Volnys (Léontine Fay, dame), 31, 358, 368, 369.
W
Wallace (sir Richard), 347.
Wallon (Henri), 399.
Walsh (vicomte Édouard), 91, 105, 107, 109, 114, 115, 129, 156.
Walsh (vicomte Joseph), 105.
Z
Zola (Émile), 389, 424, 443, 462, 467, 468, 483, 486, 487, 489, 493.
TABLE DES MATIÈRES
| CHAPITRE PREMIER | |
| La Famille et l’Enfance (1811-1823). | |
| Les Ferrar. Le traducteur du Tasse. Le comte Joseph-Antoine et Monsieur des Angles. L’Émigration. En Ukraine.—Retour aux Angles. L’Oncle Joseph. M. Eugène de Pontmartin et Mlle Émilie de Cambis. La marquise de Guerry et les Trois Veuves.—Naissance d’Armand de Pontmartin. L’hôtel de Calvière et Mademoiselle de Sombreuil. La Mission de 1819 et le voyage de la duchesse d’Angoulême. Virgile et M. Ract-Madoux. | 1 |
| CHAPITRE II | |
| Les Années de collège (1823-1829). | |
| Le voyage d’Avignon à Paris en 1823. Au 37 de la rue de Vaugirard. Le collège Saint-Louis. Le catéchisme de Saint-Thomas-d’Aquin et l’abbé de La Bourdonnaye.—MM. Roberge, Étienne Gros et Vendel-Heyl. Vox faucibus hæsit.—M. Valette et M. Michelle. Le Concours général. Sainte-Beuve et les vers latins.—Le jardin du Luxembourg, le salon du marquis de Cambis et le salon du docteur Double. Le comte Ory. Les camarades de Saint-Louis. Emmanuel d’Alzon et Henri de Cambis. | 23 |
| CHAPITRE III[532] | |
| L’École de Droit (1829-1832). | |
| M. Poncelet ou le professeur mélomane. A la Sorbonne. Cours de MM. Guizot. Villemain et Cousin.—Jules Janin et le Siècle de Charles X. Les arts et les lettres en l’an de grâce 1829. Le romantisme de Pontmartin.—L’atelier de Paul Huet et la première représentation d’Hernani. Félix Lebertre et la Silhouette. Le Petit Plutarque français. Le Correspondant. Première rencontre de Pontmartin avec l’Académie. Mort de M. Eugène de Pontmartin.—Mort de l’oncle Joseph. Le choléra. La prédiction de Léonard Retouret et le 19 avril 1832. La première représentation de la Tour de Nesle. Alfred Thureau-Dangin.—Retour à Avignon. | 46 |
| CHAPITRE IV | |
| Les Années d’Avignon (1833-1838). | |
| La rue Violette et le baron de Montfaucon. Un maire d’autrefois. Le Cercle de l’Escarène et le Café Boudin.—L’Affaire du Carlo Alberto, le vicomte de Saint-Priest et la marquise de Calvière. Les bureaux d’une feuille royaliste en 1833, Henri Abel et Eugène Roux. Les Revues littéraires de la Gazette du Midi. Esprit Requien et ses dîners du dimanche. Prosper Mérimée.—Le bonhomme Joudou et le Messager de Vaucluse. Mme Dorval. Pontmartin et le théâtre romantique. Les élections de 1837. Brochure sur Berryer.—L’Album d’Avignon. Pages sur Alfred de Musset. Joseph Michaud à Avignon. «Lisez du Voltaire.». | 66 |
| CHAPITRE V | |
| Les Années d’Avignon (1839-1845). | |
| LA MOUCHE, journal des Salons. Le journaliste Deretz. Un [533]duel dans l’île de la Barthelasse.—«L’Affaire d’Avignon». MM. de Salvador, d’Averton et de Renoard. La garde nationale d’Henri V. Gustave de Laboulie et M. Dugabé. Le président Monnier des Taillades et le procureur du roi Rigaud. Le coût d’un article et les Mie Prigioni du gérant de la Gazette du Midi.—Les Causeries provinciales de la Quotidienne. Berryer et l’Académie. Première rencontre de Pontmartin avec Cuvillier-Fleury.—L’Inondation du Rhône à Avignon et aux Angles en novembre 1840. La maison de la rue Banasterie et les Mémoires d’un notaire. Pontmartin conseiller général. Le vicomte Édouard Walsh et la Mode. Mariage d’Armand de Pontmartin. Le départ pour Paris. | 91 |
| CHAPITRE VI | |
| Les premières Années de Paris (1845-1848). | |
| Rue Neuve-Saint-Augustin. Les bureaux de la Mode. Jules Sandeau et le pavillon de la rue de Lille. Contes et Rêveries d’un Planteur de choux. Mme Cardinal et le cabinet de lecture de la rue des Canettes.—La Mode en 1845. Les déjeuners chez Véry. Joseph Méry et ses 365 sujets de roman. Rue de Luxembourg. Mort de Mme Eugène de Pontmartin.—M. François Buloz, Octave et la succession de Gustave Planche. Le jardin de la rue Saint-Benoît, Sainte-Beuve et son article des Nouveaux Lundis. | 108 |
| CHAPITRE VII | |
| La République de Février.—L’Opinion publique (1848-1852). | |
| Rue d’Isly. Sainte-Beuve et le 1er janvier 1848. Le 24 février.—Fondation de l’Opinion publique.—Comment se faisait un journal en l’an de grâce 1848.—Rédacteur en chef sans appointements.—Les Jeunes à l’Opinion publique.—Ponson du Terrail et Henri de Pène.—Cham et Armand de Pontmartin.—Les Lettres d’un sédentaire et les Mémoires d’Outre-Tombe.—La Sixième du second de la première.—Le [534]16 avril et le 15 mai. Les journées de Juin. La barricade de la rue Lafayette, le lieutenant Paul Rattier et le caporal Émile Charre.—Le ministère de M. de Falloux et la Bibliothèque de Jules Sandeau.—Les Mémoires d’un notaire.—L’Odyssée électorale de M. Buloz et les marronniers des Angles.—La revision de la Constitution et le conseil général du Gard. La Taverne de Richard-Lucas. Le coup d’État du 2 décembre. Suppression de l’Opinion publique. | 126 |
| CHAPITRE VIII | |
| La Revue contemporaine et l’Assemblée nationale.—Contes et Nouvelles.—Causeries littéraires.—La Fin du procès (1852-1855). | |
| Le marquis de Belleval ou un émule de M. de Coislin. La Revue contemporaine. Un mot d’Henry Mürger. Alphonse de Calonne.—L’Assemblée nationale. M. Adrien de La Valette et M. Mallac. Le fils de Paul et de Virginie.—Les Contes et Nouvelles. La Marquise d’Aurebonne et le Secret du docteur.—L’histoire d’Aurélie. Georgette ou une sœur d’Aurélie. Les Nouveaux Lundis. Où l’on voit Sainte-Beuve monter sur ses grands chevaux. Où l’on voit encore comment les petits pâtissent toujours des querelles des grands. Feu Edmond Dupré. Ma première rencontre avec Armand de Pontmartin.—Le premier volume des Causeries littéraires. Louis Veuillot et Cuvillier-Fleury.—Le Fond de la Coupe, l’Envers de la Comédie et la Fin du Procès. | 167 |
| CHAPITRE IX | |
| Le Correspondant, l’Union et le Journal de Bruxelles.—Les deux Érostrates.—La Mairie des Angles (1855-1862). | |
| Le second volume des Causeries littéraires. L’article sur Béranger. Lettre de Louis Veuillot à Pontmartin. Le 40 et le 44 de la rue du Bac. Le salon de Montalembert et les soirées de Veuillot.—L’entrée au Correspondant. Pontmartin [535]et le théâtre.—Les deux Érostrates. Le Spectateur et la suppression de l’Assemblée nationale. L’entrée à l’Union.—La Mûre et le château de Gourdan. La mairie des Angles. Un préfet homme d’esprit. Lettre de Louis Veuillot.—Les Variétés du Journal de Bruxelles.—Biographie du Père Félix.—Rentrée à la Revue des Deux Mondes. Pontmartin en 1862. | 204 |
| CHAPITRE X | |
| Les Jeudis de Madame Charbonneau (1862). | |
| Jacques Lecoffre, Alfred Nettement et la Semaine des Familles.—Le maire de Gigondas.—Journal d’un Parisien en retraite.—Modifications et retranchements.—L’Odyssée électorale de Strabiros.—La mort de Raoul de Maguelonne.—Jules Sandeau et H. de Balzac.—MM. Taxile Delord et Ernest Legouvé.—La lettre au Figaro.—Léopold de Gaillard et Léo de Laborde.—Le Diogène et M. Jules Claretie.—Les Jeudis de Madame Martineau.—Philinte et Alceste.—Caritidès et ses Cahiers.—Où Sainte-Beuve adresse une invocation à Jupiter hospitalier.—La visite chez Marphise.—M. Ferdinand Brunetière.—Lettre de Jules Janin.—Les Vrais jeudis de Madame Charbonneau. | 237 |
| CHAPITRE XI | |
| La Gazette de France.—Entre chien et loup.—Les nouveaux Samedis.—Les Corbeaux du Gévaudan (1862-1867). | |
| L’Avenue Trudaine.—Frédéric Béchard et Amable Escande.—L’entrée à la Gazette de France.—M. Silvestre de Sacy.—Entre chien et loup.—La Revue des Deux Mondes et la signature F. de Lagenevais.—M. Challemel-Lacour et Mgr Dupanloup.—A Pradine, chez Joseph Autran.—Alexandre Dumas fils et les Idées de Mme Aubray.—Mort de Joseph d’Ortigue.—Aurélien Scholl, le Nain jaune et le Camarade.—Les menus de M. Bec.—Les Courriers [536]de Paris, de l’Univers illustré.—Pontmartin est cité par le P. Félix en chaire de Notre-Dame.—Les Nouveaux Samedis, Arthur de Boissieu et les Lettres d’un Passant.—Les Corbeaux du Gévaudan.—Joseph Joubert.—Une lettre en vers. | 267 |
| CHAPITRE XII | |
| La Revanche de Séraphine.—Les Traqueurs de dot (1868-1870). | |
| Élection d’Autran à l’Académie. Chasses dans la Crau et la Camargue.—Mlle Rachel et Ponsard, Pernette et Victor de Laprade.—M. Victorien Sardou et la Dévote. La Revanche de Séraphine.—Mort de Lamartine et de Sainte-Beuve.—Les Traqueurs de dot et le Figaro.—L’Empire libéral. Prévost-Paradol. La guerre et la Marseillaise, Paul Chevandier de Valdrôme. Histoire d’une décoration. | 301 |
| CHAPITRE XIII | |
| Les Lettres d’un intercepté.—Le Radeau de la Méduse.—Le Filleul de Beaumarchais. La Mandarine (1870-1873). | |
| La Gazette de Nîmes et les Lettres d’un intercepté. M. Gambetta. La Journée d’un Proconsul.—Cent jours à Cannes. La Décentralisation et le Radeau de la Méduse.—Mort de Mme de Pontmartin. Le Filleul de Beaumarchais. Un mot de Louis David.—Le comte d’Haussonville et Saint-Genest. Un Bûcheron qui ne débite pas de fagots. La souscription nationale pour la libération du territoire. Projet de Pontmartin. Le comte de Falloux.—Hôtel Byron, rue Laffitte. La Taverne de Londres. M. Thiers. L’Homme Femme de Dumas fils. Au château de Barbentane. Le toast de Mistral. Entre voisins. L’inondation du Rhône en 1872.—Au Pavillon de Rohan. Une campagne au Gaulois. La Mandarine. Le 24 mai 1873, Si le Roi n’avait rien dit! | 327 |
| CHAPITRE XIV[537] | |
| Les Élections de 1876.—L’Exposition de 1878. Souvenirs d’un vieux mélomane (1874-1878). | |
| L’Union de Vaucluse. La Politique en sabots. Mort de Jules Janin. Beati non possidentes!—Les Élections de 1876. Rue et hôtel de Rivoli. Le marquis de Besplas et le château de la Garenne-Randon. Léontine Fay et le THÉATRE DE MADAME.—Mort de Joseph Autran. Le Seize-Mai. Les articles sur M. Thiers.—Séjour à Hyères. Mgr Dupanloup. La villa de Costebelle. La Messe à bord du vaisseau-école le Souverain. Lettre de l’Évêque d’Orléans. L’Exposition universelle et la rue de Passy.—Promenade au Salon de 1878. Le Barabbas de Charles Muller et l’Apothéose de M. Thiers. Mlle Sarah Bernhardt et le buste de M. Émile de Girardin. Les Souvenirs d’un vieux mélomane. Article d’Henri Lavedan. Pontmartin quitte Paris pour n’y plus revenir. | 359 |
| CHAPITRE XV | |
| Pontmartin et l’Académie (1868-1878). | |
| La fièvre verte. Le fauteuil de M. Empis. Lettre au Figaro. Le fauteuil de Sainte-Beuve. Une page des Jeudis.—Lettres de M. de Falloux, de Cuvillier-Fleury et de Joseph Autran. Le Non possumus de Pontmartin.—Le fauteuil de Saint-Marc Girardin. Fantaisies et Variations anti-académiques de M. Bourgarel.—Nouvelle lettre de M. de Falloux. Où l’on voit que Pontmartin était moins fort en calcul que feu Barrême.—Le fauteuil de Jules Janin. La peau de chagrin... académique. Le fauteuil d’Autran. M. Émile Zola se met en marche vers le Palais-Mazarin. Mgr Dupanloup s’efforce de décider Pontmartin à poser sa candidature. Pourquoi il ne s’est jamais présenté. | 389 |
| CHAPITRE XVI[538] | |
| Les Angles.—Mes Mémoires.—Souvenirs d’un vieux critique.—Le millième article.—Les Noces d’or (1879-1887). | |
| Description des Angles. Le cabinet de travail, les promenades, les visiteurs. Soirées d’hiver. Évocation du passé.—Delenda est res... punica. Pontmartin et la République conservatrice.—Mes Mémoires. Le chapitre sur Berryer. Les Souvenirs d’un vieux critique.—Le Millième article. L’Encrier de la Gazette de France. Les deux Bustes. Les souscripteurs. Lettres de Mgr de Dreux-Brézé, de Belcastel, Edmond Rousse, Désiré Nisard, Emile Ollivier. Lettre de Pontmartin au directeur de la Gazette de France.—Le critique et le romancier. La Correspondance de Pontmartin. | 432 |
| CHAPITRE XVII | |
| Les Dernières années.—Épisodes littéraires. La mort d’Armand de Pontmartin (1888-1890). | |
| La dixième série des Souvenirs d’un vieux critique et les Péchés de vieillesse. Une Revue qui paie royalement. M. Frédéric Masson et les Lettres et les Arts.—Vingt-quatre articles d’avance, Episodes littéraires.—Le dernier article, M. Émile Zola et la Bête humaine. Un souvenir de Virgile.—La dernière maladie. Visite de Léopold de Gaillard. Une mort chrétienne. Les obsèques d’Armand de Pontmartin. | 483 |
IMPRIMÉ
PAR
PHILIPPE RENOUARD
19, rue des Saints-Pères
PARIS
FOOTNOTES:
[1]Mélanges de philosophie, d’histoire et de littérature, par M. Ch.-M. de Féletz, de l’Académie française, t. II, p. 124.
[2] Aujourd’hui commune de Pujaut, canton de Villeneuve-lès-Avignon (Gard).
[3] Au mot Ferrar.
[4] Commune des Angles, canton de Villeneuve-lès-Avignon.
[5] François-Joseph Double (1776-1842). Membre de l’Académie de médecine et de l’Académie des sciences, il refusa la pairie, en 1839, parce que le Roi y mettait comme condition qu’il renoncerait à exercer la médecine.
[6] Représentée sur le Théâtre-Français le 5 décembre 1823. Le rôle de Danville fut créé par Talma et celui d’Hortense par Mlle Mars.
[7] Voy., sur le chevalier de Grave et sur son Adresse aux citoyens en faveur de Louis XVI, le Journal d’un bourgeois de Paris pendant la Terreur, par Edmond Biré, t. I, p. 337. M. de Grave publia en 1816 un Essai sur l’art de lire.
[8] Voir les Contes d’un planteur de choux.
[9] Mme de Guerry, après la mort de son mari, entra dans la congrégation dite de Picpus, consacrée à l’Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement sous l’invocation des Saints Cœurs de Jésus et de Marie. Elle y était depuis plus de trente ans, lorsqu’en 1853, à la suite de changements qu’elle considérait comme l’introduction d’une règle nouvelle, elle abandonna la communauté avec soixante de ses compagnes et résolut de porter dans une nouvelle maison l’intégrité des statuts édictés par les fondateurs de la Congrégation. Le pape Pie IX autorisa les religieuses séparées à vivre suivant l’ancienne règle, mais leur défendit de recevoir des novices ou d’admettre à la profession les novices qui les avaient suivies. C’est alors que Mme de Guerry, reprenant son nom, son titre et l’habit du monde, redemanda la fortune qu’elle avait apportée à la communauté de Picpus. Cette fortune était estimée par elle à une somme d’environ 1.200,000 fr. M. Émile Ollivier soutint devant les tribunaux la réclamation de Mme de Guerry, qui fut combattue par M. Berryer au nom de la communauté. Le tribunal de première instance de la Seine donna gain de cause à la communauté; mais Mme de Guerry triompha devant la Cour impériale de Paris (15 février 1858). Avant de mourir, elle s’est réconciliée avec son ordre et lui a rendu la fortune qu’elle avait revendiquée contre lui.—Sur le procès, demeuré célèbre, de la marquise de Guerry contre la Congrégation de Picpus, voir les Œuvres de Berryer, Plaidoyers, t. III, p. 153-310, et l’Empire libéral, par Émile Ollivier, t. IV, p. 35-46.]
[10] Ville d’Avignon. Extrait du Registre des Actes de l’état civil.—«L’an mil huit cent onze et le dix-sept juillet, à neuf heures du matin, par-devant nous Charles-Pierre-Paul Blanchetti, adjoint du maire et d’icelui chargé par délégation des fonctions de l’état civil de cette ville, est comparu en notre bureau Monsieur Castor-Louis-Eugène Ferrar de Pontmartin, propriétaire foncier, domicilié aux Angles (Gard) et demeurant en cette ville d’Avignon, rue Sainte-Praxède, lequel nous a déclaré que Madame Marie-Émilie-Aimée-Augustine-Henriette-Charlotte de Cambis, son épouse, est accouchée le jour d’hier, à une heure et demie d’après-midi, dans sa maison d’habitation, d’un enfant mâle qu’il nous a présenté et auquel il a donné les prénoms d’Armand-Augustin-Joseph-Marie; en présence de M. Joseph-François-Marie Ferrar de Pontmartin, oncle paternel de l’enfant, âgé de vingt-neuf ans, et de M. Augustin-Marie-Jacques-François-Luc de Cambis, âgé de trente ans, oncle maternel de l’enfant, demeurant en cette ville, propriétaires fonciers; et ont signé avec nous après lecture faite, les jour et an susdits.—E. de Pontmartin.—J. Pontmartin.—Aug. Cambis.—Blanchetti fils, adjoint.»
A noter, dans cet acte, l’absence de tout titre, même pour le marquis de Cambis; cela tient à ce que, sous l’Empire, les titres remontant à l’ancien régime n’avaient pas de valeur légale. Si je fais cette remarque, c’est uniquement pour aller au-devant de tout reproche possible d’usurpation à l’adresse d’Armand de Pontmartin, si éloigné de tout travers de ce genre et qui d’ailleurs, tout en se laissant donner le titre de son grand-père, ne le prit lui-même que très rarement.—Un mot sur ses quatre prénoms: Joseph est celui du parrain, le cher oncle paternel; Augustin, celui de la marraine, Augustine de Grave, dame de Cambis, aïeule maternelle; celui de Marie vient d’un usage pieux, particulièrement en honneur à Avignon; celui d’Armand vient du culte que M. Eugène de Pontmartin et son frère, depuis l’émigration, avaient voué à la famille de Polignac, et surtout au duc Armand, frère aîné du prince Jules, le futur ministre de Charles X.
[11] Dans ses Mémoires (t. I, p. 24), Pontmartin appelle hôtel de Bernis la maison habitée par ses parents jusqu’à leur départ pour Paris, et que je viens de dénommer hôtel de Calvière. Les deux désignations sont exactes, car l’hôtel appartenait indivisément au marquis de Calvière et à sa sœur la comtesse René de Bernis. Chacune de ces deux familles s’était réservé un appartement dans cette immense demeure, et c’est ainsi que Pontmartin fut l’ami d’enfance du fils de M. de Calvière et des deux fils de sa sœur.
[12] Par ordonnance royale parue au Moniteur du 13 février 1820, M. Decazes, président du conseil des ministres, avait été remplacé par le duc de Richelieu.
[13] Mlle de Sombreuil fut-elle forcée par les égorgeurs de l’Abbaye de boire un verre de sang pour racheter la vie de son père? La plupart des historiens n’ont voulu voir là qu’une légende, Pontmartin lui-même n’admettait qu’à demi cette tradition consacrée par Victor Hugo dans une de ses plus belles Odes: «Ce que je crois vrai, dit-il dans ses Mémoires, t. I, p. 24, c’est que le verre de sang lui fut présenté par les massacreurs de Septembre, qu’elle le prit, qu’elle allait le boire, et que, saisis d’un mouvement de pitié ou d’horreur, ces monstres le répandirent à ses pieds.» Ce mouvement de pitié, les massacreurs ne l’ont pas eu. C’est le poète des Odes et Ballades qui est dans le vrai. Comment, en effet, conserver un doute sur la vérité de la tradition, en présence de l’attestation suivante, adressée à M. Adolphe Granier de Cassagnac par le fils de Mlle de Sombreuil:
«Ma mère, Monsieur, n’aimait point à parler de ces tristes et affreux temps. Jamais je ne l’ai interrogée; mais parfois, dans des causeries intimes, il lui arrivait de parler de cette époque de douloureuse mémoire. Alors, je lui ai plusieurs fois entendu dire que, lors de ces massacres, M. de Saint-Mart sortit du tribunal devant son père et fut tué d’un coup qui lui fendit le crâne; qu’alors elle couvrit son père de son corps, lutta longtemps et reçut trois blessures.
«Ses cheveux, qu’elle avait très longs, furent défaits dans la lutte; elle en entoura le bras de son père, et, tirée dans tous les sens, blessée, elle finit par attendrir ces hommes. L’un d’eux, prenant un verre, y versa du sang sorti de la tête de M. de Saint-Mart, y mêla du vin et de la poudre, et dit que si elle buvait CELA à la santé de la nation, elle conserverait son père.
«Elle le fit sans hésiter, et fut alors portée en triomphe par ces mêmes hommes.
«Depuis ce temps, ma mère n’a jamais pu porter les cheveux longs sans éprouver de vives douleurs. Elle se faisait raser la tête. Elle n’a jamais non plus pu approcher du vin rouge de ses lèvres, et, pendant longtemps, la vue seule du vin lui faisait un mal affreux.
«Signé: comte de Villelume-Sombreuil.»
(Histoire des Girondins et des massacres de Septembre, par A. Granier de Cassagnac, t. II, p. 225.)
[14] Jean-François Périer, évêque d’Avignon, par l’abbé Albert Durand, directeur au petit séminaire de Beaucaire.
[15] Mes Mémoires, par Armand de Pontmartin, 1re série, p. 31-33.
[16] T. I, p. 6-14.
[17] Aujourd’hui rue Bonaparte.
[18] En 1825, Armand de Melun était élève du collège de Sainte-Barbe, dirigé par M. Henri Nicolle, frère de l’abbé Nicolle, recteur de l’Académie de Paris. Intime ami du duc de Richelieu et aussi désintéressé que lui, l’abbé Nicolle n’avait accepté le rectorat qu’à la condition de n’en pas toucher les émoluments.
[19] Le vicomte Armand de Melun, d’après ses Mémoires et sa correspondance, par M. l’abbé Baunard, p. 14.
[20] Après avoir administré cinq ans le collège Saint-Louis, l’abbé Thibault le quitta pour devenir inspecteur de l’Université, en 1825. Il eut pour successeur un prêtre alsacien, l’abbé Ganser. En 1830, un proviseur laïque, M. Liez, fut placé à la tête du collège.
[21] L’abbé Léon Sibour, parent éloigné de Mgr Sibour, archevêque de Paris, avec lequel il était du reste étroitement lié, fut lui-même évêque in partibus de Tripoli. M. Dumarsais devint curé de Saint-François-Xavier et chanoine de Paris.
[22] Ces religieuses furent remplacées plus tard dans le couvent de la rue de Vaugirard par les Dominicains, qui eux-mêmes ont cédé la place à l’Institut catholique.
[23] Ma Carmélite, dans les Souvenirs d’un vieux critique, t. IV, p. 62.
[24] En 1825, un terrible incendie avait dévoré la plus grande partie de la ville de Salins (Jura); elle a été rebâtie sur un plan plus régulier.
[25] Le 19 octobre 1826.
[26] Ce dernier nom cachait un banquier, M. Beudin, et un chef d’institution, M. Goubaux, qui avaient formé des dernières syllabes de leurs deux noms le pseudonyme de Dinaux. La première représentation de Trente ans ou la Vie d’un joueur avait eu lieu le 19 juin 1827.
[27] Chap. 1, p. 1-54.
[28] Voir plus bas le chapitre sur Armand de Pontmartin et l’Académie française.
[29] Charles Alexandre (1797-1870), élève de l’École normale, professeur de rhétorique, proviseur, inspecteur général des études, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, auteur d’un Dictionnaire grec-français, qui est longtemps resté classique.
[30] Mélanges de philosophie, d’histoire et de littérature, par Ch.-M. de Féletz, de l’Académie française, 6 vol. in-8, 1826-1828.
[31] Revue des Deux Mondes, chronique de la quinzaine, 1er janvier 1854.
[32] Nouveaux Lundis, t. II, p. 13.
[33] Annales des concours généraux, par MM. Belin et Roche. Classe de troisième, p. 97, L. Hachette, rue Pierre-Sarrazin, 12, Paris, 1826.
[34] Ancien président, sous l’Empire, de la section de législation au Conseil d’État. Son fils aîné fut vice-président de la République en 1848.
[35] Le marquis Auguste de Cambis-d’Orsan (1781-1860), député de Vaucluse le 15 novembre 1830, réélu le 5 juillet 1831, puis le 21 juin 1834; pair de France le 3 octobre 1837.
[36] Jean-Antoine Renouvier (1777-1863), député de Montpellier de 1827 à 1834; père de M. Jules Renouvier, l’archéologue, et de M. Charles Renouvier, le philosophe.
[37] Plus tard professeur d’histoire au collège Louis-le-Grand, et auteur d’une excellente Histoire du règne de Louis XIV, couronnée par l’Académie française. (Grand prix Gobert.)
[38] Emmanuel Daudé d’Alzon, né en 1811, comme Pontmartin, mort le 21 novembre 1880. Voir sur lui Souvenirs d’un vieux critique, t. I, p. 325-340.
[39] Henri-François-Marie-Auguste, comte de Cambis-d’Orsan, fils du marquis, né le 8 juin 1810; élu député d’Avignon le 13 août 1842, réélu le 1er août 1846. Il mourut le 24 août 1847.
[40] François-Frédéric Poncelet (1790-1843). Il avait publié en 1827 un ouvrage qui se rattachait à ses préoccupations musicales et qui a pour titre: Privilèges de l’Opéra. On lui doit aussi un Cours d’histoire du droit romain et un Précis de l’histoire du droit civil français.
[41] Souvenirs d’un vieux critique, t. III, p. 70, 1883.
[42] Causerie du 22 août 1887, Souvenirs d’un vieux critique, t. X, p. 104 et 106.
[43] Lamartine, Des Destinées de la poésie.
[44] Jules Janin, Histoire de la littérature française, 1829.
[45] Guillaume Tell a été représenté pour la première fois le 3 août 1829; le More de Venise, le 24 octobre 1829; Fra Diavolo, le 28 janvier 1830; Hernani, le 25 février 1830. Les Orientales et le Dernier jour d’un condamné, de Victor Hugo, sont des premiers mois de 1829, ainsi que l’édition complète et définitive des Poèmes d’Alfred de Vigny. Les Orientales parurent au mois de janvier 1829, le Dernier jour d’un condamné au mois de février, les Poèmes de Vigny au mois de mai.
[46] Les Contes d’Espagne et d’Italie furent publiés en janvier 1830, les Consolations en mars, les Harmonies le 14 juin. Les Poésies de Théophile Gautier furent mises en vente dans les derniers jours de juillet; nous les trouvons en effet inscrites sous le no 4270 de la Bibliographie de la France du 31 juillet 1830.
[47] La première édition des Scènes de la vie privée a été publiée au mois d’avril 1830. Les Chouans avaient paru au mois de mars 1829.
[48] Paul Huet était né le 3 octobre 1804. Il mourut le 9 janvier 1869. «Paul Huet, dit Théophile Gautier (Portraits contemporains), représente dans le paysage le rôle romantique, et il a eu son influence au temps de la grande révolution pittoresque de 1830. Sa manière de concevoir le paysage est très poétique et se rapproche un peu des décorations d’opéra par la largeur des masses, la profondeur de la perspective et la magie de la lumière... Nul n’a saisi comme lui la physionomie générale d’un site, et n’en a fait ressortir avec autant d’intelligence l’expression heureuse ou mélancolique.»
[49] T. I, p. 129-149.
[50] Le Correspondant du 12 mars 1830.
[51] Nouveaux Samedis, t. XIII, p. 352.
[52] La population de Paris n’était alors que de 645,698 âmes; le nombre des décès fut donc de plus de 23 par 1000 habitants. Le chiffre de 18,406 s’appliquant aux seuls décès administrativement constatés, le chiffre réel a dû être plus élevé.
[53] Tome I, p. 212-224.
[54] L’Époque sans nom, Esquisses de Paris (1830-1833), par M. A. Bazin, t. II, p. 270.
[55] Père de M. Paul Thureau-Dangin, membre de l’Académie française.
[56] Voir Monsieur Thureau-Dangin, vice-président général de la Société de Saint-Vincent de Paul. Notes et Souvenirs, 1811-1893.—Je lis à la page 8 de cette Notice: «M. Thureau fit son droit et c’est vers cette époque qu’il eut des relations d’amitié avec quatre jeunes gens à peu près de son âge qui ont laissé un nom dans les lettres et dans la politique: Louis Veuillot, Pontmartin, Montalembert et Léon Cornudet.»
[57] Louis-Gabriel-Eugène, baron Pertuis de Montfaucon (1790-1842). Nommé député du premier collège de Vaucluse (Avignon) le 13 juin 1840, il venait d’être réélu le 9 juillet 1842, lorsqu’il mourut (16 juillet) avant d’avoir pu reprendre séance. Il fut remplacé par Henri de Cambis.
[58] Nouveaux Lundis, t. II, p. 2.
[59] Saint-Priest (Emmanuel-Louis Guignard, vicomte de), né à Paris le 6 décembre 1789, mort au château de Lamotte (Hérault), le 27 octobre 1881. Il suivit sa famille à Saint-Pétersbourg lors de l’émigration et, en 1805, entra dans l’armée russe où il servit jusqu’à la chute de Napoléon. Colonel en 1814, il fut fait prisonnier; l’ordre de le fusiller, envoyé par l’Empereur, fut intercepté par les Cosaques. Il s’échappa, servit avec ardeur la cause du gouvernement royal, tenta pendant les Cent-Jours de soulever les populations du Midi, s’embarqua à Marseille à la nouvelle de la capitulation de la Palud, fut pris par un corsaire de Tunis, et, après quelques semaines de captivité, put gagner l’Espagne et rentrer à la seconde Restauration. Il fut alors nommé maréchal de camp, gentilhomme d’honneur du duc d’Angoulême et inspecteur d’infanterie. En 1823, il prit part à la campagne d’Espagne, où sa conduite lui valut le grade de lieutenant général. Ambassadeur à Berlin (1825), puis à Madrid (1827), il négocia le traité par lequel l’Espagne s’engageait à rembourser à la France, par annuités de 4 millions, sa dette de 80 millions. Au mois d’août 1830, il donna sa démission et fut nommé par le roi Ferdinand VII grand d’Espagne et duc d’Almazan. Devenu l’un des conseillers de la duchesse de Berry, il fut l’un des principaux organisateurs de la tentative royaliste de 1832. Après son acquittement, il alla rejoindre MADAME en Italie. Élu en 1849 représentant de l’Hérault à Assemblée législative, il devint l’un des chefs de la majorité. Sous le second Empire, il fut l’un des serviteurs les plus zélés et les plus intelligents du comte de Chambord, qui lui écrivit en 1867, sur la situation politique, une lettre qui eut un grand retentissement.
[60] Voir le chapitre I, p. 16.
[61] M. de Saint-Priest allait, en effet, être traduit en cour d’assises, ainsi que les autres prévenus de l’affaire du Carlo-Alberto, M. de Kergorlay père et le comte de Mesnard, tous les deux anciens pairs de France, M. de Kergorlay fils, M. Adolphe Sala, M. de Bourmont fils, Mlle Mathilde Lebeschu, M. Antoine Ferrari, Génois, subrécargue du Carlo-Alberto. Ils comparurent, le 25 février 1833, devant le jury de Montbrison (Loire). Étaient poursuivis, en même temps qu’eux, les prévenus de «la Conspiration de Marseille», MM. de Bermond, de Candolle, de Lachaud, Layet de Podio, François Esig et Ganail. Les débats se terminèrent, le 15 mars, par l’acquittement de tous les accusés.
[62] Le Caducée. Souvenirs marseillais, provençaux et autres (par M. Cauvière), t. IV, p. 206,—1880.
[63] Henri Abel, né à Aix le 15 juillet 1796, mort à Marseille le 19 novembre 1861. Au milieu de ses travaux de polémiste, il a trouvé le temps de composer une Histoire de France en cinq volumes.
[64] Attaché à la Gazette du Midi dès 1832, Eugène Roux remplaça Henri Abel comme rédacteur en chef et conserva la direction du journal jusqu’à sa mort, en mars 1877.
[65] Laboulie (Joseph-Balthazar-Gustave de) (1800-1867), avocat au barreau d’Aix, député de Marseille de 1834 à 1837, représentant des Bouches-du-Rhône à l’Assemblée constituante et à l’Assemblée législative. Doué d’un rare talent de parole, il obtint de grands succès de tribune, et fut, avec M. de Larcy, le meilleur lieutenant de Berryer.
[66] Maire de Marseille avant 1830; homme bienfaisant et tout dévoué à sa ville; éloge qui, du reste, pour les maires de la Restauration, est presque une banalité.
[67] Esprit Requien, né à Avignon en 1788, mort à Bonifacio dans un voyage d’herborisation le 30 mai 1851. Il a fondé et donné à la ville d’Avignon un Musée d’histoire naturelle qui porte son nom. Sans se mêler aux luttes politiques et tout en ayant des amis dans tous les partis, il a constamment gardé l’attitude et le nom de ce que l’on appelait un vieux blanc.—Voir, sur M. Requien, les Mémoires de Pontmartin, t. II, p. 55 et suivantes et les Nouveaux Samedis, t. X, p. 210 et 371.
[68] Revue des Deux Mondes du 15 août 1834.
[69] Jean-Baptiste-Pierre Lafitte (1796-1879), auteur dramatique et romancier. De ses nombreuses pièces de théâtre, deux surtout eurent du succès, Jeanne Vaubernier (1832) et le Pour et le Contre (1852). Il composa plusieurs romans historiques, dont deux, le Docteur rouge (1844) et le Gantier d’Orléans (1845), furent justement remarqués. Mais ce qui le sauvera de l’oubli, ce sont les Mémoires du comédien Fleury (6 volumes in-8o, 1835-1837), ouvrage spirituel et agréable, dont il fut le rédacteur.
[70] 11, 15, 22, 29 décembre 1836; 9 et 19 mars 1837.
[71] Voy. Jules Janin, Histoire de la littérature dramatique, t. VI, p. 191.
[72] Mes Mémoires, t. II, p. 127.
[73] Messager de Vaucluse, du 22 décembre 1836.
[74] Le 10 février 1829.
[75] Messager de Vaucluse, du 9 mars 1837.
[76] Messager de Vaucluse, 29 juin et 9 juillet 1837.
[77] Messager de Vaucluse, 30 juillet et 6 août 1837.
[78] Joseph Eugène Poncet (1791-1866). Incorporé en 1813 dans le 4e régiment des gardes d’honneur, il se distingua à Leipzig, reçut la croix de la Légion d’honneur et fit la campagne de France en 1814. Sous la Restauration, il se livra au commerce et conquit une situation importante. Après la révolution de Juillet, il devint colonel de la garde nationale, adjoint au maire, président du tribunal de commerce, conseiller général de Vaucluse. Il fut député de 1837 à 1840 et deux fois maire d’Avignon (1843 à 1847 et février à décembre 1852).
[79] M. Charles de Lacombe, dans sa Vie de Berryer, pourtant si complète, n’a rien dit de cette candidature avignonnaise de l’illustre orateur.
[80] Claude-Marie-Charles Deplace, entré dans la Compagnie de Jésus le 7 septembre 1824. Il professa la rhétorique dans plusieurs collèges, notamment à Saint-Acheul en 1828, avant les Ordonnances; puis, en 1833, au Passage, en Espagne. Il quitta l’Ordre vers 1838 et se voua entièrement à la prédication, où il obtint de très grands succès. L’abbé Deplace est mort à Vichy le 19 juillet 1871.
[81] Janvier et novembre 1838.
[82] Février 1838.
[83] Mars 1838.—Les deux voyageurs étaient George Sand et Alfred de Musset. Dans sa pièce, écrite au moment de leur départ pour Venise (décembre 1834), Pontmartin exprimait l’espoir, peut-être un peu naïf, de les voir revenir bientôt «aux croyances religieuses, aux régions certaines et à Celui qui ne trompe pas».
[84] Première esquisse de l’une de ses meilleures nouvelles, les Trois Veuves.—Voir le volume des Contes d’un planteur de choux.
[85] Les Écrivains modernes de la France, par J. Chaudes-Aigues.
[86] Mars 1838.—L’Album d’Avignon, t. I, p. 169 et suivantes.
[87] Joseph Michaud (1767-1839), fondateur de la Quotidienne, auteur du Printemps d’un proscrit et de l’Histoire des Croisades, membre de l’Académie française.
[88] François Poujoulat (1800-1880), rédacteur de la Quotidienne et de l’Union, représentant du peuple de 1848 à 1851, auteur de la Correspondance d’Orient (en collaboration avec Michaud) et d’un grand nombre d’ouvrages historiques justement estimés: Histoire de Jérusalem; Histoire de saint Augustin; le Cardinal Maury; le Père de Ravignan; Vie de Mgr Sibour; Vie du Frère Philippe; Histoire de la Révolution française; Histoire de France depuis 1814 jusqu’à 1865, etc., etc.
[89] Nouveaux Samedis, t. XX. p. 152.
[90] Lettre du 20 octobre 1886.
[91] Au tome II de ses Mémoires, p. 141-153, Pontmartin parle assez longuement de ce duel; seulement il le place, non en 1839, qui est la vraie date, mais en 1834. Il appelle Deretz Fabrice Dervieux et transforme la Mouche en Ruche vauclusienne. Il indique, comme l’un de ses témoins, M. Guy d’Averton; c’est le frère de Guy, Frédéric, ancien officier de la garde royale, qui servit de second à Pontmartin dans ce duel, moins épique assurément que le duel de Roland et d’Olivier en cette même île de la Barthelasse:
Ils sont là tous les deux dans une île du Rhône......
[92] Gazette des Tribunaux du 21 juin 1839.
[93] Pontmartin, au tome II de ses Mémoires, p. 278, dit que les prévenus «eurent pour avocats MM. de Laboulie et Dugabé». M. Dugabé ne plaida point à Avignon; mais l’affaire étant venue en appel, selon la législation alors en vigueur, devant le tribunal correctionnel de Carpentras (8, 9 et 10 août 1839), Me Dugabé prit place cette fois sur le banc des défenseurs, à côté de Me de Laboulie. Il était le premier avocat du barreau de Toulouse, comme Laboulie était le premier avocat du barreau d’Aix. Les électeurs de l’Ariège (Foix) l’envoyèrent à la Chambre des députés, où il siégea du 21 juin 1834 au 24 février 1848.
[94] Gazette des Tribunaux du 4 juillet 1839.
[95] Mes Mémoires, t. II, p. 280.
[96] Chaque livraison de l’Album se terminait par un article qui, sous le titre de Mosaïque, n’était autre chose qu’une causerie littéraire et politique.
[97] Michaud était mort à Passy le 30 septembre 1839.
[98] Le Livre des Orateurs, par Timon (M. de Cormenin), t. II, p. 231.
[99] Notes sur M. Royer-Collard, par son neveu M. Genty de Bussy, député du Morbihan.
[100] Œuvres complètes de Henri Fonfrède, t. X, p. 213.
[101] Lettres de X. Doudan, t. II, p. 346.
[102] Journal des Débats, 16 novembre 1839.
[103] Le cas devait en effet se réaliser. Berryer fut élu le 12 février 1852; il siégeait encore sous la coupole quand M. Cuvillier-Fleury fut nommé le 12 avril 1866.
[104] Provence, par Adolphe Dumas (12 juillet 1840); Peintures d’Eugène Devéria à Avignon (24 juillet 1840); Mathilde, par Eugène Sue; Colomba, par Prosper Mérimée (15 août 1841); Milianah, par Joseph Autran (1er juin 1842), etc., etc.
[105] Le Puff en province (29 octobre 1840); l’Angleterre en France (10 janvier 1841); Euterpe en voyage (19 août 1843), etc., etc.
[106] 4 octobre 1842.
[107] 6 et 7 janvier, 10 et 11 février 1843.
[108] Jean-Toussaint Merle (1785-1852), auteur dramatique et journaliste. Directeur du théâtre de la Porte-Saint-Martin de 1822 à 1826, il fut le mari de Mme Dorval.
[109] Le 25 novembre 1755, le Rhône grossit de dix-huit pieds dans une nuit.
[110] Le vicomte Édouard Walsh était directeur de la Mode depuis le 25 septembre 1835. Il était le fils du vicomte Joseph Walsh, l’auteur des Lettres vendéennes (1825), du Fratricide ou Gilles de Bretagne (1827), du Tableau poétique des Fêtes chrétiennes (1836), des Journées mémorables de la Révolution française (1839-1840), des Souvenirs de Cinquante ans (1844), etc.
[111] Mlle Cécile de Montravel était née, le 16 novembre 1819, au château de la Bastide de Sampzon, près Vallon, arrondissement de Largentière (Ardèche).
[112] Mme de Larochette mourut à 81 ans en 1849. Après sa mort, le Plantier échut à sa fille cadette; M. et Mme de Montravel durent se transporter dans une autre propriété qu’ils avaient achetée dans les environs, un peu au nord d’Annonay. Cette nouvelle résidence s’appelait la Mûre. De 1851 à 1862, Pontmartin y a fait chaque été un séjour de plusieurs semaines; puis deux séjours en 1864 et deux autres en 1868.
[113] Voir sur cette chapelle les pages que lui a consacrées Pontmartin dans son écrit sur le Père Félix (1861), p. 19-21.
[114] Cet hôtel occupait, rue Neuve-Saint-Augustin, les anciens appartements du maréchal de Richelieu.
[115] Correspondance de Lamartine, t. III.
[116] Jules Sandeau était né le 19 février 1811. Il mourut le 24 avril 1883.
[117] Le fils de Jules Sandeau, devenu un brillant officier de marine, rentrait au pays après une campagne dans l’Extrême-Orient, lorsqu’il mourut d’une maladie contractée au service de la France. Son père, en arrivant à Toulon, n’y retrouva plus qu’un cadavre.
[118] Souvenirs d’un vieux critique, t. IV, p. 39.
[119] Voici les titres des principales: en 1846, Clarisse Harlowe, de Jules Janin; Nélida, de Daniel Stern; Passé et Présent, de Charles de Rémusat; la Cousine Bette, de Balzac; Madeleine, de Jules Sandeau. En 1847, Petite Causerie à propos d’une grande Histoire (les Girondins, de Lamartine), etc., etc.
[120] En 1847, Pontmartin fit le Salon (26 mars et 26 avril).
[121] 15 juin 1846.
[122] 26 décembre 1847.
[123] Octobre, novembre et décembre 1847.
[124] Aujourd’hui rue Cambon.
[125] M. Duchâtel.
[126] Le marquis de Cambis.
[127] J’ai eu l’honneur de connaître M. Edmond Leclerc dans ses dernières années. C’était l’esprit le plus fin et le cœur le plus noble, type accompli de l’honnête homme. Il était le beau-frère du vicomte Henri Delaborde, secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts.—Voir dans la Correspondance de Louis Veuillot, t. I, ses lettres à M. Edmond Leclerc.
[128] P. 351-354.
[129] Il parut dans la Revue des Deux Mondes (juin-août 1846).
[130] Le Puff. Elle fut représentée le 22 janvier 1848.
[131] On s’étonnera peut-être de ne pas trouver ici le nom de George Sand. Elle avait cessé en 1841 d’écrire à la Revue, et elle ne reprit sa collaboration que dix ans après, en 1851.
[132] M. Victor de Mars, gérant de la Revue.
[133] Nouveaux Samedis, t. XV. p. 279.
[134] Souvenirs d’un vieux critique, t. V, p. 317.
[135] François-Henri-Joseph Blaze, dit Castil-Blaze (1784-1857), était né à Cavaillon (Vaucluse). Sa fille Christine, sœur de Henri Blaze de Bury, avait épousé M. Buloz.
[136] Nouveaux Lundis, t. II, p. 3.
[137] On sait qu’on appelait ainsi, sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet, le palais des Tuileries.
[138] Articles des 2 et 7 avril 1848.
[139] 25 septembre 1848.
[140] 25 novembre 1849.
[141] Pages 111-209.
[142] M. de Genoude mourut à Hyères, le 19 avril 1849, âgé de cinquante-sept ans.
[143] Alfred Nettement (1805-1869), le plus fécond et l’un des plus remarquables journalistes du XIXe siècle.—Voir Alfred Nettement, sa vie et ses œuvres, par Edmond Biré. Un volume in-8o, Librairie Victor Lecoffre, 1901.
[144] Théodore Muret (1808-1866), auteur de l’Histoire de l’armée de Condé, de l’Histoire des Guerres de l’Ouest, de l’Histoire par le Théâtre, etc.
[145] Née de la fusion de la France et de l’Écho français avec la Quotidienne, l’Union avait commencé de paraître le 7 février 1847.
[146] Voir l’histoire complète de l’Opinion publique, dans mon volume sur Alfred Nettement, sa vie et ses œuvres, chapitres XIV, XV et XVI.
[147] Théodore Muret, Souvenirs et Causeries d’un journaliste, t. I, p. 198.
[148] Jacques-Honoré Lelarge, baron de Lourdoueix (1787-1860). Il avait été directeur des Beaux-Arts, Sciences et Lettres sous la Restauration, qui le fit baron. Après la mort de M. de Genoude (avril 1849), il quitta l’Opinion publique pour devenir propriétaire et directeur de la Gazette de France.
[149] Anne-Marie-Joseph-Albert, comte de Circourt, né en 1809, avait donné, à la suite de la révolution de 1830, sa démission d’officier de marine. Le 25 juillet 1872, il fut élu par l’Assemblée nationale membre du Conseil d’État. Outre sa grande Histoire des Arabes d’Espagne sous la domination des Chrétiens (trois volumes in-8o, 1845-1848), il a publié, en 1852, Décentralisation et monarchie représentative, et, en 1858, la Bataille d’Hastings.
[150] Alphonse Bernard, vicomte de Calonne (1818-1902). En 1848, avant d’entrer à l’Opinion publique, il avait publié des brochures de circonstance, les Trois journées de Février, le Gouvernement provisoire, histoire anecdotique et politique de ses membres, et il avait été un des rédacteurs du Lampion, journal suspendu par le général Cavaignac (21 août 1848). Il essaya, avec le concours de Xavier de Montépin et de Villemessant, de le remplacer par la Bouche de fer, dont le premier numéro fut saisi le jour de son apparition. En 1850, il fonda une feuille hebdomadaire, le Henri IV, Journal de la réconciliation. Il devint, en 1855, directeur de la Revue contemporaine. Sous le semi-pseudonyme de A. de Bernard, il a publié un assez grand nombre de romans, dont les principaux sont: Pauvre Mathieu, les Frais de la Guerre, le Portrait de la marquise, etc. Devenu le doyen de la presse quotidienne, à quatre-vingt-trois ans il donnait encore au Soleil des articles sur les questions artistiques.
[151] Théodore Muret, op. cit., t. I, p. 201.
[152] L’Opinion publique des 2, 4, 8 et 15 mars 1849.
[153] Ponson du Terrail (Pierre-Alexis, vicomte DE), né près de Grenoble, le 8 juillet 1829, mort à Bordeaux en janvier 1871.
[154] Louis Moland, né à Saint-Omer le 13 avril 1824, érudit et romancier. Ses principaux ouvrages sont: Peuple et roi au XIIIe siècle; Origines littéraires de la France; Molière et la comédie italienne, etc.
[155] Henri de Pène, né à Paris le 25 avril 1830. Il fut en 1868, avec M. E. Tarbé des Sablons, le fondateur du Gaulois. La même année, il créa un autre grand journal politique, Paris, qui devint bientôt Paris-Journal. Ses chroniques forment plusieurs volumes, publiés sous les titres de Paris intime, Paris aventureux, Paris mystérieux, Paris effronté, etc.
[156] L’Opinion publique des 19 décembre 1849 et 17 janvier 1850.
[157] 3 mars 1851.
[158] L’Opinion publique du 20 janvier 1850.
[159] Amédée de Noé, dit Cham (1819-1882). Il était le second fils du comte de Noé, pair de France.
[160] Auguste Lireux, né à Rouen vers 1819, mort à Bougival le 23 mars 1870. Journaliste infatigable, il créa à Rouen le petit journal l’Indiscret; après quelques procès et duels, il vint à Paris, dirigea la Gazette des Théâtres, fonda la Patrie en 1841, écrivit au Courrier français, à la Séance, au Charivari, au Messager des Théâtres, fit de 1850 à 1855 le feuilleton dramatique du Constitutionnel; quitta la littérature pour les affaires, où il s’enrichit. Ses derniers journaux furent la Bourse comique et la Semaine financière. Directeur de l’Odéon, de 1842 à 1845, ce fut lui qui reçut et fit jouer, le 22 avril 1843, la Lucrèce de François Ponsard.
[161] L’Opinion publique du 17 décembre 1849.
[162] 9 avril 1850.
[163] 10 mai 1850.
[164] 13 juin 1850.
[165] 17 décembre 1848.
[166] 1er octobre 1849.
[167] 8 juin 1851.
[168] 23 et 30 mars 1851.
[169] 19 novembre, 19 et 25 décembre 1851.
[170] 16 et 22 février, 2, 9 et 16 mars 1851.
[171] Leur publication y dura deux années, du 21 octobre 1848 au 3 juillet 1850.
[172] Causeries du Lundi, t. I. p. 406, et t. II. p. 138 et 505.
[173] 19, 20, 21, 22, 23 février 1850.
[174] 3 et 4 juin 1851.
[175] La Mode des 5, 15 et 25 décembre 1849, 5 et 15 janvier 1850.
[176] Usine à gaz.
[177] M. Paul Rattier fut décoré pour l’héroïque bravoure qu’il avait montrée en ces terribles journées.
[178] Lamartine prononça cette parole à la Chambre des députés, dans son discours du 10 janvier 1839. «Mil huit cent trente, disait-il, n’a pas su créer son action et trouver son idée. Vous ne pouviez pas faire de légitimité: les ruines de la Restauration étaient sous vos pieds. Vous ne pouviez pas faire de la gloire militaire: l’Empire avait passé et ne vous avait laissé qu’une colonne de bronze sur une place de Paris. Le passé vous était fermé; il vous fallait une idée nouvelle. Il ne faut pas vous figurer, messieurs, parce que nous sommes fatigués des grands mouvements qui ont remué notre siècle et nous, que tout le monde est fatigué comme nous et craint le moindre mouvement. Les générations qui grandissent derrière nous ne sont pas lasses, elles veulent agir et se fatiguer comme nous. Quelle action leur avez-vous donnée? La France est une nation qui s’ennuie!»
[179] Mgr Sibour.
[180] L’Opinion publique du 18 janvier 1849.
[181] L’Opinion publique du 20 janvier.
[182] Souvenirs d’un vieux critique, t. III, p. 200.
[183] La démission de M. de Falloux fut donnée le 20 octobre 1849. Il avait dû, depuis quelque temps déjà, en raison du très mauvais état de sa santé, remettre l’intérim de son ministère à son collègue M. Victor Lanjuinais, ministre de l’Agriculture.
[184] Henri-Ange-Alfred de Gondrecourt, né à la Guadeloupe, le 22 mars 1816, mort à Albi le 16 novembre 1876. Il devint colonel des chasseurs à cheval de la garde impériale, puis général de brigade. En 1866, il fut nommé commandant de l’École de Saint-Cyr. Son premier roman, les Derniers Kerven, avait paru en 1844. Il en a publié depuis un très grand nombre, parmi lesquels Médine, le Bout de l’oreille, le Chevalier de Pampelonne, le Baron la Gazette, les Mémoires d’un vieux garçon, etc.
[185] Alexandre Cadot, 17, rue Serpente, fut l’éditeur de Balzac, de Dumas père, de Mme Sand, de Frédéric Soulié, des premiers romans de Dumas fils, du marquis de Foudras, de Roger de Beauvoir, et enfin du colonel de Gondrecourt.
[186] Épisodes littéraires, par A. de Pontmartin, p. 262 et suiv.
[187] Elles eurent lieu le 13 mai 1849.
[188] Louis Veuillot a publié, dans la Revue des Deux Mondes, le Lendemain de la Victoire, scènes socialistes, 15 juillet et 1er août 1849; Une Samaritaine, dialogue, 1er novembre 1850.
[189] M. de Falloux a publié, dans la Revue des Deux Mondes, Les Républicains et les Monarchistes depuis la Révolution de février, 1er février 1851.
[190] Léopold de Gaillard-Lavaldène, né à Bollène (Vaucluse) le 20 avril 1820. Au lendemain du 24 février 1848, il avait fondé à Avignon, avec son ami Raousset-Boulbon, une feuille catholique et royaliste, la Commune. Après avoir été successivement rédacteur à l’Assemblée nationale et directeur de la Gazette de Lyon, il devint le chroniqueur politique et le directeur du Correspondant. Le 26 juillet 1872, il fut nommé par l’Assemblée nationale conseiller d’État. Outre diverses brochures et deux volumes: Questions italiennes, voyage, histoire, politique (1860); les Étapes de l’opinion (1873), il a laissé un important travail historique, l’Expédition de Rome en 1849, avec pièces justificatives et documents inédits (1861). M. Léopold de Gaillard est mort à Bollène le 8 juin 1893.
[191] Raousset-Boulbon (Gaston Raoulx, comte DE), né à Avignon le 2 décembre 1817. Dans son héroïque aventure au Mexique, il fit la conquête de la Sonora; mais, écrasé bientôt par des forces supérieures, il fut, le 12 août 1854, fusillé à Guaymas. Il laissait un très remarquable roman, qui avait dû paraître d’abord dans l’Opinion publique, et qui parut dans la Presse, en 1835, sous ce titre: Une Conversion.
[192] Pour l’Assemblée constituante.
[193] C’est sous ce nom que Pontmartin, dans la Semaine des Familles, désignait M. Buloz. On connaît le vers de Veuillot:
Buloz, qui d’un seul œil peut éclairer deux mondes...
[194] Les Angles sont situés dans le département du Gard.
[195] La Semaine des Familles, du 2 juin 1860.
[196] Le chiffre exact fut de 23 voix pour l’adoption du vœu, et 13 contre. (Procès-verbaux des séances du conseil général du Gard, Session de septembre 1851.)
[197] Charles-Paulin-Roger de Saubert, baron de Larcy (1805-1882); député de Montpellier de 1839 à 1846; représentant du peuple de 1848 à 1852; membre de l’Assemblée nationale de 1871. Ministre des Travaux-Publics dans le ministère de conciliation du 19 février, il reprit ce portefeuille dans le cabinet du duc de Broglie (26 novembre 1873-16 mai 1874), et fut élu sénateur inamovible le 4 décembre 1877. Par son talent, son courage et sa droiture, il marqua sa place au premier rang dans nos assemblées délibérantes. Il fut l’un des meilleurs amis d’Armand de Pontmartin. Voir sur lui les Souvenirs d’un vieux critique, t. III, p. 217-247.
[198] Souvenirs d’un vieux critique, t. III, p. 228.
[199] Henri de Pontmartin, né à Avignon le 21 novembre 1844.
[200] Ces trois articles sur Béranger terminaient les Lettres d’un sédentaire (Lettres XIV, XV et XVI).
[201] Il était sorti, depuis quelques jours, de la prison de Vincennes, où il avait été transféré le 8 décembre. «Dans la nuit du 13 au 14 décembre, on vint réveiller Alfred Nettement, et on le fit s’habiller, sans vouloir lui apprendre ce qu’on allait faire; puis, on le conduisit dehors, en lui disant: Vous êtes libre. Il était à ce moment deux heures du matin. Trouver une voiture n’était pas chose facile. Il était cinq heures lorsqu’il sonna à sa porte. Ce fut Mme Nettement, toujours sur le qui-vive, qui entendit le premier coup de sonnette et qui vint lui ouvrir.» Alfred Nettement, sa vie et ses œuvres, par Edmond Biré, p. 416.
[202] Cette page était extraite de l’Essai sur les principes générateurs des Constitutions politiques et des autres institutions humaines.
[203] Voir la 73e Conférence de Notre-Dame de Paris.
[204] Louis-Charles de Belleval, marquis de Belleval, né à Abbeville (Somme) le 16 mars 1814; mort à Paris le 6 juin 1875.
[205] Voir, dans les Épisodes littéraires, p. 209 et suiv., le chapitre sur la Naissance d’une Revue.
[206] Sa collaboration à la Revue des Deux Mondes, suspendue le 15 mars 1852, ne devait reprendre que le 1er janvier 1854, pour s’interrompre le 1er février 1855. Il y eut encore deux courtes réapparitions, en 1861 et en 1866.
[207] L’article sur Louis XVII et ceux sur Autran et sur Ponsard ont été recueillis par Pontmartin dans le tome I de ses Causeries littéraires.
[208] Adrien, comte de La Valette, né à Paris en 1814. Sous le second Empire, il prit part, non sans succès, au mouvement industriel et principalement à la construction, en Suisse, d’une ligne de chemin de fer, dite la ligne d’Italie, parce qu’elle devait y aboutir par le percement du Simplon. Il a fait la partie valaisane de la ligne, celle qui remonte le Rhône depuis le lac de Genève jusqu’à Brigue; il échoua pour le percement: l’heure n’en avait pas encore sonné.—L’Assemblée nationale reparut, sous sa direction, en septembre 1877.
[209] Ses bureaux étaient situés rue Bergère, 20, près le boulevard Montmartre.
[210] Vie de Berryer, par Charles de Lacombe, t. III, p. 96.
[211] C’est la nouvelle qui avait paru dans la Revue des Deux Mondes, le 15 février 1847, sous le titre d’Octave.
[212] Ces quatre nouvelles de Balzac font partie des Scènes de la vie privée.
[213] Le marquis Auguste de Cambis, qui habitait à 11 kilomètres des Angles, le château de Sauveterre, commune de ce nom, canton de Roquemaure (Gard).
[214] Allevarrès était l’anagramme et le pseudonyme de M. Jules de Serravalle.
[215] Moniteur du 6 février 1865.
[216] Georgette, par Mme Th. Bentzon, Revue des Deux Mondes des 1er et 15 octobre, 1er et 15 novembre 1879.
[217] Nouveaux Samedis, t. XX, p. 32.
[218] Nouveaux Lundis, t. II, p. 18. Article du 3 février 1862.
[219] Après avoir commencé la série de ses Lundis au Constitutionnel en octobre 1849 et après être passé au Moniteur à la fin de 1852, Sainte-Beuve était rentré au Constitutionnel en septembre 1861.
[220] Nouveaux Lundis, t. II. p. 26.
[221] Revue de Bretagne et de Vendée, février 1862.
[222] Nouveaux Lundis, t. II, p. 25.
[223] Nouveaux Lundis, t. III, p. 44.
[224] Père de l’admirable abbé Perreyve.
[225] Le Correspondant du 10 septembre 1888.—Souvenirs d’un vieux critique, t. X, p. 342.
[226] Mélanges de Louis Veuillot, 3e série, t. II, p. 209-233.—L’article est du 4 avril 1854.
[227] Voir ci-dessus, page 116.
[228] La Mode du 28 mars 1847.
[229] Paul-Louis Courier définissait Béranger: «L’homme qui a fait de jolies chansons.»
[230] Mélanges de Louis Veuillot, 1re série, t. VI, p. 338, 342.—Avril 1855.
[231] Voir dans les Mélanges, 1re série, t. VI, p. 538 à 574.
[232] Louis Veuillot avait cinq filles. Deux venaient de mourir, l’une à Reichshoffen, le 18 juin 1855, au château de M. de Bussières, et l’autre, le 3 juillet, à Versailles, chez sa grand’mère maternelle. Une troisième, Madeleine, devait mourir à son tour, peu de temps après, à Paris, le 2 août.
[233] Correspondance de Louis Veuillot, t. I, p. 355.—Cette lettre porte pour suscription: A M. le comte A. de Pontmartin, à Serrières (Ardennes). Il faut lire: A Serrières (Ardèche). Pontmartin était alors chez sa belle-mère, au château de la Mûre, à 8 kilometres du bourg de Serrières, qui était le chef-lieu de canton et le bureau de poste. Comme le nom de la Mûre avait souvent donné lieu à des confusions avec deux petites villes de l’Isère et du Rhône et entraîné de grands retards dans l’arrivée des lettres, la consigne de la famille était de mettre simplement sur l’adresse: Serrières (Ardèche).
[234] Souvenirs d’un vieux critique, t. X, p. 167.
[235] Voir, dans la biographie de Montalembert, par le P. Lecanuet, le chapitre VI du tome III.
[236] La première livraison du nouveau Correspondant—celui de Montalembert, de M. de Falloux et du prince Albert de Broglie—parut le 25 octobre 1855.
[237] Le dernier article de Pontmartin dans le Correspondant parut le 10 mai 1890. Il avait pour titre: Le Suicide d’un journal, L’Assemblée nationale. Voir Épisodes littéraires, p. 254-321.
[238] Épisodes littéraires, p. 253.
[239] 25 décembre 1856.
[240] A propos des romans de M. Edmond About et de M. Gustave Flaubert.—25 juin 1857.
[241] Causeries du Samedi, t. I, p. 134-135.
[242] Édouard Thierry, né à Paris le 14 septembre 1813. Après avoir été longtemps un de nos meilleurs critiques dramatiques, il devint, en octobre 1859, administrateur de la Comédie-Française, fonctions qu’il abandonna en 1871. Il fut alors nommé conservateur-administrateur de la Bibliothèque de l’Arsenal.
[243] Le Fils naturel, comédie en cinq actes et en prose, d’Alexandre Dumas fils, jouée sur le Théâtre du Gymnase, le 16 janvier 1858.
[244] La Jeunesse, comédie en cinq actes et en vers, d’Émile Augier, jouée sur le Théâtre de l’Odéon, le 6 février 1858.
[245] Lettre à Alfred Nettement, du 12 juin 1858.
[246] Le Correspondant du 25 février 1857.
[247] 25 décembre 1859.
[248] 25 novembre 1860.
[249] 25 avril 1861.
[250] 25 décembre 1861.
[251] 25 décembre 1863.
[252] 25 février 1866.
[253] 25 mars 1866.
[254] Ce fut Michel Lévy qui, voulant faire entrer le volume dans une nouvelle collection à 2 francs, imagina de l’appeler les Brûleurs de Temples, ce qui contraria beaucoup Pontmartin, surtout au point de vue de la loyauté envers l’acheteur.
[255] L’Enseignement mutuel ou Un bien averti en vaut deux, dans le volume des Contes et Nouvelles.
[256] Voir Causeries du Samedi, t. II, p. 378.
[257] Voir ci-dessus page 209.
[258] Sur le vicomte Eugène-Melchior de Vogüé, voir Nouveaux Samedis, tomes XV et XX; Souvenirs d’un Vieux critique, tomes V, VII, VIII et IX; Derniers Samedis, tomes I et II.
[259] Le baron Pougeard-Dulimbert.
[260] Son fils Henri qui suivait les cours du lycée Bonaparte.
[261] Théophile Gautier avait publié en 1856 un conte intitulé: Avatar.
[262] Je dois de pouvoir publier cette lettre et toutes les autres lettres à Autran qui vont suivre, à la gracieuse obligeance de la fille et du gendre du poète, M. et Mme Jacques Normand.
[263] P. 206-209.
[264] Le tome II des Causeries du Samedi, qui venait de paraître.
[265] Cette lettre de Louis Veuillot ne figure pas dans sa Correspondance.
[266] Voir Joseph Autran, Œuvres complètes, t. II, p. 342.
[267] Elles paraissaient le mardi, tous les quinze jours, à la troisième page du journal, sous le titre: Variétés. Comme elles avaient un très vif succès, M. de Riancey insista auprès de Pontmartin pour qu’il lui donnât non plus deux mais quatre articles par mois. On lit dans l’Union du 28 décembre 1858: «A dater du 1er janvier 1859, les Causeries littéraires de M. Armand de Pontmartin deviendront hebdomadaires; elles paraîtront régulièrement le samedi de chaque semaine dans le feuilleton du journal.»
[268] Le dernier secrétaire de Sainte-Beuve, M. Jules Troubat, a recueilli ces articles en 1876 sous le titre de Chroniques parisiennes. Un vol. in-18, Calmann-Lévy, éditeur.
[269] Cf. l’article de Sainte-Beuve sur la Vie de Rancé, par Chateaubriand, dans la Revue des Deux Mondes du 15 mai 1844, et le chapitre LVIII des Chroniques parisiennes, du 4 juin 1844.
[270] Célestin-Joseph Félix, membre de la Compagnie de Jésus, né à Neuville-sur-l’Escaut, près Valenciennes, le 29 juin 1810, mort le 6 juillet 1891 à Lille. Ses Conférences de Notre-Dame sur le Progrès par le Christianisme, prononcées de 1853 à 1872, forment dix-neuf volumes in-8.
[271] Un vol. in-32. C. Dillet, éditeur, rue de Sèvres, 15.
[272] Voir, au tome II des Derniers Samedis, p. 117, le chapitre sur le R. P. Félix. «Je me souviens, écrit Pontmartin, de l’époque où j’avais le bonheur de l’entendre à Notre-Dame..... Que de fois j’ai entendu M. Cousin, auditeur attentif et assidu de ces conférences, me dire, au sortir de l’église, avec son exubérance habituelle de parole et de pantomime: «Je n’ai pas d’objection! je n’ai pas d’objection!»
[273] Les bureaux du Correspondant étaient alors rue de Tournon, 29, à la librairie Ch. Douniol.
[274] Déjà, à la fin de 1857, Pontmartin s’était, encore une fois, rapatrié avec Buloz. Seulement, ce dernier voulait qu’il redébutât par un article de critique, et Pontmartin voyait à cela plus d’un inconvénient. Il écrivait à Autran, le 16 janvier 1858: «Tout le monde ici, à commencer par ma femme, me dit que j’ai pris, depuis trois ans, une situation trop accentuée dans la critique, pour que ma rentrée à la Revue puisse s’effectuer sans inconvénient. Buloz, il faut l’avouer, est plus anti-chrétien que jamais. Il est homme à se lever la nuit, une veille de numéro, pour changer, supprimer ou ajouter, dans un de mes articles, de quoi me faire passer pour un déserteur ou un capitulateur en religion ou en politique. Il n’en faudrait pas davantage pour me faire fusiller, sur toute la ligne, depuis les Barbey du Réveil et les Jouvin du Figaro, jusqu’aux Alloury et aux Rigaud des Débats. Et cette fois, ce serait sur des points plus graves que ce qui touche à la vanité littéraire. Il en résulte, de mon côté, des hésitations, des alternatives, des lenteurs, qui, se combinant avec toutes les aspérités de Buloz, amènent le résultat négatif que vous voyez. Mon désir serait de débuter par l’Écu de six francs, Buloz voudrait, au contraire, me faire commencer par un article de critique et ce petit tiraillement intérieur a encore tout ajourné.»—Pontmartin tenait bon pour sa Nouvelle; Buloz, naturellement, exigeait une refonte générale de l’Écu de six francs. Pontmartin se résigne, et, le 5 février, il écrit: «Je corrige à satiété, avec une docilité d’élève de quatrième, les dernières pages de ma Nouvelle, qui avait dû paraître irrévocablement le 15 janvier, puis le 1er février et qui me semble maintenant ajournée au 1er mars.»
Le 1er mars, rien ne paraît, et, le 4, Pontmartin écrit de nouveau à Autran: «Le 25 février, lorsque les 42 pages de ma Nouvelle étaient composées, corrigées par de Mars et par moi, lorsque le bon à tirer était donné, M. Buloz a déclaré que de Mars m’avait égaré, que ma première donnée était la bonne, qu’il fallait y revenir, mais que nous n’avions plus le temps pour le 1er mars. Ce n’était là qu’une façon de prévenir mon irritation du premier moment. Hier, nous avons eu une longue conversation, et il m’a demandé de tels changements qu’il serait beaucoup plus court et plus simple d’écrire une œuvre toute nouvelle. Pourtant, dans ce naufrage, j’ai eu au moins un bonheur: je ne me suis pas emporté une seule minute; nous nous sommes quittés sans orage, et s’il y a séparation, il n’y aura pas rupture.»
Et puisque j’ai rouvert ces lettres de Pontmartin à Autran, je détacherai de celle du 15 décembre 1857 un mot typique de M. Buloz, qui avait perdu, le 13 décembre, son beau-père, M. Castil-Blaze, le très spirituel critique musical du Journal des Débats, où il signait: X. X. X. «Adieu, cher! écrivait Pontmartin; j’attends ma femme après-demain et j’aurai alors un peu plus de liberté. J’en profiterai pour aller recueillir çà et là quelques-unes de ces nouvelles que je ne vous donne pas aujourd’hui: ce que je sais de plus intéressant, ce sont deux enterrements: Castil-Blaze et Lefèvre-Deumier. Voici l’oraison funèbre de C. Blaze, adressée par Buloz à sa femme: «Votre père s’est toujours plu à me contrarier: le voilà qui meurt l’avant-veille d’un numéro!»—C’est tout ce qu’on a pu tirer du Reviewer quand même.»
[275] Revue des Deux Mondes, 1er août 1861.
[276] 1er octobre 1861.
[277] 1er décembre 1861.
[278] M. Victor Fournel.
[279] Lundi 3 février 1862, Nouveaux Lundis, t. II, p. 1.
[280] Le Correspondant du 25 décembre 1856.—Causeries du Samedi, t. Ier, ch. II.
[281] Le Correspondant du 25 mai 1856.—Causeries du Samedi, t. Ier, ch. III.
[282] L’Assemblée nationale.
[283] M. Henry de Riancey, directeur de l’Union, où Pontmartin, depuis la suppression de l’Assemblée nationale, publiait ses Causeries littéraires.
[284] Pontmartin venait de publier dans l’Union trois articles sur le tome Ier des Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps, par M. Guizot. Voy. ces articles au tome II des Causeries du Samedi.
[285] Souvenirs de la Restauration, par Alfred Nettement. Un vol. in-18, 1858.
[286] Le pseudonyme de Curtius cachait le nom d’un sous-directeur du Timbre, M. Charles Bouglé: il avait publié autrefois dans la Mode, d’abord sous le titre des Leçons de Neuilly, puis sous celui de l’Enfant terrible, des dialogues extrêmement piquants et qui avaient eu leur quart d’heure de célébrité.
[287] Alfred Nettement, dans la Semaine des Familles, ne prenait pas moins de trois pseudonymes: Félix-Henry, Nathaniel et René, si bien qu’il y avait souvent, dans la même livraison, sous trois ou quatre noms différents, trois ou quatre articles du directeur.
[288] Le Réveil était un recueil hebdomadaire, dirigé par A. Granier de Cassagnac, avec la collaboration de Louis Veuillot, Barbey d’Aurevilly, Ernest Hello, etc.
[289] Lettre du 22 septembre 1887.
[290] Livraison du 15 janvier 1859.
[291] Semaine des Familles du 12 février 1859.
[292] Livraison du 26 novembre 1859.
[293] Voir ci-dessus notre chapitre VII, pages 161 et suivantes.
[294] La Madelène (Jules-François-Ézéar de), né en 1820, à Versailles, d’une famille originaire de Carpentras, mort en 1859. Ses œuvres principales sont, avec le Marquis des Saffras, Brigitte et le Comte Alighiera.—Son frère Henry, auteur également de plusieurs romans remarquables, parmi lesquels je citerai en première ligne la Fin du marquisat d’Aurel (1879), a publié, en 1856, le Comte Gaston de Raousset-Boulbon, sa vie et ses aventures, d’après sa correspondance.
[295] Semaine des Familles du 16 juin 1860.
[296] Nouveaux Lundis, t. III, p. 35.
[297] Lettres à l’Étrangère, p. 303, 8 mars 1836.
[298] Historique du procès auquel a donné lieu «le Lys dans la vallée». Mai 1836. Balzac, Œuvres complètes, t. XXII, p. 436.
[299] Nouveaux Lundis, t. III, p. 36.
[300] Nouveaux Lundis, t. III, p. 42.
[301] Voir ci-dessus, chapitre VIII, p. 187.
[302] Nouveaux Lundis, t. III, p. 41.
[303] Les Jeudis de Madame Charbonneau, p. 65.
[304] Tome IV, p. 45.
[305] M. Buloz était alors commissaire du roi près le Théâtre-Français, en même temps que directeur de la Revue des Deux Mondes.
[306] Revue des Deux Mondes, 15 novembre 1891.
[307] Correspondance de Jules Janin, p. 224.
[308] Le Correspondant des 25 juillet et 25 août 1862.—Semaines littéraires, t. II, p. 1-92.
[309] Aujourd’hui no 18.
[310] Souvenirs d’un vieux critique, t. II. p. 252.
[311] Frédéric Béchard était né à Nimes en novembre 1824. Journaliste, il a collaboré à l’Artiste, à la Mode nouvelle, à la Patrie, à la Revue de Paris, à la Gazette de France, etc. Romancier, il a publié les Existences déclassées (1859), et Jambe d’argent, scènes de la grande chouannerie (1865). Auteur dramatique, il a fait jouer à l’Odéon les Tribulations d’un grand homme (1847) et le Passé d’une femme (1859), et au Vaudeville les Déclassés (1856). Il était fils de Ferdinand Béchard (1799-1870), l’un des meilleurs lieutenants de Berryer, député de la droite de 1842 à 1846, puis représentant du Gard aux Assemblées de 1848 et 1849.
[312] Amable Escande, né à Castres (Tarn) en 1810. De 1834 à 1848, il écrivit dans la Gazette de France, la Mode et l’Union. Après le 24 février, il alla prendre la direction de l’Écho du Midi, à Montpellier. Un de ses articles fut l’occasion d’un duel fameux entre M. Aristide Ollivier, rédacteur en chef du Suffrage universel, et le comte de Ginestous. M. Ollivier, frère du futur ministre de l’Empire libéral, fut tué sur le coup, et M. de Ginestous grièvement blessé. A la suite de cette malheureuse affaire, Escande revint à Paris (1851) et rentra à l’Union, puis à la Gazette de France, dont il ne se sépara, après une longue et très active collaboration, que pour devenir directeur de la Gazette du Languedoc à Toulouse.
[313] M. Gustave Janicot était, depuis 1861, directeur de la Gazette de France, où il avait succédé à M. de Lourdoueix, et où il défend encore aujourd’hui avec un talent toujours jeune et une inlassable vaillance la cause de la monarchie et celle de l’Église.
[314] Janvier 1863.—Semaines littéraires, t. II, p. 233.
[315] Lettre du 7 avril 1863.—Le comte Achille Treilhard, petit-fils du conventionnel, était depuis le 28 août 1862 directeur de la presse.
[316] Le Correspondant du 25 septembre 1863.
[317] Lettre du 11 mai 1866.
[318] Pages 146-150. Les Odeurs de Paris parurent en novembre 1866.
[319] Auteur d’une Histoire de Christophe Colomb. Voir sur lui les Causeries du Samedi, t. II, p. 312-323.
[320] M. Challemel-Lacour fut, pendant quelques mois, gérant de la Revue des Deux Mondes, après la mort de M. V. de Mars.
[321] Lettre pastorale sur les Malheurs et les Signes du temps.
[322] Lettre du 1er juillet 1867.
[323] Situé dans la commune de Cabriès, canton de Gardanne, arrondissement d’Aix (Bouches-du-Rhône).
[324] Le château de Pradine, commune de Grambois, canton de Pertuis, arrondissement d’Apt (Vaucluse).
[325] Voir, dans les Souvenirs d’un vieux mélomane, le chapitre XVII, une Partie de boules, Souvenirs des vacances de 1866. Pontmartin y a placé une très exacte description de La Malle: «Sur l’ancienne route royale d’Aix à Marseille, à une distance à peu près égale entre la vieille capitale du Parlement et la nouvelle capitale de la Méditerranée, à deux portées de fusil du Pin, autrefois relais de la poste aux chevaux, aujourd’hui bureau de la poste aux lettres, on voit une jolie maison de campagne, qui a l’esprit de n’être ni un château, ni une villa, ni une bastide. De grands arbres, presque aussi vieux, mais beaucoup plus beaux que des académiciens, d’élégants massifs de marguerites, de dahlias et de chrysanthèmes, des allées plantées de sycomores et de saphoras, une gracieuse façade se tournant à demi du côté des champs et des collines, comme pour éviter les regards indiscrets ou la poussière du grand chemin: entre la maison et la route un quinconce d’ormeaux séculaires sur une terrasse séparée des passants par une grille.»
[326] Joseph-Louis d’Ortigue, né à Cavaillon (Vaucluse) le 22 mai 1802, mort à Paris le 20 novembre 1866. Il a fait la critique musicale dans la Quotidienne, l’Ère nouvelle, l’Opinion publique, le Journal des Débats, et publié plusieurs volumes de littérature et d’histoire musicales: la Sainte-Baume, le Balcon de l’Opéra, la Musique à l’église, la Musique au théâtre, etc.
[327] Nouveaux Samedis, t. IV, p. 148.
[328] Aurélien Scholl (1833-1902), auteur dramatique et journaliste. Il a, pendant un demi-siècle, alimenté de ses chroniques une vingtaine de journaux, et il a créé une nuée de petites feuilles, la Silhouette, le Nain Jaune, le Club, le Jockey, le Lorgnon, etc., etc.
[329] Paul Parfait, né à Paris le 23 octobre 1841, journaliste et romancier. Il fut le secrétaire d’Alexandre Dumas père, qu’il accompagna en Italie, écrivit au Charivari, au Rappel, au National, à la République française, et publia plusieurs romans, l’Assassin du bel Antoine, la Seconde vie de Marius Robert, l’Agent secret, les Audaces de Ludovic, etc.
[330] Ce fut M. Challemel-Lacour qui rendit compte de la pièce dans la livraison du 1er avril 1867.
[331] Autran souffrait alors d’une affection de la vue qui devait le conduire, dans les dernières années de sa vie, à une cécité presque complète.
[332] Lettre du 14 avril 1867.
[333] De Pontmartin (Note du Père Félix).
[334] Le Progrès par le christianisme, Conférences de Notre-Dame de Paris. Année 1867, page 237.
[335] Arthur de Boissieu, né en 1835, mort à trente-huit ans le 29 mars 1873. Il avait débuté, sous le voile de l’anonyme, par les Lettres de Colombine, qui eurent une grande vogue dans le Figaro et dont le mystère fut longtemps si bien gardé. Ses Lettres d’un Passant, publiées dans la Gazette de France de 1865 à 1873, forment cinq volumes (1868-1875).
[336] Lettres d’un Passant, t. II, p. 137.—Juin 1867.
[337] Les bureaux du Figaro étaient alors rue Rossini, 3. C’est seulement en 1874 que le journal de Villemessant se transporta rue Drouot, no 26.
[338] Les corbeaux le diront.
[339] Pierre-Eugène Basté, dit Grangé, né à Paris en 1812. Il a composé un grand nombre de vaudevilles, de comédies et de drames, dont les principaux sont: Les Premiers beaux jours (1847), Fualdès (1848), les Domestiques (1861), la Boîte au lait (1862), le Supplice d’un homme (1865), la Voleuse d’enfants (1865), la Bergère d’Ivry (1866), un Voyage autour du demi-monde (1868).
[340] Du nouveau sur Joubert, par l’abbé G. Pailhès, p. 46 et suiv.
[341] Séance du 2 décembre 1867.
[342] Les Lettres d’un Passant, d’Arthur de Boissieu, paraissaient le vendredi dans la Gazette de France.
[343] Voir, dans les Lettres d’un Passant, t. II, p. 147-169, la Lettre d’un Japonais à sa fiancée.
[344] Aujourd’hui rue Joseph-Autran.
[345] M. Guizot avait jusque-là voté contre Autran.
[346] Lettre à M. Jules Claretie, du 26 mai 1868.
[347] Lettre à M. Jules Claretie.
[348] Aux Angles.
[349] M. le Vte de Salvador, au Mas d’Auphan, par Raphèle, près Arles.
[350] Célestin Crevel, l’un des principaux personnages de la Cousine Bette. Il figure également dans César Birotteau et dans le Cousin Pons.
[351] Autran avait alors en préparation un nouveau volume de poésies.
[352] Mlle Rachel s’était refusée à jouer le rôle de Méganire dans la Fille d’Eschyle, de Joseph Autran.
[353] Lettre du 20 novembre 1868.
[354] Nouveaux Samedis, t. IV, p. 240-270.
[355] Ces deux articles sur Lamartine, celui de l’Illustration et celui de la Gazette, se trouvent au tome VII des Nouveaux Samedis.
[356] Christine Nilsson, cantatrice suédoise, née en 1843. Après avoir débuté à Paris, au Théâtre-Lyrique, le 27 octobre 1864, dans le rôle de Violette de la Traviata, de Verdi, elle fut engagée au Grand-Opéra, le 15 novembre 1867, pour créer le rôle d’Ophélie dans l’Hamlet de M. Ambroise Thomas, et joua en 1869, dans le Faust de Gounod, le rôle de Marguerite. Après son mariage à Londres, en 1872, avec un Français, M. Auguste Rouzeaud, fils d’un riche négociant de Jonzac, elle ne joua plus à Paris et ne fit que de courtes apparitions sur les scènes lyriques de la province et de l’étranger.
[357] Le tome VI des Nouveaux Samedis.
[358] Berryer était mort le 29 novembre 1868. L’étude de Pontmartin parut le 31 décembre 1868.
[359] Victor Hugo et la Restauration, par Edmond Biré. Un volume in-18; 1869.
[360] Pontmartin n’a pas consacré à Lamartine moins de neuf Causeries.
[361] Nouveaux Samedis, t. XIV, p. 225.—Quelques jours après la mort de Sainte-Beuve, Pontmartin écrivait, des Angles, à M. Jules Claretie: «En fait de rappel, il me semble que la littérature n’est pas épargnée par le tambour voilé de crêpe. Lamartine et Sainte-Beuve dans la même année, c’est trop!... Étranges natures que les natures littéraires qui pourraient se dédoubler de manière à produire un méchant et un bonhomme sous une même calotte de velours! Depuis deux ans, si j’avais osé, je serais allé dix fois lui serrer la main, à ce pauvre Sainte-Beuve, et je faisais des vœux bien sincères pour que ce maître, ce modèle, nous fût conservé encore quelques années. J’ai appris sa mort, et les détails de sa mort avec une douloureuse émotion.» (Lettre du 30 octobre 1869.)
[362] Nouveaux Samedis, t. VII, p. 342.
[363] Le 10 novembre 1869.
[364] L’élection eut lieu le 7 avril 1870. M. Émile Ollivier réunit 26 voix sur 28 votants.
[365] Henri Chevreau (1823-1903). Préfet de l’Ardèche à 26 ans, conseiller d’État et préfet de Lyon depuis 1864, il avait été nommé préfet de la Seine, le 5 janvier 1870, en remplacement du baron Haussmann. Le 10 août suivant, il fut appelé à prendre, dans le ministère Palikao, le portefeuille de l’Intérieur.
[366] M. Villemain était mort le 8 mai 1870.
[367] Prosper Mérimée mourut, en effet, peu de temps après, au mois de septembre 1870. Prévost-Paradol, hélas! était mort avant lui, à Washington, le 11 juillet.
[368] Le plébiscite du 8 mai 1870.
[369] M. Émile Ollivier, M. Chevandier de Valdrôme et leurs collègues furent renversés le 10 août 1870, et remplacés par le cabinet Palikao.
[370] Journal d’un voyageur pendant la guerre, avril 1871.
[371] Le mot est du républicain Lanfrey, Moniteur de Seine-et-Oise, Décembre 1870.
[372] Lettre du 12 octobre 1870.
[373] Victor Cousin et Prosper Mérimée étaient morts tous les deux à Cannes, le premier le 13 janvier 1867; le second le 23 septembre 1870.
[374] Voir dans le Correspondant des 10 août et 10 septembre 1871, Cent jours à Cannes pendant les deux sièges, et dans la Mandarine, p. 195-309.—Dans son récit, Pontmartin parle avec reconnaissance des personnes qu’il voyait pendant ce séjour à Cannes et dont l’amitié le soutint dans cette épreuve; mais il ne les désigne que par des initiales: «M. Ernest L...d, élégant et poétique traducteur des sonnets de Shakespeare, de Pétrarque, de Lope de Vega; l’abbé C...; M. Dubois d’A.; M. X., un des avocats les plus distingués de Paris; Mme Justin D...».—Voici les vrais noms: M. Ernest Lafond; l’abbé Chaix, du clergé de Cannes; M. Duboys d’Angers, premier président de la Cour d’appel d’Orléans à la fin de l’Empire; M. Grandmanche de Beaulieu; Mme Justin Durand, née de Zagarriga, femme de l’ancien député des Pyrénées-Orientales au Corps législatif, qui, à la veille de la guerre, exerçait une vraie royauté dans toute la région de Perpignan et de Montpellier. Pontmartin, qui sait encore sourire au milieu de ses larmes, parle d’elle en ces termes: «Madame Justin D..., type de charité, de grâce et de bienveillance, à qui j’ai vu faire quelque chose de bien plus extraordinaire qu’une aumône de cent mille écus ou une souscription de trois millions: chiffres qui n’eussent pas été en désaccord avec son immense fortune et les inspirations de son cœur généreux. En plein siège de Paris, elle trouva moyen de se procurer tous mes ouvrages, et je crois même, Dieu me pardonne, qu’elle les lut!»
[375] Alors directeur de la Décentralisation, de Lyon, après avoir appartenu à la rédaction de la Gazette de France. De Lyon il passa à Marseille, où il dirigea la Gazette du Midi et où il est mort en 1899.
[376] John Martin, peintre anglais, 1789-1854. Ses meilleures toiles sont: la Chute de Babylone, le Festin de Balthazar, la Destruction d’Herculanum, la Chute de Ninive.
[377] L’article parut le 10 juillet 1871, dans le Correspondant, sous ce titre: la Critique en 1871.—Voir Nouveaux Samedis, t. VIII, p. 1-51.
[378] Voir, au sujet de cet épisode, l’éloquent écrit de M. Émile Ollivier: M. Thiers à l’Académie et dans l’histoire (1880).
[379] Trois ans plus tard, le 4 octobre 1874, une brillante revanche fut prise pour ce même siège au Conseil général par Louis-Numa Baragnon, qui déploya dans la lutte, sur ce petit théâtre, un merveilleux talent. Pontmartin avait été le principal patron de sa candidature; il eut les joies de la victoire, sans en avoir les embarras.
[380] Voir ci-dessus chapitre XII, p. 317.
[381] Le Filleul de Beaumarchais a paru dans le Correspondant des 25 décembre 1871, 10 et 25 janvier 1872.
[382] Joseph-Othenin-Bernard de Cléron, comte d’Haussonville (1809-1884), membre de l’Académie française, auteur de l’Histoire de la réunion de la Lorraine à la France, de l’Église romaine et le premier Empire, etc.
[383] Arthur-Marie Bucheron (1834-1902), connu sous le pseudonyme de Saint-Genest. Ses articles du Figaro ont eu un grand retentissement. La plupart ont été réunis en volume: La Politique d’un soldat (1872); Lettres d’un soldat (1873), etc.—Voir sur lui Nouveaux Samedis, t. VIII, p. 140; tome XI, p. 178; t. XIV, p. 289.
[384] Pontmartin ne devait pas tarder à quitter le no 20 de la rue Laffitte pour prendre, au no 2 de la même rue, un petit appartement meublé dans l’immense immeuble qui était alors la propriété de sir Richard Wallace.
[385] Nouveaux Samedis, t. VIII, p. 52.
[386] Le 9 juin 1872, des élections partielles avaient eu lieu dans le Nord, dans la Somme et dans l’Yonne. MM. Deregnaucourt, Barni et Paul Bert, tous les trois républicains avancés, avaient été nommés.
[387] Nouveaux Samedis, t. VIII, p. 203.
[388] Canton de Châteaurenard, commune de Barbentane (Bouches-du-Rhône).
[389] Le général marquis Léon d’Andigné pair de France, sénateur de Maine-et-Loire, fils du comte Auguste d’Andigné, l’auteur des Mémoires; il était le gendre du marquis de Barbentane. Il s’était conduit en héros à Reichshoffen et à Sedan. Dans la journée du 1er septembre 1870, il avait été laissé pour mort sur le champ de bataille. Deux chevaux tués sous lui, ses deux jambes traversées, son bras droit fracassé par des balles, attestaient l’acharnement de la lutte soutenue.
[390] Lis Isclo d’or, par Frédéric Mistral, 1875.
[391] Nouveaux Samedis, t. IX, p. 68 et suiv.
[392] Gazette de France du 13 octobre 1872.—Nouveaux Samedis, t. IX, p. 69.
[393] Edmond Tarbé des Sablons (1838-1902), critique musical, romancier et auteur dramatique. Le 5 juillet 1868, il avait fondé, avec Henri de Pène, le journal le Gaulois, dont il resta, l’année suivante, l’unique directeur et qu’il ne quitta qu’en juillet 1879.
[394] Nouveaux Samedis, t. X, p. 296-343.
[395] La Mandarine avait paru dans le Correspondant du 10 juin 1870. Cette nouvelle, primitivement destinée à la Revue des Deux Mondes, avait dû s’appeler tout d’abord le Feu de sarments.
[396] Nouveaux Samedis, t. X, p. 111.
[397] Ce fut Ledru-Rollin qui l’emporta. Il fut élu le 1er mars.
[398] Le Correspondant du 10 janvier 1874.
[399] Le Correspondant du 25 mars 1874.
[400] Voici le passage auquel fait allusion Joseph Autran: «M. de Pontmartin n’a eu de rival, comme critique, que Sainte-Beuve, à qui son talent n’avait rien à envier, et qui lui a, plus d’une fois, envié devant moi sa foi chrétienne et monarchique.» Le Figaro du 25 mars 1874. Article signé François Duclos, pseudonyme qui cachait un des plus spirituels écrivains du temps.
[401] Jules Janin mourut le 19 juin 1874.
[402] Le Chancelier de fer, qui aimait à maximer ses pratiques, disait volontiers: Beati possidentes! C’était aussi l’un des mots favoris de son maître Frédéric II.
[403] Lettre du 4 avril 1875.
[404] Souvenirs d’un vieux critique, t. VII, p. 251.
[405] Edmond Rostand, l’auteur de Cyrano de Bergerac, des Romanesques et de l’Aiglon.
[406] Académie française, séance du 4 juin 1903.
[407] C’était le titre sous lequel paraissaient, dans la Gazette de France, ses articles du samedi.
[408] Nouveaux Samedis, t. XIV, p. 366.
[409] Chez Baudouin frères, Pollet et Barba, rue de Vaugirard, no 17, rue du Temple, no 36, et au Palais-Royal.
[410] Le Théâtre du Gymnase, dont Eugène Scribe était le principal fournisseur et que la duchesse de Berry avait pris sous sa protection, porta, depuis le 8 septembre 1834 et jusqu’à la révolution de Juillet, le nom de Théâtre de Son Altesse Royale Madame.
[411] La Chambre des députés et le Sénat siégeaient encore à Versailles.
[412] Pontmartin eut beaucoup d’amis. J’en ai nommé plusieurs. Je me reprocherais de ne pas citer ici les trois amis d’enfance, de jeunesse et de toujours, avec lesquels il eut peut-être la plus constante intimité: Alphonse d’Archimbaud (1811-1865), fils du marquis d’Archimbaud, député de la Chambre introuvable, dont les réceptions cordiales et paternelles dans son château de Vérone, près Nyons (Drôme), avaient laissé à Pontmartin de tels souvenirs qu’il aimait à les évoquer sans cesse, surtout dans ses dernières années;—Isidore d’Athénosy (1806-1872), fils d’un haut fonctionnaire de l’administration pontificale à Avignon, un homme d’étude et de science, un royaliste militant, un catholique des anciens temps;—Eugène de Baciocchi (1807-1884), fils d’un officier corse marié à Avignon, authentiquement cousin des parents de Napoléon III, peut-être même cousin de l’Empereur. Il n’aurait eu qu’un mot à dire pour obtenir une préfecture ou tout autre haut emploi, que sa grande intelligence et son vaste savoir l’eussent rendu apte à remplir; mais ce mot, par fidélité royaliste et quoiqu’il fût pauvre, il ne voulut jamais le prononcer.
[413] M. Amédée de Jonquières, qui devait entrer, en novembre 1878, au noviciat de la Compagnie de Jésus, devenir profès de cette Compagnie le 15 août 1897 et avoir, en 1901, les honneurs de la proscription.
[414] Sur le tome XIV des Nouveaux Samedis.
[415] Le 23 juin 1877.
[416] M. Thiers était mort le 3 septembre 1877.
[417] M. Léon Lavedan était alors directeur de la presse au ministère de l’Intérieur.
[418] Vie de Mgr Dupanloup, par l’abbé F. Lagrange, t. III, p. 450.
[419] Vie de Mgr Dupanloup, t. III, p. 452.
[420] Voir ces trois récits dans les Souvenirs d’un vieux Mélomane.
[421] Nouveaux Samedis, t. X, p. 334.
[422] Le Correspondant du 10 juin et du 25 juin 1878.
[423] Salon de 1850.
[424] Salon de 1863.
[425] Le Correspondant du 25 décembre 1878. Article de M. Henri Lavedan.
[426] M. Villemain.
[427] Nouveaux Samedis, t. I, p. 164.
[428] Les Jeudis de Madame Charbonneau, p. 71.
[429] Montalembert était mort le 13 mars 1870; Villemain, le 8 mai; Prévost-Paradol, le 11 juillet; Prosper Mérimée, le 23 septembre.
[430] Au printemps de 1870 (les 7 avril et 19 mai), il y avait eu, non pas un triple, mais un quadruple scrutin; MM. Emile Ollivier, Jules Janin, Xavier Marmier et Duvergier de Hauranne avaient été élus en remplacement de Lamartine, de Sainte-Beuve, de M. de Pongerville et du duc Victor de Broglie. Pontmartin n’avait posé sa candidature à aucun des quatre fauteuils.
[431] Sur ce voyage de M. de Falloux à Versailles, au mois d’août 1871, voy. les Mémoires d’un royaliste, t. II, p. 469-511.
[432] Il venait d’être battu, comme candidat au Conseil général, dans le canton de Villeneuve-lès-Avignon, par un petit avocat d’Uzès, ex-sous-préfet gambettiste. J’extrais de sa lettre du 6 novembre ce menu détail: «Les mêmes électeurs qui m’ont repoussé comme trop aristocrate, trop féodal, c’est-à-dire, j’imagine, trop peu libéral, ont voté comme un seul homme, pendant la phase impériale, pour un chambellan qu’ils n’avaient jamais vu: voilà le suffrage universel!» Voir, sur ce petit épisode électoral, le chapitre XIII, p. 339.
[433] Vie de Mgr Dupanloup, évêque d’Orléans, par M. l’abbé F. Lagrange, t. III, p. 245.
[434] M. Thiers avait été le patron et le principal agent de l’élection de M. Littré.
[435] M. Duvergier de Hauranne, élu le 19 mai 1870, en remplacement du duc Victor de Broglie, n’avait pas encore pris séance; il ne le devait faire que le 29 février 1872.
[436] C’est, on le sait, le titre d’un des meilleurs recueils de Laprade.
[437] Le tome IX de ses Nouveaux Samedis.
[438] Taine n’avait pas encore publié le premier volume de son admirable ouvrage sur les Origines de la France contemporaine, qui parut seulement en 1876, et dans lequel il prenait si courageusement parti pour l’histoire contre la légende.
[439] L’élection en remplacement de M. de Ségur. Elle eut lieu le 1er mai 1873.
[440] Voir, ci-dessus, chapitre XIII, p. 352 et suivantes.
[441] M. Pierre Lebrun était décédé subitement le 27 mai 1873.
[442] Voir, ci-dessus, chapitre XIII, p. 352.—Sous le pseudonyme de M. Bourgarel et sous le titre de Fantaisies et Variations sur le temps présent, Pontmartin avait inséré, dans son neuvième volume des Nouveaux Samedis, trois ou quatre chapitres humoristiques publiés au mois d’octobre 1872 et dont le premier était intitulé: «M. Gambetta, membre de l’Académie française.» Le discours du récipiendaire est écrit dans une langue si... gambettiste, qu’après l’avoir entendu, cinq quarts d’heure durant, les académiciens prodiguent des marques de l’aliénation mentale la mieux caractérisée: «M. Pingard danse la pyrrhique; M. de Laprade crie: Vive l’Empereur! M. le duc de Broglie donne un croc-en-jambe à Mgr le duc d’Aumale; M. Duvergier de Hauranne se croit métamorphosé en pain de sucre, et en offre un morceau à M. Guizot; M. Dufaure s’habille en Apollon du Belvédère et marivaude avec les trois Grâces; M. Lebrun demande une valse à Mme Mohl; M. Jules Favre calcule tout haut combien il entre de pouces cubes dans un moellon, et s’écrie en éclatant de rire: «Pas un!»—M. de Sacy risque trois calembours indécents; M. Littré dit: JE CROIS EN DIEU! en quatorze langues différentes; M. Patin fait une déclaration d’amour à Mme Mathusalem; M. Saint-Marc Girardin ôte sa cravate pour y tailler deux paires de draps; le duc de Noailles jure comme un charretier. A la fin, M. Cuvillier-Fleury, seul maître de ses sens, propose à l’Académie de lui lire Alexandre, tragédie inédite de feu M. Viennet. Cette proposition insidieuse met tout le monde en fuite et les immortels se réveillent sur le pont des Arts, comme s’ils sortaient d’un mauvais rêve.» (Nouveaux Samedis, t. IX, p. 73.)
[443] Ce volume de Pontmartin avait paru au mois d’avril 1872.—Voir chapitre XIII, p. 347.
[444] Le château de Pradine, commune de Grambois (Vaucluse).
[445] L’élection eut lieu le 29 janvier 1874. Le fauteuil de M. Lebrun fut attribué à Dumas fils; celui de Saint-Marc Girardin, à M. Mézières; et celui de Vitet, à M. Caro.
[446] M. Guizot était mort le 12 octobre 1874.
[447] Voir ci-dessus chapitre XIV, p. 376.
[448] L’élection au fauteuil de M. de Loménie eut lieu le 14 novembre 1878. Taine, devenu le candidat de la droite de l’Académie, fut élu par 20 voix sur 26.
[449] Le château de la Combe de Lancey, appartenant à M. Albert du Boys.
[450] Mes Mémoires, tome II, chapitre 1.
[451] Depuis le printemps de 1888, un des deux canapés a cédé la place au très beau buste en marbre du Maître par Antoine Bastet.
[452] Souvenirs d’un vieux critique, t. VII, p. 240. 1886.
[453] M. Edme Cade, docteur en médecine à Avignon. Bulletin de l’Association amicale des anciens élèves de l’Ecole libre Saint-Joseph d’Avignon. Juin 1890.
[454] François-Nicolas-Xavier-Louis Besson (1821-1888), évêque de Nîmes de 1875 à 1888. Ses Sermons, Conférences, Panégyriques et Oraisons funèbres ne forment pas moins de quinze volumes. On lui doit en outre la Vie de Mgr Cart, évêque de Nîmes, la Vie de M. l’abbé Besson, ancien secrétaire général des Affaires ecclésiastiques, Montalembert en Franche-Comté, la Vie du Cardinal Mathieu, la Vie de Mgr Paulinier, archevêque de Besançon, etc., etc. Sur Mgr Besson, voir Nouveaux Samedis, tome XX, et Souvenirs d’un vieux critique, tomes III et VIII.—Mgr Besson avait succédé sur le siège de Nîmes à Mgr Plantier, évêque de 1855 à 1875, qui avait, lui aussi, comblé Pontmartin de prévenances et de marques de vraie amitié, et en qui l’auteur des Samedis saluait un causeur encore plus remarquable que l’orateur et l’écrivain.
[455] Article du 12 octobre 1887.—Souvenirs d’un vieux critique, t. X, p. 278.
[456] Lettre du 12 janvier 1881.
[457] L’article de M. Emile, Zola avait paru dans le Figaro du 27 décembre 1880, sous ce titre: MONSIEUR LE COMTE. Voyez la réponse de Pontmartin au tome I des Souvenirs d’un vieux critique, p. 355 et suivantes. J’en détache seulement ces lignes, où il répond au triomphant auteur de Nana qui le raillait d’être «un vaincu».
«Oui, vous êtes un vainqueur; moi, je suis un vaincu, vaincu depuis cinquante ans, et je m’en fais gloire; vaincu, avec la justice, avec la vérité, avec le droit, avec l’honneur, avec la lumière, avec la liberté, avec l’Alsace, avec la Lorraine, avec la France;—je ne dis pas avec la Religion, plus victorieuse dans ses défaites que dans ses triomphes; vaincu en bien bonne compagnie, avec les nobles femmes condamnées à l’amende pour avoir protesté contre des effractions sacrilèges; vaincu avec les ordres religieux que l’on disperse, avec les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul que l’on expulse, avec les images sacrées que l’on déchire ou que l’on décroche, avec les Frères de la doctrine chrétienne que les médecins les moins dévots saluaient comme des héros pendant le siège et la guerre; vaincu avec les zouaves de Lamoricière et les zouaves de Charette, avec tout ce qu’il y a, dans notre malheureux pays, d’honnête, de loyal, de généreux, d’éloquent, d’illustre, de libéral, de fidèle aux lois immortelles du beau, du vrai et du bien!»
[458] Souvenirs d’un vieux critique, t. V, p. 220,. 1884.
[459] Cette lettre n’est pas de la main d’Armand de Pontmartin; elle fut dictée par lui à son fils. Il en sera de même, à partir de ce moment, pour la plupart des lettres qu’il m’adressera.
[460] Le premier volume des Mémoires, avec ce sous-titre: Enfance et Jeunesse, parut dans le Correspondant des 10 et 25 septembre, 25 octobre, 25 novembre et 25 décembre 1881.
[461] Ce second volume parut dans le Correspondant des 25 novembre, 10 et 25 décembre 1885, 10 janvier, 10 et 25 février 1886.
[462] Voir ci-dessus, chapitre IV, p. 82, et chapitre V, p. 98.
[463] Voir ci-dessus chapitre XII, p. 312.
[464] Mes Mémoires, t. II, p. 218.
[465] Correspondance de Jules Janin, p. 265.
[466] Livraison du 25 décembre 1885.
[467] Dans le Correspondant du 10 janvier 1886.
[468] Le Correspondant du 10 septembre 1888.
[469] Derniers Samedis, t. III, p. 55.
[470] Le numéro mille des Samedis de la Gazette de France, qui eux-mêmes faisaient suite aux Semaines littéraires de l’Assemblée nationale, du Spectateur et de l’Union.
[471] Il avait pour sujet la publication de Mme Charles Lenormant: Le temps passé. Mélanges de Critique littéraire et de Morale par M. et Mme Guizot. Pontmartin ne l’a pas recueilli dans ses volumes de Causeries.
[472] Joseph Roumanille (1818-1891), né à Saint-Rémy de Provence d’une famille de jardiniers, mort libraire à Avignon. Catholique et royaliste, il a publié, sous la seconde République, en langue provençale, de merveilleux dialogues en prose pour la défense religieuse et sociale, le Choléra, les Clubs, un Rouge et un Blanc, les Partageux, la Férigoulo (c’est-à-dire le thym, emblème du parti rouge), les Prêtres, etc. Plus tard, sous la troisième République, il a fait, dans le même genre, les Enterre-Chiens; l’apostolat est resté identique; mais la verve a baissé. A la même époque que les premiers dialogues appartiennent les poésies, les Marguerites, les Songeuses, la Part du bon Dieu, les Fleurs de songe, et aussi un recueil de Noëls, œuvres exquises de sentiment, simples de forme, et qui conservent absolument la note populaire, quoique l’auteur soit un vrai lettré et même un humaniste.
[473] Augustin Canron (1829-1888), né et mort à Avignon, n’a guère vécu ailleurs et se serait senti dépaysé partout, sauf dans les deux Romes, celle du Rhône et celle du Tibre. Il était le principal rédacteur de l’Union de Vaucluse. Son instruction était grande en toutes choses, mais, en histoire locale, elle était prodigieuse. Il avait déchiffré et classé tous les manuscrits de la région. Sa verve était à la hauteur de sa science, et quelquefois même elle lui nuisait: on l’accusait, à l’occasion, d’avoir inventé ce qu’il avait véritablement découvert. Catholique ardent, liturgiste consommé, sa piété très italienne n’excluait pas une grande liberté de langage quand il s’agissait de juger les évêques et les curés dans leurs rapports avec le pouvoir civil. En somme, personnage très intéressant, et peut-être encore plus amusant. Il avait le mérite de conserver une inaltérable gaieté au milieu d’une existence qui n’était qu’une lutte contre la pauvreté. Peu d’hommes ont plus honoré que lui, par son talent, son désintéressement et sa fidélité, la presse monarchique de province.
[474] Voir l’Appendice, à la fin du volume.
[475] Le P. Victor Delaporte, né le 6 novembre 1846 à Saint-Vandrille (Orne). Ses deux volumes de Récits et légendes ont eu onze éditions. Une troisième série, A travers les âges, a obtenu un égal succès. On lui doit aussi des drames en vers, Loc’h Maria, Saint Louis, Tolbiac, Pour l’Honneur, Patria, etc., ainsi que plusieurs volumes de critique littéraire: Du Merveilleux dans la littérature française sous le règne de Louis XIV; L’Art poétique de Boileau, commenté par Boileau et ses contemporains; les Études et Causeries littéraires, etc.
[476] Causeries littéraires, 3 volumes; Causeries du Samedi, 3 vol.; Semaines littéraires, 3 vol.; Nouveaux Samedis, 20 vol.; Souvenirs d’un vieux critique, 8 volumes.
[477] Souvenirs d’un vieux critique, tomes IX et X; Derniers Samedis, 3 volumes.
[478] Notice sur Armand de Pontmartin, en tête des Épisodes littéraires.
[479] Nouveaux Samedis, t. IX, p. 317.
[480] Souvenirs d’un vieux critique, t. V, p. 178.
[481] Souvenirs d’un vieux critique, t. X, p. 197.
[482] La comtesse Diane de Beausacq.
[483] Souvenirs d’un vieux critique, t. V, p. 132.
[484] Nouveaux Samedis, t. IV, p. 211.
[485] Souvenirs d’un vieux critique, t. II, p. 296.
[486] Semaines littéraires, t. II, p. 333.
[487] Nouveaux Samedis, t. VIII, p. 330.
[488] Nouveaux Samedis, t. XVII, p. 155.
[489] Nouveaux Samedis, t. XIX, p. 362.
[490] Nouveaux Samedis, t. XX, p. 1.
[491] Nouveaux Samedis, t. XIX. p. 227.
[492] Nouveaux Samedis, t. XII, p. 1.
[493] Nouveaux Samedis, t. XVII, p. 279.
[494] Souvenirs d’un vieux critique, t. VIII, p. 1.
[495] Nouveaux Samedis, t. III, p. 267.
[496] Causeries littéraires.—Semaines littéraires.—Nouveaux Samedis.
[497] Voir ci-dessus, page 369.
[498] Géorgiques, livre IV.
[499] Le livre fut saisi, et, pour arrêter les poursuites, il ne fallut rien moins que l’intervention de Gambetta. Je lis, à ce sujet, dans une lettre de Pontmartin à M. Jules Claretie, du 3 janvier 1875: «Que dites-vous de l’ami Barbey? Cette fois, c’est trop fort. Quand je conseillais la tolérance à ce fougueux absolutiste, je ne m’attendais pas à le voir conduire Joseph de Maistre dans une de ces maisons qui empruntent leur sous-titre à la plus belle des vertus chrétiennes. C’est dommage, car à ne juger son livre qu’en artiste, avec le dilettantisme impassible qu’on apporterait, par exemple, au musée secret de Naples, ce diable d’homme—66 ans—n’avait jamais rien fait de si fort. Le Rideau cramoisi, Une Vengeance de femme, et surtout Un Dîner d’Athées, sont trois magnifiques cantharides. Figurez-vous qu’au moment où j’ai appris la saisie, j’allais en parler, et je comptais plaider la Possession, comme on l’entendait au Moyen Age.»
[500] Pontmartin m’écrivait, des Angles, le 4 décembre 1879: «A peine avais-je fait partir ma dernière lettre, que je me suis reproché de vous avoir parlé de M. Barbey d’Aurevilly avec cette amertume et de ce ton tranchant qui me va si mal. Royalistes et catholiques, la charité chrétienne est pour nous, en pareil cas, non seulement une vertu, mais une habileté, en face de tant d’ennemis acharnés contre nos croyances. Mes bonnes résolutions ont persisté... 24 heures. Un de mes amis avignonnais, vieux, spirituel et lettré, est venu me voir, levant les yeux au ciel, agitant un journal au-dessus de sa tête, se livrant à une pantomime qui traduisait le: «Où allons-nous?» de J. Prudhomme. C’était un no de Paris-Journal (21 novembre), renfermant un feuilleton de B. d’Aur... sur le Mariage de Figaro. Mon ami, après m’avoir demandé une tasse de tilleul pour calmer ses nerfs, m’a lu le passage suivant: «En regardant Mlle Reichenberg, en voyant, à genoux, aux pieds de la comtesse, ces jambes de femme qui ont leur sexe, je pensais aux jambes sans sexe qu’il faudrait (je ne note que des indigences) à cette charmante et incertaine créature d’entre les deux sexes, qui s’appelle Chérubin; je songeais à ces jambes si voluptueusement hermaphrodites(!!) que Raphaël donne à ses archanges, et que montre en ce moment à tout Paris cette merveille d’Emma Juteau, l’acrobate du Cirque.» Pas de commentaires, cher ami; mais encore un remerciement et une cordialissime poignée de main.»—Ce jour-là, on le pense bien, je n’essayai même pas de plaider les circonstances atténuantes en faveur de Barbey d’Aurevilly.
[501] Lettre du 24 octobre 1879.
[502] François-Victor Fournel (1829-1894), érudit, critique et romancier; ses principaux ouvrages sont: les Contemporains de Molière, la Littérature indépendante, les Rues du vieux Paris, l’Ancêtre, le Roman d’un père, Esquisses et croquis parisiens.
[503] Lettre du 1er novembre 1865.
[504] Cuvillier-Fleury demeurait à Passy, avenue Raphaël, 4.
[505] Journal des Débats du 28 novembre 1897.
[506] Parce qu’il était Nimois et aussi parce qu’il a beaucoup de talent et qu’il est un parfait galant homme, M. Gaston Boissier est un des écrivains dont Pontmartin a toujours parlé avec le plus de sympathie. Voy. Nouveaux Samedis, t. III.
[507] Voici les titres des sept nouvelles qui composent ce volume: les Feux de paille; le Point d’orgue tragique; l’Impasse; English Spoken; la Veillée; la Véritable auberge des Adrets; Rachel à trois époques.
[508] Lettre du 11 novembre 1886.
[509] Les Épisodes littéraires ont paru dans le Correspondant des 25 octobre, 10 et 25 novembre, 10 et 25 décembre 1889, 10 janvier et 10 mai 1890.
[510] Ci-dessus chapitre VII, p. 130.
[511] Il fut publié dans la Gazette de France du 23 mars.—Au moment de sa mort (29 mars), Pontmartin avait dix-huit articles d’avance aux bureaux de la Gazette. Ils parurent sans interruption pendant quatre mois. Le dernier, publié le 2 août 1890, est consacré au volume de M. Henry Houssaye sur Aspasie, Cléopâtre, Théodora. On le trouvera au tome I des Derniers Samedis; il est daté du 8 mars 1890.]
[512] Derniers Samedis, t. II, p. 372.
[513] Nouveaux Samedis, t. I, p. 114.
[514] Notice sur Armand de Pontmartin.
[515] Le R. P. Elie Bonnet, de la Compagnie de Jésus. Il avait été aumônier militaire en Algérie, puis à Avignon pendant les cinq ou six ans où nos garnisons eurent des aumôniers. Il est mort au collège de Mongré (Rhône) en mars 1895.
[516] Le 19 mars.—Joseph était l’un de ses prénoms, et aussi celui de l’oncle qui l’avait tant aimé.
[517] Bulletin de l’Association amicale des anciens élèves de l’École libre de Saint-Joseph d’Avignon. Juin 1890.
[518] 28 mars.
[519] Lettre du 2 avril 1890.
[520] Ci-dessus, page 458.