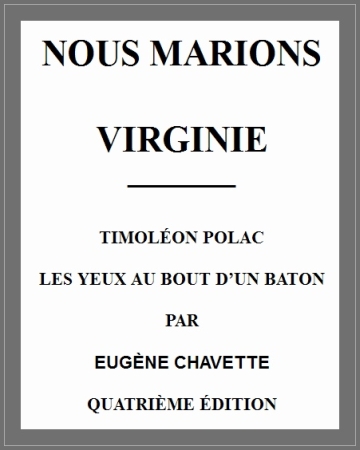
The Project Gutenberg EBook of Nous marions Virginie, by Eugène Chavette This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org/license Title: Nous marions Virginie Author: Eugène Chavette Release Date: November 6, 2012 [EBook #41307] Language: French Character set encoding: UTF-8 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK NOUS MARIONS VIRGINIE *** Produced by Laurent Vogel, Chuck Greif and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net
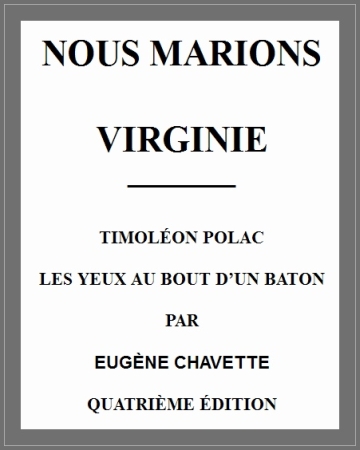
NOUS MARIONS
VIRGINIE
| EN VENTE A LA LIBRAIRIE DENTU | |
| ———— | |
| OUVRAGES D’EUGÈNE CHAVETTE | |
|---|---|
| Défunt Brichet, 2 vol. in-18 Jésus | 6 fr. |
| Le Remouleur, 2 vol. in-18 Jésus | 6 fr. |
| L’héritage d’un Pique-Assiette, 3 vol. in-18 Jésus | 9 fr. |
| La Chiffarde, 2 vol. in-18 Jésus | 6 fr. |
| La Chasse à l’Oncle, 2 vol. in-18 jésus | 6 fr. |
| La chambre du Crime, 1 vol. in-18 Jésus | 3 fr. |
| Aimé de son concierge, 1 vol. in-18 jésus | 3 fr. |
| La recherche d’un pourquoi, 1 vol. in-18 Jésus | 3 fr. |
| Nous marions Virginie, 1 vol. in-18 jésus | 3 fr. |
| SOUS PRESSE: | |
| Le roi des Limiers, 2 vol. in-18 jésus | 6 fr. |
| Le comte Omnibus, 3 vol. in-18 jésus | 9 fr. |
| L’Oreille du Cocher, 1 vol. in-18 jésus | 3 fr. |
| F. AUREAU.—IMPRIMERIE DE LAGNY. | |
TIMOLÉON POLAC
LES YEUX AU BOUT D’UN BATON
PAR
EUGÈNE CHAVETTE
QUATRIÈME ÉDITION

PARIS
E. DENTU, ÉDITEUR
LIBRAIRIE DE LA SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES
PALAIS-ROYAL, 15-17-19, GALERIE D’ORLÉANS
—
1882
Tous droits réservés
| TABLE |
Par une matinée de l’hiver dernier, un homme se tenait debout et immobile, au beau milieu de la place de l’Odéon. A terre, devant lui, il avait posé son chapeau à plat sur les bords.
Et il semblait attendre.
Profitons de son immobilité pour exquisser le portrait de cet individu, âgé d’une cinquantaine d’années. Ses cheveux gris se dressaient en un énorme toupet au-dessus d’une longue face jaune, ravagée par la misère et les privations. Cette tête aurait appelé aussitôt la pitié sans son petit œil vif, joyeux et dénotant cette philosophie qui fait gaiement supporter le malheur.
Il était complétement vêtu de noir, mais, hélas! quel noir! Le temps et l’usage avaient rendu à peu près gris le vieil habit taillé à la mode de 1840, qu’il portait soigneusement boutonné, sans doute pour dissimuler l’absence de linge.
En le voyant grave et raide sous ses haillons noirs, avec un mouchoir qui avait la prétention de jouer, autour de son cou, le rôle d’une cravate blanche, on aurait pu se croire en présence d’un notaire qui a eu des malheurs.
Donc un curieux s’arrêta; à côté de lui en vint un deuxième, puis un troisième et, en dix minutes, le chapeau et son maître furent entourés d’un cercle de commères, de badauds, de soldats qui tous, l’œil sur le couvre-chef leur montrant son dessus pelé, se disaient, fort intrigués:
—Que cache-t-il sous son chapeau?
Deux jeunes gens, l’un brun, l’autre blond, tous deux jolis garçons, s’étaient glissés au premier rang des curieux.
Le chapeau produisit aussitôt son effet sur le spectateur brun.
—Pourquoi met-il son castor sur le pavé? demanda-t-il à son ami.
—C’est peut-être pour s’asseoir quand il est fatigué? Car tu dois remarquer qu’on a oublié de meubler la place de l’Odéon, repartit l’autre.
Satisfait sans doute du nombre d’auditeurs, l’homme se moucha, releva ses manchettes, puis il salua à la ronde en commençant ainsi:
«—Jeunes beautés, laborieux citadins, intrépides guerriers.—Curieux dès l’enfance, j’ai beaucoup voyagé. Un soir, dans l’Inde, que je me promenais sur les bords du Gange, je vis venir à moi, sans autre vêtement qu’un tambourin, à cause de la chaleur torride, une belle et jeune femme qui essayait un pas de valse. Soudain, le pied lui glisse et elle disparaît dans l’humide empire...»
A ces mots de l’homme au chapeau, un frisson de terreur courut dans le groupe qui l’écoutait.
Insensible à ce succès oratoire, celui qui avait beaucoup voyagé continua:
—En la voyant rouler dans les flots, je n’écoutai que mon courage et, sans même quitter une livre de sucre que je venais d’acheter, je plonge dans le perfide élément et j’ai le bonheur de la ramener sur le gazon... moins frais que ses jeunes appas. Je cherchais ma pipe pour la lui faire respirer, quand soudain quatre cavaliers... et des plus beaux!... à la poitrine chargée de diamants, accourent sur moi à fond de train.—O toi! s’écrie celui qui en était le plus chargé, ô toi qui as sauvé ma fille! bel étranger, que veux-tu? Je suis le roi. Parle; la moitié de mon royaume est à toi... sans compter ma fille.—Non, Sire, dis-je à cet Hindoustan, un Français ne se met à l’eau que par propreté ou par désintéressement.—Quoi! tu ne veux rien? s’écria-t-il en s’arrachant les cheveux avec désespoir, laisse-moi au moins te rembourser ton sucre qui a fondu?—Non, Sire, je ne veux rien, je n’ai besoin de rien.—Ah! ces Français sont tous les mêmes!!! bégaya-t-il avec admiration...»
—Dis donc, Paul, il aurait dû demander un habit neuf? souffla le jeune homme blond de l’auditoire à son ami.
—Je voudrais pourtant bien savoir ce qu’il, y a sous ce chapeau, Ernest; j’ai une idée que c’est un lapin, répondit celui qu’on appelait Paul.
—Un lapin? oui, c’est possible... alors un lapin tout cuit, et il a mis son chapeau dessus pour le tenir au chaud.
Cependant, le propriétaire de ladite coiffure poursuivait le récit de son aventure.
«—Le roi se roulait à mes pieds en criant: de grâce! noble Français, demande-moi quelque chose... un souvenir, une babiole... accepte seulement dix millions.—Sire, un mot de plus à propos d’argent, et je m’éloigne, dis-je avec un accent indigné.—Ah! j’en mourrai! soupira le roi plein de respect pour ma belle âme...»
Après un instant d’hésitation, l’homme au chapeau baissa le ton et continua, comme s’il faisait une confidence à son auditoire:
«—Je vous l’avouerai, messieurs les militaires, je fus vaincu dans cette lutte de générosité, car je me laissai attendrir, et je pris le monarque en pitié.—Eh bien! Sire, lui dis-je, puisque vous l’exigez, je vous demanderai une chose.—Laquelle? beugla-t-il en se relevant d’un bond joyeux qui le remit achevai; laquelle?—SIRE, C’EST LA RECETTE DE LA POUDRE AVEC LAQUELLE VOUS NETTOYEZ VOS CHANDELIERS!!!»
En même temps qu’il disait ces mots sans rire, le conteur s’inclina vers le chapeau qui intriguait tant l’assistance, le souleva et découvrit un chandelier dont la partie supérieure resplendissait d’éclat, tandis que le bas en était noir de malpropreté. Il remit le chapeau sur sa tête, et plongeant la main dans la poche de son habit, il en tira une poignée de petites boîtes et reprit:
—Cette poudre, la voici. Combien vaut ce secret d’un roi? me demanderez-vous. En Allemagne et à Madagascar, j’ai refusé mille francs de mes boîtes; mais à des compatriotes, je ne demande que cinq sous. Achetez, achetez, c’est un conseil de père que je vous donne, car vous ne trouverez cette poudre que chez moi, Nicolas Borax, seul propriétaire du secret, ainsi que l’atteste le parchemin du roi indien, que j’ai déposé à la Banque. Avec cette poudre, on nettoie indifféremment les chandeliers, l’argenterie et les dents. Cinq sous! cinq sous! ne vous étouffez pas! chacun aura son tour.
Mais la recommandation de ne pas s’étouffer était complétement inutile, car la foule, aussitôt le mystère du chapeau connu, s’était éclipsée en riant.
—Saperlotte! murmura Borax en voyant s’éloigner le public, voilà mon déjeuner qui s’envole! Justement ce matin, j’ai une faim... quelle faim!...
Parmi les rares fidèles restés sur la place se trouvaient les deux jeunes gens qui s’étaient donné les noms d’Ernest et Paul. En répétant: «Cinq sous, cinq sous», Nicolas Borax était arrivé devant eux.
—Ah! fit Paul, cinq sous la boîte... et quand on en prend deux?
—C’est huit sous.
—Et quand on n’en prend pas du tout? demanda Ernest, le beau blond.
—Alors, c’est deux francs, repartit Borax, se redressant à cette plaisanterie.
—Bien. Je n’en prends pas du tout; enveloppez-le moi dans un papier, voici mes deux francs, dit tranquillement le jeune homme.
Et il mit quarante sous dans la main du bonhomme, qui, dans sa joie étonnée, balbutia:
—Conservez-moi votre pratique.
—De plus, continua le blond, si une jolie pièce de cent sous peut vous être agréable, je vous offre une occasion de la gagner en me suivant à mon atelier, avec votre Chandelier et votre chapeau. A cinq francs la séance, vous poserez pour un tableau dont vous venez de me donner l’idée.
Borax bondit de satisfaction en s’écriant:
—Accepté! Aussitôt que j’aurai fait déjeuner Bourreau, je vous rejoins.
A ce nom de Bourreau, le jeune homme chercha des yeux, en croyant que, le marchand de poudre avait un chien.
—Qui donc appelez-vous Bourreau? demanda-t-il en ne voyant aucun animal.
—Bourreau, c’est mon estomac... Ah,! monsieur, il me tourmente bien!
—Alors, avec les cinq francs, j’offre une côtelette aux cornichons... Aimez-vous les cornichons? monsieur Borax.
—Si j’ai jamais désiré un trône, c’est pour manger des cornichons sans compter, affirma le saltimbanque avec un enthousiasme sincère. Ah! jeune homme, demandez-moi tout! mes services! mon bras! ma poudre!... non, pas ma poudre... entre nous, elle ne vaut rien... Mais tout le reste est à votre disposition, homme et chandelier; disposez-en.
—Allons! en route! conseilla Ernest en se dirigeant vers la rue de Vaugirard.
Au bout de cent pas, Borax qui, son chandelier à la main, marchait à côté des jeunes gens, parut tout à coup faiblir.
—Qu’avez-vous donc, Borax? demanda Paul.
—Oh! fit-il, moi, je n’ai rien. C’est mon animal de Bourreau qui fait le diable sous le futile prétexte qu’il n’a pas vu un morceau de pain depuis quarante-huit heures.
—Comment, vous n’avez pas mangé depuis deux jours! s’écrièrent les jeunes gens douloureusement surpris.
—Que voulez-vous? La poudre à chandelier n’a pas marché ferme cette semaine. J’ai eu beau dire qu’elle nettoyait aussi les dents, je n’en ai pas vendu une boîte de plus...
On était arrivé à la porte d’un petit restaurant dans lequel les jeunes gens firent entrer l’affamé.
On alla bien vite au plus pressé, en installant aussitôt le malheureux devant une copieuse soupe aux choux.
A chaque cuillerée qu’il avalait, le saltimbanque répétait:
—Hein! Bourreau, es-tu content? te voici à la fête, mon gaillard! j’espère que tu vas me laisser un instant tranquille?
—Là! fit le peintre Ernest, maintenant que Bourreau peut patienter jusqu’à l’arrivée des côtelettes, causons un peu, ami Borax.
—Bien volontiers.
—Alors, expliquez-nous comment il se fait que vous soyez arrivé à ce point de...
—A ce point de mourir de faim. Oh! ne craignez pas de finir, mon cher protecteur, dit le bonhomme en voyant l’artiste hésiter. Ma réponse est bien simple. Je suis de ceux qui n’ont pas de veine, de ceux qui, le jour où il ramassent dix sous à terre, tombent sur une pièce fausse. Rien ne leur réussit, quoi! ils trouvent moyen de se casser une dent en mangeant du fromage à la crème.
—Et vous n’avez pas cherché à combattre?
—J’ai usé de tout, tâté de tout, j’ai fait vingt métiers. Tenez, avant ma poudre, j’étais loueur de sangsues.
—Bah! expliquez-moi, donc ce métier.
—Dame! les médecins vous arrivent chez les pauvres malades où, bien souvent, on n’a même pas une chaise à leur offrir, et il disent tranquillement: «Ça ne sera rien, mettez-vous seulement quatre-vingts sangsues au séant et après-demain vous pourrez aller vous promener... pas à cheval, par exemple!» Or, les sangsues ne sont pas comme des coups de bâton qu’on n’a qu’à demander au premier veux. Les pharmaciens ont la manie de vous réclamer sept ou huit sous pour une petite bête qu’on n’a même pas la ressource... après... de manger en se figurant que c’est un salsifis. Donc, quatre-vingts sangsues représentent une grosse somme sur laquelle on n’a pas toujours le moyen de... s’asseoir.
—Bien raisonné, approuva Paul.
—J’avais trouvé un riche capitaliste auquel j’inspirais de la confiance et qui, sans me demander les trois signatures pour négocier mon papier à la Banque, avait bien voulu m’avancer neuf francs. A ce moment, la sangsue était en baisse. Avec mes capitaux, j’en ai acheté soixante... dont vingt-deux polonaises, car je m’étais dit que si les sangsues de ce pays-là étaient comme les hommes leurs compatriotes, elles devaient aimer à pomper. Alors je me suis mis à courir la clientèle et je louais à bas prix ce qu’on aurait été obligé d’acheter si cher. Après la séance... séant, séance, c’est bien le mot... donc, après la séance, je reprenais mes pensionnaires, puis je les faisais dégorger et je criais: A qui le tour?
—Le commerce n’a donc pas marché?
—Si, dans le commencement, j’ai gagné un peu d’argent avec lequel j’ai augmenté mon pensionnat jusqu’à cinq cents élèves... toutes françaises! car j’étais revenu de mes illusions sur les polonaises.
—Bah! des paresseuses peut-être!
—Non; mais je ne sais si c’est par haine nationale, les sangsues polonaises ne veulent mordre que des séants russes... Oh! alors, il faut le dire, elles y vont d’un si grand cœur qu’elles en éclatent comme des pétards.
—Et combien preniez-vous à vos clients?
—Un sou par tête. Je les passais à quatre centimes quand on en consommait trois cents à la fois. Seulement, tant par tête, cela m’occasionnait des contestations avec le client qui me disait: «Mais, toutes n’ont pas mordu!»
—L’observation était juste.
—Oui, mais je ne pouvais pourtant pas me faire payer à la piqûre et dire à une dame: «Retournez-vous que je compte les piqûres,» et ajouter: «Vous me devez tant.»
—Et pourquoi avez-vous changé les sangsues pour la poudre à chandelier?
—Ah! voilà: la sangsue est très-impressionnable. Le vent, l’orage, la neige, tout lui dérange la santé. On la voit tout à coup monter à la surface de l’eau du bocal. On la croit rêveuse... pas du tout, elle est morte. En une semaine, une épidémie m’a enlevé les trois quarts de mon pensionnat. Alors, découragé, j’ai voulu me débarrasser du reste.
—Et vous avez cédé votre fonds?
—Non, à revendre de cette manière, on perd trop. Comme c’était le moment du jour de l’an, j’ai fait passer dans ma clientèle le prospectus suivant:
«A tous les êtres qui nous sont chers, quel plus précieux cadeau d’étrennes peut-on offrir que la santé? Comment offre-t-on la santé? Par l’application de sangsues.—Adressez-vous donc à Nicolas Borax, qui tient à la disposition du public un assortiment complet de sangsues pour étrennes.»
—Et vous les avez vendues?
—Malheureusement, non. Elles m’adoraient, ces pauvres bêtes. Quand elles ont su qu’elles allaient changer de maître, elles ont préféré se laisser mourir. Alors, j’ai pulvérisé mes bocaux et j’en ai fait ma poudre à chandelier... qui ne nourrit pas Bourreau.
—La déveine ne peut continuer quand on possède votre hardiesse industrieuse.
—Ah! fit Borax en secouant la tête, la hardiesse ne suffit pas, il faut aussi un habit. Que de gens n’auraient aucune valeur sans leur habit. Tenez, moi, je vendrais demain ma poudre cent francs la boîte si j’avais un elbeuf sur le dos... Un habit propre, bien entendu, car en voilà un sur mes épaules avec lequel il me serait bien difficile de me faire passer, même à un aveugle, pour un brillant vicomte qui revient du Bois. Ah! si j’avais un habit, j’arriverais à tout.
—Vous épouseriez peut-être une princesse?
—Non, attendu que le mariage, c’est comme les chevaux de bois, il faut vraiment aimer ça pour s’y amuser.
—Ah! vous reculez pour la princesse, ricana Paul, qui, par une raison que nous allons dire, s’était peu mêlé à l’entretien.
Le bonhomme parut se froisser de ce ton moqueur du jeune homme et repartit aussitôt:
—Si j’avais un habit, je n’épouserais pas une princesse... parce que ça se rentre, pas dans mes objets de consommation... mais je parie que je vous la ferais épouser.
A ces mots, le peintre se mit à rire en s’écriant:
—Ah! Paul n’est pas ambitieux. Au lieu d’une princesse, il se contenterait seulement d’épouser l’ange de ses rêves... n’est-ce pas?
Pour toute réponse, Paul poussa un soupir qui fit envoler les radis de la table.
—Oh! oh! fit Borax, il paraît, jeune homme, que Cupidon vous a quelque peu égratigné de sa flèche.
—Égratigné? dites donc qu’il l’a embroché... et avec une flèche grosse, comme l’obélisque! appuya l’artiste.
—Oui, dit le charlatan, je connais ces amours-là. On reste en contemplation devant ange pendant des heures, faisant des yeux sur le plat, la main en pigeon vole, et la bouche tellement ouverte que ça donne aux hirondelles l’idée d’y venir faire leur nid. On a l’air d’un homme qui va éternuer.
Paul poussa un second soupir.
—Alors, continua Borax, pourquoi n’épousez-vous pas la demoiselle?
—Pour la simple raison qu’elle est fort riche et que, de mon côté, si je mettais toute ma fortune dans mes deux mains, cela ne m’empêcherait pas de jouer du piano.
Le bonhomme prit un air sérieux.
—Voyons, voyons, dit-il, on pourrait peut-être arranger cela. Précisons d’abord la situation. La jeune personne vous aime-t-elle?
—Comment puis-je le savoir?
—Quand elle vous voit, fait-elle un petit soubresaut comme si on la pinçait dans le dos?
—Allons, Paul, fais des révélations à ton juge. A-t-on l’air de la pincer dans le dos? demanda le peintre, qui se tordait de rire.
—Il y a un peu de cela, avoua l’interrogé.
—Bon! fit Borax, l’enfant vous aime. Quant à vous, du moment que vous faites envoler des radis en soupirant le suis renseigné. Seulement, il faut maîtriser votre vent pour le quart d’heure, car je ne vois plus sur la table que du sel et du poivre à faire envoler... et ça gêne quand on les reçoit dans les yeux.
—Tiens! c’est vrai! sel et poivre ne nous suffisent pas et les côtelettes se font bien attendre, s’écria Ernest, qui comprit cet appel de leur convive.
—Oh! si je vous dis cela, c’est parce qu’il s’agit de marier votre ami, et que les côtelettes aux cornichons me donnent généralement des idées.
—Alors, voici les idées aux cornichons qui arrivent, ajouta l’artiste en désignant un garçon qui s’avançait avec un énorme plat qu’il posa sur la table.
—Attention! Bourreau! commanda Borax tout joyeux et ouvrant les narines.
Il paraît que Bourreau ne se contentait pas de peu, car en un clin d’œil, son maître lui expédia cinq côtelettes, qui disparurent par bouchées colossales. Un soupirail de cave dans lequel on enfile d’énormes bûches de Noël représenterait assez la bouche du pauvre hère pendant cet exercice.
—Diable! on voit que vous aimez les côtelettes! s’écria le peintre.
Borax fit une petite moue dédaigneuse.
—Non c’est ce qui vous trompe, pas beaucoup. Je mange des côtelettes un peu pour dire que j’en mange, mais surtout parce qu’elles font digérer le cornichon qui est trop froid pour Bourreau. La côtelette de porc me remplace le verre de Chartreuse qui précipite la digestion.
Après avoir ainsi expliqué sa façon d’employer la côtelette le bonhomme s’accouda sur la table en disant:
—Maintenant, revenons à notre mariage.
—Ah çà! vous êtes donc bien certain de me marier? s’écria Paul étonné.
—Pourquoi pas? mon jeune ami. Vous avez le grand tort de vous faire un monstre de ce qui n’est que de la bien petite bière. Que demandons-nous pour arriver à ce mariage? Qu’on nous aime. Or, on nous aime, puisque la jeune fille, en nous voyant, fait un petit saut de cabri. Donc, le reste n’est qu’un détail, un très-simple détail, dont il ne faut pas se préoccuper.
—Un détail? Vous regardez comme un simple détail le père et la mère qui se réveillent la nuit pour penser à un gendre qui soit riche!
—Ah! oui, à propos, parlons un peu du père de notre ange. Quel homme est-ce donc, ce cher papa Ange?
—Un ancien vermicellier, qui s’est retiré du commerce avec deux millions et un rhume de cerveau perpétuel.
—Bravo! passons à la mère Ange.
—Une brave femme, nulle comme un lorgnon sans verre et superstitieuse au point de prendre médecine quand on a renversé le sel sur la table.
—Bravissimo!
—Ajoutez à cela une institutrice, vieille et hargneuse, qui me déteste parce que, sans intention, j’ai coupé queue de son chien en refermant la porte cochère.
—Quelle heureuse chance! Tout est pour nous! Quant à vous, je crois inutile devons demander si vous avez une caisse.
Ce mot de caisse fit se tordre joyeusement le peintre qui s’écria:
—Mais si, demandez-le, car Paul a une énorme caisse... seulement, elle est vide... C’est même là son vrai mérite. Mon ami est grosse caisse à l’orchestre de l’Ambigu... soixante-dix francs par mois, sans compter un élève en ville qui, par ordonnance de médecin, prend des leçons de grosse caisse pour se guérir d’une surdité.
—Une grosse caisse! instrument délicieux, le soir, dans les grands bois, quand tout se tait aux champs; cela vaut mieux que le son des cloches pour faire rêver une jeune fille... tout est pour nous.
Et, comptant sur ses doigts, le saltimbanque continua imperturbable:
—Rhume de cerveau, superstition, queue de chien coupée et grosse caisse, voilà de bien jolis atouts dans notre jeu. Je vous regarde comme déjà marié, jeune homme. Vous êtes un vrai veinard! Oui, en sachant utiliser toutes vos chances, vous deviendrez l’époux de votre... Ah! à propos, comment s’appelle votre ange?
—Virginie.
—Nom suave! si j’ai jamais désiré un trône, c’est pour aimer une femme du nom de Virginie.
—Et quand me mariez-vous? demanda Paul qui n’avait pas pris au sérieux un seul mot du bonhomme.
—Mais, comme le plus tôt possible sera le meilleur, nous ferions bien d’aller tout de suite étudier le terrain, répliqua le bateleur avec aplomb.
—Alors, en route! firent les jeunes gens désireux de poursuivre la plaisanterie.
Borax suivit les deux amis, qui, cent pas plus loin, s’arrêtèrent devant une porte de la rue de Vaugirard.
—Voilà notre demeure, Virginie est la fille du propriétaire, annonça Paul.
—Tiens! dit le maître de Bourreau, vous habitez-là? Alors nous sommes porte à porte, car, moi, je perche dans une mansarde de la maison voisine.
Comme les deux artistes l’avaient dit au charlatan, la maison qu’ils habitaient appartenait au père de Virginie, M. Thomas Ribolard, ancien fabricant de vermicelle, macaroni et autres pâtes alimentaires.
Ribolard était bête comme un pot, et il avait deux millions.
Bien souvent on rencontre des individus dont on se dit: «Comment cet imbécile a-t-il pu faire fortune?» La réponse est bien simple. Par cela même qu’il est un crétin, il a inventé une grosse ineptie qu’il a lancée sérieusement. Et comme, si stupide que soit un homme, il existe toujours des gens dix fois plus buses que lui, ils font aussitôt un succès à l’absurdité lancée par cet idiot.
Donc Thomas, au lieu de fabriquer ses vermicelles arrondis en boucles de cheveux, les avait offerts carrés. Premier succès!
Pour les potages, il avait inventé les pâtes guerrières, c’est-à-dire qu’en place des produits carrés, étoiles ou losangés, il avait fait découper à l’emporte-pièce sa pâte en petits sapeurs, canonniers, généraux de brigade, etc., etc., et comme le public n’avait pu résister au plaisir de manger des généraux de brigade dans son bouillon, l’inventeur Thomas avait récolté de l’or.
Mais le grand triomphe de Ribolard avait été obtenu par son macaroni! Au lieu de le faire à un trou, il l’avait confectionné à deux trous et l’avait lancé sous le nom de macaroni hygiénique à double courant d’air.
Voilà comment les deux millions étaient arrivés à Ribolard, que sa femme regardait comme un dieu.
Joignez à cela un rhume de cerveau qui ne l’avait pas quitté depuis l’âge de douze ans, une petite taille, une tête aussi chevelue qu’une pomme de rampe d’escalier, des yeux en boules de loto, et vous aurez le portrait de l’ancien vermicellier.
Madame Ribolard,—de son petit nom Cunégonde,—était bien la meilleure preuve qu’un imbécile trouve toujours plus crétin que lui, car elle était d’une bêtise à couper à la hache. On lui avait dernièrement escroqué dix francs pour une quête, en lui faisant croire que les ouvriers qui travaillaient aux mines de gruyère, sous Montmartre, s’étaient mis en grève contre les entrepreneurs avides qui voulaient leur décompter les trous du fromage.
Et pourtant de ces deux abrutis était née Virginie, charmante blonde de dix-huit ans, gracieuse et spirituelle jeune fille.
—Nous avons dépensé les yeux de la tête pour lui donner tous les arts d’agrément, répétaient à tout le monde les Ribolard en se rappelant les douze francs par mois qu’on leur avait demandés pour apprendre à Virginie à faire du bruit sur un piano en poussant des miaulements plaintifs. Car, il faut tout dire, si charmante qu’elle fût, l’aimable Virginie n’était pas taillée pour le chant. Elle vous avait une petite voix si aiguë que les globes de pendule se fêlaient quand elle chantait.
A sa sortie du pensionnat, les Ribolard avaient remué ciel et terre pour trouver à leur fille une institutrice qui lui donnât les belles manières du grand monde, et, sur les renseignements de leur charbonnier, ils avaient enfin trouvé mademoiselle de Veausalé.
Paméla de Veausalé prétendait avoir été élevée à la cour de Monaco. Aussi ses nobles et fières allures effarouchaient les Ribolard, qui s’extasiaient surtout au sujet de son altière vertu.
Car, à table, la pudibonde Paméla devenait rouge comme un radis et se cachait la figure sous sa serviette quand, par hasard, un domestique avait posé devant elle une volaille du côté du croupion.
Elle était si grande, si sèche et si maigre, qu’on aurait pu s’en servir pour déboucher un plomb ou nettoyer des verres de lampe. A l’entendre, vingt-deux hommes, dont trois nègres, s’étaient tués par désespoir de n’avoir pu attendrir son cœur.
Elle passait le temps à tricoter des paletots et des jambières pour son chien Raoul, un affreux roquet oubliant la propreté avec un cynisme qui étonnait les Ribolard.
—C’est bien drôle, se disaient-ils, mademoiselle de Veausalé nous affirme pourtant que Raoul était reçu dans les salons du prince de Monaco.
Un épouvantable malheur était venu frapper cet objet de l’unique affection de Paméla, car l’infortuné Raoul avait eu la queue coupée dans la porte cochère, qu’on avait refermée à son passage. Aussi, la hargneuse fille avait-elle voué une haine bleue au meurtrier de la queue de son chien.
Quand, escortant son élève, elle rencontrait le musicien Paul dans l’escalier, elle lui faisait des yeux qui auraient effrayé le joueur de grosse caisse si, pour calmer sa peur, il n’avait vu en même temps les regards, beaucoup plus doux, que la gentille Virginie abaissait sur lui.
Paméla inspirait donc aux époux Ribolard un saint respect, mêlé d’espoir, qui leur faisait dire, en songeant à l’avenir:
—Quand Virginie sera en âge d’être mariée, mademoiselle de Veausalé, parmi toutes ses belles connaissances de la cour de Monaco, saura nous trouver quelque duc ou prince.
Tous les domestiques de la maison avaient reçu l’ordre d’obéir aux moindres caprices de l’altière Paméla, qui en abusait.
Cocher, soubrette, valet de chambre, groom, concierge, cuisinière exécraient la veille fille. N’osant l’affronter en face, ils lui faisaient une guerre sourde. Ils se vengeaient surtout sur le chien Raoul en le gavant des étranges pâtées qui amenaient le roquet à ces oublis que les Ribolard trouvaient étonnants de la part d’un quadrupède qui avait fréquenté la cour de Monaco et vécu sur les genoux de la plus haute société.
Tel était le milieu dans lequel avait végété Virginie, milieu si triste que la blonde jeune fille en bâillait à la journée.
Or, quand on bâille, on lève assez naturellement les yeux aux ciel.
Donc, un jour qu’elle se livrait à cet exercice devant sa fenêtre, ses yeux levés avaient aperçu à une mansarde du toit la tête d’un jeune homme qui la contemplait.
D’abord, on s’était regardé.
Puis, de la part de Paul, la télégraphie du geste avait marché, timide en commençant, pour se continuer, après, de plus en plus expressive.
Enfin, les deux jeunes gens en étaient arrivés à s’aimer sans s’être jamais parlé.
Donc Nicolas Borax s’était rudement avancé en se vantant de faire le mariage qui devait réunir le demi-million de dot de Virginie aux soixante-dix francs par mois que sa grosse caisse produisait à Paul. Car le musicien ne comptait que comme une ressource passagère les quinze francs payés par l’élève qui apprenait la grosse caisse pour se traiter de la surdité... attendu qu’il s’en irait aussitôt guéri.
Or, au moment où les deux jeunes gens introduisaient Borax dans la maison, ils ne se doutaient guère que mademoiselle Paméla de Veausalé, en prenant ses grands airs, venait de dire aux Ribolard:
—Chers amis, j’ai une bien importante proposition à vous faire au sujet de Virginie, qui me semble être en âge de se marier.
—Auriez-vous trouvé un époux pour notre fille? s’écrièrent aussitôt les époux.
La gouvernante inclina majestueusement la tête.
—Un de vos amis de la cour de Monaco? demanda le vermicellier.
Elle attendit, pour continuer, que Ribolard eût fini de palpiter de joie, car il faut dire qu’à la moindre émotion éprouvée par le digne homme son continuel rhume de cerveau lui faisait aussitôt rage dans le nez. C’étaient des gloc, gloc, gloc, qui grondaient alors dans sa trompe nasale engorgée avec un tel fracas que le roquet Raoul se mettait à aboyer en furibond.
Enfin les gloc, gloc, de Ribolard ému s’apaisèrent, et mademoiselle de Veausalé put continuer.
—Oui, reprit-elle, j’espère marier Virginie au comte Bonifacio de Aricoti, le neveu du fameux duc de Croustaflor.
—Des nobles! s’écria le joyeux père dont le nez lâcha une seconde série de gloc, gloc.
—De la plus vieille noblesse. Tous leurs ancêtres sont morts aux croisades.
—Quel honneur pour notre famille!
—A ma vive sollicitation, le duc de Croustaflor a bien voulu consentir à n’accepter pour son neveu qu’un demi-million de dot.
—Vraiment!
—Pour lui, ce n’est qu’une goutte d’eau.
—Il est donc bien riche?
—Si le duc est riche! mais jugez-en par son seul train de maison. Cinquante chevaux, seize phoques apprivoisés, cent domestiques et trente pompiers.
—Pourquoi les pompiers?
—Pour veiller sur ses titres de propriété et sur les diamants de famille, qui sont enfermés dans un pavillon à part.
—Et les phoques apprivoisés?
—Pour se faire promener en mer.
Madame Ribolard avait écouté tout cela bouche béante et ouvrant des yeux surpris, comme si elle voyait passer un veau à deux têtes.
—Alors, cette fortune reviendrait un jour à Virginie? demanda-t-elle.
—Naturellement, puisque le duc, qui est garçon, n’a que Bonifacio pour héritier de ses immenses propriétés d’Italie, d’Egypte, du Mexique, du Pérou... car M. de Croustaflor possède des propriétés dans tous les pays.
—Excepté en France, pourtant?
—Ah! je ne saurais vous le dire. Vous comprenez bien que je n’ai pas été assez indiscrète pour exiger des détails quand le duc m’a annoncé qu’il daignait accepter votre demi-million. «Que la petite plaise à Bonifacio et je me contenterai de cette misère.» Voilà ce qu’il m’a dit hier.
—Comment! hier! il n’est donc pas en ce moment à Monaco? s’informa Ribolard aussi vite que le lui permettait son nez, dont les gloc, gloc, avaient repris leur train.
—Il est maintenant à Paris, où il est venu pour se faire couper les cheveux. Il prétend qu’on ne sait tailler les cheveux qu’à Paris. Aussi, avec son énorme fortune, il ne regarde pas à ce que peut lui coûter cette coquetterie.
—Ça lui reviendrait à meilleur marché de faire venir un coiffeur de Paris à Monaco.
—Alors, on ne lui taillerait pas les cheveux à Paris.
—Tiens! c’est juste! que je suis bête! confessa modestement madame Ribolard, qui avait avancé cette idée économique.
—Et son neveu Bonifacio?
—Le comte accompagne le duc.
—Est-ce qu’il vient aussi pour se faire couper les cheveux à Paris?
—Oh! non, le comte Bonifacio de Aricoti ne pense qu’à une chose, lui... à épouser une Française blonde.
—Pourvu, que Virginie lui plaise! s’écria la maman tremblante.
—Pour cela, il suffit que le comte voie votre fille un seul instant, dit mademoiselle de Veausalé en souriant à la mère craintive.
—Oui, mais comment la verra-t-il?
—J’ai un moyen tout trouvé. En causant hier avec M. de Croustaflor, il m’a appris que son neveu et lui devaient aller ce soir à l’Ambigu. Envoyez retenir des fauteuil de balcon. Ces messieurs seront à l’orchestre et le jeune homme pourra ainsi s’enivrer des charmes de Virginie.
—C’est une idée!
—Dans la soirée, je préviendrai M. de Croustaflor que nous sommes là.
—Bon!
—Alors, je conviendrai que si Virginie a su captiver le comte de Aricoti, ces messieurs nous feront un signe quelconque.
—Oui, mais quel signe?
—Si M. le duc, par exemple, pendant le dernier entr’acte, tenait à la main le petit banc de l’ouvreuse? proposa madame Ribolard.
—Oh! fit le mari, on ne peut solliciter une telle complaisance d’un homme si riche. J’aimerais plutôt qu’il se mît à brosser son chapeau à rebrousse-poil. Cela attire moins l’attention des voisins que le petit banc. Qu’en dites-vous, mademoiselle de Veausalé?
—J’ai mieux à vous proposer. Ces messieurs se passeront les pouces dans l’entournure du gilet.
—Chacun dans son gilet à soi? demanda la mère.
—Oui, oui, Cunégonde, ma bonne; ne veux-tu pas que le duc aille fourrer son pouce dans le gilet de son neveu et réciproquement?... Ce serait trop exiger.
—Mais, mon ami, je m’informe, moi. Il faut bien convenir de tout pour qu’il n’y ait pas de malentendu.
Ce point arrêté, Paméla de Veausalé continua sa leçon aux époux.
—Quant à vous, dit-elle, si vous agréez le jeune homme...
—Oh! il est tout agréé d’avance. Vous comprenez bien que le neveu d’un homme qui possède des phoques et des pompiers est tout reçu... à moins qu’il ait deux nez... et encore!... cela pourrait passer pour un caprice d’homme riche.
—Soit! Vous ferez donc aussi connaître votre consentement par un signal discret.
—Très-bien. Cherchons un signal discret.
—Si tu laissais tomber ton chapeau dans l’orchestre, gros chéri? avança Cunégonde.
—Alors je prendrai mon plus vieux.
L’institutrice fit la moue, en disant:
—Il faudrait quelque chose de plus simple, monsieur Ribolard.
—Si j’ôtais ma cravate en ayant l’air d’être incommodé par la chaleur.
—Non, je propose que vous vous mouchiez.
—Oui, c’est cela. Je me moucherai trois fois de suite en regardant ces messieurs. Et puis, après, que ferons-nous, mademoiselle de Veausalé? Quand tout le monde aura dit oui, irons-nous boire ensemble une chope au café?
—Les choses ne se traitent pas comme cela à la cour de Monaco, mon cher monsieur. Le grand monde a d’autres usages. Il ne faudrait pas abuser de la complaisance de M. le duc à accepter votre demi-million, dit Paméla d’un air pincé.
—Mon Dieu! mademoiselle de Veausalé, il faut me pardonner. Je n’ai jamais été à la cour de Monaco. Ce que vous me direz, je le ferai.
—Eh bien! je vous amènerai ces messieurs ici pour vous les présenter. Vous les inviterez à dîner.
—Justement, la cuisinière réussit des flans délicieux. Nous dirons qu’ils ont été faits par Virginie; il est bien permis à des parents de faire valoir leur fille.
—Maintenant que tout est convenu, il faut envoyer retenir des places à l’Ambigu, si nous ne voulons pas être dans un coin où ces messieurs ne pourraient nous découvrir.
On expédia aussitôt un domestique.
Puis toute la maison fut en révolution.
On pressa le dîner.
On bouleversa les armoires pour les toilettes.
A tout moment, les époux Ribolard embrassaient leur fille; mais comme ils ne lui soufflaient pas un mot du motif pour lequel ils la conduisaient au théâtre, la jeune fille, étonnée de ces caresses répétées, se disait:
—Comme l’Ambigu les rend tendres!
Pendant que Paméla de Veausalé offrait aux époux Ribolard cette brillante perspective d’avoir bientôt pour gendre le neveu d’un homme qui possédait des phoques, Nicolas Borax, à la suite de ses deux guides, avait pénétré dans l’atelier du peintre, situé au sixième étage de la maison et tout à côté de la mansarde de Paul, la grosse caisse.
—Là, maître Nicolas Borax, nous sommes arrivés, dit Ernest en introduisant le saltimbanque dans son atelier.
Nicolas courut d’abord ouvrir la fenêtre du fond et s’écria:
—Parfait! plus que parfait! je n’aurai pas à monter et descendre six étages pour venir vous voir. Ma mansarde est juste à la hauteur de votre local. Je pose un pied sur votre gouttière, un pied sur la mienne, et, crac! en une seule enjambée je suis d’une maison dans l’autre... et cela sans danger, car nos deux gouttières sont assez larges et solides pour y faire passer le bœuf gras et son cortége.
—Comment, Borax, c’est vous qui habitez la mansarde de la maison voisine!!! s’écria le peintre.
—Précisément.
—Alors, c’est donc vous qui, tous les jours, de deux à quatre heures, m’écorchez les oreilles en faisant hurler un cornet à piston?
—Oui, je cultive mon talent.
—Vous appelez cela un talent, malheureux! Mais, depuis six mois que vous l’exercez, je n’ai plus une seule punaise dans mon atelier; elles se sont enfuies épouvantées.
—Oui, pour se réfugier chez moi, ajouta douloureusement Paul.
Borax, au lieu de s’émouvoir du reproche, fit un bond de joie.
—Tiens! tiens! vous me révélez un des côtés utiles du cornet à piston. Je vais en faire une nouvelle corde à mon arc. Dès ce soir, j’adresserai un prospectus à ma clientèle, où j’annoncerai que j’entreprends la suppression des punaises par un moyen de moi seul connu. Il y a tout un avenir dans ce secret.
—Vous direz encore que vous l’avez appris du roi de l’Inde.
—Non, non, j’inventerai que j’ai retrouvé ce secret dans les papiers d’un grand musicien décédé... de Rossini, par exemple.
Et Nicolas, se frottant les mains, continua, tout guilleret:
—Superbe! superbe! cette recette contre les punaises... Oui, superbe et pleine d’humanité, car elle débarrasse de l’animal sans le faire périr... La Société protectrice des animaux est capable de me donner un prix. Ah! monsieur Ernest, si je gagne une fortune, c’est bien vous qui me l’aurez mise dans la main.
—Alors, par reconnaissance, vous devriez bien ne plus me briser la tête avec votre piston pendant deux heures.
A cette demande, Borax devint sérieux et répondit d’une voix grave:
—Impossible, cher monsieur, c’est vraiment impossible!
—Comment impossible! Vous ne pouvez renoncer à votre infernale musique?... Car je ne voudrais pas vous faire un mauvais compliment, mais vous jouez d’une telle épouvantable façon que vous devez faire souffrir même votre instrument.
—Oui, oui, je le sais si bien que je me mets du coton dans les oreilles pour ne pas m’entendre moi-même... mais il m’est impossible de ne pas jouer, dit Borax désespéré.
—Pourquoi? demandèrent les jeunes gens étonnés de son refus.
—Parce que c’est ma seule manière de payer mon terme.
—Ah! bah!
—Oui, voici la chose. Il faut vous dire que mon propriétaire est dentiste, et qu’il possède un fils que, d’abord, il avait établi serrurier. En voyant que le jeune homme ne mordait pas ferme à la serrurerie, le papa s’est dit: «J’ai une jolie clientèle, autant qu’elle reste à mon garçon; je vais lui apprendre mon état.»
Alors, tous les jours, de deux à quatre heures, le jeune homme fait son apprentissage en s’exerçant sur les mâchoires des clients. Vous comprenez que l’ancien serrurier jouit d’une main un peu lourde, il se figure qu’il crochette une serrure... De sorte qu’il en résulte, de la part des clients, d’affreux beuglements qui discréditeraient le papa dentiste en effrayant le quartier. Pendant cette leçon, qui dure deux heures, je joue du cornet à pleins poumons, ça étouffe les cris... on prend les hurlements des victimes pour les accords de mon piston... et, en récompense de cette adroite mélodie, le propriétaire dentiste me fait cadeau de mon terme.
—Et quand le fils saura-t-il enfin arracher une dent?
—Je ne pourrais pas trop vous dire, mais le papa dentiste m’a proposé hier de me signer un bail gratis de neuf ans, avec clause de musique.
—Diable! fit Ernest effrayé; alors, pendant neuf années, je suis exposé à vous entendre! Heureusement qu’en neuf ans de piston continu vous pouvez arriver à en jouer agréablement.
—Oui, mais le propriétaire veut insérer dans le bail que, si j’arrive à une certaine force, je serai tenu de prendre des élèves commençants qui n’annonceront aucune disposition.
A ce moment, on frappa à la porte de l’atelier.
—Entrez! fit Ernest.
Un joli petit minois de femme se montra aussitôt par l’entre-bâillement de la porte poussée.
—Mais avancez donc, mademoiselle Clémence, s’écria Paul en s’élançant à sa rencontre.
—Jolie créature, murmura Borax.
—C’est la femme de chambre de madame Ribolard, lui souffla le peintre.
—Si j’ai jamais désiré un trône, c’est pour avoir une pareille femme de chambre, soupira Nicolas.
L’amoureux Paul avait fait entrer Clémence et lui offrait une chaise.
—Il y a donc du neuf? demanda-t-il.
—Oui; j’étais montée dare dare à votre chambre pour vous le conter, et, ne vous y trouvant pas, j’ai eu l’idée de venir vous relancer dans l’atelier de M. Ernest, répondit la gracieuse soubrette en adressant à ce dernier une œillade langoureuse que vit Borax.
—Parlez.
—Sachez donc que monsieur et madame se sont d’abord enfermés pendant une heure avec la Veausalé. A la suite de quoi il y a eu un grand branle-bas dans la maison pour s’occuper des toilettes. Ils étaient comme fous! Monsieur faisait des gloc, gloc, avec son nez, à tel point que nous avons cru qu’il allait lui éclater. Madame sautait comme une petite folle, si bien que, ne pouvant pas lui agrafer sa robe, tant elle bondissait, j’ai fini par lui demander si elle avait avalé les élastiques de son sommier. «Non, qu’elle m’a dit, mais apprends que nous marions Virginie.»
—Ah! mon Dieu! s’exclama la grosse caisse.
—Après? dit Ernest.
—Je ne sais pas autre chose si ce n’est que l’entrevue doit avoir lieu ce soir à l’Ambigu... votre théâtre, monsieur Paul. Ainsi, vous connaîtrez votre rival.
Et la soubrette courut à la porte en criant:
—Je me sauve bien vite, car on s’apercevrait de mon absence.
L’amoureux était resté atterré par cette nouvelle.
—Parfait! plus que parfait! tout va bien pour nous, déclara Borax avec aplomb.
Cette assurance de Nicolas rendit un peu de courage au musicien.
—Vous trouvez que tout va bien? demanda-t-il.
—Parfait! plus que parfait, répéta Nicolas. Ce soir, nous étudierons l’ennemi à l’Ambigu. Mais, avant qu’il nous attaque, il faut que nous ayons compté nos forces.
—Comptons, fit le peintre.
—Nous disons donc que nous avons déjà pour nous mademoiselle Clémence, autant que j’ai pu en juger par la dose d’électricité qui lui chargeait l’œil en regardant M. Ernest.
—Ah çà! Borax, qui diable a pu vous faire croire qu’elle songe à moi? s’écria l’artiste.
—J’ai du flair. La brunette a de la tendance à votre endroit.
—Mais non, c’est une fille qui se tient énergiquement dans cette île escarpée et sans bords qu’on appelle la vertu.
—Possible! mais elle descendrait volontiers dans votre nacelle pour faire un on deux tours sur l’eau. Donc, nous regarderons Clémence comme acquise à notée cause si vous le voulez bien...
—Allons, soit! je me dévouerai pour Paul, dit le peintre avec une petite pointe de fatuité.
—Bon! une dans le sac, reprit le bon homme. Passons au portier. Ce fonctionnaire est le plus important pour nous. Dans la bataille que nous allons livrer, le concierge représente notre artillerie rayée. Il me faut un peu l’étudier.
—Voulez-vous que je vous le fasse monter? demanda Paul.
Le jeune homme ouvrit une fenêtre, lança un strident coup de sifflet, puis il ajouta:
—C’est notre façon d’appeler Calurin quand nous avons une commission à lui donner.
—Très bien. Je vais tout de suite me mettre au mieux dans ses papiers. Vous allez voir cela.
Le saltimbanque courut à la porte de l’atelier, qu’il tint toute grande ouverte.
On entendait Calurin gravir l’escalier.
Quand Borax le crut assez près pour que, par la porte béante, le portier pût entendre ce qui se disait dans l’atelier, il s’écria de sa voix la plus perçante:
—Oui, messieurs, oui, j’ai visité des palais somptueux, des demeures de rois... et nulle part, entendez-vous? nulle part je n’ai trouvé une habitation aussi bien tenue que la vôtre! Cour, vestibule, couloirs, tout resplendit de cette propreté bienfaisante qui est la moitié de la santé. Les escaliers y sont tellement propres que, si j’y laissais tomber une pièce de dix sous, je ne regarderais pas à la ramasser avec ma langue.
En arrivant à la porte de l’atelier, le concierge n’avait pas perdu un mot de la phrase, et sa figure exprimait une reconnaissante satisfaction.
—Ah! Calurin, dit Ernest, si tu étais arrivé dix secondes plus tôt, tu entendais monsieur faire l’éloge de la propreté de la maison.
Le pipelet salua Borax avec empressement.
—Oui, monsieur Calurin, je complimentais mes amis sur la bonne tenue de la maison qui vous a confié ses destinées.
L’air de contentement du portier disparut tout à coup sous une pensée triste qui venait sans doute de lui arriver, et il répondit, en poussant un soupir douloureux:
—Oui, elle est bien tenue... car j’ai malheureusement trop de temps pour m’en occuper. Vous voyez devant vous, monsieur, un exilé... un malheureux exilé... chassé de son foyer domestique.
—Tiens, c’est vrai, s’écria Ernest, conte donc tes infortunes à monsieur, qui ne les connaît pas; il a beaucoup voyagé, et son ami le roi de l’Inde lui aura sans doute donné une poudre qui te serait utile.
—Quoi! monsieur est ami du roi de l’Inde!
—Oui, les deux doigts de la main ne sont pas mieux liés l’un à l’autre. Il faudra même que je lui parle de vous pour son château de Calcutta dont le concierge vient de se retirer avec quinze mille livres de rente, gagnées en deux ans. Mais avant, monsieur Calurin, contez-moi d’abord votre malheur.
—Mon malheur résulte de mon trop de bonheur.
—Ah! vraiment?
—Parle, parle, pauvre ami, ouvre ton âme à monsieur, crièrent les deux jeunes gens qui, connaissant le genre d’infortune du concierge, prenaient plaisir à la lui faire raconter.
—Alors, monsieur veut bien m’écouter?
—Je bois vos paroles, Calurin, je les bois, déclara Borax avec empressement.
—Voici donc mon histoire: Figurez-vous que tant que ma femme était demoiselle, elle était rongée par ce désir: «Etre mère!!» Moi, je lui répondais: «Tu peux t’en fier à moi, je suis du Midi»; et, aussitôt le mariage fait, je me suis si bien appliqué à lui tenir ma parole, que j’ai réalisé onze fois ce vœu de ma femme d’être mère.
—Onze enfants! c’est une heureuse réussite, car les familles nombreuses sont bénies du ciel, déclama le charlatan.
—Il paraît que le père n’est pas compris dans la bénédiction, car je n’ai jamais été plus malheureux. Bref, les onze petits, ma femme et moi, ça fait treize à table. TREIZE!!! Comme mon épouse est très-superstitieuse, elle m’envoie, à l’heure des repas, balayer la maison pour éviter un malheur. Alors je trompe ma faim en cirant mes escaliers et en me disant: «On me gardera ma portion.» Pas du tout! j’ai enfanté onze petits ogres, qui mangent même le vert des artichauts. De sorte que je périrais de faim sans mademoiselle Madelon, la cuisinière de M. Ribolard, qui veut bien me soulager quelquefois d’une côtelette égarée de la table de ses maîtres.
—Triste! triste! triste! répéta Borax en affectant un air désolé; mais, mon cher monsieur Calurin, l’avenir vous réserve un moyen pour n’être plus treize à table.
—Lequel? s’écria le concierge plein d’espoir.
—C’est d’être quatorze. Espérons que vous aurez un douzième enfant.
—Hélas! non! Ernestine dit que notre place ne rapporte pas assez, et que nous sommes déjà beaucoup trop à l’étroit. Ah! si nous avions cette loge du palais de Calcutta, chez votre ami le roi de l’Inde, dont vous parliez tout à l’heure, peut être que mon Ernestine sourirait à un nouvel effort.
—Je penserai à vous, père intrépide. Messieurs, songez donc à me rafraîchir la mémoire au sujet de Calurin quand j’écrirai à mon ami le roi? prononça Borax avec un aplomb superbe.
—En vous contant mes malheurs, j’ai oublié de vous demander quelle est la commission pour laquelle vous m’avez fait monter, s’informa le portier, redevenu gai après cette promesse d’une loge à Calcutta.
—Ah! oui, reprit le peintre, c’était pour te dire que, si un monsieur avec un nez d’argent venait me demander, tu lui répondes toujours que je suis retourné en nourrice. N’y manque pas, Calurin, si étrange que te paraisse cette consigne, tout mon avenir en dépend.
—Soyez tranquille, monsieur Ernest, promit le concierge, qui s’en alla sans se douter qu’on ne l’avait appelé que pour le montrer à l’intime camarade du roi de l’Inde.
—Encore un qui sera dans notre sac. Nous le tiendrons par la cuisinière Madelon, qui lui fourre les côtelettes de Ribolard.
—Alors, il faudrait d’abord tenir Madelon, avança Paul.
Borax eut un sourire vainqueur en répliquant:
—Je m’en charge. Je ne sais pas à quoi ça tient, mais les cuisinières me profitent assez... sans compter ma poudre, qui nettoie les casseroles à la perfection. Nous aurons donc le concierge; il faut à présent nous occuper de sa femme, la féconde Ernestine.
—Oh! c’est facile, dit le peintre en riant. Si nous tenons le mari par la cuisinière, nous aurons la femme par le cocher Benoît.
—Ah! vraiment?
—Oui, les mauvaises langues prétendent qu’elle a un faible pour lui.
La délibération fut interrompue subitement par cette exclamation de Paul, le joueur de grosse caisse:
—Ah! voici l’heure de me rendre à l’Ambigu!
Il est sept heures. On a déjà joué la petite pièce et la foule, arrivée pour le drame à succès, emplit la salle de l’Ambigu.
Sur le premier rang des fauteuils de balcon, la famille Ribolard s’étale dans tout son plein. Virginie est prise entre mademoiselle de Veausalé et sa mère; Ribolard est assis entre sa femme et un vieux monsieur, à tournure militaire, qui commence à s’effaroucher des étranges allures de son voisin.
La jeune et jolie blonde a déjà aperçu Paul, placé devant son instrument, dans un coin de l’orchestre. Elle lui lance de bien doux regards quand elle ne se sent pas surveillée par Paméla, qui se tient raide et immobile comme une girafe qui réfléchit.
Son maintien fait l’admiration de Ribolard, et il murmure à sa femme:
—Ne t’appuie pas à ton dossier, Cunégonde; imite la prestance de mademoiselle de Veausalé. Copie donc ses manières du grand monde.
—C’est que je suis très-mal assise. Il y a une grosse bosse dans mon fauteuil, de sorte que, quand je veux me redresser, j’ai une... joue qui porte à faux.
Quant à Ribolard, qui prêche les bonnes manières à son épouse, il se tient pour ainsi dire le ventre sur l’appui en velours du balcon, le corps à demi penché en dehors et fouillant du regard le public de l’orchestre pour tâcher de découvrir le noble duc de Croustaflor et son neveu.
En dessous de lui se trouvent les claqueurs du parterre qui, en voyant ce monsieur suspendu sur leurs têtes, commencent à manifester des inquiétudes d’autant plus sérieuses que le nez du vermicellier ému fait entendre un bruyant gloc gloc qu’ils prennent pour un hoquet.
—Est-ce que son dîner lui fait mal? murmurent-ils ça sera du propre quand il va être secoué par la grande scène entre Machanette et madame Laurent. Justement nous l’avons au-dessus de nous! il faut aller reprendre nos parapluies au vestiaire pour le moment de l’averse.
—Eh! là haut! rentrez donc votre pochard! crie un de ces messieurs.
—Tapez-lui dans le dos, ça tue le hoquet, ajoute un autre.
Mais Ribolard ne remarque pas l’orage qui gronde à ses pieds. Il est dévoré par l’impatience de connaître les illustres amis de Paméla, et bientôt il souffle à sa femme:
—Cunégonde, trouve donc une phrase ingénieuse pour demander à mademoiselle de Veausalé, sans donner de soupçons à Virginie, si ces messieurs sont arrivés.
Madame Ribolard se creuse la cervelle pour trouver la phrase ingénieuse, puis, elle murmure à sa fille:
—Ma bichette, prie donc de ma part mademoiselle de Veausalé de te dire si la viande est dans la marmite.
Virginie, surprise par cette question étrange, regarde un instant sa mère pour s’assurer si elle plaisante, mais elle la voit si sérieuse qu’elle suppose qu’au départ on a fait mettre le pot-au-feu pour prendre un bouillon en rentrant du théâtre, et elle transmet l’interrogation à son institutrice.
Mademoiselle de Veausalé accueille la question avec une moue de dédain. Elle en devine le sens caché, mais la façon vulgaire dont la demande lui est posée froisse ses grandes manières, et elle répond dans son beau langage de la cour de Monaco:
—Dites à votre maman que les narcisses ne sont pas encore en fleur.
Virginie est encore plus étonnée par cette réplique, qui ne rime pas du tout avec la question, mais elle la répète à sa mère, après s’être dit tout bas:
—Quel drôle d’effet leur produit l’Ambigu!
En recevant la réponse de Paméla, madame Ribolard reste un instant pensive. On voit qu’elle cherche à comprendre.
—Eh bien! qu’a-t-elle répondu? demande l’impatient et curieux vermicellier.
—Elle dit que la réglisse ne fond pas dans le beurre, lui murmure Cunégonde.
Ce renseignement plonge le vermicellier dans un ahurissement qui se manifeste aussitôt par de si bruyants glocs glocs que son voisin, le vieux militaire, impatienté par ce fracas, s’écrie d’un ton hargneux:
—Ah çà! mille escadrons! vous n’avez donc pas fini de faire craquer vos bottes neuves, vous?
Une querelle est sur le point de s’engager, mais les trois coups se font entendre derrière la toile et l’ouverture commence.
—Mon Dieu! que je suis mal assise, murmure la pauvre Cunégonde.
Pendant que les Ribolard cherchaient à découvrir leurs illustres étrangers, ils ne se doutaient guère qu’ils étaient eux-mêmes le point de mire de deux spectateurs, placés tout près de la grosse caisse, au premier rang des fauteuils d’orchestre.
C’était le peintre Ernest, accompagné de Borax, qu’il avait revêtu d’un de ses habillements. Séparés de l’orchestre par la cloison basse, ils pouvaient causer avec Paul qui, pendant la pièce, n’avait pas autre chose à faire que d’appuyer de grands coups de grosse caisse les éclats de voix du traître quand il persécute l’héroïne.
—Voici le papa Ribolard, dit Ernest à Borax.
—Pourquoi agite-t-il ainsi les bras, avec son ventre posé sur le balcon?... Il apprend donc à nager? Il va se jeter dans le parterre.
—La grande raide est l’institutrice.
—Elle est grasse comme un manche de fouet. Qu’a-t-elle donc sur les yeux... des soucoupes?
—Non, des lunettes.
—Mazette! elles sont de taille! elle a de quoi voir deux actes à la fois... Allons, bon! voilà le père Ribolard qui se remet sur le ventre!
—Il cherche son futur gendre.
—Ah! on frappe les trois coups; il paraît que nos rivaux ne viendront qu’à l’acte suivant.
Mais au moment où la toile se lève, la porte de l’orchestre s’ouvre avec fracas, puis deux messieurs entrent bruyamment et dérangent Borax et Ernest pour gagner leurs stalles, placées à l’extrémité de la banquette.
L’un est très-grand et très-mince. Son œil est hardi, son allure sans gêne, et sa figure fatiguée est ornée, sur chaque joue, d’un énorme favori brun teinté de fil blanc, qui lui retombe sur la poitrine.
L’autre est petit, blond, très-gros, avec un nez retroussé en hameçon.
A leur apparition, Ernest s’est vivement retourné du côté de mademoiselle de Veausalé, qui, en entendant claquer la porte de l’orchestre, avait braqué son regard de ce côté pour examiner les arrivants. Le peintre surprend un imperceptible salut qu’elle adresse aux nouveaux venus.
—Je crois que voici nos gens, souffle-t-il à Borax, en reprenant sa place après le passage des retardataires.
—Alors le futur serait donc le petit gros? Autant vaudrait épouser un saucisson à pattes. Ah! nous allons leur procurer de l’agrément, à ces deux gilets en cœur.
A la fin de l’acte, le duc de Croustaflor et le comte Bonifacio sortent en adressant un petit signe à Paméla, qui, de son côté, se lève pour gagner le couloir et rejoindre ces messieurs.
Les Ribolard, en voyant disparaître mademoiselle de Veausalé, comprennent qu’elle va faire connaître à ses illustres amis les signaux qui ont été convenus pour le dernier entr’acte.
—Cunégonde, voilà le moment décisif. Es-tu émue, ma bonne? murmure le vermicellier tout pâle.
—Ah! mon chéri, je suis trop mal assise pour être à la joie...
—Moi, ma louloute, je suis tellement impressionné que tu dois entendre mon cœur battre.
Ce que Ribolard prend pour le battement de son cœur est le gloc gloc de son rhume de cerveau qui crépite si fort que le vieux militaire voisin s’écrie, exaspéré:
—Mille escadrons! vous voulez donc me rendre enragé, vous, en faisant craquer vos bottes neuves! Décampez au plus vite à une autre place ou retirez vos bottes, je vous donne le choix!
Ribolard, tout abasourdi, n’a pas encore eu le temps de répondre que la tremblante Cunégonde lui presse le bras en soufflant:
—Mon chéri, ne cède pas à la fougue de ton caractère. Ne te compromets pas, cet homme est un fou!
—Je le vois bien; il veut que je m’en aille à une autre place ou que je retire mes bottes.
—Montre-toi le plus sage, il faut céder aux insensés. Retire-les plutôt que d’avoir une dispute qui compromettrait le mariage de Virginie.
—Attendons un peu. Sa manie va peut-être lui passer, dit Ribolard.
Mais le vieux militaire, furieux, a tiré sa montre et reprend d’un ton rageur:
—Je vous donne dix minutes pour vous décider... et pas un fichtre avec!
Virginie n’a rien vu ni entendu. Elle couvre du regard son Paul, mélancoliquement appuyé sur sa grosse caisse.
Avant que les dix minutes du délai soient écoulées, madame Ribolard obtient de son époux qu’il change de place avec elle, d’abord pour lui éviter une querelle avec le vieux militaire qui lui veut faire retirer ses bottes, ensuite parce qu’elle n’est pas fâchée de quitter le fauteuil bossu qui la fait tant souffrir.
Le mari est à peine posé sur son nouveau siége qu’il se relève subitement.
—Qu’as-tu, mon loulou? demande Cunégonde.
—Je crois que je viens de m’asseoir sur ta lorgnette oubliée dans la stalle.
—Mais non, c’est la bosse du fauteuil que tu sens... Ce siége manque un peu de confortable, n’est-ce pas? Tu dois avoir un côté qui porte à faux?
—Oui, mais je vais me caler, dit le vermicellier d’un air capable.
Il tire un magnifique foulard de sa poche; il le roule d’abord en long, puis il le tresse en rond et en fait une de ces couronnes dont se servent ceux qui portent des fardeaux sur la tête.
Il l’insinue alors sous la forte portion de son individu qui est à faux, puis il pousse un petit cri de triomphe.
—Es-tu mieux? demande son épouse.
—J’attendrais ainsi la fin du monde.
A cet instant mademoiselle de Veausalé reparaît. Les spectateurs, placés derrière les époux Ribolard, ayant quitté leurs stalles pour aller flâner dans les couloirs, l’institutrice peut donc se glisser entre les deux rangs de fauteuils et venir, par derrière, souffler bien bas au ménage:
—Tout est convenu avec ces messieurs. Pouce dans le gilet et réponse du mouchoir; ils sont placés au premier rang des fauteuils d’orchestre, juste en face de la contre-basse. Votre futur gendre est blond, avec un nez à la Roxelane; il est petit, et gras d’un dodu de bon goût.
—Est-ce que M. le duc de Croustaflor est ce grand monsieur maigre, et si distingué de manières, que je vois là-bas, debout devant sa stalle et s’apprêtant à prendre une prise dans un cornet en papier? demande Cunégonde.
Paméla jette un regard sur l’orchestre.
—Non, dit-elle, le duc et son neveu ne sont pas encore rentrés. Celui que vous voyez est sans doute quelque spectateur voisin qui sera venu se mettre là pendant l’entr’acte pour examiner la salle.
—Il a aussi l’air bien comme il faut.
La personne que madame Ribolard trouve si distinguée n’est autre que Borax. En voyant sortir les deux étrangers, il les a suivis dans les couloirs, et, quand ils ont rejoint l’institutrice, il a écouté adroitement leur conversation.
—Bon! se dit-il, je dois les empêcher d’atteindre le dernier entr’acte pour donner ou recevoir le signal.
Il prend aussitôt une contre-marque, sort du théâtre et s’en va chez un épicier voisin acheter dix sous de poivre en poudre.
Au moment où madame Ribolard le trouve si distingué, Borax est en train de répandre son poivre devant les deux stalles des illustres seigneurs.
Enfin les trois coups sont encore frappés, le public regagne ses places et la musique se fait entendre. Comme la première fois, MM. de Croustaflor et Bonifacio ont attendu le lever du rideau pour faire leur entrée et déranger chacun sur leur trajet.
Quand ils passent devant Borax, celui-ci les examine bien et murmure:
—C’est drôle! il me semble que j’ai déjà vu ces deux cocos quelques part... surtout celui qui a des favoris qui lui descendent sur le ventre.
L’arrivée tardive des deux nobles excite un mécontentement qui se traduit bientôt par ce cri:
—Assis! assis! Passez donc!
Mais ces messieurs ne peuvent ni s’asseoir ni passer. En gagnant leurs places, un des très-longs et flottants favoris de M. de Croustaflor vient de se prendre dans la boucle d’oreille d’une dame, qui a poussé un hurlement de douleur en se sentant arracher l’oreille. Le duc, le comte, la dame et son mari cherchent à débarrasser le bijou des boucles frisées du favori, mais cela demande quelques minutes, pendant lesquelles le publie beugle toujours:
—Assis! assis!
Un spectateur fait enfin passer une paire de ciseaux à ongles pour trancher la difficulté.
Bientôt la dame attachée lance un second hurlement, car elle vient de sentir qu’on lui entamait la peau. C’est son époux qui, effaré par les clameurs de la foule, est tellement troublé qu’il est en train de trancher l’oreille de sa femme pour séparer les deux prisonniers, au lieu de songer à couper le favori. Le cri de sa femme le rappelle à des idées plus simples, et bientôt M. de Croustaflor peut regagner sa place en abandonnant une forte touffe de son ornement qui reste pendue à l’oreille de la dame.
Les Ribolard ont vu de loin cette mutilation.
Le vermicellier en est tout pâle et murmure:
—Comme le noble duc doit souffrir; lui, si coquet de sa personne qu’il vient de Monaco à Paris pour se faire tailler les cheveux.
Le calme s’est enfin rétabli, et le public écoute l’acte, qui est le plus important de la pièce. C’est là que se trouve la scène capitale entre l’héroïne et le traître, où dit-on, les acteurs chargés du rôle font crouler la salle entière sous les bravos des assistants.
Bientôt ce moment arrive. Les artistes jouent la scène avec une telle âme que le public enthousiasmé se met à claquer des mains et à trépigner avec frénésie.
Comme tout le monde, MM. de Croustaflor et Bonifacio ont frappé des pieds avec un acharnement qui soulève les nuages du poivre versé par Borax devant leurs places.
Aussi, après la sortie du traître, quand l’héroïne, restée seule, commence son monologue sentimental pour invoquer une tante qui, du haut des cieux, veille sur son innocence, elle est tout à coup interrompue par les épouvantables éternuments de l’illustre duc de Croustaflor, auquel le poivre ravage le nez. Il a beau vouloir se retenir, il éternue sans relâche et avec une telle force que c’est à croire que sa tête va se détacher de son corps.
L’actrice est obligée de s’arrêter pour attendre la fin des exercices de ce spectateur qui, à chaque fois, va frapper du crâne dans le dos du musicien placé devant lui.
—A moi, Bonifacio! crie le duc, entre chaque court instant de répit que lui laissent les éternuments.
Mais le comte de Aricoti a bien autre chose à faire que de s’occuper de son oncle. Au lieu du nez, le poivre lui a ravagé les yeux et la gorge. Il râle et il est aveugle. Il passe son temps à essuyer ses yeux rouges et pleurants, qui coulent comme des robinets de fontaine, en même temps qu’il pousse les cris rauques d’un chat qui étrangle. La douleur est si forte qu’il piétine avec rage, ce qui contribue à faire monter de nouveaux nuages de poivre, dont se régalent ses yeux et le nez de son oncle.
—A la porte, la cabale! crie toute la salle à ce monsieur qui interrompt la pièce par ses explosions.
Le duc de Croustaflor veut résister un instant, mais il lui est impossible de comprimer ses détonations.
—A la porte, la cabale! hurle toujours le public qui devient furieux.
Le noble étranger se lève; il se glisse péniblement entre les rangs pressés des spectateurs furibonds qui, sous leurs mouchoirs, leurs chapeaux ou leurs programmes, cherchent à s’abriter contre les éternuments dont l’auguste seigneur les asperge en passant. Au départ de son oncle, le comte Bonifacio de Aricoti, devenu complétement aveugle, a saisi d’une main les basques de l’habit du duc, qui lui sert de caniche d’aveugle. Il se fait traîner en essuyant de l’autre main ses yeux, d’où jaillissent deux vraies sources.
Du haut de son balcon, le ménage Ribolard a assisté aux malheurs des deux infortunés. Les époux sont désolés de cette catastrophe, qui peut faire manquer le mariage.
—Avec son favori coupé, le duc se sera enrhumé. Il aurait dû s’entourer la figure d’un foulard en sentant la première atteinte du froid, murmure le vermicellier à sa femme.
—Comme il éternue... que de force!
—Dame! il éternue suivant sa fortune. Un homme si riche ne peut éternuer comme un modeste employé.
—Et M. Bonifacio, as-tu vu comme il pleurait à chaudes larmes?
—Oui... il aura été fortement secoué par la scène du traître et de l’héroïne... Cela prouve qu’il a l’âme sensible... Virginie sera heureuse avec lui.
—Est-ce que tu ne le trouves pas un peu gros?
—Puisque mademoiselle de Veausalé t’a dit que, dans le grand monde, on appelait cela un dodu de bon goût.
—Mais où est-elle donc passée, mademoiselle Paméla?
—Elle vient de sortir, en me faisant comprendre par un signe qu’elle allait retrouver ses illustres amis pour tâcher de les ramener, répond le vermicellier.
En effet, l’institutrice a quitté la salle pour se mettre à la recherche des seigneurs disparus. Elle finit par les retrouver au café du théâtre, où ils sont en train de soigner le mal étrange qui les abat. Le comte de Aricoti se tient renversé sur une banquette, la tête en l’air, avec une serviette mouillée sur les yeux. Quant au fier duc, ses éternuments ont cessé, mais le feu qui lui dévore l’intérieur des narines est si intense que, pour calmer l’incendie, il s’est fait servir un saladier plein d’eau dans lequel il laisse tremper son nez.
M. de Croustaflor daigne sortir de son bain pour promettre à Paméla que, aussitôt leurs souffrances apaisées, son neveu et lui rentreront dans la salle pour faire connaître leur décision à la famille Ribolard.
L’institutrice se hâte de les quitter pour porter cette bonne réponse aux parents de Virginie.
Cependant, l’acte durant lequel les nobles étrangers sont sortis vient de finir, et le café est envahi par les consommateurs. Parmi eux se trouvent Ernest et Borax, qui arrivent s’asseoir à côté des deux représentants de la cour de Monaco.
—Que faut-il servir à ces messieurs? leur demande le garçon empressé.
—Tiens! s’écrie Borax, quelle est cette consommation nouvelle qu’on prend par le nez? Si c’est bon, servez-m’en une. Ça doit être russe, cette invention-là. Comment l’appelez-vous, garçon?
Le garçon explique que, depuis un quart d’heure, les voisins de table se tiennent ainsi, l’un le nez dans l’eau, l’autre les yeux sous une serviette mouillée.
Loin de baisser le ton, Borax reprend, de son organe le plus perçant:
—Mais alors, si ce monsieur attend que son nez fonde, apportez-lui donc une petite cuiller pour le retourner. Vous voyez bien que c’est un médecin qui prépare l’infusion que va boire le malade qui a une serviette sur la figure.
En entendant ces paroles, M. de Croustaflor retire son nez du saladier, jette une pièce de cinq francs au garçon et se lève en dardant un regard furieux sur le mauvais plaisant.
Au lieu de s’émouvoir du coup d’œil menaçant, le saltimbanque se dit aussitôt:
—Oui, j’en suis certain, j’ai déjà vu ce paroissien quelque part.
Sans attendre sa monnaie, le duc a enlevé la serviette du visage de son neveu, qu’il entraîne en disant:
—Venez, comte.
Par malheur, Bonifacio, encore aveuglé par le poivre, n’y voit pas assez pour se conduire; il renverse un monsieur qui entrait à ce moment dans le café.
C’était Ribolard, qui amenait sa famille pour se rafraîchir pendant l’entr’acte.
Le duc reconnaît aussitôt le vermicellier et lui tend la main pour le relever; mais celui-ci a été tellement saisi par la surprise de se trouver aussi subitement en présence des illustrissimes étrangers qu’il reste assis par terre sans avoir la force de bouger. M. de Croustaflor et Paméla s’empressent de le remettre sur ses jambes, pendant qu’il balbutie tout ému:
—Ah! Monseigneur... Altesse... Sire... quelle auguste complaisance de la part d’un homme qui possède des phoques! Peut-on vous offrir un verre de vin?
Le rouge de la honte envahit le front de l’altière Paméla en entendant Ribolard offrir un verre de vin au duc, comme s’il s’adressait à un commissionnaire qui vient de lui scier son bois.
—Observez-vous donc, gronde-t-elle d’un ton rogue, n’oubliez pas que vous parlez à un homme dont tous les ancêtres sont morts aux croisades.
Quant à Cunégonde, elle est tremblante d’un saint respect et elle souffle à sa fille:
—Tiens-toi droite, Virginie. Le grand, qui a relevé ton papa, possède des pompiers, et le petit blond, au nez en queue de lapin, est son neveu, qui héritera des phoques.
La jeune fille ouvre des yeux ébahis en entendant cette phrase burlesque de sa mère. Elle ne comprend pas plus l’admiration de son père pour des gens qui l’ont renversé sur le derrière. Aussi, elle murmure:
—Décidément, l’Ambigu les rend malades!
Mademoiselle de Veausalé, qui a gardé son sang-froid, installe la famille devant une table à laquelle, sur un geste de l’institutrice, M. le duc daigne aussi prendre place. Il fait asseoir son neveu qui, toujours aveuglé par le poivre, demande d’une voix étonnée:
—Est-ce que nous sommes déjà rentrés dans la salle?
Le garçon est venu prendre les ordres des nouveaux consommateurs. Ribolard commande de l’orgeat pour les dames et un cassis pour lui. Quant au duc, il l’interroge de l’œil, n’ayant plus la témérité de rien lui offrir après la verte semonce de mademoiselle de Veausalé. Pour le tirer d’embarras, M. de Croustaflor s’adresse directement au garçon.
—Servez-moi ce que vous voudrez, dit-il.
—Mais où sommes-nous donc? redemande encore l’aveugle Bonifacio.
—Comte de Aricoti, nous sommes en la société de M. de Ribolard.
Le neveu ouvre ses yeux, plus rouges qu’un pantalon de soldat, et débite gracieusement:
—Monsieur de Ribolard, enchanté de faire votre connaissance... c’est un bonheur que m’enviera la cour de Monaco.
Le garçon revient avec les consommations demandées par le vermicellier. Laissé libre par le duc de lui servir ce qu’il voudrait, le garçon a cru être agréable au client en lui apportant un nouveau saladier plein d’eau pour faire encore infuser son nez.
Les époux Ribolard n’osent interoger, mais ils restent les yeux braqués sur le saladier en se demandant ce que le duc veut faire de ces trois litres de liquide.
—Est-ce qu’il va les boire? dit tout bas le mari à mademoiselle de Veausalé.
—Même par les plus grandes chaleurs M. de Croustaflor ne se rafraîchit jamais que le bout des doigts, répond l’institutrice.
—Et ça lui calme la soif?
—Parfaitement. Quand elle est trop ardente, il se rafraîchit le bout du nez, ajoute Paméla qui, craignant que le duc ne se livre encore à son exercice, cherche à prévoir le cas.
Mais rien n’étonne Ribolard de la part d’un homme aussi riche, et il réplique:
—Ces grands seigneurs peuvent se permettre bien des choses.
Assez embarrassé de son saladier, M. de Croustaflor le passe à son neveu, en disant:
—Tenez, Bonifacio, désirez-vous un peu vous rafraîchir les yeux?
—Les doigts, le nez, les yeux... Il paraît qu’ils se rafraîchissent tout... excepté la langue, se dit le vermicellier en avalant son cassis.
—Non, merci, ça commence à s’éclaircir, répond le gros blond.
Ribolard trouve que c’est le vrai joint pour chauffer la conversation, et il s’écrie gracieusement:
—Monsieur le comte de Aricoti possède une bien belle âme. L’état de ses yeux fait l’éloge de sa vive sensibilité. Pour qu’une scène de drame ait pu le faire pleurer à tel point, il faut qu’il soit bien impressionnable.
—Très bien! très-bien! fait tout bas mademoiselle de Veausalé, mes compliments, monsieur Ribolard... on n’aurait pas mieux dit dans le grand monde.
Tout fier de l’éloge obtenu de la difficile Paméla, le mari pousse le coude de sa femme en lui murmurant:
—Dis donc aussi quelque chose, Cunégonde, ils vont croire que tu es en cire.
Le fait est que madame Ribolard est restée, bouche béante, en respectueuse contemplation devant les deux étrangers.
—Que veux-tu que je leur dise?
—Quelque chose d’aimable.
Cunégonde se recueille un instant, puis elle prend sa mine gracieuse pour demander:
—Viendrez-vous manger la soupe à la maison un de ces jours?
Mademoiselle de Veausalé fait un bond énorme d’indignation sur la banquette en entendant cette invitation trop cavalière, qui jure avec tous ses grands principes du savoir-vivre. Mais le duc de Croustaflor s’incline gracieusement et répond:
—C’est un honneur que j’ambitionnais sans oser le solliciter.
—Eh bien, si vous voulez, mardi, je tâcherai d’avoir un joli poisson et ma fille vous fera un flan.
Ribolard est resté stupéfait du succès de sa femme en parlant aux grands de la terre.
Quant à Virginie, qui a assisté muette à cette scène, un petit pressentiment vient de l’avertir qu’un danger pourrait bientôt la menacer, et elle songe à son Paul.
A l’autre bout du café, Ernest et le charlatan, assis à leur table, ont deviné ce qui se passe.
—Sapristi! grogne Borax, c’était bien la peine de dépenser dix sous de poivre pour empêcher ces deux cocos de s’entendre avec les Ribolard!
Le lendemain de cette soirée à l’Ambigu, la charmante Virginie, qui vient de se lever, est rêveuse dans sa chambre. Elle a enfin compris le motif de cette étrange agitation que, la veille, montraient ses parents. La brusque invitation à dîner et sa prompte acceptation lui annoncent la prochaine entrée de deux inconnus dans la maison paternelle qui, ordinairement, ne s’ouvre qu’à de vieux amis, tous anciens commerçants.
Au retour du théâtre, elle a surpris entre ses parents et Paméla quelques phrases à mots couverts qui l’ont éclairée sur la cause de l’invitation. Enfin, elle a deviné que son amour pour Paul va avoir à soutenir un assaut, et elle s’est préparée à le défendre.
Le commencement de l’attaque ne se fait pas longtemps attendre. Au premier bruit qu’elle a entendu dans la chambre de sa fille, madame Ribolard, que la joie a empêchée de dormir, est entrée chez Virginie, dont elle guettait le réveil.
—Bonjour, ma bichette, t’es-tu bien amusée hier au théâtre? demande la brave femme après avoir d’abord embrassé sa fille comme du bon pain.
—Oui, maman, beaucoup.
—La demoiselle de la pièce fait, à la fin, un joli mariage, n’est-ce pas? Un colonel de cavalerie très-riche, très-riche! Aimerais-tu à faire un pareil mariage?
—A épouser un colonel de cavalerie?
—Un colonel, ou un avoué, ou un grand seigneur, peu importe! pourvu qu’il ait une immense fortune, ajoute la mère, qui veut arriver adroitement à son but.
—Oh! maman, l’héroïne n’épouse pas le colonel à cause de sa fortune, mais parce qu’elle l’aime et qu’il l’a défendue contre le traître. Ah! à propos du traître, dis donc, est-ce que tu ne trouves pas qu’il ressemble beaucoup à un des messieurs que tu as invités à dîner?
—Auquel?
—A celui qui avait des yeux rouges... tu sais? le petit blond énorme.
—Où vois-tu donc qu’il soit énorme? demande madame Ribolard, décontenancée par cette première appréciation donnée par sa fille sur le comte Bonifacio de Aricoti.
—Comment, tu ne le trouves pas gros?
—Mais non, mais non, il possède tout au plus ce que dans le grand monde on appelle un dodu de bon goût.
—Oui, mais, dans le petit monde, on nomme cela un éléphant.
—C’est vrai, car il serait vraiment impossible de prendre pour une trompe le nez de ce monsieur... Te souviens-tu, maman? tu m’as dit toi-même qu’il ressemblait à une queue de lapin.
—Mais, bichette, une queue de lapin ne manque pas d’une certaine élégance.
—Là où elle est placée dans le lapin, c’est possible; mais, au milieu de la figure d’un monsieur, je t’assure qu’elle perd beaucoup de son élégance.
Virginie n’est pas méchante; mais, dans la persuasion que le comte Bonifacio est celui qu’on lui destine, elle est sans pitié pour le gras jeune homme que, de son côté, Borax compare à un saucisson à pattes. En voyant sa mère troublée, la jeune fille, pour lui porter le dernier coup, ajoute en riant:
—Ah! voilà un mari dont je ne voudrais pas! J’aurais trop l’air d’avoir épousé un rouleau à macadam.
La maman n’ose pas insister, et se dit:
—La première impression du comte sur Virginie laisse un peu à désirer; il faut que je remette le soin de la persuader à son père, qui est adroit comme un singe.
A ce moment même, Ribolard, l’adroit comme un singe, entre dans la chambre. Il a aussi cherché un ingénieux moyen de surprendre l’opinion de sa fille, et il arrive tout heureux de l’avoir trouvé.
—Ninie, devine un peu le beau rêve que j’ai fait cette nuit?
—Tu as songé au drame de l’Ambigu.
—Pas du tout, j’ai rêvé que tu te promenais en mer, traînée par des phoques gracieux...
—Alors, je devais avoir bien peur?
—Non, pour te rassurer, tu avais à tes côtés le noble comte de Bonifacio... Tu sais, ce jeune homme d’hier qui a l’âme si sensible, le cœur si tendre.
—Et le nez si court! interrompt Virginie.
—Tu trouves qu’il a le nez un peu court; c’est drôle, je ne l’ai pas remarqué... balbutie le vermicellier, déconcerté par la réplique.
—Quand tu es entré, j’étais justement en train de parler de ce monsieur avec maman. N’est-ce pas, petit père, qu’il est affreux?
—Euh! euh! fait le papa, qui n’ose plus insister.
Virginie se sait trop aimée de ses parents pour être jamais mariée contre son gré. Elle se contente donc, pour le moment, de n’en pas ajouter plus long sur le gros futur qu’il ont en vue, et elle feint de ne pas remarquer leur embarras.
Les deux époux ont échangé un regard triste en reconnaissant que leur projet menace de ne pas se réaliser aussi facilement qu’ils l’espéraient. Néanmoins, le vermicellier retrouve bientôt une figure moins allongée, car il vient de se dire:
—Mademoiselle de Veausalé est fine comme l’ambre; elle saura prendre Virginie et l’éblouir par les splendeurs qui l’attendent à la cour de Monaco.
D’un coup d’œil, le père fait signe à sa femme de le suivre. Ils vont rejoindre Paméla, qu’ils trouvent au salon occupée à essayer un paletot d’hiver à son chien Raoul, car le froid est devenu très-vif pendant la nuit, et le cher animal tousse un peu.
La fière demoiselle voit tout de suite que les Ribolard ont eu hâte d’interroger leur fille, et qu’ils ne s’applaudissent pas du résultat de cette tentative.
—Eh bien? demande-t-elle.
—Virginie n’a pas été positivement séduite par le dodu de bon goût de votre protégé, qu’elle trouve un peu éléphant, annonce Cunégonde.
—Et puis encore?
—Elle dit que son nez est insuffisant.
—Et après?
—Enfin l’effet produit par M. de Aricoti sur l’esprit de notre enfant a été celui d’un rouleau à macadam.
Mademoiselle de Veausalé a écouté impassible ce rapport. Elle quitte un instant Raoul, qu’elle pose sur un fauteuil, et elle marche droit au vermicellier.
—Quelle impression une huître vous a-t-elle faite, la première fois que vous l’avez vue? lui demande-t-elle.
Ribolard la regarde tout ahuri.
—Répondez-moi. Quel effet vous a produit la première huître que vous avez vue?
—Dame! elle ne m’a pas d’abord séduit.
—Et maintenant?
—J’adore l’huître.
—C’est donc parce que l’huître a une saveur, une délicatesse que vous n’aviez pas primitivement appréciées. Eh bien, M. Bonifacio de Aricoti est une huître... une véritable huître.
—Ah! vraiment?
—Virginie a pu ressentir pour le comte cet éloignement que vous a inspiré la première huître; mais, de même que vous adorez maintenant les huîtres, elle raffolera du comte quand elle aura étudié toutes les brillantes qualités de cette nature d’élite.
—Vous en êtes certaine? demande Ribolard, auquel la comparaison du comte avec une huître a rendu l’espoir.
—Le neveu du duc de Croustaflor a tout pour dompter l’imagination d’une jeune fille. Il danse avec une légèreté surprenante; sa conversation est brillante; il découpe une volaille au bout de la fourchette; il chante la romance à vous faire fondre en larmes, et il est poëte jusqu’au bout des ongles. Que Virginie le regarde quand il improvise des vers, et l’auréole du poëte fera disparaître son nez.
—Est-ce qu’il n’en aura plus du tout? demande Cunégonde effrayée.
—Si, je veux dire que votre demoiselle, séduite par l’inspiration poétique qui embellira le visage du comte, ne s’apercevra plus qu’il a le nez un peu court. Donc, placez au plus vite mon protégé en face de votre fille; mettez-le à même de déployer ses moyens irrésistibles, et vous verrez Virginie se traîner à vos pieds pour vous supplier de lui donner un tel mari.
—Vous croyez, mademoiselle Paméla? Alors l’enfant aura bien changé d’avis, car, ce matin, rien n’annonce en elle qu’elle adorera le comte, dit Ribolard avec un léger doute.
—Rappelez-vous votre première huître, répète mademoiselle de Veausalé. Donc, il faut songer sérieusement à mettre les jeunes gens en présence.
—Notre dîner est pour après-demain; j’ai pensé toute la nuit à ce que j’offrirais à ces millionnaires, dit Cunégonde.
—Oh! le duc aime le sans-façon. Ainsi pas de cérémonie... douze plats tout au plus. Ayez surtout une volaille, pour fournir au comte l’occasion de prouver son talent de découpeur... un canard, par exemple... c’est le plus difficile de l’art.
—Bon! jusqu’à mardi, sans avoir l’air de rien, je jetterai dans la conversation, devant Virginie, que rien n’est plus extraordinaire à découper qu’un canard; cela préparera le triomphe du jeune homme, ajoute le vermicellier.
A la suite de cette conférence, la maison Ribolard est, pendant deux jours, tout en l’air. On époussette les meubles et on cire les parquets, on accorde le piano et on nettoie l’argenterie; enfin, on se prépare à recevoir dignement le duc de Croustaflor et son neveu.
De son côté, Borax n’a pas perdu son temps. Pendant les quarante-huit heures qui le séparaient du grand dîner, il a su se mettre au mieux avec tous les domestiques du ménage Ribolard. A l’aide de sa poudre à chandeliers, il a gagné la protection de la cuisinière Madelon, dont il a récuré bien à fond toute la batterie. Aussi s’est-il glissé dans la cuisine, et il a assisté à l’arrivée des victuailles et vu tous les apprêts culinaires.
Par la femme de chambre, il sait que, dans l’intérieur de l’appartement, on s’occupe des derniers préparatifs.
Comme il fait ce jour-là un froid excessif, madame n’a eu, depuis le matin, qu’une seule préoccupation, celle que l’appartement soit bien chaud pour l’heure où ces messieurs se présenteront.
Aussi les foyers de cheminée sont devenus de vrais brasiers et une douce chaleur règne dans le salon et la salle à manger.
Borax quitte la cuisine après avoir recueilli de la cuisinière ce dernier détail qu’on doit se mettre à table à six heures précises.
Il est tout pensif et murmure:
—Je ne peux pas aller encore leur fourrer du poivre devant leur place à table, et il faut pourtant que j’empêche ces gredins-là,—car ce sont deux vrais gredins, maintenant que la mémoire m’est revenue, je les connais,—que je les empêche, dis-je, de manger une seule bouchée de ce délicieux repas dont ils sont indignes.
Après avoir cherché un peu le moyen d’arriver à son but, Borax s’écrie tout à coup:
—J’ai mon affaire!
Il se dirige aussitôt vers la boutique voisine d’un marchand de faïences, où il fait choix d’une demi-douzaine de grands plats. Puis, muni de son achat, il regagne à la hâte la maison et grimpe à l’atelier du peintre.
Dans l’escalier, il rencontre le concierge Calurin, qui balaye les marches.
—Oh! oh! fait le portier, il paraît qu’il y a aussi grand dîner chez M. Ernest, car vous venez de faire vos provisions de vaisselle.
—Mais oui, monsieur Calurin, notre peintre a invité quelques amis. Ah! à propos, il m’a chargé de vous demander un service.
—Trop heureux de lui être agréable.
—Voici la chose: Au moment de l’arrivée de ses convives, M. Ernest désire leur faire une surprise... seulement, elle ne peut être préparée qu’au dernier moment. De là-haut nous entendrons bien le bruit de la porte cochère, fermée à la nuit tombante, qui nous annoncera l’arrivée des convives...
—Et alors, vous apprêterez votre surprise.
—Oui, mais nous avons une crainte.
—Laquelle?
—Comme le propriétaire donne aussi à dîner, il se peut qu’en entendant la porte cochère se refermer, nous nous figurions que c’est notre monde qui arrive, quand au contraire, ce seraient les invités du propriétaire.
—Eh bien?
—Là est le service que nous attendons de votre complaisance. Soit pour les Ribolard, soit pour nous, les arrivants devront s’adresser à la loge. Si donc les invités de M. Ribolard se présentent les premiers, lancez-nous un énorme coup de sifflet, cela voudra nous dire: «Vous avez entendu le bruit de la porte cochère, mais ce n’est pas votre monde, c’est celui du propriétaire; ainsi, ne préparez pas votre surprise.»
—Bon! c’est convenu. Je siffle si les invités de M. Ribolard arrivent les premiers.
—Merci d’avance, monsieur Calurin.
Et Borax continue son ascension en se disant:
—De cette manière, je saurai au juste quand les bandits mettront le pied dans la maison.
Les deux amis s’étonnent de le voir apparaître avec sa vaisselle, mais ils ont beau l’interroger, le saltimbanque répond:
—Laissez-moi faire. Je m’occupe du mariage de Virginie.
Puis il a ouvert une fenêtre de l’atelier qui donne sur les toits de la maison et, tant qu’il fait jour, il examine les cheminées qui jettent dans l’air la fumée des énormes feux qu’on fait chez les Ribolard.
A six heures moins le quart, on entend le bruit sourd de la porte cochère qui se referme et, bientôt, retentit un vigoureux coup de sifflet lancé d’en bas par le concierge, qui tient parole.
—Bon! se dit Borax, voici mes coquins qui arrivent le bec enfariné.
Il prend ses plats, enjambe la fenêtre et, se promenant sur les toits comme un vrai chat, il place une assiette bien à plat sur chaque mitre des cheminées de Ribolard de manière à intercepter le passage de la fumée.
A ce moment même, au premier étage, M. de Croustaflor et son neveu pénétraient dans le salon que Cunégonde avait tant pris soin de chauffer depuis le matin.
Mais à peine les premières salutations ont-elles été faites que la cheminée lance tout à coup d’énormes bouffées d’une fumée tellement épaisse qu’il est complétement impossible de se voir. Les deux étrangers restent immobiles, sans oser bouger, dans ce salon qu’ils ne connaissent pas, de peur de renverser les meubles. Ils toussent et pleurent sans pouvoir répondre à la voix désolée de Ribolard, qui leur crie, au milieu du nuage qui le rend invisible:
—Mille pardons, messeigneurs, le vent aura changé subitement... Je n’y comprends rien. Jamais cette cheminée n’a fumé.
Le vermicellier finit par gagner une fenêtre, qu’il ouvre. La fumée se dissipe un peu, mais la douce chaleur qui régnait dans la pièce est aussitôt remplacée par un froid intense qui vient geler les deux invités sous leur habit de cérémonie.
Cunégonde est désespérée et perd la tête. Ribolard reste effaré devant la cheminée qui continue à lancer sa fumée, quand la fenêtre ouverte devait établir un courant d’air.
Seule, mademoiselle de Veausalé a gardé son sang-froid, et elle donne ce conseil aux époux contrits:
—Au lieu de laisser ces messieurs grelotter dans le salon, faites-les passer tout de suite dans la salle à manger, qui doit être bien chaude.
—Oui, oui, c’est une idée! Par ici, messieurs, donnez-nous la main, laissez-vous guider.
Au milieu de l’épais nuage, on finit par arriver à la porte de la salle à manger, qui est ouverte par Ribolard.
Le malheureux vermicellier recule épouvanté pour n’être pas asphyxié, car la salle à manger est si pleine de fumée qu’on peut à peine distinguer la lueur de la lampe.
A l’autre bout de la pièce, derrière ce nouveau nuage, on entend la voix de Madelon qui, du seuil de sa cuisine, crie avec fureur:
—Ah çà! monsieur, qu’est-ce qui prend à vos cheminées? Il n’y a pas moyen de tenir dans la cuisine... le feu de mon rôti me rend sa fumée... je n’y vois plus clair à retrouver mes casseroles. Je crains fort d’avoir pris du cirage pour du beurre... tout mon dîner est perdu!... sentez-vous?
Effectivement, à la fumée se joint une odeur de brûlé qui prouve que Madelon, aveuglée, ne pouvant plus surveiller ses fourneaux, les sauces et les mets vont de mal en pis.
—Je n’y comprends rien! jamais les cheminées n’avaient fumé, répète Ribolard avec désespoir.
On ouvre portes et fenêtres. L’appartement, que Cunégonde avait voulu rendre si chaud, est devenu une vraie glacière au milieu de laquelle le duc et le comte tremblent de froid.
—Ça va passer. Nous pourrons tout à l’heure nous mettre à table. Si, en attendant, ces messieurs voulaient accepter des édredons pour se réchauffer? dit madame Ribolard, qui pleure en voyant les deux invités souffler dans leurs doigts.
Mais M. de Croustaflor se soucie peu de rester dans un appartement qui jouit de dix degrés de froid pour y manger un mauvais dîner brûlé. Aussi, comme il a hâte de s’esquiver, il prend sa voix la plus aimable:
—Mais ne vous désolez donc pas, mes très-excellents amis. C’est un bien petit malheur qui peut arriver à tout le monde. Ce qui est différé n’est pas perdu... la partie sera remise à demain. Mon neveu et moi nous allons dîner au plus proche restaurant et, dans la soirée, nous reviendrons vous demander une tasse de thé.
Tout en parlant, le duc a poussé Bonifacio vers l’antichambre, et ils partent avant que les Ribolard aient pu les retenir.
La désolation des époux est extrême!
Tout à coup, le vermicellier s’écrie:
—Tiens! voilà qui est bien extraordinaire! nos cheminées ne fument plus.
En effet, depuis que les deux étrangers sont sortis, les cheminées tirent d’une façon merveilleuse, sans rendre la plus petite fumée.
—Si l’on faisait courir après nos invités? propose aussitôt Cunégonde.
—A quoi bon, puisque tout le dîner est brûlé?
—Ces messieurs ont promis de revenir dans la soirée, vous les inviterez pour demain, conseille mademoiselle de Veausalé.
On referme les fenêtres et l’on ravive les feux. Puis, après avoir mangé, du dîner, ce qui a pu échapper au désastre, on va s’installer au salon pour attendre le retour de MM. Croustaflor et Bonifacio.
A sept heures, un coup de sonnette retentit.
—Ce sont eux! s’écrie le ménage.
On s’élance vers la porte qui vient de s’ouvrir, en même temps que la soubrette Clémence annonce:
La mine souriante et sans aucun embarras, le saltimbanque s’avance dans le salon des Ribolard.
—Tiens! fait-il, Hippolyte n’est donc pas là?
—Qui appelez-vous Hippolyte? demande le vermicellier, revenu de la surprise que lui a causée l’entrée de ce personnage inconnu.
—Oui, Hippolyte, un ancien camarade à moi. C’est comme Auguste, l’autre, le petit saucisson à pattes avec un nez retroussé... c’est pour ainsi dire mon élève. Dans le temps, on ne voyait que nous dans les cours...
—Dans les cours! s’écrie Cunégonde.
Mais son époux l’interrompt en lui murmurant vite:
—Chut! tais toi. Oui, dans les cours. Ce monsieur est probablement un diplomate, grand ami de nos illustres invités... Il veut parler des cours étrangères... C’est à coup sûr un ancien ambassadeur.
Pendant que Ribolard donne cette explication à sa femme, le charlatan a promené ses regards dans le salon et vient d’apercevoir enfin mademoiselle de Veausalé qui, depuis l’entrée du bateleur, se tient droite et immobile dans le coin le plus obscur. Aussitôt la figure de Borax devient joyeuse. Il court brusquement à elle, lui saisit la tête et lui applique un baiser retentissant sur la joue en s’écriant:
—Comment! c’est toi, Paméla? Te voilà donc ici? Est-ce que tu as renoncé à avaler des sabres? Comment va ton fils, ma bonne vieille?
Puis il revient aux époux en disant:
—Je savais bien que ce farceur d’Hippolyte devait être ici... puisque voilà sa femme.
Les yeux écarquillés par la surprise, les Ribolard ont assisté à cette singulière scène qui leur semble un peu trop compromettre la dignité de la pimbêche demoiselle de Veausalé.
Mais celle-ci se redresse, noblement courroucée, en s’écriant:
—Je ne connais pas cet homme!
—Comment! tu ne me reconnais pas, Paméla? Tu ne remets pas ton vieux Borax, l’ami de ton Hippolyte chéri! Moi qui faisais le boniment au public devant notre baraque quand tu avalais des sabres dans les fêtes de banlieue. Tu ne me reconnais pas! moi qui ai, pour, ainsi dire, créé une position à ton fils en lui retroussant le nez,... ce qui lui a donné une physionomie de Jocrisse qui vaut de l’or pour faire la parade... Tu ne me reconnais pas!... Ah! ma vieille Paméla, tu es bien ingrate!
Furibonde et rouge d’indignation, mademoiselle de Veausalé répète encore:
Mais les éclats de sa voix furieuse ont réveillé son roquet Raoul, qui dormait sur un coussin du canapé. L’animal a commencé un grognement de colère, qui se change tout à coup en un jappement joyeux quand il a senti le saltimbanque. Il s’élance vers lui et se livre à des bonds aimables et à des caresses.
Borax le montre à mademoiselle de Veausalé, en lui disant d’une voix mélancolique:
—Tu le vois, Paméla... Ton chien n’est pas comme toi, il a la mémoire du cœur, lui! Il reconnaît son vieil ami... son ancien professeur, car, s’il possède quelques talents de société, c’est à moi qu’il en est redevable... Je suis certain qu’il n’a pas dû oublier mes leçons... Venez; ici, Raoul, faites le mort, mon garçon.
Au commandement du bonhomme, le chien se couche aussitôt au milieu du salon et reste immobile.
—Très-bien, Raoul. Voyons maintenant si vous vous souvenez du reste... Attention!
Et Borax continue, en s’adressant à l’animal étendu:
—Raoul, il faudrait vous lever pour venir travailler.
Le chien ne fait aucun mouvement.
—Vous ne voulez donc pas vous réveiller pour prendre votre leçon d’anglais.
La bête ne remue pas davantage.
—Raoul, j’aperçois le commissaire.
A ces mots, le roquet se lève d’un bond et se met à aboyer en furieux.
—Bien! très-bien! Raoul. Je suis content de toi. Je constate que tu n’as pas oublié ton éducation première. Je vois avec plaisir que tu n’es pas comme ta maîtresse, qui renie son ancienne et noble profession de saltimbanque.
On comprend facilement avec quelle stupéfaction profonde les époux Ribolard ont assisté aux évolutions du chien leur révélant ainsi ses talents de société.
—Il y a erreur, bien sûr, il y a erreur, balbutie enfin Cunégonde. Il n’est pas possible qu’une femme qui a fréquenté les cours ait pu avaler des sabres. Car vous ne pouvez nier, monsieur, que mademoiselle de Veausalé ait fréquenté les cours?
—Mais, je ne le nie pas, ma brave dame, nous avons fréquenté toutes les cours où le concierge voulait bien nous permettre d’entrer pour faire nos exercices.
—Ah çà! vous nous parlez donc des cours des maisons? demande le vermicellier qui a retrouvé la parole, que la surprise lui avait coupée.
—Naturellement. Nous avions réuni nos talents à cinq: Paméla, son homme, son fils, moi et le chien. Ces messieurs chantaient; je les accompagnais sur le cornet à piston. Le concert était coupé par un intermède comique du chien, et la représentation se terminait par le grand tour du sabre avalé par la beauté ici présente.
Depuis que mademoiselle de Veausalé a été trahie par son chien, elle a beaucoup perdu de son assurance et de sa morgue aristocratique. Néanmoins, elle croit devoir protester contre les assertions de Borax. Elle se redresse donc avec une majestueuse arrogance en disant:
—Je ne crois pas de ma dignité de relever les contes inventés par cet homme ivre, et je me plais à penser que vous voudrez bien m’accorder la satisfaction de le faire chasser. Je ne rentrerai dans ce salon qu’après l’expulsion de ce personnage effronté. C’est une mesure que je réclame, non pas pour moi, qui suis au-dessus de pareilles attaques, mais dans votre propre intérêt, car je ne saurais vous dissimuler la pénible impression que produira sur le noble duc de Croustaflor, qui va venir, la vue d’un ivrogne s’ébaudissant en plein salon.
Et mademoiselle de Veausalé, après cette allocution hautaine, se retire dans la salle à manger, pour y attendre que les Ribolard aient fait jeter dehors le mauvais drôle qui a osé ternir sa réputation.
Les époux sont restés muets et interdits. Ils ne peuvent se décider à croire que celle qu’ils ont prise pour la fine fleur de la cour de Monaco n’ait été qu’une vulgaire avaleuse de sabres.
—Voyons, cher monsieur, demande le vermicellier, êtes-vous bien sûr de ne pas vous tromper? Il est arrivé très-souvent qu’on ait pris une personne pour une autre. Je vous citerai l’exemple de Lesurques.
—C’est possible, dit le bateleur, mais vous avez vu le chien travailler.
—Le fait est que le chien nous a montré des talents que nous ignorions complétement.
Borax est devenu sérieux. Il prend sa voix la plus persuasive:
—Mes chers amis, je vois en vous de braves et honnêtes gens, mais un peu trop crédules. Vous êtes en ce moment bernés par une intrigante qui s’entend avec son mari pour marier leur fils à votre Virginie.
—Quoi! le noble duc de Croustaflor ne serait qu’un acrobate... ce n’est pas possible! s’écrie Ribolard qui résiste.
—Non, ce n’est pas possible! il a des manières trop distinguées, ajoute Cunégonde.
En reconnaissant qu’il ne peut vaincre la confiance stupide des époux, le bonhomme se dit qu’il vaut mieux en tirer parti dans leur propre intérêt, et, aussitôt, il feint d’être indécis.
—Au fait, dit-il, quand je pense à Lesurques, j’ai peur de m’être laissé égarer par une ressemblance... il se peut que je me trompe.
—Oui, oui, vous devez vous tromper... Nous ne pouvons pas admettre que M. de Croustaflor et mademoiselle de Veausalé soient deux saltimbanques mariés.
—Il y aurait pourtant un vrai moyen de s’assurer si votre prétendu duc est Hippolyte, le mari de Paméla.
—Dites-le! s’écrient les Ribolard avec empressement.
—Hippolyte avait, dans le temps, une incommodité singulière, pour la quelle il avait consulté les plus grands médecins.
—Laquelle?
—Dès qu’il entrait dans une maison, les cheminées se mettaient à fumer, répond Borax avec aplomb.
Le ménage pousse un cri de surprise en se rappelant l’événement qui a fait manquer le dîner.
—Cela nous est déjà arrivé, avoue Ribolard.
—Ah! vraiment! fait Borax, mais il ne faut pas juger à la légère... Quelquefois un hasard, un accident, une saute de vent peut occasionner un dérangement dans les cheminées. Vous devez donc être mieux convaincus pour juger plus sainement. Deux épreuves valent mieux qu’une. Paméla vient de dire que le Croustaflor doit arriver tout à l’heure. Si le prétendu duc n’est réellement que mon ami Hippolyte, vos cheminées vous le diront.
Et il s’éloigne en ajoutant:
—Je pars pour laisser l’entrée libre au Croustaflor. Pas un mot de ce secret à Paméla. Je reviendrai plus tard savoir ce que la cheminée vous aura répondu.
Arrivé sur le carré, Borax part d’un éclat de rire en se disant:
—Leur bêtise est trop profonde. Autant que j’en profite pour le bien de Paul et de Virginie... Je vais regrimper sur les toits et jouer des assiettes aussitôt que le Croustaflor reparaîtra.
Après sa sortie, les deux époux sont restés tout émus des révélations qu’il leur a faites. Ils hésitent encore à croire, mais leur confiance en mademoiselle de Veausalé est fortement ébranlée. Aussi, quand Paméla, qui a entendu partir Borax, rentre dans le salon avec ses grands airs de la cour de Monaco, les Ribolard examinent anxieusement celle qu’ils prenaient pour un dessus de panier d’aristocratie et qui, peut-être, n’est qu’une avaleuse de sabres.
—C’est drôle, se dit Ribolard, je n’avais pas encore remarqué comme elle a une bouche fendue. Elle se la sera coupée sans doute en avalant une lame de travers.
Néanmoins, les époux dissimulent avec l’institutrice. Ils attendent, pour se convaincre, l’arrivée des hauts visiteurs sur lesquels la cheminée leur apprendra la vérité. Si l’illustre Croustaflor est un vrai duc, la cheminée doit tirer comme d’habitude. Si le faux seigneur n’est que le saltimbanque Hippolyte, il sera trahi par sa singulière maladie de faire fumer la cheminée partout où il entre.
—Quelle étonnante infirmité! pense Cunégonde. Et dire qu’il n’y a pas de médecins pour vous guérir.
De son côté, Paméla est mal à l’aise. Elle voit que les époux sont pensifs, et elle se demande ce que Borax a pu leur dire pendant sa courte absence. Tout en réfléchissant, elle dispose le thé sur un guéridon, devant la cheminée.
Enfin la sonnette de l’antichambre annonce le retour du duc et de son neveu.
M. de Croustaflor entre d’un air aimable en demandant:
—Eh bien, très-chers amis, êtes-vous enfin délivrés de cette fumée incommode qui nous avait privés de dîner?
Mais au lieu de faire les empressés et de répondre, les époux restent immobiles comme des chiens de faïence à épier la cheminée, qui flambe toujours.
—Oui, c’est bien un duc. Elle ne fume pas! se dit le vermicellier.
—Elle tire! donc ce n’est pas Hippolyte, pense de son côté Cunégonde.
Et, rassurés maintenant, les époux présentent un visage souriant au duc de Croustaflor. Mais celui-ci regardait aussi la cheminée pour y découvrir ce que les Ribolard y examinaient si attentivement, et, au moment où ceux-ci tournent la tête de son côté, il s’écrie tout à coup:
—Allons, bon! voici la cheminée qui recommence ses plaisanteries.
Effectivement le foyer, naguère si calme, lance d’énormes bouffées d’une fumée épaisse qui envahit le salon. Comme avant le dîner, la pièce se remplit d’un nuage qui ne permet plus de se voir.
—La cheminée a parlé, le Croustaflor n’est qu’un saltimbanque! se dit Ribolard convaincu.
Tout bête qu’il est, le vermicellier trouve pourtant un moyen de mieux s’assurer du fait. Au milieu de la fumée qui le rend invisible, il se dirige vers le duc, qu’il entend tousser, et lui souffle tout bas:
—Quoi? répond imprudemment le duc, en croyant que c’est le comte de Bonifacio qui lui parle.
Satisfait de son épreuve, Ribolard va s’éloigner, quand une main lui saisit le bras et une voix murmure vivement à son oreille:
—Jouons des guiboles, mon homme. On nous a devinés. Cet infect crétin de Ribolard sait tout; il n’y a plus moyen de lui chiper son sac.
Le père de Virginie reconnaît aussitôt l’organe de mademoiselle de Veausalé qui, dans ce langage rappelant peu la cour de Monaco, croit s’adresser à son époux Hippolyte, que la fumée lui cache.
—Ah! quelle jolie chandelle je dois à ce bon M. Borax! se dit le vermicellier, enfin persuadé et tout tremblant du danger que sa fille et sa fortune ont couru.
Depuis que la cheminée a lancé son premier flocon de fumée, Cunégonde est restée clouée par l’émotion dans son coin.
Et quelques minutes se passent avant que les époux pensent à ouvrir les fenêtres.
Enfin Ribolard songe à donner de l’air, et la fumée se dissipe. Mais, comme il s’apprête à chasser les trois misérables qui le trompaient, il pousse un cri d’étonnement.
Ainsi que dans les pièces-féeries, quand une toile, qui disparaît, laisse voir un changement de tableau, le nuage, en s’éclaircissant, lui montre Borax et l’amoureux Paul qui ont remplacé Paméla, Hippolyte et leur fils.
Après avoir retiré ses assiettes des mitres des cheminées, le charlatan et son protégé se sont fait introduire sans bruit chez les Ribolard par leur amie Madelon la cuisinière. Au milieu de la fumée, Borax a soufflé à l’oreille de Paméla un mot qui l’a fait fuir avec ses deux complices.
A la vue de Borax, le vermicellier, plein de reconnaissance, éclate de joie en s’écriant:
—Ah! vous avez sauvé notre fille et notre fortune des mains de ces sacripants... Parlez... Comment pouvons-nous vous remercier?
Borax se redresse majestueux et répond:
—Jadis, j’ai vu se rouler à mes pieds le roi de l’Inde, qui voulait me faire accepter un cadeau parce que j’avais sauvé sa fille qui se noyait dans le Gange. Eh bien, cher monsieur, savez-vous ce que j’ai réclamé pour ma récompense?
—Non, fait le papa, plein de respect pour cet homme qui a sauvé la fille du roi de l’Inde.
—Est-ce qu’il va aussi demander à M. Ribolard de lui céder sa recette de poudre à chandeliers? se dit l’amoureux Paul inquiet.
Mais le bateleur introduit une variante dans son récit, et il ajoute:
—Oui, pour ce service, j’ai imposé au roi d’unir deux jeunes gens qui s’aimaient, et d’accorder trois mois de gratification à tous ses domestiques. Et il y consentit.
—Quoi! si peu! s’écrie le reconnaissant Ribolard; mais moi, sans être monarque, j’en ferais autant.
—Eh bien, monsieur Ribolard, je vous prends au mot, ajoute Borax en lui présentant Paul; unissez ce jeune garçon à celle qu’il aime et dont il est aimé.
—Mais à qui voulez-vous que je l’unisse?
—A votre Virginie.
Les deux époux, surpris, regardent leur fille, qui devient rouge comme une pivoine et qui fait savoir, par un joli petit signe de tête, qu’elle consent à ce qu’on demande.
Sans donner aux parents le temps de se reconnaître, l’ami du roi de l’Inde continue:
—Je vous le répète, mes amis, vous êtes de simples et de braves gens, dont les goûts modestes n’ont même pas besoin de la grande fortune que vous possédez. Employez-la donc à faire votre fille heureuse, car le bonheur vaut mieux que les millions. A vouloir chercher au-dessus de votre condition, ou bien vous trouverez des gens qui prendront vos écus pour vous mépriser ensuite, ou bien vous risquerez de tomber entre les mains de drôles adroits, comme l’étaient ceux qui furent mes camarades de misère jusqu’au jour où j’appris que je m’étais mêlé à des voleurs.
—Mais comment donc les avez-vous fait partir? demanda Cunégonde.
—En leur rappelant que la police pourrait bien venir les chercher ici pour certain vol qu’ils se sont permis jadis, en s’introduisant par les fenêtres ouvertes dans le rez-de-chaussée d’une cour où le portier les avait laissés entrer pour chanter.
—Ah! les gueux! il faudra compter notre argenterie. Paméla, qui avalait des sabres, pourrait fort bien avoir eu l’idée d’avaler aussi la louche et les couverts.
Les Ribolard adorent leur fille, et le danger qu’ils ont couru les a guéris de chercher un gendre au-dessus d’eux. Ils consentent donc à unir Virginie à celui qu’elle aime.
Aussitôt qu’il a donné son consentement le vermicellier attire son sauveur dans un coin et lui souffle:
—Si vous revoyez jamais le roi de l’Inde, dites-lui bien que j’ai imité son exemple en tout.
—Je m’empresserai de lui écrire aussitôt que, comme lui, vous aurez aussi donné les trois mois de gratification aux domestiques.
—Dès ce soir ce sera fait.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un mois après, Paul épousait Virginie.
Reconnaissants envers celui qui les avait mariés, les jeunes gens avaient offert à Borax un habit neuf, dans la poche duquel il trouva un contrat de douze cents francs de rente.
Malgré ce bien-être qui l’exemptait maintenant de courir sur les places, le pauvre saltimbanque devint triste et inquiet. Quelque chose semblait lui manquer.
Un matin, les nouveaux mariés, de leur appartement situé sur la place de l’Odéon, entendirent une voix qui disait sous les fenêtres:
«—J’ai beaucoup voyagé. Un jour que je me promenais sur les bords du Gange, je vis venir à moi, sans autre vêtement qu’un tambourin, à cause de la chaleur torride, une belle jeune fille qui essayait un pas de valse... Soudain le pied lui glisse et elle disparaît dans l’humide empire... etc.»
Les jeunes époux coururent à la fenêtre et virent Borax qui, debout devant son chapeau posé à terre, récitait son boniment au milieu d’un groupe.
Il n’avait pu renoncer totalement à sa vie de saltimbanque, et, après avoir voulu longtemps résister, il avait repris son vieil habit et sa poudre à chandeliers.
FIN
Certain dimanche du mois de mars 1816, au premier étage d’une belle maison de la rue Richelieu, dans un cabinet de travail, orné de nombreux cartons à étiquettes, d’où s’exhalait une odeur de vieux papiers, un monsieur, d’une cinquantaine d’années, se tenait immobile, raide comme un pieu, et élevant au-dessus de sa tête ses deux bras en manches de chemise.
Cette position, qui, même pour le plus fin observateur, n’aurait pu indiquer que ce monsieur était un notaire, n’avait d’autre but que de laisser libre en ses évolutions un petit homme, rond comme une boule, qui, suant et soufflant, était en train, à l’aide d’une aune en cuir souple, de prendre mesure d’une culotte neuve à Me Louis-Athanase de la Morpisel, notaire royal.
—Rien à changer à nos dernières mesures, vous n’avez pas engraissé ni diminué depuis six mois, déclara le tailleur enfermant le carnet sur lequel il avait crayonné ses chiffres.
Un notaire en manches de chemise consent quelquefois à descendre de sa dignité. Aussi le nôtre, en baissant les bras, répliqua-t-il avec une pointe d’ironie dans le sourire et l’accent:
—Je ne puis en dire autant de vous, mon cher Bokel; vous engraissez, pour ainsi dire, à vue d’œil... La, vrai! vous devenez d’un dodu auquel il faut prendre garde.
Le tailleur ne tenait sans doute pas à ce qu’il lui fût ainsi parlé de son embonpoint, car il riposta avec une certaine aigreur:
—Dites tout de suite, monsieur de la Morpisel, que je vais bientôt porter mon ventre dans une brouette.
—Non, non, vous n’en êtes pas encore là. Je vous engage seulement à vous méfier de cette graisse qui vous envahit... Tenez, je puis vous citer un exemple qui vous servira de leçon. J’ai un ami qui...
Le notaire interrompit sa phrase commencée pour dire à Bokel, qui lui tendait son habit à endosser:
—Ma robe de chambre, s’il vous plaît. Je ne remets pas cet habit, que vous allez emporter, car il a besoin d’une réparation de doublure.
Le tailleur prit la robe de chambre, placée sur un fauteuil, et, tout en aidant M. de la Morpisel à en passer les manches, il le ramena curieusement à ses moutons par cette phrase:
—Vous me disiez donc que vous avez un ami intime qui...?
—Je me suis trompé en disant: j’ai... il est, hélas! plus juste de dire: «j’avais un ami», car j’ai reçu hier la nouvelle de sa mort... mort causée par une obésité phénoménale.
—Est-ce qu’il portait son ventre dans une brouette, lui?
—Non, il le faisait porter par ses nègres.
—Pas possible! fit le tailleur.
—Comme je vous l’affirme. Mon pauvre ami était si gros, si gros que...
Il était écrit que Bokel n’entendrait pas la fin de l’histoire, car le récit fut coupé par l’apparition d’un domestique du notaire, qui tendit une carte à son maître en disant:
—La personne vient pour affaire pressée.
—Mais c’est aujourd’hui dimanche, l’étude est fermée, répondit le tabellion, en prenant la carte.
—J’en ai fait l’observation à ce monsieur. Il m’a répondu qu’il lui serait impossible de revenir demain, vu qu’il quitte Paris ce soir et que...
—Oui, oui, il a raison! Fais-le entrer tout de suite! s’écria M. de la Morpisel, qui venait de jeter les yeux sur la carte.
Puis se retournant vers le tailleur, il ajouta en guise de congé:
—A bientôt, mon cher Bokel; avant tous vêtements neufs, occupez-vous des réparations de mon habit et renvoyez-le-moi promptement.
—Vous l’aurez après-demain.
Malgré cette sorte d’injonction d’avoir à céder la place au client attendu dans le cabinet notarial, le tailleur n’en prit pas moins son temps pour plier l’habit. Il ne l’avait pas encore enveloppé dans sa toilette en serge noire quand, sur le seuil, apparut le visiteur.
—Ah! monsieur le vicomte, que je suis donc heureux de vous voir!... J’allais vous écrire, s’écria le notaire en s’avançant à la rencontre de t’arrivant.
—M’écrire... pourquoi?
—Mais pour vous féliciter de votre nomination.
—Ah! vous savez que le roi....
—Vous a rendu votre grade.
—Oui, Sa Majesté a bien voulu me confier le commandement d’un de ses vaisseaux.
—Quand partez-vous?
—Ce soir même. Je dois rejoindre immédiatement mon bord et y attendre mes instructions et l’ordre de mettre à la voile.
—Où vous envoie-t-on?
—Destination inconnue, dit le vicomte en souriant.
—Inconnue pour les autres, n’est-ce pas? Votre sourire me prouve que le mystère n’existe point pour vous.
—Entre nous, je sais qu’on veut m’envoyer à Saint-Louis du Sénégal...
—A Saint-Louis du Sénégal! répéta vivement M. de la Morpisel avec une intonation qui frappa son interlocuteur.
—Avez-vous là-bas un ami ou un intérêt quelconque qui me mette à même de vous être utile? s’empressa de dire-le vicomte.
—Non, malheureusement! Le seul être, un de mes amis d’enfance, que je connaissais en ce pays, n’est plus de ce monde, répondit tristement le notaire.
Puis son émotion passée:
—Et qu’allez-vous faire au Sénégal? ajouta-t-il.
—Il s’agit de ravitailler en hommes, vivres et matériel cette colonie redevenue française par les traités de l’an dernier. L’expédition se compose de quatre bâtiments qui marcheront de conserve sous mes ordres.
Ces détails donnés, le capitaine de vaisseau aborda le motif de sa visite:
—L’ordre du ministre de la marine m’enjoignant de quitter Paris aujourd’hui même, force m’a été de vous relancer en plein repos dominical pour vous parler de quelques affaires que je veux mettre en ordre.
—Tout à votre disposition, cher monsieur.
Cependant le tailleur Bokel, tout en nouant son paquet, avait prêté l’oreille au dialogue. C’était chez lui une conviction acquise que, dix-huit fois sur vingt, il y a profit à écouter les autres parlant de leurs affaires. Mais, s’il était curieux, il était prudent aussi. Comprenant que la conversation était arrivée à ce point qu’il ne pouvait plus tenir la place et, qu’à rester, il allait se faire trop carrément congédier, il se glissa doucement lors du cabinet.
Comme il suivait le couloir de dégagement qui conduisait à la sortie, il entendit une voix, quelque peu empâtée, qui disait dans l’antichambre:
—M’est avis que mon capitaine en aura long à conter à ton patron. Nous avons donc tout le temps d’aller sécher une bouteille pour fêter mon départ.
—Non, non, Filandru, il faut en rester là, mon vieux, car tu as déjà trop séché de bouteilles, répondait une autre voix, qui était celle du domestique du notaire.
Celui auquel s’adressait ce conseil était un grand diable, sec comme un hareng saur, noir comme une taupe, à l’œil hardi et railleur, bref, un de ces êtres dont l’allure et le physique trahissent, à première vue, ce qu’on appelle vulgairement une pratique finie. Porteur du costume de marin de l’Etat, notre personnage, que nous savons s’appeler du nom de Filandru, était, en ce moment, dans un demi-état d’ébriété dont il n’avait pas conscience, car il répliqua moqueusement:
—Tu sais, toi, je te rendrai dix bouteilles si tu veux joûter à qui mettra l’autre sous la table... Ah! tu me crois en ribote pour une fichaise de cinq mauvaise fioles, si petites qu’elles n’auraient pas seulement rempli mon soulier!... Ah! non, ah! non, il en faut une autre dose que ça pour que Filandru ne puisse plus distinguer un éléphant d’un ver-à-soie et que...
La parole lui fut coupée par l’apparition de Bokel sortant du couloir pour traverser l’antichambre.
Que Filandru fût encore en état de distinguer un éléphant d’un ver à soie, c’était possible; mais cette faculté de reconnaître les divers êtres de la création était, pour le moment, un peu obscurcie, car, à la vue du grassouillet arrivant, il cligna de l’œil au domestique, et d’une voix trivialement ironique:
—Ouais! lâcha-t-il, on fait du lard dans l’état de notaire.
—C’est le tailleur de monsieur, lui souffla le valet.
—Ah! bon, je le prenais pour ton maître... N’empêche qu’il est gras à tuer. S’il tombait dans la marmite du bord, l’équipage se régalerait d’un agréable bouillon.
Le propre des gens ivres est de croire qu’ils n’ont fait que murmurer bien bas ce qui a pu être entendu de vingt mètres à la ronde. Aucune des paroles du marin n’avait donc été perdue pour le tailleur. Si pénible qu’il nous soit de jeter la défaveur sur notre héros, nous devons à la vérité d’avouer que Bokel avait l’humeur rageuse toutes les fois qu’on ne trouvait pas qu’il était de taille plus élancée qu’un peuplier.
Donc, aux plaisanteries de Filandru, il se redressa comme un coq sur ses ergots et, rouge de colère, il passa devant le marin en lançant un «vil maraud!» tout vibrant de mépris.
Le mot était à peine dit que la velue et vigoureuse main du vil maraud harponnait le pauvre Bokel, en même temps que sa voix, saccadée par un gros rire, prononçait ces mots:
—De quoi? mon petit ventru, on rit avec toi et tu te fâches!... Est-il appétissant, ce boulot-là! on en mangerait... il doit être en sucre... Ça donne envie de le lécher un brin.
Ce disant, Filandru, écartant ses mâchoires aux dents longues, aiguës, plus jaunes que du buis, exhiba une langue noirâtre dont le parfum combiné des aromes du tabac à chiquer et de l’eau-de-vie fit faire au tailleur, en la voyant à deux pouces de son visage, un tel soubresaut de dégoût qu’il se trouva dégagé de l’étreinte du farceur aviné.
Sans écouter les excuses du domestique du notaire, il gagna la porte et disparut, poursuivi par les éclats de rire du marin, tout joyeux de sa plaisanterie.
Nous croyons parfaitement inutile d’insister sur tout ce qu’amassa de colère rentrée le tailleur pendant la route qui le ramenait au logis. Son coup de sonnette fut terrible; il tança la servante qui ne lui avait pas ouvert la porte assez vite, apostropha ses ouvriers; en un mot, tel fut son vacarme qu’il fit accourir dans l’atelier, où elle ne mettait jamais les pieds, mademoiselle Paméla Bokel, sa fille.
Car Bokel était père... et veuf.
C’était une charmante fille, cette demoiselle Paméla! Un vrai morceau pour un roi qui aurait aimé le potelé! Taille moyenne; chevelure brune, teint rosé et, avec cela, de grands yeux noirs qui pétillaient de la plus impatiente curiosité quand elle demandait chaque jour à son père:
—M’as-tu trouvé un mari?
A quoi le papa, en s’armant de toute la majesté que lui permettait son embonpoint, répondait:
—N’es-tu donc pas bien sous l’aile de ton père?
—J’ai dix-huit ans, répliquait Paméla.
—Sois tranquille, tu ne perdras pas pour attendre un peu.
Au fond, Bokel eût été heureux de marier sa fille. La demoiselle avait un petit caractère difficile qu’elle tenait de sa défunte mère, laquelle, disait la chronique, avait été une maîtresse femme, qui menait son époux au doigt et à l’œil.
Mais si le tailleur appelait de tous ses vœux l’heure où il se débarrasserait de sa fille en faveur d’un gendre, il voulait aussi que ce gendre fût énormément riche. L’affection paternelle, avouons-le, n’entrait pour rien dans ce souhait, inspiré par l’unique égoïsme. A tailler des culottes, à couper des gilets, à coudre des habits, le cher papa s’était amassé une fortune assez rondelette, dont il ne soufflait mot à son enfant, attendu qu’il s’était promis, Paméla une fois mariée, d’appliquer cette fortune à la satisfaction de sa félicité paternelle. Le printemps et l’été de sa vie, grâce à l’humeur tyranique de sa défunte épouse, avaient été un affreux purgatoire; il voulait tâter du paradis, en se donnant un automne tout capitonné de plaisirs et de jouissances variées.
Or, un gendre énormément riche, comme il désirait de le trouver, serait fort coulant sur le chiffre de la dot, qui, si minime qu’elle pût être, devait écorner le capital auquel le tailleur comptait demander de lui égayer son été de la Saint-Martin.
Certes, Paméla était trop charmante pour que, des deux désirs du papa, celui d’être délivré de sa fille ne fût pas d’une réalisation facile. Mademoiselle Bokel n’aurait pas manqué d’amoureux... sans le sou qui se seraient estimés fort heureux de l’épouser pour ses beaux yeux. Mais, plus tard, tant il est vrai qu’on ne vit pas d’amour et d’eau claire, les jeunes époux seraient venus pleurer misère en plein milieu de ce bonheur plantureux que se promettait le tailleur. «Croissez et multipliez!» commande l’Évangile aux nouveaux mariés. A ce précepte, Bokel, en guise de corollaire, n’eût pas manqué d’ajouter l’avis suivant: «Mais ne comptez pas sur moi pour élever vos mioches.»
Donc, on le voit, il était logique en demandant au ciel un gendre fort riche.
Cela bien posé, nous reprendrons notre récit au moment où Bokel était rentré chez lui comme une trombe, cherchant à épancher sur le tiers et le quart cette colère causée par l’effronté marin Filandru, qui avait osé lui dire que, mis en pot-au-feu, il ferait un excellent bouillon.
Il est à remarquer que, très-souvent, une plaie, qui se serait facilement cicatrisée, se trouve ravivée par les accidents qu’amène le guignon. «On se cogne toujours où on a mal,» dit un dicton qui, ce jour-là, fut de toute vérité pour notre héros.
Après avoir déchargé, en partie, sa fureur sur sa servante et ses ouvriers, Bokel, à demi soulagé, se serait refroidi, peu à peu. Par malheur, son premier coupeur, bien inconsciencieusement, ralluma le feu. Croyant faire du zèle en rendant compte de ce qui s’était passé pendant l’absence du patron, il profita de ce calme trompeur pour lancer cette phrase:
—M. le duc de B... est venu pour commander un gilet. En apprenant que vous aviez fermé son crédit, il est parti bleu de rage contre vous... On aurait dit qu’il voulait vous manger.
Ce dernier mot était vraiment malheureux! il fit tressauter l’homme obèse.
—Me manger!... En pot-au-feu, n’est-ce pas? lui aussi! cria-t-il d’une voix aiguë qui annonçait une nouvelle tempête.
Le nuage n’avait pas encore crevé sur la tête du coupeur quand mademoiselle Paméla, que l’organe furibond de son père avait fait accourir, entra dans l’atelier en demandant d’un ton étonné:
—Qu’as-tu donc, papa?... toi, d’ordinaire, gentil à croquer!
Croquer!!! A cet autre coup d’épingle sur la plaie vive, le tailleur fut secoué par un tremblement qui donnait à son abdomen des frémissements de gélatine, et, plus rouge qu’une tomate, il bégaya furieusement:
—Me manger! Me croquer! Me mettre dans une marmite!... Ma fille aimerait son père en bouillon gras! Oh! les enfants!
Sur ce, n’en pouvant dire plus long, car il étranglait, il gagna son bureau en poussant de petits cris rauques et en brandissant, comme une massue, le paquet qui contenait l’habit de M. de la Morpisel, notaire royal.
Nous n’insisterons pas sur l’ahurissement des témoins de cette sortie rageuse.
—C’est un tigre! murmura le coupeur aux ouvriers, quand le patron eut disparu derrière la porte, qu’il avait refermée avec une violence extrême.
Comme, à ce moment, onze heures sonnaient, ouvriers et coupeur, qui, à cause du dimanche, n’avaient qu’une demi-journée de travail, décampèrent au plus vite.
Quant à mademoiselle Paméla, elle avait couru à la cuisine et elle s’était mise à fondre en larmes dans les bras de Gertrude, brave servante qui l’avait élevée.
—Pour sûr, il a été mordu par un chien enragé! disait la cuisinière.
—Il ne m’a jamais parlé de la sorte! balbutiait la jeune fille en sanglotant.
—C’est moi qui ai reçu la première averse quand je lui ai ouvert la porte, ajoutait Gertrude.
Les deux femmes étaient d’autant plus épouvantées qu’elles ne comprenaient rien à cette démence furieuse qui n’avait beuglé d’autre explication que les mots pot-au-feu et bouillon gras. Aussi pleuraient-elles si bien à chaudes larmes que leurs yeux noyés d’eau les empêchaient de voir que les rognons du déjeuner se crispaient sur le gril en petits résidus noirs et qu’un certain ragoût de veau, au lieu de chanter joyeusement au fond de son récipient, gardait ce silence sournois qui, chez les ragoûts, est l’indice qu’ils vous jouent le mauvais tour de s’attacher au fond de la casserole.
A défaut de leurs yeux obscurcis par les pleurs, ce fut le nez qui les prévint de cette catastrophe culinaire annoncée par une odeur de mauvais augure.
—Bonté du ciel! Un pareil déjeuner va doubler l’humeur de dogue de votre papa! s’exclama le cordon-bleu qui, perdant la tête, crut conjurer le désastre en ajoutant du sel.
Demoiselle et cuisinière se reprirent à trembler de plus belle devant l’orage nouveau qui montait à leur horizon. Ce tremblement ne tarda pas à devenir des plus convulsifs au double bruit d’une porte ouverte, puis refermée, qui leur vint aux oreilles du fond de l’appartement.
—Voici la bête féroce qui sort de son antre, murmura la servante en saupoudrant son veau d’une seconde dose de sel.
Paméla, brisée par la terreur, se laissa tomber sur une chaise, en fermant les yeux pour ne pas voir arriver le danger.
Tout à coup les deux femmes relevèrent brusquement la tête et se regardèrent, stupéfaites de joie.
La voix de Bokel venait de se faire entendre, non pas rauque et irritée, mais fredonnant le petit air tout sautillant qui était habituel au tailleur quand il se sentait en belle humeur. Son pas, qui s’approchait de la cuisine, était léger, doux, bien réglé, celui d’un homme en parfaite tranquillité d’âme. Bientôt le propriétaire du pas et de la voix apparut sur le seuil de la cuisine, le visage joyeux, l’œil aimable et le sourire aux lèvres.
Il y eut même, dans son timbre, une sorte de mélancolie tendre, quelque chose de la harpe éolienne, quand il prononça ces prosaïques paroles:
—Eh bien! ma brave Gertrude, nous as-tu fait un bon petit fricot?
Tout en parlant, il s’était avancé vers les fourneaux pour se régaler d’avance l’odorat et le regard dudit fricot. Il y eut, de la part des deux femmes, un moment de silence terrible pendant qu’il soulevait le couvercle de la casserole. Elles ne le voyaient que de dos et il leur sembla, le long de ce dos, qu’un frémissement remontait vers les épaules. A coup sûr, ce ne pouvait être qu’une fureur subite qui, secouant le tube humain qu’elle ne pouvait briser, allait faire explosion par la bouche.
Point du tout! Au lieu d’une tempête de cris et de jurons, ce fut un éclat de rire qui résonna au-dessus de la casserole, puis le tailleur se retourna en disant:
—Bast! on déjeune comme un prince avec du pain et du fromage quand on a le cœur content.
Là-dessus, il prit sa fille par la taille et l’entraîna vers la salle à manger en lui demandant d’un ton profondément étonné:
—Que signifient tes yeux rougis? C’est à croire que tu as pleuré.
—Sans doute.
—Et pourquoi?
—Tu as été si méchant!
—Moi! fit le père, qui avait vraiment l’air de tomber des nues, j’ai été méchant! Quand ça?
—Tout à l’heure; quand tu agitais ton paquet en poussant des cris.
Bokel, à cette réponse, pouffa encore de rire.
—Ah! tu as pris cela pour de la colère, toi! s’écria-t-il.
—Qu’était-ce donc?
—Mais c’était de la joie... de la plus folle joie... Le bonheur m’étouffait.
Et comme la jeune fille, arrivée devant son couvert, allait s’asseoir, le tailleur l’embrassa au front, en ajoutant:
—Car je t’ai enfin trouvé un mari selon mes vœux, bichette.
Il y aurait impudence de notre part à soutenir que Bokel disait la vérité en attribuant à une joie folle ce transport qui avait effrayé toute la maison; mais nous affirmerons que l’immense satisfaction qui rayonnait maintenant dans son regard était de la plus complète sincérité. C’était bien l’œil d’un homme arrivé au comble de ses souhaits les plus ardents.
Il avait réellement trouvé son gendre!!! Le gendre de ses rêves!!!
Comment ce rara avis tant désiré était-il tombé sous sa main, ou, plutôt, comment une aussi violente colère avait-elle fait place à un contentement aussi énorme? Pour expliquer le fait, nous remonterons à l’instant où le tailleur furibond, brandissant le paquet qui avait l’honneur de contenir le vieil habit de M. de la Morpisel, s’était enfermé dans son cabinet.
Par cela même que la crise de cet emportement, dont la cause était si stupide, avait été plus aiguë, la réaction fut plus prompte. Au bout de cinq minutes, Bokel était tout honteux de la scène idiote qu’il venait de faire. Hurler et trépigner, fendre l’air avec l’habit d’un notaire, parce qu’on vous a trouvé gentil à croquer, cela ne sentait-il pas la folie et n’appelait-il pas les douches? Alors le tigre, la bête féroce, comme l’avaient nommé les siens, devint plus penaud que renard pris par une poule. Ceux qui redoutaient de le voir s’élancer en rugissant de sa tanière étaient bien loin de se douter, qu’on en juge, que le pauvre diable n’osait plus sortir, tant il avait peur de se rencontrer, de l’autre côté de la porte, avec un médecin qu’on aurait été chercher en toute hâte. Ce fut donc avec un fort soupir de soulagement qu’il entendit partir les ouvriers et le coupeur, ces témoins de sa démence. Restaient encore les deux femmes et, avec les femmes, Bokel avait pris l’habitude d’être brave; mais, que voulez-vous? en cet instant, il était tant déconfit qu’il reculait à se montrer tout de suite.
Il voulut donc gagner du temps.
Le meilleur moyen d’arriver à ce but, qui s’offrit à lui, fut de s’occuper de l’habit, tant secoué, de M. de la Morpisel, qu’il avait promis de renvoyer, tout réparé, le surlendemain.
En deux clins d’œil, le ventru bonhomme eut promptement constaté le mauvais état des boutons, du collet et de la doublure des basques. (Disons, entre parenthèses, que M. de la Morpisel était un notaire qui usait beaucoup. Ce qui nous fait avancer cette assertion, c’est qu’il était veuf de sa troisième femme.) Après cet examen à première vue, Bokel, qui aimait à aller au fond des choses, introduisit dans les poches de derrière une main en quête de trous à boucher; puis, tout naturellement, il en vint à sonder la poche de côté.
Dans celle-là, le frou-frou d’un papier froissé se fit entendre, et la main du fouilleur ramena aussitôt une lettre, oubliée là par le notaire.
Nous n’en avons pas fait mystère, le digne tailleur était un maître curieux. De plus, nous l’avons dit, il cherchait à gagner du temps. Il ne pouvait donc pas trouver une plus agréable occupation que celle de lire cette lettre. En conséquence, il l’ouvrit et, comme tout autre l’eût fait à sa place, son premier soin fut d’aller chercher des yeux la signature.
—Tiens! tiens! fit-il sur le ton de surprise de celui qui rencontre un nom pouvant s’appliquer sur un visage de sa connaissance.
Mais il reconnut son erreur quand, revenu à l’en-tête de la lettre, il y lut son point de départ.
—Saint-Louis du Sénégal, murmura-t-il, alors ce n’est pas le même, car le mien n’a jamais quitté Paris.
Puis, avec la physionomie de l’homme qui se souvient, et après s’être encore assuré que la suscription portait bien l’adresse du notaire, il se posa cette question:
—Serait-ce l’ami dont me parlait ce matin M. de la Morpisel en me disant qu’il était si gros, si gros que force lui était de faire porter son ventre par ses nègres?
Après cette réflexion, et sa mémoire l’aidant toujours, Bokel ajouta:
—Mais mon client ne m’a-t-il pas dit aussi que son ami était mort?
Sur ce, il consulta la date de la lettre. Elle était vieille de trois mois. Ce laps de temps, même en admettant qu’il fût possible de s’exercer à sauter le pas, étant plus que suffisant au moins décidé pour faire cinq cents fois la dernière culbute, le tailleur, rassuré sur la véracité du notaire, commença enfin sa lecture.
Elle était fort longue, cette lettre et, paraît-il, intéressante au superlatif, car, à mesure qu’il la lisait, Bokel fit entendre un «Fichtre!» auquel succéda un «Sapristi!» qui fut suivi par un étrange «Sacrebleu!» Comme ces trois exclamations furent lancées sur des tons d’une différence notable, nous allons essayer de les analyser.
Dans le Fichtre! il y avait l’accent d’une surprise mêlée de crainte. C’était, de prime abord, l’étonnement d’un homme qui apprend une chose phénoménale, puis qui se dit, après courte réflexion, que, dans un temps donné, cette même chose phénoménale menace de le concerner désagréablement.
Le: Sapristi! s’accentuait tout autrement. Bokel, paraissant avoir oublié ce danger dont le premier tiers de la lettre assombrissait son avenir, s’exclamait joyeusement devant l’heure présente que le deuxième tiers de la missive lui offrait tout agrémentée d’un profit inattendu, d’une aubaine inespérée. La preuve en est que, s’interrompant de lire pour secouer la tête, il murmura en soupirant:
—Ma foi! voilà une créance que je regardais bien comme perdue!
Ce disant, il avait posé la lettre sur son bureau pour étendre la main vers un casier dont il tira un registre qui, sur maroquin rouge, portait ce titre en lettres dorées: DÉBITEURS VÉREUX. Le doigt du tailleur glissant le long de l’échelle alphabétique, accolée à la droite des feuillets, s’arrêta au P, et, s’introduisant dans la tranche, ouvrit le registre à cet endroit. Alors, pendant que le même doigt descendait la colonne de ces noms marqués au P, la voix du chercheur marmotta entre ses dents:
—P. P. Po... Pol... Pola... Ah! le voici! Voyons jusqu’à quel chiffre le gueux a su abuser de ma confiance.
Il faut croire que le gros homme n’était pas des plus faciles sur le crédit, car il y eut une intonation de vive surprise dans son timbre quand il reprit:
—83 francs!!! Comment ai-je pu me laisser entraîner à une folie pareille!
Son renseignement pris, Bokel revint à la lettre aux deux tiers connue de lui, et en poursuivit la lecture jusqu’à la fin.
Sans doute que cette fin, au premier moment, ne lui avait pas inspiré grand intérêt, car ce fut seulement quand il était bien tranquillement en train de remettre le papier dans ses plis que tout à coup, en tressaillant de la tête aux pieds, il lâcha enfin le «sacrebleu!» que nous avons qualifié d’étrange.
Ce juron fut bref, rauque, à demi étranglé par l’émotion qui, subitement, empourpra les larges joues du tailleur. L’œil écarquillé, la bouche béante, la face illuminée par la joie, tout, chez Bokel, révélait le mortel brusquement surpris par une idée hardie qui lui ouvre un horizon immense, superbe... quelque chose comme un conte de fées qui promet de devenir une réalité splendide.
L’extase de notre gras personnage dura cinq minutes, après lesquelles il leva son regard, tout jubilant, vers le ciel, représenté par le plafond du cabinet et, les yeux fixés sur le piton de la rosace, il prononça d’une voix émue:
—Merci! mon Dieu! je tiens le gendre de mes rêves!
C’était après ce remercîment à la Providence, qui lui faisait sortir un gendre d’une poche de l’habit de M. de la Morpisel, que le tailleur, non sans avoir d’abord mis sous clef la précieuse lettre, était sorti de son cabinet pour aller rejoindre à la cuisine Paméla, Gertrude et le ragoût de veau qui s’était attaché au fond de la casserole.
On comprend de reste quelle fut aussi la joie de Paméla quand son père, alors qu’elle allait se mettre à table, lui avait annoncé, après un baiser au front, qu’il avait enfin trouvé un mari.
Aussi s’empressa-t-elle de demander:
—Beau garçon?
—Il est riche, répondit le papa.
—Brun ou blond?
—Très-riche, te dis-je.
—Jeune ou vieux?
—Cinq fois millionnaire.
De quelque côté que la jeune fille tentât de revenir à l’assaut, Bokel ne donna pas plus de développement à sa confidence. Renonçant donc à poursuivre un interrogatoire auquel son père ne faisait qu’une réponse unique, Paméla coupa au court en disant:
—Quand me le présenteras-tu?
—Ce soir même, si je suis assez heureux pour le trouver encore chez lui à cette heure, annonça le tailleur en se levant de table après avoir regardé le pendule, qui marquait midi.
—Alors, pars vite, conseilla la jeune fille. Moi, je vais me faire belle pour recevoir ton protégé et je commanderai à Gertrude de nous préparer un bon dîner.
Il était dit que, dans cette journée, Bokel devait éprouver une émotion désagréable toutes les fois qu’il serait question de nourriture. Aux derniers mots de sa fille, il pâlit un peu, et, dans son œil, il y eut une légère expression de peur en même temps qu’il s’écriait vivement:
—Mais non, mais non, pas de bon dîner!... Tu ne peux t’imaginer combien mon jeune homme est piètre mangeur!... Une mouche lui ferait deux repas.
—Ta, ta, ta! répliqua la demoiselle d’un petit ton gourmand, ne fût-ce que pour me dédommager de notre mauvais déjeuner de charcuterie, je tiens à mon dîner fin.
Trop insister parut imprudent à Bokel, qui, ravalant son secret, céda aussitôt.
—Va donc pour un dîner fin, dit-il.
—Allons, pars, pars vite, répéta la jeune fille, qui, impatiente déjà de connaître son futur, poussa gaiement monsieur son père par les épaules hors de la salle à manger.
Rentré dans son cabinet, le tailleur resta un gros quart d’heure à réfléchir, en homme qui étudie son plan et dispose ses batteries. Après quoi, il prit dans sa caisse des billets de mille francs qu’il glissa dans son portefeuille. Puis, d’un paquet de factures, il en tira une au bas de laquelle il traça quelques mots et qu’il plaça ensuite à côté des billets de banque. Cela fait, il mit le portefeuille dans sa poche.
Cinq minutes après, Bokel, portant un énorme paquet de vêtements sous son bras, sortait de chez lui. Vous n’auriez jamais dit qu’il pesait deux cent quarante cinq livres, tant la satisfaction le rendait alerte et léger. Il avait vraiment l’air de ne pas toucher terre.
La démarche, à petits pas pressés et sautillants, de notre héros, n’avait plus rien de cette allure saccadée qui, le matin, l’avait ramené de chez le notaire, alors qu’il frémissait de colère après la plaisanterie du grossier marin. Nous pouvons vous affirmer qu’il avait complétement oublié l’ignoble Filandru et sa langue infecte. Bokel avait un bien autre martel en tête et ce martel, à en juger par le sourire qui ne quittait pas les lèvres du digne homme, devait lui battre bien agréablement au cerveau.
Toujours trottinant, il ne mit pas plus d’une demi-heure à se rendre de la rue de Richelieu au haut du faubourg Saint-Jacques où il s’arrêta enfin devant une masure à cinq étages qui, sur sa façade crevassée, portait cette enseigne: Hôtel du Paradis.
Sans hésiter, Bokel enfila l’allée sombre et gluante d’humidité qui donnait accès dans la maison. Au bout de vingt pas, il se trouva devant une sorte de trou noir. C’était la loge du concierge. Il eût fallu au moins un bon quart d’heure à l’arrivant pour que ses yeux, en s’habituant aux ténèbres, pussent s’assurer si ce bouge contenait un habitant.
—M. Timoléon Polac? demanda-t-il à tout hasard.
Le hasard lui fut propice, car une voix lui répondit aussitôt:
—Au sixième, chambre 34.
Le tailleur, en tâtonnant du pied, avait déjà trouvé la première marche de l’escalier quand la crainte de faire une ascension inutile lui inspira cette autre et prudente question:
—Êtes-vous bien sûr qu’à cette heure M. Polac soit encore chez lui?
—Oh! oui, j’en suis sûr, riposta moqueusement la voix. Depuis ce matin je le guette au passage pour lui annoncer de la part du patron de l’hôtel que si, ce soir, il n’a pas donné un fort à-compte sur sa note, on l’enverra coucher à la belle étoile. J’ai déjà grimpé trois fois à son sixième et tambouriné à sa porte; mais bernique! mon gaillard fait le mort.
Si peu rassurant que fût ce renseignement sur la situation financière de celui qu’il venait visiter, Bokel n’en commença pas moins l’escalade des six étages. Nous croyons oiseux d’annoncer que le gros homme soufflait comme un soufflet de forge quand, après sa pénible montée, il se trouva enfin devant la porte du nº 34.
Bokel n’était pas tailleur que d’hier seulement. En qualité de créancier, il était expert en moyens nombreux de se faire ouvrir une porte s’obstinant à rester close. Après avoir un peu attendu pour retrouver son haleine, il frappa trois petits coups bien nets, coups d’ami, coups sans gêne ni prétention, coups qui endorment la méfiance et annoncent une visite agréable.
Rien ne bougea dans la chambre.
Un créancier stupide et ordinaire eût persisté à frapper et, par son obstination, n’eût que mieux révélé sa personnalité. Bokel se garda bien de cette faute. Après cette unique épreuve, il s’éloigna aussitôt en faisant résonner ses talons de bottes pour attester son départ. Cette manœuvre donnait à croire que le visiteur était un intime, monté au hasard, qui n’insistait pas parce qu’il n’avait nulle raison de se persuader qu’on ne voulait pas le recevoir. Cette façon d’agir en piquant la curiosité du reclus, pouvait le faire sortir à la sourdine de sa chambre pour venir, par-dessus la rampe de l’escalier, reconnaître celui qui s’éloignait et le rappeler s’il y avait lieu.
Mais, si Bokel possédait un joli fonds des ruses du créancier, celui qu’il nommait Timoléon Polac paraissait jouir d’une solide expérience de débiteur; car le tailleur, qui, le nez en l’air, s’était arrêté à l’étage au-dessous, ne vit, en haut, aucune tête curieuse dépasser la rampe.
—Le finaud doit m’avoir reconnu par quelque trou invisible percé dans la porte ou la muraille, pensa le tailleur.
Comme il était fermement résolu à trouver son homme, il renonça aux finasseries. Après avoir remonté l’étage, il se mit à refrapper en disant de son timbre le moins rogue:
—Ouvrez, monsieur Polac; c’est moi, votre tailleur; je vous apporte vos vêtements.
Même silence!
Ce qui fit que la voix de Bokel s’adoucit encore pour ajouter vivement:
—Ouvrez, je vous jure que je ne viens pas pour vous demander de l’argent.
C’était bien engageant, n’est-ce pas? Mais le locataire, en admettant qu’il fût chez lui comme l’affirmait son portier, devait être un garçon sceptique qui refusait de croire ace fait anormal qu’un tailleur monte au sixième étage pour ne pas réclamer d’argent.
Le silence continua!
Ce que voyant, Bokel tira son portefeuille, en sortit la facture que nous l’avons vu y placer et la glissa sous la porte en disant, d’un ton presque suppliant:
—Tenez, pour vous prouver que je ne veux pas d’argent, voici votre facture acquittée... Maintenant que vous ne me devez plus rien, monsieur Polac, ayez la bonté de m’ouvrir.
Si le locataire était absent, il est probable qu’il était parti en laissant sa fenêtre ouverte, car, à défaut de l’habitant du logis, on ne pouvait attribuer qu’à un très-fort courant d’air la rapidité avec laquelle la facture avait été attirée de l’autre côté de la porte.
Oui, il devait exister un courant d’air. Eût-il été possible autrement qu’un aussi généreux procédé n’amenât d’autre résultat que de laisser le solliciteur toujours en arrêt devant la porte immobile?
Mais Bokel était résigné à tout. Il n’y avait plus à hésiter! Les grands moyens devaient être mis en jeu. Donc en étouffant un soupir, il cueillit dans son portefeuille un de ses billets de mille francs et, encore sous la porte, il en fit passer un bout en débitant d’une voix attendrie:
—Et comme j’ai appris par votre concierge que vous étiez un peu gêné, je vous conjure, monsieur Polac, d’accepter ce léger service de la part d’un ami dévoué.
Tout en insinuant le billet, Bokel en serrait légèrement l’autre bout entre ses doigts. Il voulait se rendre compte de la manière dont ce papier allait se mettre en route pour le voyage déjà si prestement accompli par la facture. A la petite secousse qui lui fit lâcher prise, il comprit que le courant d’air était bien innocent de la disparition.
Soutenir que le tailleur, quand il eut tout à la fois constaté la présence du locataire et vu son billet raflé, ne fut pas subitement saisi de la peur bleue d’avoir sacrifié ses mille francs en pure perte, ce serait trop s’avancer. Mais cette crainte n’eut que la durée de l’éclair. Comme si Bokel eût prononcé le fameux Sésame, la porte tourna immédiatement sur ses gonds, et, dans son cadre béant, apparut un grand jeune homme de vingt-cinq ans environ, dont la toilette ne nous demandera pas un demi-volume de détails, attendu qu’elle consistait uniquement en une simple chemise et une paire de pantoufles.
—Ah! cher monsieur Polac, vos amis ont bien de la peine à se faire admettre chez vous! dit le gros homme en se glissant aussitôt dans la chambre.
Au lieu de répondre, Timoléon, qui tenait encore en main la facture et le billet de mille francs, ferma la porte sans cesser d’attacher sur le tailleur un regard où se lisait tout l’ébahissement d’un être qui examine un phénomène.
Cette surprise effarée ne fut pas remarquée par Bokel, et cela, pour une excellente raison. Dès son entrée, ses yeux s’étaient fixés sur les jambes nues du jeune homme et, ajoutons-le, lesdits yeux rayonnaient d’une sorte d’admiration joyeuse.
Etait-ce que ces jambes étaient d’un modèle irréprochable? Pas du tout! Le seul sentiment que leur vue pouvait inspirer, même au mortel le moins sensible, était celui d’une pitié profonde. Deux bâtons de chaise, qu’on aurait fait bouillir pendant quinze jours, seraient restés plus gras que n’étaient ces tibias dont la peau se collait sur les os sans accuser la plus minime parcelle de chair. A les montrer dans une baraque de foire, ces jambes-là auraient été un gagne-pain pour leur propriétaire.
Et tout le reste de l’individu était à l’avenant. A l’endroit des coudes, l’a toile de la chemise semblait repoussée par la pointe d’une baïonnette, et, sur chaque épaule, elle se redressait comme tendue sur une lame de rasoir.
Cependant, Bokel, tout à son examen, se disait avec un frémissement de satisfaction:
—Un squelette! Un vrai squelette!... Quelle chance pour moi!... Jamais, je crois, je n’aurais osé demander au ciel de me le donner aussi maigre!
Entre l’un, qui faisait cette réflexion, et l’autre, qui n’avait cessé de regarder alternativement le tailleur et le billet de mille francs, le silence avait duré une grosse minute. Il fut enfin rompu par Timoléon, qui s’écria:
—J’ai beau vous étudier, vous ne m’avez pas du tout l’air d’être timbré!
—Moi! timbré?
—Ni pochard!
—Pourquoi serais-je pochard ou timbré?
—Comment! vous, Bokel, le plus arabe de tous mes créanciers, vous le plus opiniâtre pourchasseur d’à-compte, vous, la providence des huissiers, vous me prêtez de l’argent et m’acquittez ma facture... sans être toqué ni ivre!... Ce n’est pas possible!... Dites-moi que je rêve!
—C’est la pure réalité.
—Alors vous êtes un faux Bokel! L’autre, le vrai, n’est pas capable d’un tel trait!
Bokel prit son air digne et d’une voix lente et grave:
—Monsieur Polac, dit-il, vous oubliez que, sous chaque tailleur, il y a un homme... De ce que le fournisseur s’est montré quelquefois un créancier sévère, il n’en faut pas déduire que l’homme n’aime pas à savourer les doux charmes de la bienfaisance.
—Ah bah! fit railleusement Timoléon à cette belle phrase.
Et, mal convaincu, il se prit à tourner et retourner le billet en ajoutant:
—Si vous êtes le Bokel véritable, c’est alors votre billet qui est faux... Je suis certain d’avance de ne pas pouvoir le passer.
Comme si une fée eût voulu le mettre à même de tenter tout de suite l’épreuve, on frappa au même instant à la porte et la voix du portier cria grossièrement:
—Puisque le gros monsieur est entré, vous pouvez bien m’ouvrir... Je vous avertis que le patron m’a autorisé à aller chercher un serrurier... Ainsi donc, de l’argent ou on vous flanque dehors.
D’un bond, Polac fut à la porte qu’il ouvrit et, lançant le billet à la face du concierge:
—Tiens, bélître! dit-il, va payer ma note et remonte-moi le reste de la somme.
Le cerbère n’avait encore pu trouver un seul mot que la porte lui était déjà refermée sur le nez par Timoléon, qui revint au tailleur. Ce dernier, pendant la scène, s’était mis à vider le paquet de vêtements apportés pour son client.
—Un squelette! Un vrai squelette! Quelle chance pour moi! se répétait-il tout en dépliant un pantalon.
Le mot «squelette» n’avait rien d’exagéré et convenait tout aussi bien que lame de rasoir, manche à balai, fil à beurre et autres termes usuels de comparaison applicables à cette maigreur qui causait à Bokel un contentement dont nous ne tarderons pas à connaître le secret.
Mais, de ce que les os lui perçaient la peau, Timoléon n’était pas pour cela un de ces pauvres hères, minés par l’étisie, n’ayant plus que le souffle, qui se cramponnent péniblement à l’existence. Non vraiment!... il avait complétement oublié d’engraisser, voilà tout. Il était des mieux portants et, surtout, des plus frétillants; un gaillard tout nerfs et tout muscles, dur à la fatigue, courageux en diable et de la plus joyeuse humeur... mais n’ayant pas pour quatre sous de poésie. Notons ce dernier point. Il aura son importance dans la suite de notre récit. Une abondante chevelure brune s’ébouriffait au-dessus de son visage spirituel, aux yeux gais et malins, à la bouche largement fendue, et meublée de trente-deux dents d’une solidité à mâcher du fer. Tel était Timoléon Polac.
Dans l’empressement qu’il avait mis à donner le billet de mille francs au portier, il avait été surtout poussé par l’arrière-pensée que la tailleur, ayant offert avec l’espoir d’être refusé, allait faire une triste mine en voyant s’envoler l’argent. Il en fut pour son injurieux soupçon, car Bokel, sitôt le concierge disparu, lui tendit le pantalon, en disant d’un ton fort tranquille:
—Maintenant, habillez-vous.
—Ah çà! bien vrai, vous ne regrettez donc pas votre billet de banque? s’écria Polac tout en s’introduisant dans le pantalon.
—En voulez-vous un second? demanda vivement le gros homme, dont la main se porta aussitôt vers la poche contenant son portefeuille.
Il n’y avait plus à douter. Voix et geste avaient été si naturels que notre sceptique fut convaincu.
—Grand merci! dit-il. Avec le restant de la somme que va me rapporter le concierge, j’aurai amplement de quoi suffire à mes projets.
—Ah! vous avez des projets? reprit Bokel avec un accent d’inquiétude dans la voix. Peut-on les connaître?
—Parfaitement. J’en ai deux. Le premier consiste à me payer avant tout un joli coup de fourchette.
—Tiens, oui, j’y pense. Je vous ai surpris au saut du lit... un peu tard, il faut l’avouer... Vous avez sans doute passé la nuit dernière dans quelque soirée du grand monde? débuta le tailleur sans aucune conviction qu’il avait trouvé le motif véritable de ce lever tardif.
—Dans le grand monde! répéta Polac après une longue fusée de rire. Alors j’y serais allé en manches de chemise, car, il y a trois jours, j’ai vendu mon dernier habit pour manger... Si vous m’avez encore trouvé au lit à deux heures de l’après-midi, c’est par ordre du proverbe: Qui dort dîne.
A ces mots, Bokel prit son air attristé et d’une voix de pitié douce:
—Vous ne pouvez donc pas remonter sur l’eau, mon cher monsieur Polac!
Et sur ces mots, il lâcha deux grosses larmes qui glissèrent sur sa face joufflue.
Timoléon aurait dû ouvrir des yeux grands comme une porte cochère à la vue de cette émotion. Bokel, l’arabe impitoyable, devenu une sensitive! le crocodile métamorphosé en bengali! N’était-ce pas là un vrai miracle? Mais en homme qui s’est résolu à prendre la balle au bond et à profiter d’une aubaine extraordinaire en remettant à plus tard l’instant de s’étonner, Polac endossa, sans la plus mince apparence de surprise, le gilet que lui présentait le tailleur et répondit:
—Que voulez-vous? mon brave Bokel, je n’ai pas de chance! Mon père, qui avait de la fortune, m’avait élevé à rien faire. La Restauration l’a ruiné. Puis le chagrin l’a tué. Je me suis trouvé, du jour au lendemain, sur le pavé et sans un liard. Quand j’étais riche, on m’avait cent fois assuré que je tripotais assez agréablement la musique. J’ai voulu vivre de ce talent. J’ai tenté mon premier essai sur le propriétaire de cet hôtel. Le jour de sa fête, je lui ai dédié une romance, paroles et musique de ma composition. Mon homme est un ancien marchand de cochons, mais puisqu’on prétend que la musique attendrit les rochers, il pouvait me servir de pierre de touche. Le soir, il m’a envoyé par le portier une tranche du gigot de sa table, en y joignant, au lieu de haricots, ces paroles amères: «Plutôt que de s’occuper de toutes ces notes-là, il ferait mieux de me payer la mienne.» Dès lors je me le suis tenu pour dit sur l’effet foudroyant de mon génie musical, et j’ai lâché mon luth.
Tout cela avait été joyeusement débité par Timoléon, qui, après s’être un moment admiré dans son gilet neuf, reprit sur le même ton:
—Que vous dirai-je encore? J’ai frappé inutilement à vingt portes pour demander un emploi. Cependant j’ai vécu de la vente des rares épaves sauvées du naufrage de mon opulence. Rien que sur le prix de ma montre, j’ai pu manger durant quatre mois. Mais je suis arrivé au bout du rouleau, et, il y a deux jours, il m’a fallu vendre ma dernière redingote.
A ce souvenir fort triste pourtant Polac s’interrompit pour éclater de rire.
—J’ai eu beau répéter, reprit-il, que ce vêtement était de la coupe du fameux Bokel, sa vente m’a fourni deux repas si minces, si minces qu’autant vaudrait avouer que je suis à jeûn depuis quarante-huit heures.
—La sobriété est une vertu, avança le tailleur d’une voix grave.
—Oui, mais pas poussée jusqu’à ce point, répliqua Timoléon. Aussi ne faut-il pas vous étonner si, de mes deux projets à réaliser avec le reste du billet de mille francs que va remonter le concierge, le premier est de me payer un solide coup de fourchette.
Ces derniers mots ravivèrent la mémoire du tailleur.
—Tiens! c’est vrai! fit-il, vous avez parlé de deux projets... Et quel est le second?
—De venir en aide à un aussi malheureux que moi... Un pauvre garçon qui n’avait que sa place pour vivre, et que le nouveau gouvernement a destitué brutalement afin de caser une de ses créatures.
—Vous vous intéressez donc beaucoup à cet infortuné, monsieur Polac?
—Parbleu! c’est mon cousin germain.
La réponse était à peine faite que le gros tailleur tressaillit de tout son être en s’écriant:
—Eh! oui, au fait! vous êtes deux cousins! je l’ai lu dans la...
Mais au moment de parler de la lettre trouvée dans l’habit de M. de la Morpisel, le tailleur sentit qu’il allait commettre une imprudence et se rattrapa en disant:
—...Je l’ai lu dans la Quotidienne.
Puis, tout heureux de s’être raccroché à une branche, il crut être malin en ajoutant:
—Oui, c’est par la Quotidienne que j’ai appris cette destitution. J’ajouterai même qu’en lisant ce nom de Polac, j’ai cru qu’il s’agissait de vous.
Timoléon, qui était en train de passer une manche de l’habit neuf, se retourna vivement à ces mots:
—Qu’est-ce que vous me chantez là, Bokel! dit-il avec surprise. Vous ne pouvez avoir vu le nom de Polac dans le journal à propos de mon cousin, attendu qu’il s’appelle Dumouchet, du nom de son père, marié à ma tante, morte depuis dix années.
Bokel fut beau d’aplomb.
—Alors c’est que je confonds, dit-il ingénument. Je m’imagine l’avoir lu dans le journal, quand, peut-être, c’est vous qui m’en aurez parlé.
Timoléon n’en avait nul souvenir, mais la chose lui paraissait de si peu d’importance qu’il répondit:
—C’est possible.
Après un petit silence pendant lequel il avait ajusté l’habit sur le dos de son client, le tailleur reprit sur un ton d’indifférence supérieurement jouée:
—Ce M. Dumouchet est votre seul cousin germain?
—Oui, puisqu’il est le fils unique de ma tante et que mon oncle ne s’était pas marié.
—Ah! votre père avait donc aussi un frère?
—Oui, et un rude homme, je vous le jure.
—Vraiment?
—Un gaillard qui aimait les coups. Il était un des corsaires qui, sous l’empire, ont été la terreur des Anglais. Ah! c’est lui qui vous faisait rudement valser les écus quand, après chaque croisière, il revenait à Paris dépenser en folies de toutes sortes ses pleines sacoches de guinées anglaises.
Placé derrière Polac, le tailleur écoutait avec un sourire béat, en remuant la tête d’un petit mouvement doux et approbateur. Il est probable que si Timoléon s’était retourné, il n’aurait rien retrouvé de cette joie sur la figure du poussah. Elle s’épanouissait parce qu’elle ne se savait pas surveillée. A la moindre alerte, elle eût disparu de la surface de la peau. En même temps que le facies jubilait ainsi, la voix de Bokel se faisait triste pour demander:
—Il est donc mort aussi, ce brave corsaire?
—Je le crois, répondit Polac tout occupé de faire jouer ses bras dans les entournures du vêtement.
—Comment! Vous le croyez! N’en êtes-vous pas certain?
—Depuis 1808, je n’ai plus entendu parler de lui. Rien n’est venu m’apprendre son sort. A coup sûr, sa fin aura été violente. Il aura péri dans un naufrage ou se sera fait tuer dans un combat.
—Ou il sera mort en captivité sur quelque ponton anglais.
—J’en doute; il était gas à faire sauter son navire plutôt que de se rendre.
—Bref, toutes les probabilités vous font croire que le courageux marin n’est plus de ce monde, ajouta Bokel dont la voix était toujours navrée et dont la face souriait toujours aussi derrière Timoléon.
Tout à coup le visage du ventru se contracta. Une expression de terreur remplaça l’hilarité. Une crainte, subite était entrée comme une épine aiguë en plein milieu de sa satisfaction. Aussi, ce coup-là, sa voix, qu’il s’efforçait de maîtriser, était-elle vraiment émue, quand il demanda:
—Dites-moi, monsieur Polac, votre cousin est-il aussi célibataire?
—Non, il a femme et enfants.
Ce renseignement, paraît-il, appelait une seconde question dont la réponse pouvait renverser de fond en comble le plan secret du tailleur. Après avoir rassemblé tout son courage et cherché à humecter d’un peu de salive sa langue desséchée par la peur, il demanda encore:
—Et votre cousin, M. Dumouchet, comme vous le nommez, est-ce que, par hasard, il est aussi...
La chose à savoir était grandement intéressante pour Bokel puisqu’il s’y reprenait à deux fois.
—Aussi quoi? répéta Polac.
—Aussi élancé... aussi aérien que vous? prononça enfin Bokel tout d’une haleine.
—Allons, dit le jeune homme en riant, lâchez donc le vrai mot... Est-il aussi maigre que moi, n’est-ce pas?
—Oui, balbutia le tailleur, dont l’anxiété se trahissait par d’énormes gouttes de sueur.
—Eh! eh! fit le jeune homme en secouant la tête d’un air de doute, je ne dirais pas trop non.
A ces mots, la figure de Bokel passa du rouge vif au blanc jaune.
—Si le cousin marié est le plus maigre, je suis enfoncé! pensa-t-il avec désespoir.
N’ayant d’autre souci que de s’admirer en sa toilette nouvelle, Timoléon n’avait nullement remarqué l’agitation douloureuse de son fournisseur. Quand, satisfait de se voir si flambant neuf, ses regards se tournèrent vers le tailleur, celui-ci, encore mal remis, eut pourtant la force de trouver le sourire dont il accompagna ces mots:
—Il paraît que la maigreur est de famille chez les Polac.
—C’est à le croire. Il y a six mois, je ne sais plus à quel propos, mon cousin et moi, nous avons eu l’idée de nous peser.
—Et? fit Bokel que l’angoisse, qui lui serrait la gorge, empêcha d’achever sa question sur le résultat de cette pesée.
—Je l’ai emporté sur lui de 27 livres, déclara Timoléon.
Bokel ferma les yeux et se retint à la table. Le pauvre obèse se sentait près de s’évanouir.
—Malheur! malheur! se disait-il, c’est le cousin marié qui est le plus étique! O mon beau rêve!
Mais, subitement, comme le naufragé qui s’accroche à tout, il se redressa en entendant Polac ajouter:
—Aujourd’hui, Dumouchet doit m’avoir rattrapé ou peu s’en faut.
—Hein! fit Bokel, vous avoir rattrapé! Ne venez-vous pas de me dire qu’il était aussi dans une profonde détresse?
—Et je vous le répète. Je ne crois pas que mon cousin mange tous les jours.
—Mais, alors, il ne peut avoir engraissé.
—C’est incontestable.
—Par conséquent, comment a-t-il pu regagner ces 27 livres qui vous avaient donné la victoire?
—Mais d’une manière fort simple..... En maigrissant encore.
Tout un feu d’artifice de joie éclata sur la face du tailleur.
—Quoi! quoi! s’écria-t-il, votre triomphe sur votre cousin consistait-il à peser 27 livres... de moins?
—Sans doute, puisque nous voulions savoir lequel de nous deux était le plus maigre.
On a beau dire: la joie n’étouffe pas; car c’en eût été fait de Bokel. C’était un vrai mastodonte que ce digne coupeur de culottes et, pourtant, il sautillait sur ses jambes énormes, tant une immense satisfaction le gonflait comme un vrai ballon. Pour un rien, il aurait dansé. Il nous faut dire, que cet émoi échappait à Timoléon, occupé, en ce moment, à contempler mélancoliquement son vieux chapeau qui allait si mal rimer avec ses vêtements nouveaux. Tout en promenant sa manche sur ce qui restait, par places, du poil jauni de son couvre-chef, le jeune homme avait continué:
—Il fut un temps, disait-il, où j’ai connu Dumouchet avec un petit bedon fort respectable. Il faut qu’il ait rudement pâti pour en arriver là, car il est d’un acabit à engraisser.
—Vrai! vrai! répéta Bokel tout aux anges.
—Je ferais même un pari.
—Lequel?
—Celui qu’avant un mois il aura repris du corps grâce aux deux ou trois cents francs que je compte lui offrir sur le restant de mon billet de mille francs.
Et avec un ton d’impatience:
—Ah çà! poursuivit Polac, ce portier est bien longtemps à me rapporter ma monnaie! Je gagerais que ce drôle n’a pas voulu se donner la peine de remonter mes cinq étages. Il doit m’attendre dans sa loge pour me remettre les écus au passage... Au fait, rien ne nous empêche de descendre... Est-ce votre avis, Bokel?
—Descendons, dit avec empressement le tailleur, qui tenait à ne pas quitter sa proie.
—En route, alors, reprit Polac en se dirigeant vers la porte. Si votre chemin est de suivre la rue Saint-Jacques, je vais vous faire un bout de conduite... pas bien long, par exemple... car je me rends chez Dumouchet.
—Ah! M. votre cousin habite dans le voisinage?
—Oui, vingt numéros plus bas dans la rue... la maison du rôtisseur.
Malgré son air empressé, Bokel pestait fort contre ce départ.
—Diable! se disait-il, comment empêcher mon oiseau de s’envoler?
Mais, après la chaude alarme qui l’avait tant secoué, la veine venait de tourner décidément en faveur du gros homme. Polac, en ouvrant la porte, se trouva en présence du portier, qui allait frapper.
—Ah! c’est vous, Calichon! Savez-vous, mon vieux, que vous mettez le temps à rapporter la monnaie du monde! dit le locataire du ton hautain de l’homme qui a payé.
A quoi le portier, pour s’excuser, répondit avec une pointe de malice:
—Il m’a d’abord fallu attendre que le propriétaire fût revenu du vif saisissement qui l’a pris en voyant enfin votre argent.
Puis, en tendant un papier:
—Voici la note acquittée, ajouta-t-il.
—Bon, Posez-la sur la commode... Maintenant, vite, remettez-moi le reste de mon billet de mille francs, ordonna Timoléon en avançant la main.
Le concierge fouilla dans sa poche, dont il tira une pièce de monnaie, qu’il mit dans la paume en creux de la main du jeune homme en disant:
—Voici ce qui vous revient.
—Deux sous! bégaya Polac, démonté par cette surprise désagréable.
—Dame! monsieur peut faire lui-même son compte... Quel est le prix mensuel de sa chambre?
—Trente francs.
—Combien monsieur avait-il déjà donné d’à-compte avant ce jour, que le propriétaire vient de marquer d’une grande croix sur son calendrier?
—Aucun à-compte. Je tenais à savoir jusqu’à quel point on aurait confiance en moi, prononça fièrement Timoléon.
—Depuis combien de mois monsieur nous a-t-il fait l’honneur d’être notre locataire?
—La vie passe si vite qu’on n’a pas le temps de faire des calculs oiseux.
—Puisque monsieur n’a pas daigné s’occuper de ce détail, je lui apprendrai que voilà 33 mois qu’il honore la maison de sa résidence... Or, 33 mois à 30 francs font 990 fr.
La faim qui grondait au fond des entrailles de Timoléon le fit descendre de cette dignité du haut de laquelle il dominait le portier.
—Mais alors, mon cher Calichon, il me revient encore dix francs.
—C’est la vérité. Seulement, pour ports de lettres, menues fournitures et frais divers, je me suis fait une véritable fête d’avancer pour monsieur la somme de 9 francs dix-huit sous... Reste donc à toucher ladite somme de deux sous, dont je viens d’opérer le versement entre les mains de monsieur.
Cela dit, le portier exécuta une courbette respectueuse, qu’il fit suivre de cette requête:
—Je n’ai plus maintenant qu’à me recommander à la générosité de monsieur.
—Tiens, prends tout, vorace! et disparais au plus vite pour ne pas me laisser le temps de me repentir de ma prodigalité, dit Timoléon, qui, après lui avoir mis les deux sous dans la main, le poussa par les épaules sur le carré et referma la porte.
Bokel avait assisté, tout heureux de son résultat, à cette scène où, comme dans la fable de la laitière et le pot au lait, Polac venait de voir tous ses beaux projets renversés.
Le seul regret que sa déconvenue inspira au jeune homme fut loin d’être dicté par l’égoïsme.
—Pauvre Dumouchet! s’écria-t-il en songeant à celui qu’il avait voulu secourir.
Puis, en se mettant à rire:
—Voilà le plantureux déjeuner, que je comptais m’offrir, vite digéré, ajouta-t-il.
—Bah! bah! fit Bokel en appuyant sur les mots, nous n’en dînerons que mieux.
—Nous? répéta Polac.
—Sans doute. Nous... car je compte bien, Monsieur Polac, que vous me ferez l’honneur d’accepter le dîner que ma fille a fait préparer à votre intention.
Nous l’avons dit, Timoléon était un garçon qui savait fort bien que tout effet a sa cause; que rien ici-bas ne s’obtient gratis. Fort persuadé que, tôt ou tard, il lui faudrait compter avec son ex-farouche créancier, il obéissait, pour la circonstance, au précepte proverbial: «Mieux vaut tenir que courir.» Ce fut donc sans la moindre surprise qu’il répondit:
—Puisque ce dîner est préparé à mon intention, je serais un rustre de refuser, mon cher bienfaiteur... Vous permettez que je vous appelle mon bienfaiteur, n’est-ce pas?
—Oui, oui, en attendant mieux, répondit Bokel d’un petit ton malin et avec un amical regard en coulisse.
Avant que Timoléon pût lui demander l’explication de sa phrase, il avait gagné la porte en disant:
—J’ai une petite course fort pressée à faire dans le quartier... Avant une heure, je reviendrai vous prendre.
Sur le seuil de la chambre, il se retourna et, avec la même voix et le même regard tendre, il répéta:
—En attendant mieux, beaucoup mieux, mon cher Timoléon.
Et il disparut aux yeux du jeune homme, qui, pour tuer le temps jusqu’à son retour, se creusa la tête à chercher le motif de la conduite du tailleur à son égard et finit par arriver à cette conclusion:
—Il veut probablement me charger d’assassiner quelqu’un.
Cependant Bokel était arrivé sur le trottoir et s’était mis à descendre la rue à pas comptés, en examinant, à droite et à gauche, les maisons qu’il dépassait.
—C’est ici! murmura-t-il en suspendant sa marche, voici le rôtisseur dont m’a parlé Polac.
En homme qui combine son plan, il demeura, un moment, pensif devant l’amas de volailles entassées sur des plats dans la montre. Cette méditation pouvait si bien se prendre pour l’extase d’un gourmand qui flairait à pleines narines l’odorant fumet des marchandises, que le rôtisseur quitta le coin de l’âtre flamboyant d’où il surveillait quatre broches garnies, pour accourir sur le pas de la porte.
—Dindons, poulets, canards, pigeons, toutes pièces de premier choix et de dernière fraîcheur, débita-t-il d’une voix engageante.
Bokel devait avoir trouvé son plan, car, aussitôt, il répondit par un petit salut approbateur et entra dans la boutique.
—Que désire monsieur? Un beau poulet sans doute? Voici son affaire, reprit le rôtisseur en offrant, comme de raison, une volaille qui exigeait une prompte vente tant elle était à deux doigts d’être gâtée.
D’un geste de main, Bokel arrêta le zèle du boutiquier.
—Pour le moment, dit-il, je ne désire que de simples renseignements.
—Sur qui? sur quoi? demanda le rôtisseur d’une voix qui avait perdu tout à coup son aménité.
—Sur un locataire qui habite votre maison... Un nommé Dumouchet.
De prévenante qu’elle avait été au début, la mine du rôtisseur était devenue un peu moins souriante quand Bokel avait refusé l’achat de la volaille. Ce fut bien pis après la demande de renseignements. Elle tourna au menaçant.
L’œil s’alluma, les oreilles se teintèrent de rouge, et l’énorme moustache qui s’étalait entre le nez, dont le bout devint blanc, et la bouche, dont les dents grincèrent, hérissa tous ses poils aussi raides que les piquants d’un porc-épic. En même temps une voix rauque prononça ces mots, qui ne formaient pas précisément une réponse à la demande:
—Toi, plein de soupe, je te conseille de détaler au plus vite, si tu ne tiens pas à ce que je te fasse asseoir dans ma lèchefrite, dont la graisse est bouillante... Foi de Bizot! ex-sergent de la garde impériale, tu peux compter là-dessus, si, dans trois secondes, tu ne m’as pas débarrassé de ta face de mouchard.
C’était clair, catégorique, peu rassurant, et le rôtisseur était un gaillard le taille à exécuter son programme.
Bokel, pourtant, ne broncha pas plus que si l’autre eût parlé de le couronner de roses.
Et voici pourquoi:
En France, a-t-on dit assez justement, tout finit par des chansons. C’est donc par des chansons de l’époque que nous allons essayer d’exprimer les diverses nuances du plaisir que causait, à si peu de distance de leur Restauration, le retour des Bourbons. «Ramené par l’amour de notre peuple», avait d’abord dit Louis XVIII, avant de s’asseoir sur ce trône que, quinze jours plus tard, il prétendait tenir de Dieu et de ses ancêtres. Or, cet amour, nous le répétons, avait ses degrés.
On comptait, en première ligne, les fanatiques qui chantaient à l’heure cette cantate:
Ceux-là étaient les satisfaits, tous gens bien placés, à même le râtelier du budget. Leurs cantiques partaient d’un estomac repu et leur adoration s’entourait de toutes les formes sous lesquelles on avait reproduit les augustes traits de monarque, ami de l’olivier. D’aucuns, même, portaient son portrait en boutons de culotte.
Après ces sectaires, arrivaient les expectants. On leur avait fait des promesses qu’on n’avait pas encore réalisées. Aussi avaient-ils piqué leur amour avec une épingle sur un bouchon pour qu’il ne se défraîchît pas les ailes, et ils attendaient pour le reprendre que la manne tombât sur eux. C’étaient les sondeurs, les «Faudrait voir à voir». Ils avaient été fort chauds, mais, peu à peu, ils s’attiédissaient en chantant, avec prudence pourtant, certains couplets, demi-hargneux, dont le refrain était:
Venaient ensuite les blagueurs, moitié figues et moitié raisins. Pas encore ennemis, mais bien près de l’être. Riant pour ne pas avoir à se fâcher. A propos du déluge de médailles, portraits, bustes, statuettes qui reproduisaient la face de l’ami de l’olivier, ce clan-là chantonnait:
Enfin arrivaient ceux qui aimaient le monarque d’une façon... féroce, à peu près comme le crocodile ou le requin aime l’homme. Ces derniers, donnant pour sujet à leur muse l’embonpoint royal, chantaient entre leurs dents:
Voilà en résumé, ce que la Restauration appelait un peu à la légère: Avoir comblé tous les vœux!
De tous ceux qui vouaient le sang de saint Louis aux manipulations de la charcuterie,—et ils formaient l’immense majorité,—les plus ardents étaient les bonapartistes. Aussi le gouvernement, mal rassuré sur cette façon de l’aimer, faisait sillonner leurs masses profondes par ces curieux à l’oreille fine et à l’œil observateur sur lesquels Béranger appelait l’éveil de ceux qui causaient trop haut de leur goût pour les saucisses en leur chantant ce refrain:
Voilà donc pourquoi le rôtisseur, bonapartiste à tous crins en sa qualité d’ancien soldat licencié, quand il avait entendu Bokel l’interroger sur le compte de Dumouchet, ce destitué par la Restauration, l’avait tout naturellement pris pour un mouchard et menacé, s’il ne déguerpissait, de le faire asseoir dans la graisse crépitante de sa lèchefrite.
Mais, nous l’avons dit, si peu avenant que fût le destin promis aux parties postérieures et charnues de son individu, Bokel n’avait pas bougé, car cette réponse, grosse d’orages, était, en même temps, une déclaration de principes qui, tout aussitôt, lui avait montré le joint qu’il cherchait pour l’exécution de son plan.
—Bon, pensa-t-il, un bonapartiste! Je tiens mon homme.
Puis, sans s’inquiéter des gros yeux furibonds du rôtisseur, et après avoir promené un regard prudent sur les volailles rôties ou crues, comme s’il voulait s’assurer qu’aucune d’elles n’était de la police, il glissa rapidement ces mots à mi-voix:
—Vous vous trompez, mon ami, je suis de votre bord.
—Vrai! vous êtes pour l’Emp...
—Chut! chut! fit Bokel en coupant d’un geste de main le mot compromettant. Oui, mon opinion est la même que la vôtre et que celle de M. Dumouchet, cette intéressante victime de l’injustice monstrueuse du régime actuel.
—Oh! oui, le pauvre homme! En voilà un qui en voit de dures pour le quart d’heure, dit le rôtisseur dont la méfiance et la fureur s’étaient complétement dissipées.
—Pas de place, pas de pain, n’est-ce pas?
—Ces gueux-là l’ont jeté sur le pavé comme un chien, sans se demander comment il nourrirait le lendemain sa femme et ses enfants.
—De sorte que l’argent manque? continua Bokel, poursuivant son interrogatoire.
—Dame! oui. Je puis vous en parler à bon escient, car, peu à peu, je l’ai vu emporter tout ce qu’il y avait à vendre dans son ménage... et, cela, pour manger.
—Cette vie-là doit l’avoir fait maigrir? demanda le tailleur avec inquiétude.
—Il n’a plus que la peau et les os.
—Que la peau... répéta Bokel en pâlissant.
—... Et les os, oui, monsieur; il fait passer sa femme et ses mioches avant lui et ne mange que ce qui reste... quand il en reste, ce qui ne doit pas arriver tous les jours... Ah! oui, je vous en réponds, il est d’une belle maigreur! Il a, je...
Le rôtisseur s’interrompit tout à coup pour tendre la main vers la rue.
—Tenez, fit-il, vous pouvez en juger par vous-même, car le voilà qui sort de la maison... Voulez-vous que je l’appelle?
Bokel n’eut même pas le temps de répondre non, car l’homme aux volailles se reprit aussitôt pour dire d’une voie émue:
—Au fait, mieux vaut le laisser filer et le guetter à son retour, il serait trop peiné d’être abordé en ce moment avec la charge qu’il a sur le dos.
En effet, celui que désignait le rôtisseur, était un grand efflanqué qui remontait la rue en portant un matelas sur ses épaules.
Si court que fût le passage de Dumouchet, il suffit à Bokel pour le bien regarder. Cet examen le contenta sans doute, car un léger sourire parut sur ses lèvres.
—Eh! eh! se dit-il, oui, il est pas mal maigre, le cousin marié... mais il n’approche pas encore de Polac... Pourtant, comme il finirait par le rattraper, il faut que j’y mettre bon ordre.
Cependant, l’ex-militaire de l’empire avait continué:
—M. Dumouchet va encore poster un matelas au Mont-de-Piété... J’aurais dû m’y opposer, car, en ma qualité de principal locataire, je suis responsable des loyers et j’ai déjà payé trois termes pour lui... mais, bah! entre gens de la même opinion, il faut s’entr’aider... Pas vrai?
—C’est si bien mon avis que je vais vous le prouver sur l’heure, dit gravement le tailleur.
Il mit la main à sa poche et prit son portefeuille, d’où il tira encore un des billets de mille francs que nous l’avons vu y placer à son départ.
—J’appartiens, reprit-il, au comité de bienfaisance bonapartiste, qui s’est chargé, sous le voile de l’anonyme, de venir en aide à ceux de notre parti qui ont eu à souffrir des injustices du régime actuel... Tenez, voici la somme destinée à M. Dumouchet.
—Je la lui remettrai à son retour, promit le rôtisseur, ébahi par une telle largesse, en prenant le billet qui lui était tendu.
—Non, non, dit vivement Bokel, remettre cet argent à M. Dumouchet ne serait pas répondre aux intentions du comité que je représente... Je me suis mal expliqué. J’aurais dû plutôt dire que c’est à vous-même que je donne ces mille francs.
Rendant muette, d’un signe de main, la surprise du rôtisseur, qui allait s’exclamer, Bokel poursuivit:
—Veuillez m’écouter. Le comité s’occupe de replacer Dumouchet dans une position au moins égale à celle qu’il a perdue. Mais, avant tout, il veut lui assurer, et aux siens comme à lui, le plus précieux de tous les biens. Je veux dire qu’il entend d’abord leur rendre une santé qui a été altérée par les privations de toutes sortes. Il exige donc que la présente somme soit employée uniquement... vous m’entendez? uniquement... employée en nourriture, rien qu’en nourriture. Vous me comprenez?
—Parfaitement. Je suis chargé de les nourrir jusqu’à concurrence de mille francs.
—Et sans détourner un sou, un seul sou du but que s’est proposé le comité.
—Oui, oui, tout en boustifaille... Rien qu’en déjeuners et dîners.
—C’est cela même. Voyons, dites-moi un peu comment vous entendez les nourrir?
—A déjeuner, je leur donnerais un dindon.
—Pourquoi pas deux dindons?
—Deux dindons? Pour six... dont quatre bambins! Ce serait trop, vraiment trop!
—Le comité ne marchande pas ses bienfaits, dit gravement Bokel.
—Va pour deux dindons alors!
—Bien. A présent, parlons du second déjeuner.
—Hein! fit le rôtisseur en ouvrant des yeux énormes à la pensée que les deux dindons avaient seulement mission de remplacer le café au lait du matin.
Le tailleur avait continué:
—Pour le second déjeuner, nous disons donc un gigot... mettons même deux gigots, puis quelques pigeons et une salade de pommes de terre. Rien ne vaut les farineux pour rétablir la santé. Vous abuserez donc des légumes farineux... Occupons-nous maintenant du dîner. C’est d’ordinaire le repas sérieux de la journée. Il nous le faudra solide, substantiel... Nous aurons alors l’oie, le canard, le lapin, un morceau de viande de boucherie et encore des légumes farineux... toujours des farineux.
—Mais, à manger de la sorte, ils n’auront même plus le temps de se moucher!... Monsieur Dumouchet, qui est un pieu, tournera au ballon dans quinze jours... Ils vont avoir de la viande à coucher dessus!
Bokel, à cette objection, redressa la tête, et d’une voix sévère:
—Monsieur, dit-il, j’ai déjà eu l’honneur de vous apprendre que le comité ne marchande jamais ses bienfaits et qu’il a horreur de l’étriqué.
—Quel comité! quel comité! murmura le rôtisseur émerveillé.
Après cette leçon donnée à son homme, Bokel, redescendant de ses grands chevaux, se fit bon prince en ajoutant:
—Eussent-ils trop de viande, pensez-vous que les Dumouchet manqueront d’autres malheureux à nourrir de leurs restes?.. Ils ne sont pas sans connaître, autour d’eux, de nombreux affamés.
—Oh! oui... Entre autres, il vient quelquefois chez eux un grand jeune homme, gras comme le coupant d’un sabre, qui les aiderait d’un rude coup de dent... Oh! celui-là doit avoir un fier appétit! Je gagerais bien qu’il a toute une table d’hôte dans l’estomac! répondit le rôtisseur avec une sorte d’admiration pour celui dont il parlait.
Bien qu’il eût immédiatement deviné qu’il s’agissait de Timoléon, le tailleur parut n’attacher aucune importance à ce détail et reprit d’un ton grave:
—Vous avez bien compris, n’est-ce pas, l’intention du comité? Rendre avant tout la santé à ses protégés. Puis, plus tard, assurer leur bien-être par un emploi.
Et sur le ton d’une confidence:
—Je me suis senti si douloureusement affecté par l’aspect souffreteux de M. Dumouchet que je m’engage, si, dans quinze jours, vos bons soins l’ont fait refleurir, à demander au comité une prime pour vous... Ainsi donc ne vous écartez pas de cette sorte de menu que nous avons dressé ensemble.
—Soyez tranquille. Je vais vous le bourrer qu’il en deviendra bossu.
—Au besoin, pour le cas où des spasmes d’estomac le réveilleraient la nuit, je ne verrais aucun inconvénient à ce qu’il trouvât un jambon sur sa table de nuit pour faire médianoche.
—Il aura son jambon, dit le rôtisseur, qui, en somme, était enchanté d’avoir à vendre le plus possible.
Bokel leva un doigt comme pour appuyer sur les paroles qu’il allait prononcer.
—N’oubliez pas, recommanda-t-il, que les bienfaits du comité sont anonymes. Ainsi donc, motus! inventez ce que vous voudrez, mais pas un mot sur nous.
—Je dirai à M. Dumouchet qu’une tireuse de cartes m’a conseillé de placer des fonds sur son avenir, qui doit redevenir brillant, proposa le rôtisseur, enchanté d’avoir l’air d’être charitable à si bon compte.
—Parfait! ingénieuse idée!... C’est donc convenu, vous allez m’engraisser ces gens-là... Après le présent billet de mille francs, il y en aura encore un autre, si c’est nécessaire, car, je ne saurais trop le répéter, le comité de bienfaisance bonapartiste ne veut pas qu’on lésine... Et songez à la prime qui vous attend; gagnez-la.
Sur ce, après un petit salut protecteur, Bokel quitta la boutique, laissant le rôtisseur déjà occupé à choisir les volailles avancées qu’il coulerait, le soir même, à la famille Dumouchet, et, à chaque croupion qu’ai flairait, répétant avec enthousiasme:
Cependant le tailleur, aussi vite que le permettait sa grosse masse, avait remonté la rue Saint-Jacques. Chemin faisant, il souriait et se frottait les mains en murmurant:
—Machiavel n’aurait pas inventé mieux! Pendant que ce rôtisseur va gaver à gogo le Dumouchet et lui donner du ventre, moi, je me charge, si la chose est encore possible; de faire maigrir Timoléon... J’en suis pour mes deux billets de mille francs, mais qui ne risque rien n’a rien.
Un quart d’heure après, il reparaissait chez Timoléon Polac; qu’il trouva arpentant sa chambre d’un pas impatient qui rappelait celui des bêtes féroces du Jardin des Plantes quand on tarde trop à leur apporter leur pâture.
—En route! cria-t-il gaiement au jeune homme.
—En route... pour la soupe? dit Timoléon, qui, avant de se mettre en marche, tenait à bien préciser le but de sa sortie.
—Mais oui, mais oui, redit gentiment le tailleur avec une petite risette. En arrivant à la maison, nous allons trouver le couvert mis et Paméla nous attendant.
Après avoir suivi une rue de traverse pour n’avoir pas à repasser devant la boutique du rôtisseur, Bokel prit, avec Timoléon, le chemin de son domicile. Marchant côte à côte, l’un si maigre et si long, l’autre si court et si rond, ils avaient l’air à eux deux d’un bilboquet en voyage. Tant courtes que Polac s’efforçât de faire ses enjambées, elles étaient encore trop grandes pour les petites jambes du tailleur et le contraignaient à un trot de chasse qui l’essoufflait.
Quand on arriva au Pont-Neuf, Bokel poussa un ouf! douloureux et prit racine sur le trottoir. Il fut au moins deux bonnes minutes à retrouver son haleine.
—Etes-vous fatigué, mon cher bienfaiteur? demanda le jeune homme quand il le vit en état de parler.
—J’avoue que je m’assiérais volontiers.
—Voulez-vous que nous entrions dans le café que je vois là-bas, au bout du pont? Nous y ferons d’une pierre deux coups, proposa Timoléon.
—Que voulez-vous dire avec vos deux coups?
—Pendant que vous vous reposerez à l’aise, moi, j’avalerai une tasse de chocolat... Rien ne m’ouvre l’appétit comme une tasse de chocolat.
—Y pensez-vous? Dans une heure à peine, nous serons à table, objecta le gros homme.
—Mettons que je n’aie rien dit, accorda stoïquement le jeune homme en imposant silence à la révolte de son estomac.
—Je ne refuse pourtant pas de faire d’une pierre deux coups, reprit Bokel, dont l’œil, pendant ce dialogue, avait inspecté le Pont-Neuf, qui, à cette époque, était encore une sorte de champ de foire où abondaient les charlatans, bateleurs, marchands d’orviétan, chanteurs, frituriers et autres industriels forains.
—Ah! vous approuvez alors la tasse de chocolat? demanda Timoléon, se raccrochant à l’espérance.
—Non, pas précisément.
—Alors comment prétendez-vous faire d’une pierre deux coups?
—Mais d’abord en m’asseyant dans un excellent fauteuil, où je me reposerai.
—Bon, voilà le premier coup de la pierre... quel est le second?
—Et, étant assis, savoir combien je pèse, dit le tailleur en montrant du doigt, à vingt pas de là, une bascule à fauteuil dont une vieille femme était en train d’épousseter les housses en calicot rouge.
—Allons! prononça Timoléon, jugeant inutile de s’opposer à cette lubie du poussah de se peser en plein air.
Si vous aviez vu comme l’œil de Bokel pétillait d’une malice contenue quand il posa ses vastes... charmes dans le fauteuil, qui, du reste, fit entendre un craquement, vous auriez immédiatement deviné qu’il y avait préméditation chez le gros madré et qu’il éprouvait la satisfaction intime d’un homme arrivé à ses fins.
—Deux cent quarante-cinq livres, annonça la vieille femme d’une voix pleine d’admiration respectueuse.
—A vous, jeune homme, dit Bokel après s’être dégagé avec effort du fauteuil où ses formes s’étaient trop exactement emboîtées.
—Oh! après vous, ce serait fatuité de ma part, répondit Timoléon avec une fausse modestie.
—Ta, ta, ta, fit le tailleur en poussant le récalcitrant sur le fauteuil.
Quoiqu’il eût le sourire aux lèvres, le cœur battait ferme à Bokel pendant que la vielle femme interrogeait le cadran de son appareil.
—Il doit peser dans les quatre-vingts livres... Ce serait trop demander au ciel que de souhaiter soixante-quinze livres... car il a les os forts, trop forts même, se disait le tailleur avec angoisse.
Quant à Timoléon, que le fauteuil, qui avait gémi pour Bokel, balançait avec un doux mouvement d’escarpolette, il se prêtait à la chose avec cette complaisance qu’on doit aux fantaisies d’un tailleur qui donne des notes acquittées, glisse des billets de mille francs et offre un dîner à ses clients véreux.
Après avoir attendu l’arrêt de l’aiguille du cadran, la vieille se redressa et d’un ton dédaigneux:
—Soixante et onze livres, dit-elle.
Toute la grasse personne de Bokel eut un frémissement de joie à cette déclaration.
—Soixante et onze livres! répète-t-il d’une voix tremblante, vous ne vous trompez pas, madame?
—Vérifiez vous-même, dit la femme en montrant le cadran.
—Oui, c’est la vérité, déclara le tailleur après avoir examiné l’aiguille.
Et, comme Polac voulait se lever du fauteuil, il le repoussa doucement sur le coussin et se mit à le regarder avec des yeux humides de tendresse et en balbutiant:
—Timoléon, mon cher Timoléon...
Mais l’émotion lui serrait trop la gorge; il n’en pouvait dire plus long. Il se contentait de repousser le jeune homme sur le fauteuil à chaque tentative pour se lever et le couvait toujours du même regard attendri en répétant:
—Timoléon, mon cher Timoléon.
Un peu abasourdi par cette scène, Polac consentit à rester sur le fauteuil, attendant que la parole sortît enfin de la bouche du tailleur et se disant:
—Qu’est-ce qu’il lui prend? Quelle drôle de maladie! Depuis le commencement je me doutais bien qu’il est devenu fou... Pourvu que je dîne!
—Débarrassez donc le plateau! criait la propriétaire de la balance en poussant Polac dans le dos.
Enfin Bokel parut être maître de son émoi. La salive revenue sur sa langue lui permit de balbutier d’une voix douce:
—Timoléon, je crois que vous sauriez rendre une femme heureuse.
—Je le crois aussi, avoua Polac, moins par fatuité que par condescendance pour l’accès de démence qui, selon lui, se déclarait chez le tailleur.
—... Et qu’un beau-père serait fier de vous, continua Bokel.
Pendant qu’il était en train de flatter la folie de son homme, Polac lui servit bonne mesure.
—Chaque matin, répondit-il, je me lèverais en me demandant: Comment rendre mon beau-père fier de moi? Ce serait ma préoccupation de toutes les heures.
—Débarrassez donc le plateau! criait toujours la vielle de la balance.
—Timoléon? dit-il.
—Bokel?
—Veux-tu être mon gendre?
Polac n’hésita que le temps juste de se dire:
—Je recommanderai à sa fille de le coucher de bonne heure après lui avoir fait prendre un bain de pieds bien chaud.
Et il se jeta dans les bras qui lui étaient tendus en s’écriant:
—Ah! Bokel, vous êtes une vraie pluie de bienfaits!
Puis, comme c’était un garçon qui, dans toutes choses, ne perdait jamais de vue le côté positif, il ajouta:
—Si c’est un rêve, ne me réveillez pas, car je vous dirais: Allons dîner!
—Oui, allons dîner. Paméla doit s’impatienter, répondit le tailleur.
Et les deux hommes se remirent en route, chacun faisant à part sa réflexion.
—Quelle singulière toquade! M’offrir d’être son gendre parce que je pèse soixante et onze livres! pensait Polac, ne prenant pas le moins du monde au sérieux ce qui venait de se passer.
De son côté, le tailleur se disait:
—J’ai assez bien joué mon rôle.., Je le tiens!... Soixante et onze livres! il faudra que je veille à ce qu’il ne bouge point de ce poids-là.
Quand ils furent dans l’escalier de sa maison, Bokel s’arrêta pour faire la leçon au jeune homme.
—Timoléon, dit-il, voulez-vous que je vous enseigne un moyen de plaire à votre future? Ne mangez pas beaucoup à table; Paméla n’aime pas les gros mangeurs... Peut-être trouverez-vous qu’elle-même mange d’une belle force... Méfiez-vous! C’est un piége qui vous sera tendu.
Mademoiselle Paméla attendait les deux dîneurs sous les armes, c’est-à-dire dans une toilette fraîche et claire qui la rendait vraiment charmante. Que ventre affamé n’ait pas d’oreilles, nous n’y contesterons pas, mais, à coup sûr, il a des yeux, car Timoléon, si fort en appétit qu’il était, quand il vit le gracieux minois de la jeune fille, eut cette pensée de regrets:
—Quel malheur que son père me l’ait proposée dans un accès de folie! Si cela avait été sérieux, j’avoue que j’aurais volontiers descendu le fleuve de la vie avec cette belle petite camarade-là dans ma barque.
Après les salutations, Bokel s’était hâté d’attirer sa fille dans la pièce voisine.
—Comment le trouves-tu? demanda-t-il.
—C’est un vrai mât, répondit franchement Paméla.
—Le fait est qu’il est un peu élancé... Une baguette d’osier, je le confesse... mais, tu sais, une baguette, ça n’en plie que plus facilement dans les mains d’une femme adroite.
—Vrai! il est par trop maigre! répéta la jeune fille encore sous la première impression.
—Je te l’ai choisi exprès aussi... svelte. Lis les meilleurs auteurs, mon enfant, et tous te diront que le mariage engraisse les hommes... qu’il les engraisse même énormément.
A l’appui de son dire, Bokel crut devoir joindre une preuve convaincante. Il fit tourner sa grosse personne sous les yeux de Paméla en disant:
—Tiens, moi qui te parle, quand j’ai épousé ta mère, ma taille tenait entre ses dix doigts... Eh bien, tu vois comme le mariage m’a profité!
Puis, cessant son mouvement de toupie:
—Oui reprit-il, le mariage engraisse, c’est un fait acquis... Aussi qu’arrive-t-il? C’est que, bien souvent, une jeune fille à illusions, qui avait épousé un jeune homme bien campé, à formes parfaites, à l’allure étoffée, s’est étonnée, au bout de quelques années de mariage, de voir son mari, tout au plus après la trentaine, s’épaissir, se déformer, s’alourdir par l’embonpoint et, bientôt, ne plus rappeler en rien l’élégant cavalier de la lune de miel... Timoléon obéira donc à la loi commune. Mais, au moins, avec lui, tu as de la marge... il a tant à faire, pour être seulement potelé, que tu es à peu près certaine de conserver un mari de tournure dégagée par-delà la cinquantaine.
A ce plaidoyer sur l’effet du mariage, Bokel, voyant sa fille encore hésitante, ajouta cette péroraison, qui, selon lui, était irrésistiblement concluante:
—Crois-en ton père, ma fillette, oui, le mariage engraisse. Mon état de tailleur me permet d’en parler savamment. Si tu savais le nombre de clients que je fournissais quand ils étaient garçons et que j’ai continué d’habiller après leur mariage... tous, d’anciennes tailles de fée dont, maintenant, il me faut, tous les six mois, élargir les ceintures de culotte.
Après avoir ainsi fait entendre la voix sévère de la raison doublée de l’expérience, Bokel fit vibrer des cordes plus douces.
—Et puis, reprit-il d’une voix câline, vois-tu, ma mignonne, un mari maigre, ça s’entoure plus facilement de soins et de prévenances.
Toute jeune fille, rêvant mariage, s’est créé d’avance l’idéal qui obtiendra le doux oui de son cœur. Timoléon répondait si peu aux espérances secrètes de Paméla que, malgré les flots d’éloquence que venait de dépenser le papa, elle continua de secouer la tête d’une façon qu’il était impossible de prendre pour un consentement.
—Mille boutons! va-t-elle le refuser! se demanda le tailleur alarmé.
Aussi se hâta-t-il de remonter à l’assaut.
—Timoléon Polac, reprit-il, est un garçon de bonne famille, bien élevé, instruit, gai...
—Ah! il est gai? dit Paméla dont le caractère n’engendrait pas la mélancolie.
—Gai au possible! Avec lui la vie ne sera qu’une chanson... Ah! à propos de chanson, il te fera des romances, car il est poëte et musicien.
Nous avons oublié d’annoncer que la fille du tailleur tapotait du piano, cette maladie que des familles cruelles donnent à toutes les demoiselles à marier... ce crime qui en est encore à attendre de notre législation une pénalité sérieuse.
De ce qu’elle taquinait la dent d’hippopotame d’un doigt plus ou moins alerte qui allait tirer des entrailles du piano des borborygmes bruyants, Paméla se croyait musicienne.
Donc, la gaieté et la musique furent les deux premiers atomes crochus qui s’incrustèrent, en faveur de Polac, dans le cœur de Paméla.
Le ciel a voulu que les femmes, même les pianistes, soient toutes vulnérables par la sensibilité. Ce fut sur ce point faible que Bokel, qui, sous sa couche de graisse, cachait une certaine science du beau sexe, porta sa nouvelle attaque.
—Ah! oui, reprit-il, mon jeune homme est d’une gaieté vraiment inaltérable... Tiens, tu l’as vu souriant, n’est-ce pas? Eh bien, croirais-tu... je te le dis en confidence... qu’il n’a pas mangé depuis deux jours?
—Il a donc une maladie qui lui ôte l’appétit? demanda la jeune fille dont la sensibilité s’éveilla.
—Bien au contraire! la maladie dont il souffre donne un violent appétit... car elle s’appelle la misère.
—Ah! le pauvre garçon! s’écria Paméla d’une voix qui attestait une profonde pitié.
Puis, tout aussitôt, sa bonne âme, remuée au possible, lui fit ajouter:
—Si je disais à Gertrude de corser notre dîner d’une forte omelette au lard.
—Non, n’en fais rien, fit vivement le tailleur. Il est pauvre, mais fier. Cette prévenance, dont il s’apercevrait, le froisserait péniblement.
Une réflexion lui étant subitement montée à l’esprit, mademoiselle Bokel était devenue pensive.
—Qu’as-tu donc, Bichette? demanda le père.
—Je réfléchis, papa.
—A quoi?
—A ce que tu me dis maintenant de ce jeune homme après ce que tu m’en as conté ce matin.
—Que t’ai-je donc conté?
—Qu’il avait cinq millions en mariage.
—T’ai-je dit «qu’il avait»... alors il y a eu erreur de ma part, j’aurais dû dire «qu’il aura». Oui, il aura cinq millions, je te l’affirme... Et le plus étonnant de la chose, c’est qu’il ne se doute pas de la fortune qui va lui tomber sur la tête.
—Et tu ne l’en préviens pas!
—Je m’en garderais bien! Il commettrait quelque imprudence qui lui ferait tout perdre... Aussi je ne saurais trop te recommander de ne pas lui souffler mot de ce brillant avenir que tu partageras... Fie-t-en à ton père, qui, par ses efforts, saura faire arriver ces millions à ton mari.
—Oh! mon mari, mon mari... il faut d’abord qu’il me plaise, répondit Paméla, peu décidée par la perspective des millions. Disons, pour l’excuser, qu’elle était à cet âge heureux et bête où l’on n’est pas encore persuadé que, si la fortune n’est pas le bonheur, elle lui ressemble diantrement, car la sagesse des nations a prouvé qu’il est plus agréable de se contenter de tout que de peu.
Mais, dans son cœur qu’elle prétendait encore fermé à Polac, il s’était glissé, à l’insu de Paméla, ce sentiment de pitié, dont nous avons parlé, qui la fit s’écrier:
—S’il n’a pas mangé depuis deux jours, il faut, bien vite, faire servir la soupe.
Et, suivie de son père, elle rentra dans la pièce où attendait Polac, qui, pour prendre son mal en patience, s’était retracé tous les charmes de Paméla en se disant:
—Vous offrir sa fille quand on est sur une balance, ce n’est pas sérieux... Et, vraiment, c’est dommage, car elle est séduisante, cette brunette.
Père et fille venaient à peine de faire leur apparition qu’une autre porte s’ouvrit pour laisser passer la tête de Gertrude, qui, suivant sa façon d’annoncer que le potage était servi, prononça ces mots:
—Mademoiselle est dans les assiettes.
—Je montre le chemin, dit Paméla en se dirigeant vers la salle à manger.
Bokel retint Timoléon, qui allait suivre la jeune fille et lui souffla vite à l’oreille:
—Vous savez? je vous ai prévenu. Méfiez-vous du piége. Ne mangez pas trop.
Nous n’attarderons pas notre récit à détailler la salle à manger du tailleur. Elle n’avait vraiment de remarquable qu’un tableau que son auteur, peintre sans le sou, avait donné à Bokel en acquit de compte. C’était un Ugolin dévorant ses enfants. Le tailleur, ayant décidé que c’était un sujet qui poussait à l’appétit, lui avait accordé la plus belle place dans sa salle à manger.
On aurait, croyons-nous, plus de chance d’être obéi en commandant à un singe de ne pas faire de gambades qu’en ordonnant à un affamé de deux jours de modérer son appétit. Malgré l’avis reçu et, surtout, parce-qu’il ne prenait pas au sérieux la scène de la balance, Timoléon s’escrima si bien sur les plats du dîner que Paméla, qui était, nous l’avons dit, une vaillante fourchette, s’arrêta pour l’admirer. Bokel avait beau faire les gros yeux à son convive et lui allonger, sous la table, des coups de pied qui le rappelaient à la prudence, le jeune homme ne recula pas d’une seule bouchée. Notons aussi que Polac n’était pas de ces mangeurs sombres, taciturnes, concentrés, qui dévorent silencieusement un morceau, les yeux fixés sur celui qui va suivre. Pas du tout. La bouche archi-pleine, il eût parlé. Aussi, spirituel de nature et, de plus, émoustillé par un dîner plantureux, il fut si drôle, si gai, si vraiment bonne et franche nature que (explique qui voudra le cœur de la femme et les mobiles qui y font naître la haine ou l’amour), que Paméla, disons-nous, tout en croquant son dernier fruit du dessert, fit à son papa un petit signe qui voulait clairement dire:
—J’accepte ce mari-là.
Musicien! poëte! homme d’esprit! joyeux luron et fort mangeur! que voulez-vous? Elle était subjuguée... Ajoutons à sa louange que l’avenir, tout doré de millions, ne pesa en rien sur sa décision, car, pas un instant, elle n’y songea.
Au signe de son enfant, Bokel se leva de table et prit un petit temps pour se donner un air gravement ému.
—Est-ce qu’il va chanter? se demanda Timoléon en le voyant se recueillir.
Ayant mis une main dans son gilet comme s’il éprouvait le besoin de comprimer les bondissements de son cœur, le front radieux, enfin beau et digne, Bokel, avec une voix dans laquelle il croyait avoir fait passer toute son âme, mais qui, en réalité, avait l’air de sortir de ses bottes, prononça cette phrase:
—Mon cher Timoléon, je vous autorise à embrasser votre fiancée.
Polac, en entendant la permission qui lui était octroyée, crut à un retour de folie du tailleur. Mais, nous l’avons dit, c’était un véritable «va comme je te pousse» qui aimait beaucoup mieux embrasser une jolie fille que le fond d’un chaudron. Eût-il même voulu hésiter qu’il y eût été décidé par la joue fraîche et rose du feu de la pudeur que lui tendait franchement Paméla.
—Laissons-nous faire, se dit-il.
Et il campa sur le visage de la jeune fille un si sonore et bon baiser que mademoiselle Bokel en poussa un petit cri de fauvette effarouchée.
Toujours majestueux, toujours la main dans son gilet, Bokel reprit la parole:
—Inutile de vous dire, mon gendre, que dès ce moment, vous êtes de la maison. Vous resterez avec nous jusqu’au jour du mariage. Ma table sera la vôtre et je vais, de ce pas, vous faire préparer une chambre à l’étage au-dessus.
Comme le hasard, probablement, avait mis dans la main de Polac celle de Paméla, et que le jeune homme sentit les doigts mignons de le jeune fille, par une douce pression, lui commander l’obéissance, il se répéta encore:
—Laissons-nous faire.
Puis à haute voix:
—Agissez comme vous l’entendez, cher et estimable beau-père.
Cinq minutes après, quand il revint, Bokel trouva les deux jeunes gens échangeant ces phrases niaises, communes à tous les amoureux. Pourtant, si insignifiant qu’avait été l’entretien, Polac trouva que l’absence du père aurait pu être moins courte, car, séduit par la gentillesse de Paméla, il se surprit à se dire:
—Eh! eh! ne prenons pas la chose au vrai, car je m’en amouracherais... Elle est ravissante.
Le tailleur vint à sa fille et, après l’avoir embrassée au front, il dit en souriant:
—Tu comprends, Paméla, que Timoléon et moi nous avons à parler sérieusement. Nous allons donc te laisser à ton piano et nous retirer dans mon cabinet, où nous nous entretiendrons, tout en dégustant notre moka... car, vous prenez du café, n’est-ce pas, mon gendre?
—Oui, beau-père.
—Vous allez en goûter un dont vous me direz des nouvelles... Je le brûle et le fais moi-même, et j’ai la prétention de croire que, nulle part, on ne le boit plus exquis.
Après cet éloge de son café, Bokel, en montrant la porte de son cabinet qui ouvrait sur la salle à manger, ajouta:
—Le temps de donner encore un baiser à mon enfant et je vous suis, mon cher Polac.
Le jeune homme aurait volontiers donné aussi un second baiser, mais, faute d’y être invité, il se contenta de saluer et pénétra dans le cabinet, où, sur la table, une cafetière fumait entre ses deux tasses.
—J’espère que tu ne lui as pas parlé des millions pendant mon absence, souffla le père à sa fille aussitôt que Polac eut disparu.
—Non, papa.
—Ne t’avise pas d’en rien dire, car il croirait que tu as voulu l’épouser pour sa fortune.
—Sois tranquille, papa, je serai muette.
Sur cette promesse de sa fille, le tailleur vint rejoindre Timoléon.
La porte n’était pas plutôt refermée sur Bokel que le jeune homme demandait à brûle-pourpoint au tailleur:
—Voyons, Bokel, quand finira votre plaisanterie?
—Quelle plaisanterie?
—Celle qui dure depuis ce matin; la note acquittée, le billet de mille francs, les habits neufs, le dîner et cette singulière idée d’avoir l’air de m’accorder la main de votre fille... Dans le commencement j’ai bien voulu me prêter à l’aventure, car, je vous l’avoue, je vous supposais le cerveau fêlé... Mais, maintenant que la chose prend de telles proportions, je désire y mettre un terme, car... car...
Et, après avoir hésité à mettre la vraie phrase au bout de son car, Timoléon y ajouta cette variante:
—Car elle est vraiment délicieuse, votre fille.
—Ce qui signifie que vous ne voulez pas en être amoureux.
—Non, mais j’ai peur de le devenir.
—Eh bien, quel mal voyez-vous à aimer votre femme?
—Ah çà, est-ce que nous allons recommencer la comédie du gendre et du beau-père!... J’en ai assez, je vous le repète, dit Timoléon de la voix brève d’un homme agacé.
—Mon cher ami, voulez-vous me permettre de vous faire une proposition? répliqua Bokel en souriant à cette boutade.
—Laquelle?
—Celle de vous signer ici, séance tenante, un dédit de dix mille francs pour le cas où je reviendrais sur ma parole de vous prendre pour gendre.
—Alors, sérieusement, vous m’accordez Paméla?
—Oui, si elle vous plaît.
—Parbleu! oui, elle me plaît.
—Eh bien, laissez-moi donc vous appeler mon gendre tout à l’aise et buvons notre café pendant qu’il est chaud.
Ce disant, Bokel avait pris la cafetière.
—Goûtez-moi cela! un vrai nectar, ajouta-t-il après avoir empli la tasse de Polac.
Mais Polac avait bien d’autres soucis que de savourer du café et de s’apercevoir que, de ce nectar tant prôné, Bokel ne s’était versé que quelques gouttes.
—Mais, reprit-il en insistant, pourquoi m’avoir choisi, moi, précisément moi, qui n’ai ni le sou ni métier?
Bokel lâcha un bon gros rire tout bonhomme et répondit:
—Vous venez justement de dire le motif qui me guide.... Parce que vous n’avez ni le sou ni métier.
Et il avança la cafetière en disant:
—N’est-ce pas qu’il est bon, ce café?
—Ma foi! je l’ai bu sans y faire attention.
—Alors, une seconde tasse.
Pas plus que l’autre, cette tasse ne fut appréciée par Timoléon. Au moment où il la portait à ses lèvres, le tailleur lui demandait:
—Voulez-vous que je ne fasse pas de cachotteries avec vous... que je joue cartes sur table?
—Certainement, dit Polac en ingurgitant le café à la hâte, pour être tout oreilles à la confession que lui proposait le gros homme.
Bokel prit une mine navrée et d’une voix dolente:
—Eh bien, la, vrai, dit-il, je crois que je mourrais s’il me fallait me séparer de ma fille. Quand elle m’a avoué qu’elle avait du goût pour le mariage, elle m’a percé l’âme. Que je la marie à un époux riche ou à un commerçant, il lui faudra suivre son mari. Vous me direz qu’en l’unissant à un tailleur que j’associerais à mon commerce, mon but serait atteint... Oui, mais mon enfant a été éduquée un peu trop en princesse; elle dédaignerait un tailleur... Avec vous c’est autre chose. Vous êtes bien élevé, poëte, musicien; bref, vous avez un tas de manigances qui séduisent les femmes. Aussi, voyez-vous que Paméla a lâché son oui sans se faire prier.
—Bon, mais, je le répète, je n’ai ni métier ni fortune.
—C’est justement pourquoi, je vous le répète aussi, je vous donne ma fille. Suivez bien mon raisonnement. Sans métier, vous n’aurez donc d’autre occupation que de faire le bonheur de mon enfant. Sans fortune, vous ne dépendrez que de moi. Je vous donnerai la table, le logement, un peu d’argent de poche. Je fournirai aux dépenses du ménage... Mais pas un sou de dot, ce qui vous mettra dans l’impossibilité d’aller vivre ailleurs avec votre femme. De cette façon, je suis certain, tout en la mariant, de ne pas me séparer de Paméla... Vous me direz que c’est de l’égoïsme, soit! mais telles sont mes conditions; les acceptez-vous? Tout cela vous explique pourquoi j’ai eu l’air de vous jeter ma fille à la tête.
Au fond, que demandait Polac? De connaître la raison qui, depuis le matin, faisait si généreusement agir le tailleur à son égard. Celle qu’on lui donnait était des plus croyables. Il est vrai que ce rôle de mari en tutelle, de gendre en épinette, était un peu humiliant; mais d’un autre côté, Paméla, dont il entendait rugir le piano, était si jolie, si séduisante, etc., etc., que l’humiliation avait une agréable compensation. Et puis, ne pouvait-il pas espérer qu’il parviendrait à se faire tant adorer de sa femme qu’elle serait son alliée dans la guerre d’indépendance qu’on déclarerait plus tard à ce papa égoïste qui prétendait être en tiers dans le ménage?
Il arriva que Timoléon qui, deux heures auparavant, aurait juré que Bokel avait le cerveau fêlé, trouva, grâce à l’explication, sa conduite des plus naturelles, et ne vit plus en lui qu’un père qui s’y était adroitement pris pour marier sa fille à sa convenance.
Aussi, quand Bokel, qui l’avait laissé réfléchir, lui tendit la main en demandant:
—Oui ou non, voulez-vous être mon gendre?
Il s’empressa de toper en s’écriant:
—Accepté! beau-père.
Mais, en même temps, un souvenir lui vint. Tout lui parut expliqué, sauf un point.
—Voyons, beau-père, reprit-il, dites-moi donc pourquoi vous avez choisi, pour m’offrir votre fille, l’instant où j’étais sur la balance qui venait d’accuser mon poids de 71 livres!
Bokel était un gaillard qui ne se laissait jamais surprendre sans vert, car, tout aussitôt et sans la moindre hésitation, il répondit:
—Par gourmandise.
Et, comme Polac le regardait avec des yeux étonnés qui réclamaient des détails, il poursuivit:
—Imaginez-vous que Paméla, qui trouve que j’engraisse trop, s’est mis en tête d’enrayer mon obésité en me privant de pâtisseries, plats farineux, sucreries et autres mets féculents dont je raffole. En lui donnant un mari aussi maigre que vous, elle mettra à honneur de le remplumer et, alors, reparaîtront sur la table un tas de gobichonnades dont il faudra bien que j’aie ma part.
Cette explication était donnée avec un gros rire tout sensuel. Les yeux du poussah reluisaient de gourmandise, et le bout de sa langue se promenait sur ses lèvres comme s’il se léchait les babines après un plat sucré.
—Ah! je n’entends plus le piano, fit alors remarquer Timoléon.
—C’est que ma fille est allée se coucher. Nous ferons bien de l’imiter, car il se fait tard... Je vais vous conduire à votre chambre, répondit le tailleur.
Sur la route qui menait à la chambre de son futur gendre, Bokel, en homme prévenant qui tient à ce que ses hôtes n’aient rien à désirer, montra à Timoléon, au bout du couloir, une certaine petite porte en prononçant ces deux mots:
—C’est là.
Après avoir quitté le jeune homme, quand Bokel redescendit chez lui, il souriait en murmurant:
—Je l’ai roulé avec mes explications de papa qui ne veut pas se séparer de sa fille... il va épouser de confiance... et, seulement, le lendemain du mariage, lorsqu’il sera trop tard pour nous brûler la politesse, il apprendra la vraie vérité.
De son côté, Timoléon se disait entre deux draps:
—Pourquoi, diable! m’étais-je figuré que Bokel était fou? Tout ce qu’il m’a dit là est bien clair, bien net... C’est un papa fort égoïste, mais très-sensé.
Puis il s’endormit.
Mais deux heures après, il s’éveilla en proie à un violent trouble intestinal.
—Qu’est-ce cela? se dit-il. Ah! j’y suis! c’est parce que j’ai mangé à ma faim... manque d’habitude!
Et plusieurs fois, pendant la nuit, il utilisa le petit renseignement que lui avait donné le prudent Bokel.
Le lendemain, Bokel, qui était sorti de bonne heure, ne rentra qu’à l’heure du déjeuner. Il trouva les fiancés jouant sur le piano un morceau à quatre mains. A six notes près, Paméla suivait Timoléon. C’était une mélodie à faire hurler un sourd de douleur.
—Mes enfants, je viens de m’occuper de vous, annonça le tailleur. Je ne suis pas de ces parents barbares qui font languir les amoureux. Aussi me suis-je dit qu’il fallait abréger les délais de bans et publications autant que la loi le permet. Je vous annonce donc que dans dix jours vous serez mariés... A moins que vous n’ayez changé d’avis depuis hier.
—Oh! papa, peux-tu dire... s’écria la jeune fille en forme de protestation.
—Dame! mignonne, tu sais le proverbe. La nuit porte conseil, répliqua le tailleur en riant.
Puis, vivement, à Timoléon:
—A propos de nuit, mon cher ami, comment avez-vous passé cette première nuit sous mon toit?
Parler devant Paméla de ses promenades nocturnes, c’eût été, de la part de Polac, mêler trop de réalisme à la poésie de ses amours.
—Je n’ai fait qu’un somme, répondit-il.
—Ah! vraiment! dit Bokel, d’un ton dans lequel un observateur aurait relevé une pointe d’étonnement.
—Ou plutôt, reprit galamment Timoléon, je n’ai fait qu’un long rêve où je me voyais déjà marié.
—Ah! vous avez bien dormi... alors, tant mieux! tant mieux! Je craignais que le changement de chambre, de lit, d’habitudes ne vous eût tenu éveillé, dit Bokel, qui, tout en feignant de se moucher, observait la contenance du jeune homme.
—Du tout, du tout, reprit tranquillement Timoléon, je me souhaite d’avoir toujours de pareilles nuits.
—Tant mieux, tant mieux! répéta le tailleur.
Mais ses lèvres mentaient, car, en lui-même; le gros homme se disait:
—Il est donc bâti en fer, ce garçon-là?.. il faudra que je lui double la dose.
Nous croyons inutile de conter un à un, et par le menu, ces dix jours pendant lesquels Polac fit sa cour. Nous ne parlerons pas plus de la série de repas de famille où Timoléon ouvrit la plus vaste carrière à son appétit sans qu’aucune observation lui fût faite par son futur beau-père, qui semblait avoir pris le parti de le laisser dévorer à sa faim. Disons seulement que Bokel s’était subitement pris d’une belle passion pour les morceaux de piano à quatre mains, qui demandait à être satisfaite le soir, après dîner.
—Allons, mes enfants, disait-il sitôt le dessert mangé, jouez-moi mon morceau à quatre mains pendant que je m’occupe du café.
En effet, la musique durant, il passait son café au filtre, le versait, le sucrait, de sorte que Timoléon, quand la dernière note vibrait encore, voyait le tailleur s’approcher du piano, lui tendre une tasse pleine en répétant cette phrase invariable:
—Acheté, choisi, brûlé, moulu, passé par moi. J’ai la prétention justifiée de dire que, nulle part, il ne s’en boit de plus exquis.
Et il restait là, attendant que Polac eût avalé tout le contenu de sa tasse comme s’il quêtait un compliment... Ce que, du reste, Timoléon ne lui faisait jamais attendre car, non moins invariablement, il répétait aussi:
—Je n’ai jamais bu du café ayant un goût pareil.
Phrase, il faut le dire, à laquelle le jeune homme ajoutait un sens sous-entendu, car, en lui-même, il ne manquait pas de se dire:
—Respectons sa manie de croire qu’il fait de bon café... mais, sacrebleu! quelle drogue!... Il est rudement vrai que je n’en ai jamais bu ayant un tel goût.
Si grand amateur de piano agacé par quatre mains que fût devenu Bokel, il faut reconnaître qu’il n’était pas de ces fanatiques qui abusent des exécutants. Une fois le morceau, pendant lequel il préparait son café, terminé, il tenait Timoléon et sa fille quittes de tout nouveau vacarme et, engourdi par la torpeur d’une douce digestion, il laissait les jeunes gens à leur bavardage amoureux.
Donc, ces dix jours, qui précédèrent le mariage, s’écoulèrent dans un calme uniforme. Nous ne trouvons à y glaner qu’une seule conversation, tenue l’avant-veille du mariage, qui n’était pas la répétition de ce qu’on avait dit et archi-répété depuis une semaine.
Entre la poire et le fromage du dîner, à propos de nous ne savons plus quoi, Paméla s’écria d’un petit ton résolu:
—Tu sais, papa, que je veux faire un voyage de noces!
Bokel, depuis huit jours, attendait-il cette phrase? Nous ne saurions le dire. Mais le fait est qu’il s’empressa de répondre avec une satisfaction visible:
—Mais telle a été toujours mon intention, ma chérie. Nous le ferons ce voyage de noces, sois-en certaine. J’ai déjà donné mes ordres au chef coupeur pour qu’il me remplace pendant mon absence.
Le projet de voyage avait souri à Timoléon. En entendant Bokel parler de venir en tiers dans ce chemin des amoureux où, dit un refrain, on n’est bien qu’à deux, il ne put retenir une légère moue qui échappa au tailleur, car, sans se douter qu’il était de trop dans ce futur déplacement, il reprit d’un ton bonhomme.
—Voyons, où irions-nous bien, fillette? Que dirais-tu d’une semaine passée à Fontainebleau?
—Non, fit Paméla d’un signe de tête.
—Ou à Montmorency?
Mademoiselle Bokel répéta son mouvement négatif.
—As-tu une idée, ma belle? Alors dis-la-moi, reprit le papa.
—Je veux voir la mer, déclara la jeune fille.
A cette époque, temps des coches et des coucous, le rêve de tous les Parisiens était de voir la mer au Havre ou de visiter la Suisse. Les commerçants trimaient pendant trente années avec cette espérance qu’un jour leur fortune acquise les mettrait à même d’aller voir la mer au Havre ou le lever du soleil sur le Righi. Un Parisien qui avait vu la mer ou le mont Blanc obtenait dans son quartier cette considération que les mahométans accordent à ceux de leurs coreligionnaires qui ont fait le pèlerinage de la Mecque.
Au désir exprimé par sa fille, une lueur de joie, qui n’eut que la durée de l’éclair, avait brillé dans l’œil de Bokel. On eût dit que le gras bonhomme attendait cette phrase.
—Oui, je veux voir la mer, répéta la jeune fille... Et vous, Timoléon?
—Du moment que vous le désirez, mademoiselle, j’aurais mauvais goût à ne pas partager vos souhaits.
—Et même, poursuivit Paméla, j’aimerais à me sentir assise dans une barque, mollement balancée par la vague.
C’était là, probablement, une balle que le tailleur guettait au bond, car il s’écria:
—Ah! tu aimerais à être balancée par la mer! Eh bien! tu seras balancée, je m’y engage! Non-seulement tu verras la mer, mais encore tu iras dessus... N’est-ce pas, Timoléon, que nous lui ferons faire un tour en mer?... Tiens! est-ce que ce projet ne vous plaît pas?
En effet, la figure de Polac, qui s’était épanouie tant qu’il avait été question de voir la mer sans quitter ce qu’on nomme le plancher des vaches, s’était rembrunie dès qu’il avait été parlé de se confier aux caprices du flot. A la question de Bokel, il répondit avec une franchise quelque peu embarrassée:
—C’est qu’il me faut vous avouer que je n’ai pas du tout le pied marin... La mer ne me réussit nullement... Au premier roulis, je suis obligé de me coucher dans mon cadre où, du moment du départ à celui de l’arrivée, je reste anéanti par le mal de mer... Jusqu’à ce jour mes voyages ont été de courte durée, mais je crois que, s’il me fallait naviguer pendant un mois, je passerais tout ce temps-là sans pouvoir avaler gros comme un pois de nourriture.
Il y eut une immense explosion de joie dans le ton avec lequel le tailleur s’écria imprudemment:
—Un mois sans manger!... Quelle chance!...
Puis, tout aussitôt, pour expliquer sa singulière exclamation, il se hâta de se reprendre en disant:
—Quelle chance ce serait pour un capitaine au long cours qui aurait vingt passagers comme vous!... Il ferait une fière économie sur la nourriture.
Ensuite, revenant à son sujet:
—Après tout, mon cher gendre, ne vous effrayez pas trop d’avance, car je n’entendais parler à Paméla que d’une simple et fort courte promenade en mer... par un temps de calme plat. Si la chose peut vous déplaire, nous y renonçons.
—Mais non, mais non, dit vivement Polac, il n’y faut pas renoncer. Je braverai le péril, car je suis certain que la présence de Paméla me rendra fort et vaillant.
Si insignifiante que cette conversation ait pu paraître à notre lecteur, nous avons été obligé de la relater tout au long, car elle prépare notre dénouement. Disons encore qu’elle avait fait à Bokel une impression des plus joyeuses, car, vingt fois, quand il était seul, il éclatait de rire en se répétant:
—Un mois sans manger! Quel atout dans mon jeu!.. quoique je regarde la partie des millions comme déjà gagnée!
Qu’avons-nous oublié encore de ce qui se passa dans les dix jours d’avant le mariage? Rien autre, il nous semble, que de dire qu’au désir exprimé par Polac d’annoncer son mariage à son cousin Dumouchet et de le prendre pour témoin, Bokel s’y était énergiquement opposé en alléguant cette étonnante raison:
—Non, non, il est trop malheureux... N’insultons pas à sa misère par notre joie... Ce serait manquer de cœur.
Tout en conseillant ainsi l’éloignement de Dumouchet, le tailleur était loin de prêcher d’exemple, car, la veille du mariage de sa fille, il se rendit chez le rôtisseur.
—Eh bien, quelles nouvelles de M. Dumouchet? demanda-t-il à l’homme aux volailles.
—Ah! monsieur, vous pouvez assurer au comité que son protégé se rend digne de ses bontés. M. Dumouchet engraisse à vue d’œil. Vous ne le reconnaîtriez pas.
—Comment a-t-il pris ce déluge de viande?
—Très-bien; je lui ai dit ce dont nous étions convenus... que je lui faisais crédit sur son brillant avenir, qui m’avait été annoncé par une tireuse de cartes... Alors il a joué sans scrupule des mâchoires... C’est plaisir d’avoir un gaillard pareil à l’engrais... Il profite en diable.
—Très-bien. Continuez et songez à la prime que vous réserve le comité.
Sur ce, Bokel était revenu chez lui et, suivant sa coutume de parler à mi-voix quand il réfléchissait, un passant à l’oreille fine aurait pu l’entendre qui murmurait:
—Pendant que le cousin engraisse, Polac se tient en jolie maigreur... Mon futur gendre m’a fait un instant peur en mangeant à gogo chez moi, mais j’y ai mis bon ordre à l’aide de mon café purgatif.
Ce gueux de Bokel disait juste. Si les jours, grâce à Paméla, faisaient la joie de Timoléon, les nuits causaient le désespoir du jeune homme, qui, à chacune de ses cinq ou six promenades nocturnes, se répétait:
—Décidément, ça ne me profite pas de manger à ma faim!
Disons encore que, pendant ces dix jours, M. de la Morpisel avait deux fois fait réclamer l’habit que Bokel avait promis de lui rapporter tout réparé sous quarante-huit heures.
Enfin arriva le jour où Polac et Paméla furent mariés.
Nous n’avons pas à détailler les pompes et les joies de la noce de nos jeunes gens. Ce fut, pour ainsi dire, un mariage à huis clos, grâce à Bokel, aussi partisan de l’économie qu’ennemi du fla-fla. A l’issue de la cérémonie, un déjeuner fut offert aux témoins de rigueur et à deux ou trois amies de pension de la mariée.
Et ce fut tout.
Ajoutons pourtant qu’à ce déjeuner dînatoire, Bokel s’abstint de s’occuper du café, dont la préparation fut abandonnée à Gertrude, ce qui amena Timoléon, après l’avoir bu, à faire cette réflexion burlesque:
—Il se peut que ce café soit moins bon que celui du beau-père, mais il est meilleur.
Nous passerons donc tout de suite au lendemain des noces, quand, à dix heures du matin, Polac, au sortir de la chambre nuptiale, se trouva nez à nez avec son estimable beau-père.
Le gros homme était en train de nouer les coins d’une toilette en serge noir qui enveloppait un habit.
—Savez-vous ce que vous devriez faire, mon gendre? demanda-t-il. Vous avez deux longues heures à dépenser avant que votre femme soit prête à déjeuner. Accompagnez-moi chez un client auquel j’aurais dû reporter cet habit depuis longtemps. Vous serez l’excuse vivante de mon retard. Je vous présenterai à ce client et, croyez-moi, c’est une bonne connaissance à faire que celle de M. de la Morpisel, notaire royal... Vous ne vous en repentirez pas.
Comme Bokel avait souri en prononçant les derniers mots sur lesquels il avait appuyé, Timoléon s’imagina que l’habit à reporter n’était qu’un prétexte.
L’espérance vint lui souffler que son beau-père avait un motif pour le conduire chez le notaire.
—Tiens! tiens! se dit-il, est-ce que maintenant qu’il est certain que je n’ai pas épousé sa fille par intérêt, il voudrait revenir sur sa promesse de ne pas me compter un sou de dot?... Ce manque de parole serait vraiment gentil de sa part.
Et, avec empressement, il répondit:
—Je vous suis, beau-père.
Quand les deux hommes arrivèrent chez M. de la Morpisel, le tailleur se garda bien de passer par l’étude. Il se présenta à l’entrée particulière, que vint lui ouvrir le domestique.
—M. de la Morpisel est-il occupé avec quelqu’un? demanda Bokel.
—Oui, mais ce quelqu’un-là est sans importance, et n’empêchera pas mon maître de vous recevoir.... Il y a bien aussi dans l’étude un inconnu qui attend son tour, mais il a l’air d’un pauvre diable fait pour avoir de la patience, dit dédaigneusement le valet.
—Alors nous vous suivons, dit Bokel, en marchant à la suite du domestique, qui, par les appartements du notaire, les conduisit au cabinet de M. de la Morpisel.
Ce dernier, quand il tourna la tête au bruit de la porte qui s’ouvrait, était en train d’écrire une lettre destinée sans doute à être emportée par un individu qui se tenait respectueusement debout auprès du bureau.
Le demi-tour de tête de M. de la Morpisel ne lui permit d’apercevoir que Bokel, dont d’ailleurs l’énorme masse faisait un rempart qui rendait invisible son gendre, marchant derrière lui.
—Ah! c’est vous, Bokel? dit le notaire; le temps d’écrire cette lettre, qu’on attend, et je suis à vous.
—A vos ordres, monsieur, répondit le tailleur, en faisant à Timoléon un signe de s’asseoir.
Quand lui-même eut placé sur sa chaise la partie de son individu sur laquelle il avait l’habitude de se poser, Bokel pensa alors à regarder le personnage qui attendait la lettre.
Ah! si vous aviez vu sa figure! elle tourna au rouge violet, tant une colère rageuse vint subitement la colorer. Là, devant lui, il voyait l’ignoble marin, le nommé Filandru, cet effronté drôle qui avait osé l’appeler «gras à tuer,» en disant qu’il ferait un bon bouillon dans la marmite du bord; ce mécréant enfin, dont la langue avait tenté de s’assurer s’il n’était pas en sucre.
Filandru avait aussi reconnu son homme. Il faut croire que le marin n’était pas fertile en plaisanteries et que, quand il en tenait une et la croyait bonne, il en abusait, car, immédiatement, sans se troubler, à la vue de la fureur muette de Bokel, il se mit à faire fonctionner à vide ses mâchoires de requin, en montrant le blanc jaune de ses yeux et en se frottant, de la main, le creux de l’estomac, en un mot toute la pantomime d’un glouton qui se pâme d’aise en mâchant un morceau de choix.
Bokel allait éclater si, à ce moment, M. de la Morpisel qui venait de finir sa lettre, n’avait, en relevant la tête, interrompu la grimace de l’impudent Filandru.
Après avoir glissé son mot sous enveloppe, le notaire y joignit une liasse de billets de banque en disant au marin:
—Du moment que mon client vous a envoyé, c’est qu’il a confiance en vous. Parce que vous me voyez mettre dans ce pli, vous jugez que vous devez bien veiller à ne pas le perdre ni à vous le laisser voler.
—Un rude malin que celui qui volerait Filandru! répliqua orgueilleusement le marin. Vous pouvez être certain que mon commandant aura la lettre dans deux jours.
—Il m’avait demandé de lui envoyer ces fonds en numéraire, mais la somme eût été d’un poids et volume trop embarrassants pour vous. Votre capitaine trouvera facilement à changer là-bas ces billets contre espèces en s’adressant au premier fournisseur de la marine.
—Dans une heure, lettre, billets et le beau garçon qui est dans ma peau seront en route, dit le marin en enfouissant l’enveloppe au plus profond de la poche de côté de sa veste d’uniforme.
Le notaire s’était levé et, tout en accompagnant Filandru vers la porte, il reprit:
—Il doit bien s’impatienter de rester ainsi en rade, votre commandant, lui qui, il y a une quinzaine de jours, quand il vint me faire ses adieux après avoir reçu l’ordre de rallier son bord au plus vite, croyait prendre immédiatement la mer.
—Il paraît que l’expédition n’est pas encore au complet... On attend un brick qui doit arriver de Brest. Il y a gros à parier que nous ne serons pas partis dans huit jours.
—Allons, bonne chance, mon brave! souhaita le notaire au marin qui franchissait le seuil du cabinet.
Après avoir refermé la porte, M. de la Morpisel revint vivement à Bokel en s’écriant:
—Et mon habit, homme sans parole! Vous m’aviez pourtant promis de me le...
Le notaire s’arrêta en apercevant alors Timoléon qui le saluait.
—J’ai pris la liberté, pour vous le présenter, de vous amener mon gendre, se hâta de dire Bokel.
—Ah! vous avez marié votre fille?
—Oui, depuis hier, elle est madame Polac.
Le notaire fit un saut en arrière.
—Polac! répéta-t-il d’une voix éclatante de surprise, vous vous nommez Polac, jeune homme?
—Oui, monsieur.
—Timoléon Polac... Hein? est-ce là votre prénom? Répondez, continua le tabellion avec la même vivacité.
—Oui, Timoléon Polac.
M. de la Morpisel se frappa le front, puis les cuisses, enfin le derrière. Il fit le télégraphe avec ses bras, eut l’air de s’envoler en agitant les coudes, claqua des mains, toussa, éternua, ricana, frétilla sur ses jambes comme un dindon qui danse sur une plaque de tôle brûlante, se refrappa sur le derrière, sur le front et les cuisses, tout cela avec cette joie qui, selon nous, doit être celle de l’homme qui découvre un merle blanc, et finit enfin par s’écrier:
—Mais, jeune homme, vous ne lisez donc jamais les journaux? Voilà dix jours que je vous réclame par la voix de toute la presse.
Bokel était resté calme pendant cette scène, qui avait ahuri Timoléon.
—Mon gendre a occupé ces dix jours à faire la cour à ma fille.
Le notaire était un homme positif, qui répliqua d’un ton péremptoire:
—Il n’y a pas fille qui tienne, fût-elle plus belle que Vénus, quand il s’agit d’encaisser des millions.
—Quoi! j’ai des millions à recevoir! bégaya Timoléon tout palpitant, ce qui, vu sa maigreur, lui donnait l’air d’un fil de fer qui vibre.
—Oui, cinq bons millions vous attendent.
Polac fut superbe. Il remit son chapeau sur sa tête et demanda:
—Où ça m’attendent-ils? J’y vais.
—Oh! oh! bien loin d’ici, annonça M. de la Morpisel en souriant à cette bonne volonté.
Timoléon ouvrait la bouche pour exprimer le dédain que lui inspirait la distance, quand trois coups furent frappés à la porte du cabinet, qui, tournant sur ses gonds, laissa passer une tête qui disait:
—En voyant sortir le marin, j’ai pensé que la place était libre et, comme c’est mon tour de passer, je me présente... M. de la Morpisel, s’il vous plaît!
Et l’arrivant fit un pas en avant, ce qui le mit en vue de Timoléon qui s’écria:
—Eh! c’est Dumouchet!
A ce nom, M. de la Morpisel se remit à gesticuler, à battre des ailes, à se claquer le postérieur jusqu’au moment où sa surprise un peu apaisée lui permit de s’écrier:
—L’autre! c’est l’autre!... Enfin je les tiens tous les deux!
Comme tous les gens tombés dans l’extrême misère, Dumouchet était devenu humble et timide. Pour rien au monde il ne se serait permis de rire de ce notaire royal métamorphosé en derviche tourneur. Ce fut donc quand M. de la Morpisel eut pleinement terminé ses exercices qu’il se risqua enfin à dire en présentant au tabellion un papier qui ruisselait de graisse:
—Le rôtisseur qui me fournit mes repas m’ayant, ce matin, monté des pommes de terre frites dans ce fragment de journal, le hasard a fait que j’y ai jeté les yeux. C’est alors que j’ai lu l’avis que vous donniez à MM. Timoléon Polac et Baptiste Dumouchet de passer à votre étude pour y entendre une communication importante.
Cela dit, Dumouchet salua M. de la Morpisel et ajouta:
—Je suis Baptiste Dumouchet... et je viens écouter la communication importante.
—Vous seriez entré une minute plus tôt que vous m’auriez entendu la faisant à votre cousin... Il s’agit de cinq millions qui vous attendent, répondit le notaire.
—Quoi, cinq millions! répéta Dumouchet, se sentant près de se trouver mal de bonheur.
Timoléon s’empressa de le soutenir.
—Oui, cousin, dit le nouveau marié, nous voici devenus riches... Chacun nos cinq millions!
Mais à ces mots M. de la Morpisel se mit à secouer la tête en disant vivement:
—Ah! non, ah! non, pas de malentendu, je vous prie. Je n’ai pas annoncé que cinq millions attendaient chacun de vous: ne persistez pas dans cette erreur. Je vais mieux préciser. Il y a cinq millions... cinq seulement, vous m’entendez, qui planent sur vos têtes, mais Ils ne tomberont que sur un seul de vous... c’est-à-dire sur celui de vous deux qui remplira une condition prescrite.
Mettez-vous à la place des deux cousins, et que, sans un petit trémolo préparatoire, on vous annonce brusquement qu’une pluie de millions va tomber sur votre tête. Votre premier mouvement sera de pointer le nez en l’air et d’ouvrir la bouche pour recevoir l’ondée bienfaisante. Puis, la réflexion arrivant, vous penserez alors à vous demander par quelle cause il se fait que ce nuage doré crève précisément sur votre individu.
Il en aurait, indubitablement, été ainsi des jeunes gens, si, au lieu d’attendre l’éveil de leur curiosité, M. de la Morpisel ne l’avait désagréablement hâtée en parlant de «cette condition prescrite» qui n’assignait qu’un élu au bonheur de palper les millions.
—Ah! il y a une condition prescrite? répétèrent ensemble les deux cousins à cette nouvelle inquiétante qui, comme une douche d’eau froide, calma le bouillant transport de leur satisfaction.
—Une condition formelle... qui ne fait qu’un seul heureux, déclara le notaire.
Nous aurions bel à mentir en assurant que la voix des jeunes-gens était d’un calme parfait quand, avec le même ensemble, ils demandèrent:
—Quelle est cette condition?
—Ne feriez-vous pas mieux de vous informer d’abord par qui cette condition a été exigée? dit le tabellion en riant.
Notons, en passant, que Bokel, pendant cette scène qui aurait dû vivement exciter son intérêt de beau-père, demeurait bien tranquille dans son coin. Son air, sa prestance, son sourire étaient celui de l’homme qui sait d’avance à qui est réservé le gros lot.
A la remarque du notaire, les deux cousins étaient restés si bien interdits que M. de la Morpisel put continuer.
—Voyons, dit-il, ne vous doutez-vous pas un peu de qui vous vient cet héritage? car c’est un héritage... Cherchez bien... Ne vous connaissez-vous pas un parent dont, depuis longtemps, vous n’avez plus reçu de nouvelles?
—Oui, oui, notre oncle Gaspard Polac, le marin, s’écria Dumouchet.
—Le courageux corsaire. Nous avons toujours cru qu’il avait été tué dans un combat ou qu’il était mort sur les pontons anglais, ajouta Polac.
—Mort? il ne l’était pas encore il y a quelques mois, reprit le notaire, ainsi que le prouve une lettre qu’il m’écrivit alors... car, sachez-le, j’étais un des bons amis de votre oncle. Quand je le vis pour la dernière fois, il y avait à peine une année que j’avais acheté cette étude... De là vient que là-bas, sachant ses jours comptés, il s’est souvenu de moi pour me transmettre ses intentions dernières en me priant de vous retrouver.
Tout en parlant, M. de la Morpisel s’était rapproché de son bureau dont il se mit à bouleverser les paperasses avec une vivacité qui, peu à peu, dégénérant en impatience, lui fit murmurer:
—Que diable est devenue cette lettre!... impossible de remettre la main dessus!
Assis qu’il était auprès du bureau, Bokel avait entendu ces mots. Il se pencha vers le notaire et, d’un ton bien humble, il souffla à l’oreille:
—Si monsieur de la Morpisel daigne me faire l’honneur de venir m’écouter dans l’angle de la fenêtre, je lui apprendrai où se trouve sa lettre.
Pour toute réponse, le tabellion se dirigea vers l’endroit désigné.
Bien qu’il fût persuadé qu’il n’y avait aucun danger à être franc, le tailleur n’en prit pas moins ses précautions. Sa confession, dite à voix basse, commença par poser cette condition:
—Avant tout, je prie monsieur de la Morpisel de promettre le secret à un père qui n’est coupable, au fond, que d’avoir voulu le bonheur de sa fille.
Le clignement d’yeux par lequel répondit le notaire était à la fois une invitation à parler et la promesse du secret réclamé.
—Elle est dans la poche de l’habit que je vous rapporte, déclara carrément le tailleur.
—Et vous l’avez lue?
—Puisque M. Polac est devenu mon gendre, répondit-il simplement.
—Alors vous connaissez la condition?
—Puisque M. Polac est devenu mon gendre, répéta encore le gros homme.
A cette réponse, M. de la Morpisel tourna involontairement un regard vers Polac.
En ce moment, Timoléon, mettant à profit la conférence secrète de son beau-père avec le tabellion, apprenait son mariage à Dumouchet, qui faisait la moue de n’avoir pas été invité. Certes, le pauvre Dumouchet ne pouvait pas passer pour un gros homme, mais il faisait si bien ressortir la maigreur de son cousin qu’elle frappa le notaire.
—Mazette! fit M. de la Morpisel en souriant à Bokel, mes compliments, mon cher!
—N’est-ce pas que nous avons des chances?... reprit le tailleur en pesant sur les mots.
—Oh! mieux que des chances... Vous pouvez dire que vous avez la certitude du succès.
Puis, comme il fallait expliquer aux jeunes gens cette sorte de messe basse, tenue derrière un rideau, qui avait interrompu une explication palpitante d’intérêt pour les cousins M. de la Morpisel reprit en élevant progressivement la voix:
—Mais non, mais non, vous pouvez rester, mon cher Bokel. Ce qui intéresse votre gendre ne doit pas être un mystère pour vous.
Et s’adressant à Timoléon:
—N’est-ce pas, monsieur Polac, que vous ne voyez aucun inconvénient à ce que je retienne votre beau-père, qui veut se retirer avant que je vous en dise plus long, par peur d’être indiscret?
—Restez donc, beau-père, je vous en supplie, se hâta de dire Polac.
Pensant que ce serait trahir le secret promis à Bokel que de se mettre, sous les yeux des jeunes gens, à tirer la lettre de l’habit rapporté par le tailleur, le notaire se reprit à remuer les papiers de son bureau à la recherche de la missive disparue, recherche qu’il interrompit pour dire:
—Après tout, cette lettre n’est pas un acte officiel. C’était une correspondance toute privée, d’un ami à un ami... Je finirai pourtant par la retrouver un jour ou l’autre... J’ai eu grand tort même de la chercher ainsi, car je puis m’en passer, attendu que je la sais par cœur... Votre oncle m’y racontait toutes ses aventures et par quelle suite de circonstances il avait été amené à ne choisir qu’un seul de ses deux neveux pour héritier... Vous plaît-il que je vous en fasse part?
—Nous écoutons, dit Polac.
—Messieurs, reprit le tabellion, s’il vous souvient de Gaspard Polac, votre oncle, vous devez savoir que c’était un gaillard actif, audacieux, brave au possible... Pourtant, si fort qu’on aime les plaies et bosses, il arrive un moment, surtout quand on y a gagné un magot, où on se lasse de canonner et hacher son semblable. Votre oncle finit, par se dire qu’à ce jeu, qui lui avait été toujours heureux, il attraperait un jour sur les doigts... il renonça donc à écumer les mers pour jouir du produit de ses rapines... non, je me trompe, du produit de ses glorieux exploits, en plantant ses choux. Mais comme il était d’un caractère qui s’accommodait mal des entraves mesquines et irritantes de notre civilisation, il alla s’installer sur la côte de Guinée, en Afrique, à cent lieues de tout voisinage et tout au bord de la mer; fraîcheur et solitude... car ce n’était pas un homme d’estaminet. Huit jours après, le nouveau rentier, qui trouvait le temps un peu long, eut l’idée... à titre d’amusement... d’établir un petit comptoir pour la traite des noirs. Cette distraction, qui agrémentait la monotonie de son existence de bourgeois, était, de plus, fort salutaire pour son tempérament, qui exigeait beaucoup d’exercice, car il avait des tendances à l’embonpoint. Cela lui remplaçait le jardinage, qui, vous le savez, est l’occupation favorite des commerçants retirés. Bien nourrir ses nègres pour les mieux vendre offrait, avec l’élevage des lapins, une analogie qui flattait ses goûts champêtres. Son imagination vive lui faisant prendre ses noirs pour des mérinos, il se croyait berger. Parfois l’épidémie lui décimait sa marchandise, mais il s’en consolait en faisant ce raisonnement fort juste qu’à cultiver des pêches il aurait eu aussi à se plaindre des loirs, qui seraient venus lui gâter ses plus beaux fruits. Telle était, me disait-il dans sa lettre toute bucolique, la distraction qu’il avait adoptée... faute d’un billard. Aussi fut-il fort étonné, au bout de quelques années de ce passe-temps hygiénique, de voir qu’il avait doublé sa fortune. Notre campagnard possédait cinq millions.
—Cinq millions! répétèrent machinalement les deux neveux, qui tendaient au récit du notaire des oreilles longues d’une aune.
Le plus médiocre narrateur, quand il se sent un auditoire attentif,—et celui de M. de la Morpisel l’était au possible,—devient orateur verbeux. Le notaire, modulant sa voix, étudiant ses phrases et arrondissant ses gestes, poursuivit donc, presque sans un temps pour reprendre haleine:
—Nul bonheur n’est durable ici-bas! M. Gaspard Polac, votre oncle, en fit la triste épreuve. Lui qui, persuadé qu’on profite toujours à voyager, avait tant pris à cœur de faire voir du pays à ses nègres, éprouva le contrecoup de nos événements politiques. En même temps que la paix de 1814 nous amenait la Restauration, elle portait atteinte aux jouissances de votre oncle, car des bâcleurs de traités, ignorant combien, sur la côte de Guinée, la vie est vraiment vide d’amusements, abolirent la traite des nègres. Deux envois de marchandise de premier choix faits par votre oncle, que des croiseurs malintentionnés empêchèrent d’arriver à bon port, le dégoûtèrent de son ermitage. Trois cents lieues de côte à remonter le séparaient du Sénégal, la colonie la plus proche, il les suivit la canne à la main...
—Rude marcheur! murmura Timoléon.
—Oui, la canne à la main, car il se faisait porter par ses nègres, dont le zèle avait besoin d’être stimulé autrement que par des paroles polies ou la promesse d’une sous-préfecture... du moins à cette époque, car, depuis, une philanthropie imprudente a gâté ces natures primitives... Messieurs les négrophiles ont-ils bien compris le véritable intérêt des classes noires? l’avenir les jugera.
Sur ces paroles sévères, M. de la Morpisel resta un doigt en l’air, semblant écouter l’écho de sa voix qui allait s’éteindre dans les cartons du cabinet. Pour expliquer cette charge du notaire contre les négrophiles, apprenons au lecteur que le père de la troisième femme dont le tabellion était veuf avait été un négrier qui avait profité de l’abolition de la traite pour ne pas payer la dot promise.
—Bref, notre oncle arriva enfin à Saint-Louis du Sénégal? dit Timoléon impatient de connaître la fin de l’histoire.
—Hélas! oui, malheureusement pour lui! poursuivit le notaire. La paix, qui venait de se conclure, lui permettait de résider dans cette colonie, encore au pouvoir des Anglais, mais qui, de par les traités, allait redevenir française. Il s’installa donc en homme résolu à n’avoir plus d’autre occupation que de manger son revenu, c’est-à-dire à vivre dans l’oisiveté la plus plantureuse. Ce fut ce qui causa sa perte. Ce repos absolu, succédant à une existence qui avait été toujours prodigieusement active, ne pouvait convenir à un homme qui avait besoin d’un exercice incessant pour combattre ses tendances à l’embonpoint. De plus, la fatalité voulut que lui, qui, jusqu’à ce jour, avait été d’une sobriété de chameau, se laissât aller à fourrer son nez dans les casseroles.
A ce point de son histoire, M. de la Morpisel crut devoir mettre sa voix sur le ton dramatique.
—Oui, messieurs, le nez dans les casseroles... et son mauvais génie fit qu’il trouva une vive satisfaction à ce nouveau moyen de tuer le temps. Dès ce moment, à raison de cinq repas par jour, il vogua à pleines voiles sur l’océan de la gourmandise. En une seule année, il engraissa de 90 livres. Six mois plus tard, il ne pouvait plus marcher que soutenu sous les bras par deux nègres. A la fin de la deuxième année, le plus petit mouvement ne lui était plus possible qu’avec l’aide d’un cabestan viré par ses moricauds. La graisse l’envahissait toujours, le plongeant dans une torpeur à peu près continuelle... Et, cela, par la faute des traités de 1814!!! On eût laissé cet homme actif à ses occupations champêtres qu’il vivrait encore!
Cette dernière phrase, on le comprend, sonnait mal aux oreilles des neveux. Avides tous deux de voir arriver la conclusion que leur faisait tant attendre le tabellion, ils guettaient l’occasion d’interrompre. Une reprise de respiration de M. de la Morpisel leur permit enfin de placer chacun sa phrase.
—Bref, notre oncle est mort, dit Dumouchet d’un ton qui réclamait moins de prolixité de la part du notaire.
—Et son héritage est ouvert, ajouta Timoléon, cherchant aussi à pousser le conteur vers son dénouement.
—Oui, messieurs, il est mort étouffé par cette graisse qu’il maudissait, car elle l’avait pour ainsi dire privé, aussitôt qu’il en avait voulu user, de toutes les jouissances que lui offrait sa grande fortune... Aussi arriva-t-il que, saisi de la crainte que ses millions ne profitassent pas mieux à son héritier, il introduisit dans son testament cette condition qui exclut l’un de vous de la succession.
—Ah! et quelle est cette condition? prononça Dumouchet impatient.
—Sur tout ce qui précède, reprit le notaire, j’ai consulté mes souvenirs, car ces détails étaient contenus dans cette lettre égarée que M. Gaspard Polac m’avait adressée quelque temps avant sa mort et dans laquelle il me faisait part de ses intentions dernières, en me donnant la charge de vous retrouver... Mais, pour ce qui regarde la condition, je vais vous donner lecture d’une seconde lettre qui, elle, est presque une pièce officielle, car elle émane du solicitor anglais qui, là-bas, veille sur la succession.
Pendant cette longue scène, Bokel était resté immobile et muet dans son coin. Mais, maintenant, il fallait voir comme il se trémoussait d’aise pendant que M. de la Morpisel feuilletait dans un carton pour en tirer la lettre du solicitor. Il clignait gentiment de l’œil à son gendre pour le rassurer.
—Ecoutez; messieurs, dit le notaire en revenant avec la lettre.
«Monsieur de la Morpisel,
»Ainsi qu’il le prévoyait lui-même dans la lettre qu’il vous a écrite le 9 du présent mois, M. Gaspard Polac est mort aujourd’hui 23 novembre.
»Si comme je n’en doute pas, vous avez retrouvé les neveux du défunt, veuillez leur faire part de cette clause que je copie textuellement dans le testament de leur oncle:
»La graisse m’a empêché de jouir de ma fortune. Voulant qu’elle profite à mon héritier ou, pour mieux dire, que mon héritier en profite et n’en soit pas empêché par l’embonpoint d’hippopotame qui me tue, voici ce que j’ai décidé:
»Cinq millions à empocher valant bien la peine de faire le voyage de Sénégal, mes deux neveux se présenteront à Saint-Louis, devant mon ami, le solicitor John Huguesdon, qui les fera monter chacun dans le plateau d’une balance. Celui de mes neveux dont le plateau enlèvera celui de son cousin, c’est-à-dire le plus lourd, sera exclu de ma succession.»
»Daignez agréer, monsieur de la Morpisel, l’assurance de toute ma... etc.»
Tout en remettent la lettre dans ses plis, le notaire ajouta après avoir salué:
—Maintenant, messieurs, à vous de décider ce que vous avez à faire.
—Parbleu! je pars, s’écria Timoléon en se redressant tout fier de sa taille d’allumette.
—Oui, nous partons! prononça Dumouchet avec autant de force que son cousin.
—Ah bah! fit Polac avec surprise.
—Quoi! vous? dit M. de la Morpisel non moins étonné.
—Allons donc! lâcha Bokel.
Mais, à son tour, Dumouchet se mit à les regarder, en demandant d’une voix naïve:
—Qu’avez-vous? On croirait que je viens de dire une énorme bêtise!
—Dame! fit Timoléon.
—Cela nous en a tout l’air, ajouta Bokel.
—C’est à supposer que vous n’avez pas bien compris la clause du testament, avança le notaire d’un ton poli.
—Pardonnez-moi; j’ai parfaitement compris. Le plus maigre aura l’héritage.
—Eh bien! alors..., dit en ricanant Polac.
—En conséquence..., modula Bokel ironiquement.
—D’où il résulte..., accentua le tabellion.
Dumouchet avait vraiment l’air de tomber des nues.
—Voyons, reprit-il, expliquez-moi donc ce que signifient vos demi-phrases et vos figures moqueuses.
—Mais, malheureux, ne viens-tu pas de dire que tu partais! reprit Polac.
—Sans doute.
—Regarde-moi donc, insensé! As-tu la prétention de lutter?... Je pèse soixante et onze livres.
—Bah! bah! pour cinquante-huit livres de différence, ce n’est pas la peine de m’effrayer, répliqua Dumouchet d’un ton décidé.
—J’ai peur que vous ne fassiez là un voyage inutile... et il est bien long, ce voyage, dit M. de la Morpisel en guise de conseil.
—Un grand mois de mer!... appuya Bokel.
—Oh! la mer ne me fait pas peur... Je m’y porte comme un vrai charme... Ah! le voyage dure un grand mois!... Alors nous aurons tout le temps, Timoléon d’engraisser, et moi de maigrir, riposta Dumouchet.
A cette espérance manifestée, Bokel secoua la tête d’une façon gouailleuse:
—N’y comptez pas, fit-il.
—Pourquoi?
—Parce que vous venez de dire qu’en mer vous vous portez comme un charme... tandis que mon gendre... il peut vous l’affirmer lui-même... aussitôt le navire en route, se sent à tel point malade que, le voyage durât-il un mois... comme celui du Sénégal, il lui est impossible de rien manger. N’est-ce pas, Timoléon?
—Le fait est que je vais passer un bien vilain mois, répondit Polac.
Mais, paraît-il, Dumouchet était dans son jour de compréhension difficile, car il répliqua:
—Qu’est-ce que cela prouve?
—Comment voulez-vous qu’à ne pas manger mon gendre engraisse au point de vous donner la victoire?
Nul mulet n’est plus têtu que celui qui ne veut pas boire. Dumouchet devait être parfaitement décidé à ne pas boire puisqu’il se mit à hausser les épaules au raisonnement du tailleur en s’écriant:
—Ta, ta, ta, on a vu des choses plus extraordinaires que cela... Je vous répète que je partirai et... je vais bien vous étonner... je suis certain que c’est moi qui empocherai les millions.
Timoléon, à ces mots, lâcha un rire moqueur.
M. de la Morpisel eut un regard de pitié pour le téméraire.
Bokel fit le geste d’un homme qui désespère de faire entendre raison à un fou.
Mais Dumouchet n’en continua pas moins de secouer la tête d’un air convaincu en continuant:
—Oui, oui, pensez et dites tout ce que vous voudrez, je n’en persiste pas moins à soutenir que j’aurai l’héritage, malgré mes 58 livres de trop.... car j’ai confiance, moi, voyez-vous, grande confiance.
—Confiance en quoi? demanda le notaire.
—Je vous le dirais, que vous ririez encore.
Puis, se ravisant:
—Je vais vous le dire... j’ai confiance dans les cartes.
Comme l’avait prédit Dumouchet, un triple éclat de rire ponctua sa phrase.
—Comment aviez-vous pu déjà consulter les cartes sur un héritage dont vous ne vous doutiez même pas quand vous êtes entré dans mon cabinet? reprit le notaire.
—Voilà justement ce qui augmente ma confiance, car c’est quand rien au monde ne pouvait faire supposer l’héritage qu’une tireuse de cartes a prédit que le plus bel avenir m’était réservé.
—Une farceuse qui a voulu se moquer de toi, dit Timoléon en goguenardant.
—Erreur, cousin.
—Pourquoi?
—Parce que ce n’est pas à moi que cette prédiction a été faite.
—A qui donc? à ta femme?
—Non, à mon rôtisseur... Oui, oui, riez, riez... mais la chose n’en est pas moins vraie... Apprenez qu’il y a une douzaine de jours, ma famille et moi, nous mourions de faim, quand tout à coup, je vis entrer, suivi de son aide, le rôtisseur qui habite ma maison. L’un et l’autre étaient chargés de plats qu’ils posèrent sur tous les meubles... même sur la table de nuit, où fut placé un jambon. Et comme je m’étonnais de ces victuailles en me disant trop pauvre pour les payer, le rôtisseur me répondit: «Mangez sans crainte, vous me payerez plus tard; j’attendrai, car une tireuse de cartes m’a annoncé qu’un superbe avenir vous est réservé.»
Et Dumouchet, cela dit, ajouta encore sur le ton de la plus ferme conviction:
—Donc j’ai confiance dans les cartes... et je partirai quand même.
Nous laissons à deviner quelle pinte de bon sang se faisait Bokel, dans son coin, pendant cette histoire de rôtisseur.
Il fut mis fin à la scène par cette proposition de M. de la Morpisel:
—Puisque vous êtes tous deux décidés à partir, il faut profiter d’une expédition que le gouvernement envoie au Sénégal... Le commandant est de mes clients et de mes amis... Pendant huit jours encore, il demeurera en rade de l’île d’Aix... Voulez-vous que je vous donne une lettre de recommandation pour qu’il vous reçoive à son bord?
—Accepté! répondirent les deux cousins et Bokel.
En deux minutes, M. de la Morpisel eut écrit la lettre offerte et il la tendit au tailleur en disant:
—Aussitôt arrivés là-bas, vous vous ferez directement conduire au vaisseau du commandant... il est inutile que l’on sache que vous êtes des passagers de faveur.
—Et comment s’appelle ce vaisseau? demanda Bokel.
—La Méduse, répondit le notaire.
Notre intention n’étant pas de raconter tout au long l’expédition de la Méduse, nous nous contenterons d’en relever seulement les détails qui sont utiles à notre histoire. Dépossédée en 1808 par les Anglais de ses établissements sur la côte occidentale d’Afrique, la France les avait reconquis par les traités de 1814 et 1815 qui lui rendaient le littoral depuis le cap Blanc jusqu’à l’embouchure de la Gambie.
Deux années après sa restauration, le gouvernement des Bourbons n’avait pas encore pensé à replanter le drapeau français dans cette colonie, ou, plutôt, il avait fallu deux ans au fiévreux Dubouchage, ministre de la marine, pour organiser cette expédition de quatre voiles qui avait charge d’aller ravitailler le Sénégal en hommes, matériel, vivres et munitions. Les Anglais, voyant que nous ne prenions pas possession, avaient continué, malgré les traités, d’exploiter tranquillement le pays, attendant pour déménager que la France leur donnât congé.
A cette époque où la vapeur n’avait pas encore reçu son application à la marine, la navigation à voiles était une véritable science, très-compliquée, qui exigeait un long et sérieux apprentissage et une pratique incessante. Le salut de l’équipage et du navire dépendait donc uniquement du savoir nautique, de l’expérience et du sang-froid de l’homme à qui avait été confié le commandement suprême.
Ce fut sur ces données, qui lui indiquaient le choix à faire, que le ministre Dubouchage, ayant à nommer le chef de l’expédition du Sénégal, duquel allait résulter le sort de quatre bâtiments, désigna... devinez qui? Vous ne trouveriez jamais; autant donc vous l’apprendre... désigna un receveur des droits réunis. Il est vrai que, jadis, il avait débuté dans la marine. Mais, depuis vingt-cinq ans qu’il n’avait remis le pied sur un navire, son emploi de receveur devait lui avoir complétement fait oublier le peu qu’il avait appris, supposé qu’il eût appris quelque chose.
Il faut aussi ajouter que cette incapacité hors ligne se tenait au premier rang des fanatiques qui s’égosillaient à chanter:
Ce fut pareillement dans ce chœur de sectaires qu’on choisit les ineptes escamoteurs de commandement auxquels furent confiés l’Alouette, l’Eléphant, le Golo, le Lynx, la Licorne et autres navires de l’Etat, qui, à la même époque que la Méduse, périrent par l’ignorance de leurs capitaines ou ne furent sauvés du naufrage que par les lieutenants, qui, à l’heure du péril, forcèrent les chefs incapables à abandonner le commandement. Pour récompense, ces sauveurs furent, à leur retour au port, traduits en jugement. La Restauration, on le voit, était le bon temps pour les gens de mérite.
Revenons à notre sujet.
Ce fut le 17 juin 1816, à sept heures du matin, que l’expédition du Sénégal partit de la rade de l’île d’Aix. Les navires qui en faisaient partie étaient la frégate la Méduse, la corvette l’Echo, le brick l’Argus, et la flûte la Loire. Ces bâtiments étaient chargés de provisions de toutes sortes destinées, nous l’avons dit, à ravitailler la colonie. Outre l’infanterie de marine, composée de deux cent cinquante-cinq hommes, qui devait là-bas tenir garnison, ils emportèrent cent-dix émigrants qui allaient tenter la fortune en ce pays lointain. C’était donc, en plus des quatre équipages, un personnel de trois cent soixante-cinq individus, dont deux cent quarante avaient été embarqués sur la Méduse.
C’est parmi ces derniers que nous retrouverons Bokel, sa fille, son gendre et le cousin Dumouchet, dont la confiance dans les cartes était demeurée inébranlable.
Semblable à l’entraîneur qui suit partout le cheval qu’il a dressé, pour qu’il ne perde rien de ces avantages qui doivent lui assurer le prix, le tailleur n’avait pas hésité un instant à accompagner Polac. Le gros homme, quand il avait une idée, la suivait jusqu’au bout du monde.
—Timoléon a beau m’affirmer qu’il est toujours malade en mer, s’était-il dit, il se peut que, cette fois, la mer lui fasse grâce. Laissé à lui-même, mon gendre dévorerait. Je dois donc être là pour veiller au grain.
Et, dans ses bagages, il avait emporté une ample provision de son fameux moka.
Mais où le courage de Bokel, si brave pour lui-même, avait faibli, c’était à propos de Paméla, qui, malgré tout, n’avait pas voulu se séparer de son mari.
—On m’a promis un voyage de noces, répétait-elle.
—Mais nous allons au diable, ma chérie, disait le papa.
—Ta, ta, ta, je ne veux pas qu’on suppose que mon mari m’a plantée là le lendemain des noces. La loi m’ordonne de suivre mon époux partout où il lui plaît de résider; le maire me l’a dit. Timoléon va au diable, dis-tu?... J’irai au diable.
—Mais ton piano, ma bichette... songes-y donc! quelle privation pour toi, car nous ne pouvons pas l’emporter!... Ne m’as-tu pas dit cent fois que l’existence serait vide pour toi sans piano? disait le père en s’adressant à l’âme de la musicienne.
Dans ce vide que devait laisser l’absence du piano, il s’était glissé, depuis la veille, un époux, ce qui fit que Paméla demeura insensible à cette perspective de rester des mois sans faire grincer les dents des malheureux auxquels il était donné d’entendre le vacarme de son beau talent.
Elle avait donc résisté à toutes les sollicitations du papa, même quand il s’était écrié avec un certain lyrisme:
—Penses-tu à mes affres de toutes les secondes quand je te verrai à la merci des flots capricieux?
Quand le tailleur avait appelé Timoléon à la rescousse, ce dernier avait répondu:
—Alors, beau-père épargnez-vous ces affres en ne venant pas avec nous.
Cette proposition avait immédiatement mis fin aux instances de Bokel.
Et puis, il faut l’avouer, bien qu’il sût ce qui en était de la fameuse prédiction de la tireuse de cartes au rôtisseur, Bokel, ressentait une terreur secrète à la pensée de Dumouchet. Il avait beau avoir les atouts pour lui et se savoir une marge de 58 livres en moins, la confiance stupide du concurrent à l’héritage le démontait.
—A-t-on vu cette canaille qui persiste quand même à nous tenir tête? murmurait-il; mais je serai-là pour éventer les piéges qu’il tendrait à mon gendre.
Si Dumouchet préparait un piége à son cousin, il faut reconnaître qu’il cachait bien son jeu. Quand on allait monter dans la diligence qui devait les conduire au port d’embarquement, Dumouchet s’était présenté fort léger de bagages, mais traînant avec lui trois sacs de pommes de terre, pois cassés et lentilles.
—A bord, où les rations sont parfois insuffisantes, il est bon d’avoir quelques provisions, avait-il dit à Bokel, qui palpait les sacs.
—Et c’est avec ce supplément de nourriture que vous comptez maigrir des 58 livres qui vous séparent de mon gendre? avait demandé le tailleur un peu rassuré.
—Ah! à propos des 58 livres, je ne vous ai pas accusé mon véritable poids, ce matin, chez le notaire. Tout à l’heure, avant de partir, l’idée m’est venue de me peser encore... Les 58 livres ne sont plus le chiffre exact.
—Auriez-vous maigri? bégaya presque Bokel, prenant l’alarme.
—Au contraire, j’ai trois livres de plus.
—La Providence nous sourit! pensa le gros homme avec un soupir de soulagement.
Ensuite, à haute voix:
—Malgré cet avertissement du ciel, vous osez donc encore tenter la lutte?
—Les cartes l’ont prédit... J’ai confiance. En me faisant ses adieux, le rôtisseur m’a encore parlé de la tireuse de cartes.
La quatuor n’arriva au port qu’au milieu de la nuit du 16 au 17 juin, quelques heures avant le départ de l’expédition. Il fallait donc au plus vite monter sur la Méduse.
Bokel s’enquit d’une embarcation.
—Tenez, lui dit un homme du port, voici justement une chaloupe de la Méduse qui rejoint son bord; profitez-en.
Dix minutes après ils étaient assis dans la chaloupe, glissant sur le flot calme de la rade, en pleine obscurité.
—Eh bien, mon gendre? avait demandé Bokel dès le deuxième coup d’aviron, pressé qu’il était de voir Timoléon malade.
—Eh bien, quoi, beau père? dit Polac, sans deviner le sens de la question.
—M’aurait-il trompé? pensa le tailleur, qui, plein de méfiance, laissa tomber le dialogue.
Quand l’embarcation accosta la Méduse, on lui jeta la mince échelle de corde qui devait servir à l’escalade des arrivants. C’était un exercice de gymnastique dont se tirèrent à leur honneur Paméla, avec la prestesse d’un écureuil, Timoléon aussi agilement qu’un singe et Dumouchet à la façon prudente et calme de l’ours.
Vint alors le tour de Bokel.
Bien qu’une romance parle d’un éléphant qui, en une heure de far niente, se balançait dans une toile d’araignée, on en est toujours à se demander comment il était parvenu à se hisser jusqu’à ce genre de hamac... Etait-ce à l’aide d’une échelle de corde? Il faut en douter, si nous nous en rapportons à l’expérience tentée par Bokel, qui, ne fût-ce que du poids de la trompe, ne possédait pourtant pas la pesanteur d’un éléphant.
Les quatre premiers échelons furent franchis par l’énorme tailleur avec une espèce de facilité qui faisait l’éloge de la vigueur de ses poignets, chargés d’enlever une pareille masse. Mais, comme le pied du tailleur cherchait l’échelon suivant, la corde se livra subitement à des oscillations qui le dérobèrent sous lui, de sorte que Bokel, manquant d’un point d’appui, retenu seulement par les mains, resta suspendu dans le vide.
Une seconde de plus, et c’en était fait de notre héros, qui allait se laisser choir dans la mer, si, en cette situation critique, une large main ne s’était posée, en guise d’assiette, sous les formes puissantes de Bokel, qui parvint à retrouver pied sur l’échelle. Grâce à ce secours, donné par un des marins de l’embarcation, le tailleur put enfin se hisser jusqu’à portée des mains de Timoléon et de Dumouchet qui, l’empoignant par le collet, lui firent brusquement achever l’ascension.
Mais, au moment où il était enlevé à force de bras, Bokel sentit la main de son sauveur d’en bas tapoter ces mappemondes opulentes qu’elle avait soutenues et, en même temps, un voix gouailleuse prononçait, en dessous au tailleur, ces quelques mots:
—Gras à tuer, je le disais bien, gras à tuer!
Et presque aussitôt sauta sur le pont, à côté de Bokel tout essoufflé, un marin qu’il reconnut avec terreur.
C’était le loustic Filandru, patron de la chaloupe qui avait amené les passagers.
Le mauvais plaisant vint se camper sous le nez du tailleur et, tout ricanant:
—Eh! eh! fit-il, nous y venons donc à la marmite du bord, mon boulot?
Puis, ce fut un gros éclat de rire accompagnant encore ces paroles:
—Bon bouillon! bon bouillon!
Nous ne jurerions pas que l’épithète de «vil maraud!» dont il s’était servi à sa première rencontre avec Filandru, ne monta pas aux lèvres indignées de Bokel; mais il la retint au passage. En somme, ce grossier personnage, qui ne voyait en lui qu’une sorte de gîte à la noix, venait de lui sauver la vie, et puis, il faut l’avouer, sur ce pont de vaisseau où Filandru était, pour ainsi dire, chez lui, le tailleur avait perdu tout à coup la majeure partie de cette superbe qu’il montrait sur le solide plancher des vaches. Disons aussi que Filandru, rappelé par son devoir de patron de la chaloupe, qu’il s’agissait maintenant de hisser à bord, avait immédiatement tourné le dos à sa victime.
Grâce à la lettre de M. de la Morpisel, qui réclamait, en faveur de ses protégés, l’intérêt du commandant, beau-père, gendre et fille obtinrent des hamacs dans un petit coin à part du bâtiment, tout encombré de troupes et d’émigrants. Dumouchet, s’il l’avait voulu, aurait pu partager ce bien-être relatif, mais, un peu agacé par la persistance de Bokel à parler du succès assuré de son gendre, il s’était retiré à l’écart, traînant après lui ses sacs de provisions farineuses.
—J’aurais mieux fait de le garder sous l’œil, pensa le tailleur, regrettant de ne pas s’être opposé à cette séparation.
Rompu qu’il était par le long et harassant trajet de la diligence qui l’avait amené de Paris à destination, le tailleur, bien que non coutumier du hamac, dormait profondément quand il fut tiré de son sommeil par un certain mouvement de balançoire bien accentué que venait de prendre son hamac. C’était le roulis de la Méduse qui, après avoir levé l’ancre, se mettait en route.
Le premier regard de Bokel fut pour son gendre, qui, étendu dans un hamac accroché, au-dessous du sien, dormait à poings fermés. Ce sommeil prouvait un courage remarquable, car, s’endormir quand, sur sa tête, planait Bokel, cette lourde masse de Damoclès qui, à sa première chute, pouvait l’écraser, attestait, chez Timoléon, une rare insouciance du danger.
Loin d’apprécier l’héroïsme de ce sommeil, Bokel fut tout à une pensée de méfiance.
—Quoi? Nous voici en mer et pas encore malade! Le fourbe m’a abusé, se dit-il.
Certes, il n’y avait pas grand temps perdu puisque le bâtiment n’était pas à plus de cent mètres de son point de départ, mais le beau-père ne put tenir à cette preuve d’insigne mauvaise foi et, descendant de son hamac, il vint secouer Polac en s’écriant:
—Eh bien! eh bien! mon gendre, à quoi pensez-vous donc? nous sommes en mer, mon ami.
Tout en sursaut qu’il était, le réveil de Timoléon fut aimable.
—Tiens, c’est vous, beau-père? dit-il; je faisais un rêve-de bon augure. Je me voyais déjà dans la balance et enlevé par le poids de Dumouchet.
—Qui veut la fin veut les moyens, prononça sévèrement le tailleur.
—Qu’entendez-vous par là?
—Ne m’avez-vous pas affirmé que la mer ne vous réussissait pas? ajouta le beau-père de son même ton grave tout plein de reproches.
Du hamac voisin, se fit entendre la voix de Paméla, qui venait de se réveiller.
—Mais, papa, disait-elle, Timoléon ne peut pourtant pas être malade rien que pour te faire plaisir.
—Nous sommes en mer, je n’ai que ça à dire, répliqua sèchement Bokel.
—Oh! depuis cinq minutes à peine.
—Soit! mais depuis cinq minutes, un homme d’honneur serait malade!!!
Marius, sur les ruines de Minturnes, ne devait pas avoir visage plus sombre et plus désespéré que celui de Bokel quand, après ces paroles de blâme, il alla s’asseoir sur un rouleau de cordages, à quelques pas des deux époux.
Il fut tiré de ses méditations lugubres par une voix empâtée qui lui demandait:
—Vous n’êtes donc pas venu à la première distribution de vivres?
C’était Dumouchet qui, d’une bouche pleine, lui adressait cette question en lui montrant un morceau monstrueux de biscuit sur lequel son pouce retenait une large tranche de lard.
La vue de cette ration colossale que le concurrent à l’héritage allait s’introduire dans l’estomac fut comme un baume sur le cœur ulcéré du tailleur.
—Si ce maudit Dumouchet continue à se nourrir de la sorte, le manque de parole de mon gendre ne sera que demi-mal, se dit-il.
De sorte que ce fut avec un quart de sourire qu’il répliqua au mangeur:
—Oh! oh! à en juger par votre ration, je vois que la Méduse soigne ses passagers.
—Ah! mais non, mais non, fit vivement Dumouchet, il n’en est pas ainsi pour tout le monde! Figurez-vous que j’ai retrouvé un parent de ma femme dans le Père la Méduse.
—Qui appelle-t-on ainsi?
—Le maître-cambusier du navire... Et, dame! il m’a promis de me soigner si copieusement que je n’aurai pas même besoin d’entamer mes sacs de provisions.
Ces paroles entrèrent comme une musique dans l’oreille du tailleur.
—La Providence me sourit, se répéta le gros homme, dont c’était la phrase favorite, surtout quand il parvenait à faire accepter par un client une culotte mal coupée.
Il était donc, sinon calmé, tout au moins de moitié moins grognon quand, pour prendre l’air, il monta sur le pont. Il n’eut guère le temps de se rafraîchir les poumons, car, à son troisième pas, une large main lui tapota le ventre et une voix railleuse s’écria:
—Oh! le bon nanan! le bon nanan!
C’était Filandru, qui continuait sa sotte plaisanterie.
Et comme il n’est si stupide farce qui ne rencontre des rieurs, une dizaine de marins, qui flânaient là, se mirent à répéter en chœur:
—Oh! le bon nanan!
Que voulez-vous? ces joyeux lurons n’avaient pas été élevés sur les genoux des duchesses. Leur genre d’esprit n’avait aucun rapport avec celui de M. de Talleyrand. Ils trouvaient à rire de cette ineptie au gros sel, et ils s’en donnaient à cœur joie, sans la moindre méchanceté. Bokel n’aurait pas commis la bêtise de s’en fâcher que, le lendemain, un autre passager serait devenu le plastron de Filandru.
Donc, pendant qu’il était en train d’être bête, le gros homme ne le fut pas à demi. Il se redressa la tête de trois quarts, à la Mirabeau, et avec une moue, de mépris il lança ces mots superbes:
—Arrière, engeance!
Seulement, tout en commandant: arrière! il reculait pour regagner l’entre-pont, poursuivi par les huées des marins qui se tordaient de joie.
C’était à croire, de prime-abord, que la Providence ne lui souriait plus. Il n’en était rien, pourtant. Elle lui ménageait, au contraire, une charmante compensation. A peine Bokel était-il rentré sous le pont qu’il aperçut son gendre, pâle et défait, vacillant sur ses jambes et les bras étendus en homme qui cherche un point d’appui.
—A moi, papa! se mit à crier Paméla, qui, trop faible pour soutenir son mari, le suivait dans ses mouvements de valse.
Du premier coup d’œil, Bokel comprit tout. En une seconde, il fut près de Timoléon, et d’une voix frémissante de joie, il bégaya:
—Mes excuses, mon gendre, mes plus sincères excuses d’avoir douté de vous un moment. Vous êtes homme de parole.
Et, tout en parlant, il poussait l’homme de parole vers son hamac, sur lequel Timoléon se laissa tomber comme une masse en murmurant:
—Décidément la mer ne me réussit pas.
A peine la Méduse était-elle arrivée au large que le temps avait changé. Du 17 an 29 juin, il se maintint si mauvais que les quatre bâtiments, qui auraient dû naviguer de conserve, furent obligés de se séparer. La Loire d’abord, puis l’Argus restèrent en arrière, incapables qu’ils étaient de suivre la marche supérieure de la Méduse, Pendant deux jours, en forçant de voiles, l’Echo se maintint en vue. Mais il lui fallut aussi renoncer à la lutte.
La Méduse poursuivit, sa course jusqu’à la l’île de Ténériffe, devant laquelle elle se mit à louvoyer pendant douze heures, pour permettre aux conserves de rejoindre. L’Echo seul se présenta.
Le 30 juin, la Méduse reprit le large.
—Tout va bien, nous approchons; se disait Bokel, qui, beaucoup par crainte de rencontrer Filandru en montant sur le pont, ne s’éloignait pas du hamac de son gendre, auquel, suivant son expression, rien ne réussissait, pas plus le roulis que le tangage, ou les aliments glissés par Paméla en cachette de son père.
Dumouchet, ainsi qu’il l’avait annoncé, se portait comme un charme. L’air de la mer lui creusait l’estomac au point que, grâce aux générosités du Père la Méduse, le maître-cambusier, il ne se présentait plus devant Bokel que toujours bâfrant à pleine bouche.
—Il prend du ventre! se disait le tailleur doucement réjoui et faisant bonne mine au cousin de son gendre, car c’était par lui qu’il avait des nouvelles de ce qui se passait sur le pont.
Quand, le matin du 1er juillet, Dumouchet vint faire à son cousin et au tailleur sa visite habituelle, Bokel lui dit en souriant:
—Avant huit jours, vous serez dans la balance.
—Euh! euh! fit Dumouchet.
—Car, dans huit jours, nous serons à Saint-Louis.
—Euh! euh! répéta le cousin entre deux bouchées, oui, si nous arrivons... ce qui n’est pas l’avis du Père la Méduse.
—Ah! que dit donc votre ami le cambusier?
—Que le capitaine est un âne, pas plus malin que son soulier, qui finira par nous flanquer dans le pétrin... il paraît qu’il a déjà commis trois ou quatre boulettes carabinées qui ont failli perdre la Méduse... Faut voir la mine des autres officiers, forcés d’obéir. On lit dessus que le navire est flambé... Je vous plains, père Bokel.
—Ah çà! il me semble que, s’il m’arrive malheur, vous en aurez votre part, avança le tailleur, étonné de la tranquillité de Dumouchet.
—Oh! moi, je n’ai nulle crainte... Ce que les cartes ont prédit doit se réaliser. Je suis certain d’avoir l’héritage.
La conversation fut interrompue par un grand bruit qui eut lieu sur le pont.
—Qu’est-ce que ce remue-ménage? demanda le tailleur en dressant l’oreille.
—Ce sont les préparatifs qui commencent.
—Préparatifs de quoi?
—De la cérémonie du baptême du Tropique. Il paraît que nous passons aujourd’hui la ligne. Vous connaissez cette coutume burlesque de la marine... les gens de l’équipage prétendent que ce sera fort gai... C’est un nommé Filandru qui mène toute la bande. Il va représenter le bonhomme Tropique... Le cambusier m’a dit que ce Filandru devait faire monter sur le pont la marmite du bord... Pourquoi? je l’ignore... Une imagination à lui... Je parie que ce sera drôle.
Sans qu’il pût s’en rendre compte, un petit frisson avait passé dans le dos de Bokel en entendant parler de la marmite du bord.
Il n’était pas encore remis de son émotion qu’une pétarade de coups de feu se fit entendre sur le pont, puis une musique infernale lui succéda.
—Ah! voici la cérémonie qui commence. Je monte là-haut pour n’en rien perdre, annonça Dumouchet.
Nous ne nous attarderons pas à détailler cette burlesque fête maritime, aujourd’hui tombée en désuétude, qu’on appelait le baptême de la Ligne et qui mettait à la merci des marins ceux qui, pour la première fois, passaient sous le tropique. C’était alors pour les équipages une double occasion de se réjouir et d’empocher l’argent des passagers, qui payaient tribut pour se soustraire au bain formidable dont la coutume les menaçait. Sur la Méduse, qui comptait deux cent quarante passagers, la fête en question promettait donc, ce jour-là, une ample récolte à ses marins.
Quand Dumouchet, après avoir quitté le tailleur, mit le pied sur le pont, il aperçut son protecteur, le Père la Méduse, assis, loin de la fête, sur le petit cabestan de l’arrière et fumant une pipe si courte de tuyau que son nez avait l’air d’être sur le gril.
—Voici qu’on commence à rire! dit Dumouchet en l’abordant.
—Rira bien qui rira moins ce soir, lâcha lentement le vieux cambusier entre deux bouffées de tabac.
—Oh! oh! vos idées sont encore au noir.
—Mon garçon, il faut être une vraie buse comme notre capitaine... respect que je lui dois... pour ne pas voir de quoi il va retourner... Il a fait fausse route, l’animal bâté... toujours respect que je lui dois. Nous naviguons sur un vilain cirage, voyez-vous.
—Mais non, mais non, fit l’optimiste Dumouchet; le vent est bon.
—Heureusement, car s’il cessait, vous serions entraînés par les courants sur les récifs du golfe Saint-Cyprien. Depuis que nous avons doublé le cap Barbas, la Méduse joue un mauvais jeu.
Le loup de mer disait cela si tranquillement que Dumouchet, loin de s’en effrayer, se mit à plaisanter.
—Allons, vieil ami, vous broyez du noir parce que Filandru, le Roi Tropique, ne vous a pas donné place dans son cortége... Eh! eh! il paraît qu’ils s’amusent fort là-bas.
En effet, autour de Filandru qui trônait majestueusement, au milieu de sa cour, c’étaient des cris, des rires, des huées à chaque nouveau baptême. Beaucoup de ceux que l’aspersion attendait avaient tenté de ne pas se conformer à l’usage, mais, dénichés dans leurs cachettes, ils étaient amenés de force devant Sa Majesté Tropique et une abondante douche punissait leur rébellion.
Au milieu de cette joie, sous ce ciel bleu, par une mer calme et une bonne brise, si près de cette terre d’Afrique qu’on allait bientôt aborder, il était impossible à Dumouchet de prendre au sérieux les prédictions sinistres du cambusier.
Il revint donc à la charge en disant:
—Si nous étions en aussi grave péril que vous l’affirmez, est-ce que les officiers, en admettant l’incapacité du commandant, seraient tranquilles comme nous les voyons en ce moment?
—Eux, mon petit? ils pensent tout bas ce que je dis tout haut: que le capitaine n’est pas plus marin qu’une paire de pincettes... Mais la discipline leur clôt le bec. Tout chambernerait que les officiers obéiraient encore à l’imbécile qui commande... Et puis, à quoi serviraient les conseils? Tenez, cherchez l’Echo qui, hier soir, était encore en vue.
Dumouchet interrogea l’horizon.
—Ce navire a disparu, dit-il.
—Eh bien, toute cette nuit il a multiplié ses feux de signaux, que notre capitaine n’a pas su ou voulu comprendre. A coup sûr, l’Echo nous signalait un danger auquel, après son devoir accompli, il a jugé bon de se soustraire.
Le vieux loup de mer tira de sa pipe trois, ou quatre bouffées, puis il reprit:
—Comme s’il avait hâte d’arriver le premier au Sénégal, notre oison de commandant a profité de la marche supérieure de la Méduse pour devancer les autres bâtiments de l’expédition... Nous sommes seuls maintenant... Qu’un malheur arrive et nous n’aurons personne pour nous venir en aide.
—Oh! nous sommes si près de la côte! avança Dumouchet toujours incrédule.
—Dans l’intérêt de notre peau, nous serions mieux à quarante lieues au large. Depuis deux heures, l’eau a changé de couleur... Mauvais signe! mon petit, mauvais signe!... Je ne...
Le cambusier fut interrompu par une tempête de hurlements joyeux. Deux cents voix criaient alors à plein gosier.
—Bon nanan! le baptême à bon nanan!
La plaisanterie de Filandru, on le voit, avait conquis de nombreux adhérents.
—Ah çà! mais c’est Bokel! se dit Dumouchet en reconnaissant le malheureux tailleur que quatre hommes... et ils en avaient leur charge... apportaient, tenu par les jambes et par les bras, en présence du Roi Tropique, auquel il avait refusé de rendre hommage.
De vive force, le beau-père de Timoléon, qui rugissait de colère, fut installé sur une sorte d’estrade ronde dont il eût été impossible de deviner les supports, car elle était entourée de toile à voile.
—Sujet rebelle, commença Filandru...
Si Dumouchet n’en entendit pas plus, c’est qu’à ses côtés la voix du cambusier venait de lâcher un énergique juron, vibrant de colère et de mépris.
—A qui, diable! en avez-vous? demanda-t-il.
—A notre dindon de capitaine... Tenez, voyez-vous notre lieutenant qui lui parle?...
—Oui, et même avec animation?
—Savez-vous ce qu’il lui dit?
—Non.
—Il lui apprend que le navire est en perdition depuis deux heures... car depuis deux heures nous naviguons sur le banc d’Arguin, où l’inepte entêtement de ce gardeur de porcs nous a conduits.
—Oh! oh! fit Dumouchet un peu ébranlé.
Le premier juron du cambusier n’était rien comme vigueur auprès de celui qui sortit alors de ses lèvres.
—Crétin! buson! idiot! baudet! bûche! Ne voilà-t-il pas qu’il hausse les épaules!
En effet le capitaine, qui s’amusait fort des pasquinades de Sa Majesté Tropique, venait de se débarrasser du donneur d’avis par un petit mouvement d’épaules et avec le sourire protecteur et narquois de d’homme sûr de son fait qui a pitié de l’erreur d’un autre. Quitte de cet importun, le commandant se reprit à écouter Filandru, qui, continuant son discours, disait alors à Bokel maintenu sur son estrade:
—... En conséquence, attendu qu’il est de toute justice que le crime soit puni et la vertu récompensée, et comme, d’après ma faible jugeote, il n’est pas de plus douce satisfaction pour l’homme vertueux que celle de s’insinuer dans le torse un excellent bouillon...
La parade du Roi Tropique fut interrompue par la voix grave du marin de service qui, chargé de jeter la sonde, annonçait au lieutenant de quart:
—Dix-huit brasses!
—...Or, continua Filandru, comme les morceaux de belle viande grasse produisent le plus exquis bouillon...
—Onze brasses! cria le sondeur.
—Amenez les bonnettes! commanda le lieutenant aux gens de quart.
—... Attendu, poursuivait le bonhomme Tropique, que le sujet rebelle, qui a refusé de comparaître devant nous et de nous rendre hommage, est dans les meilleures conditions pour produire le bouillon...
Toute l’assistance était si joyeusement attentive, chacun apprêtait si bien son rire pour le dénouement qu’on sentait prochain que personne n’entendait le marin qui annonçait:
—Neuf brasses!
Ni la voix du lieutenant qui commanda la manœuvre pour serrer le vent.
La Méduse se mit à loffer.
—... Donc, continua Filandru, nous condamnons le coupable à être précipité dans la marmite du bord.
La phrase n’était pas même achevée que vingt mains vigoureuses faisaient basculer les planches formant parquet sous les pieds de Bokel, qui disparut dans l’immense chaudière, pleine d’eau, au dessus de laquelle il avait été juché.
Oh! le bon rire qui éclata comme un coup de tonnerre, si bruyant, si énorme qu’on n’entendit pas encore l’homme de la sonde qui criait:
—Six brasses!!!
Les uns riaient comme un coffre, les autres à ventre déboutonné, ceux-ci à gorge déployée, ceux-là en se tenant les côtes. On riait aux larmes, sous cape, dans sa barbe, comme un fou, à pleine rate, aux anges, en pouffant; bref, inventez toutes les façons de rire si vous voulez vous faire une idée de cette joie folle.
Ce n’était donc vraiment pas, nous le répétons, le moment de prêter attention à ce marin qui criait: six brasses!
Seul de ceux qui n’étaient pas de service, le vieux cambusier avait entendu ces deux mots:
—Accrochez-vous vite à cette manœuvre, dit-il à son voisin Dumouchet.
—Pourquoi? demanda ce dernier tout en obéissant.
—Parce que, nous aussi, nous allons rire.
A ce moment, un épouvantable choc renversa tous les rieurs sur le pont. Des gens si gais ne pouvaient pas être sérieusement solides sur leurs jambes: ils tombèrent comme des capucins de cartes.
En loffant, la Méduse venait de donner un coup de talon.
—Flic! lâcha le cambusier.
La frégate courut encore un moment, puis elle donna un deuxième coup de talon.
—Flac! fit le loup de mer.
Enfin, un troisième.
—Floc! ajouta encore le vieillard.
Et, s’adressant à Dumouchet toujours cramponné à sa corde, ce qui l’avait préservé d’une chute:
—Maintenant, vous pouvez lâcher prise, c’est fini... N’est-ce pas que c’était drôle tous ces gens flanqués par terre? Je vous disais bien que nous allions rire à notre tour.
—Oui, mais qu’est-ce qui s’est passé?
—Quoi donc?
—Parbleu! les trois secousses.
—C’est la Méduse qui vient de s’échouer. Nous sommes perdus!... Le vrai malheur, c’est que j’ai cassé ma pipe, répondit tranquillement le cambusier.
Au milieu de la terrible catastrophe, Bokel aurait pu placer sa fameuse phrase: «La Providence me sourit», car le premier choc avait renversé la marmite profonde dans laquelle il était bel et bien en train de se noyer, attendu qu’il y était entré la tête la première. Trop peu ingambe pour se retourner, et, au milieu de l’épouvante générale qui ne laissait pas penser à lui, il aurait péri dans cette marmite, sans ce choc qui avait fait rouler l’énorme récipient.
Lorsqu’il rentra sous le pont, Paméla, restée près du hamac de Timoléon, abattu par ce long jeûne, se précipita au devant de lui.
—Papa, demanda-t-elle, quelle est la cause de ces trois secousses?
Encore à demi suffoqué par sa noyade, presque étranglé par l’effroi, Bokel resta sans répondre, inondant le parquet de l’eau qui ruisselait de ses habits.
—Oh! oh! fit Timoléon, ce qui est arrivé doit être bien grave, car je vois que vous avez couru pour venir me l’annoncer. Avez-vous chaud, mon Dieu! Quelle transpiration! Vos habits en suintent. Ne vous laissez pas refroidir, beau-père.
Puis, tout à coup, d’une voix étonnée:
—Parbleu! voilà qui est drôle! s’écria-t-il.
—Quoi donc? demanda Paméla.
—Je ne sens plus le mal de mer, il vient de me quitter brusquement.
En effet, la Méduse, échouée sur le sable, n’ayant plus ni roulis ni tangage, le malaise de notre héros avait cessé.
A en croire tous les rapports qui ont été faits sur le naufrage de la Méduse, le navire aurait pu être sauvé, si l’incapacité du capitaine, qui perdit un temps précieux, alors que la mer était calme, n’eût retardé les manœuvres que le mauvais temps, deux jours après, rendit inutiles.
L’échouement de la frégate avait eu lieu à trois heures de l’après-midi. Le défaut de confiance dans l’habileté du capitaine amena l’indiscipline et l’on perdit cette journée. Le lendemain on tenta de touer le navire dans des eaux plus profondes en virant au cabestan sur des ancres mouillées au large. Mais sur ce sable, mêlé de vase, les ancres ne purent mordre et cédèrent.
La première mesure à prendre était d’alléger la frégate de tout ce qui se pouvait jeter par-dessus le bord. On commença par des barils de farine, puis on défonça la moitié des tonnes d’eau douce.
Grâce à d’autres et aussi tristes sacrifices, la ligne de flottaison remonta de 30 centimètres.
On se remit au cabestan.
Mais tous les efforts n’aboutirent qu’à faire sortir le vaisseau de son lit pour le traîner sur le sable à cent mètres. Si, comme on l’a dit, la frégate n’avait touché que sur le bord du banc d’Arguin, elle était bien près d’être sauvée. Malheureusement, au milieu de la nuit, le temps changea, la mer grossit, et la Méduse, ne se trouvant plus dans le moule de vase qu’elle s’était creusé, se mit à talonner de plus en plus violemment.
A trois heures de la nuit, le maître calfat vint annoncer qu’une voie d’eau s’était déclarée. On se jeta aux pompes. Une demi-heure plus tard la quille se fendit en deux endroits.
La Méduse était perdue sans ressource!
On abandonna donc tout moyen de sauver la frégate pour ne plus songer qu’au salut des hommes.
Alors, aux dangers de la mer, vinrent se joindre les premières menaces de l’indiscipline soulevée par le sentiment de la conservation personnelle. Les soldats de marine se révoltèrent, persuadés qu’ils étaient que l’équipage voulait les abandonner en s’enfuyant sur les embarcations. Au fond, leur crainte avait une apparence de raison. Toutes les embarcations du bord, bien remplies, pouvaient à peine contenir 250 personnes, et on était plus de 400 hommes sur la Méduse.
Ce fut alors qu’on parla de construire le radeau qui emporterait l’excédant des naufragés. Les vivres devaient être déposés sur le radeau, qui serait remorqué par les embarcations, et, à l’heure des repas, les équipages des canots viendraient y prendre leurs rations et se reposer pendant que d’autres rameurs iraient les remplacer aux avirons des canots remorqueurs. Sur ces belles promesses destinées à encourager ceux que le sort appellerait sur le radeau, chacun se mit au travail avec l’énergie du désespoir.
Cependant, que devenaient nos quatre principaux personnages?
Du premier coup Timoléon, radicalement guéri du mal de mer, avait deviné le danger. Mais il parlait si gaiement de la situation à sa femme; il lui assurait la terre si proche, et surtout, si facilement abordable par ce joli vent de large; il avait tant l’air de causer d’une agréable promenade sur l’eau, quelque chose comme une descente de la Seine jusqu’à Saint-Cloud, que, ma foi! la gentille Paméla s’était peu à peu laissé prendre à cette fausse confiance que montrait son mari.
Un seul être aurait pu la dissuader de cet optimisme. C’était Bokel. Mais le tailleur était devenu à moitié idiot d’épouvante, compliquée de regrets bien amers. Il se disait que si le désir louable de marier sa fille sans lui donner de dot ne l’avait pas poussé à prendre ce Polac maudit, il serait, à cette heure, bien tranquillement occupé à couper du drap au plus juste pour les culottes de MM. un tel et un tel. Dans sa pensée, il se voyait victime de son excellent cœur, de sa tendresse paternelle, de son envie d’assurer l’avenir de sa fille... Oh! comme on était stupide d’aimer ses enfants!... Quoi? faute d’une dot, sa fille ne se serait pas mariée?... En bien, après? Les couvents de filles ne sont pas faits pour les serpents à sonnette... Dans cette sainte retraite, elle aurait prié pour la longue vie, pour la santé, pour le bonheur de papa. Et lui, doucement capitonné dans ses cinquante mille livres de rente, il aurait savouré cette existence de veuf qui a beaucoup à se rattraper. Il se voyait établi en Normandie, le pays du bon beurre, dans un ermitage où il n’aurait d’autre cure que de s’occuper, à toute heure, de sa grassouillette personne... Une belle fin à une belle vie! Il avait toujours payé ses billets à échéance et, après trente ans d’affaires, il n’avait pas perdu quinze cents francs à faire crédit... Que pouvait-on dire de mieux?
Ainsi pensant, Bokel allait, de temps en temps, se montrer sur le pont pour voir où en étaient les travailleurs du radeau; puis il rentrait au plus vite, sombre, effrayé et tout disposé à adresser cette prière à la Providence qui ne lui souriait plus:
—Mon Dieu, acceptez mon gendre et ma fille... et laissez-moi ici-bas pour les pleurer!
S’il est bien vrai, comme certains le prétendent, que, quand la mort a fait sa râfle quelque part, les plus à plaindre sont ceux qui restent, le bon Bokel, on le voit, se sacrifiait.
De son côté, Dumouchet faisait partie de ceux qui, pendant qu’on travaillait au radeau, aidaient le maître cambusier à monter sur le pont les caisses de biscuits, les tonneaux d’eau douce, les barils de salaisons et autres provisions que les naufragés devaient emporter.
Sa confiance dans les cartes s’était un peu ébranlée. Il avait besoin d’être raffermi dans sa certitude du bel avenir à lui prédit. Aussi ne se faisait-il pas faute d’interroger le cambusier, toujours calme et paraissant n’avoir d’autre souci que de rouler de la joue droite à la joue gauche la chique qui remplaçait sa pipe cassée.
—Voyons, père la Méduse, disait-il, je ne suis pas un garçon qu’un rien effraye. Par conséquent, répondez-moi franchement.
—Bon, allez-y, fiston.
—Le radeau est une bonne idée, n’est-ce pas? Notre salut est assuré?
—Pfuiii! sifflait le vieux marin en clignant de l’œil et en remuant la tête.
Cette réponse ne satisfaisant pas Dumouchet par son manque de détails précis, il continuait:
—Alors, vous croyez que nous allons avoir de la misère à avaler?
—Pfuiii! recommençait le cambusier.
Et la conversation continuait ainsi depuis un quart d’heure, quand le vieux marin, ayant enfin pitié du questionneur, finit par lui dire:
—Voulez-vous un bon conseil?
—Parbleu!
—Je vais vous le donner, mais je suis certain d’avance que vous ne le suivrez pas.
—Oh! que si, je vous le jure!
—Eh bien, ne partez pas sur le radeau.
—Alors, vous me conseillez d’embarquer dans les canots?
—Pas plus dans les canots que sur le radeau.
Dumouchet resta un moment interdit.
—Mais, reprit-il, si ce n’est de me sauver à la nage, je ne vois pas comment.....
—A la nage!... vous feriez bien plaisir aux requins qui entourent la frégate.
—Est-ce que votre conseil consiste à me décider en faveur des requins?
—Non pas.
—Alors, à moins que vous n’ayez une paire d’ailes à mettre à ma disposition, je ne vois pas quelle chance me reste d’être sauvé.
Le cambusier tourna la tête pour s’assurer que nul autre ne pouvait entendre son conseil, puis, tout bas:
—Restez sur la Méduse, dit-il.
—Mais elle va sombrer!!
—Pfuiii! recommença le cambusier.
—C’est la mort inévitable... tandis que sur le radeau ou dans les embarcations...
—Pfuiii! pfuiii! lâcha le loup de mer d’un ton impatient.
Et Dumouchet eut beau dire, il n’ouvrit plus la bouche que pour éjecter le jus de sa chique.
Cependant le radeau s’était achevé, mais la nuit était venue et il fallut renvoyer le départ au lendemain. Pendant cette attente nocturne, la Méduse s’enfonça dans la vase de près de 80 centimètres.
Deux personnes, cette nuit-là, dormirent d’un sommeil paisible: Paméla, que son mari avait tout à fait ralliée à cette perspective d’une simple promenade sur l’eau pour le lendemain, et le cambusier, qui avait donné un conseil si étrange à Dumouchet.
Au point du jour, l’embarquement eut lieu. L’ordre en avait été réglé d’avance. On ne devait descendre qu’après que les provisions, entassées sur le pont, auraient été transbordées sur le radeau. Par malheur, les premières tonnes étaient à peine transportées que la frégate s’inclina un peu dans la vase. Une voix-ayant crié: Nous sombrons!!! ce fut alors une panique générale. Sans ordre, malgré la résistance des chefs, les uns s’aidant du premier cordage venu, d’autres se jetant à la mer plutôt que d’attendre leur tour sur les échelles encombrées, on envahit pêle-mêle les embarcations et le radeau.
En cet instant, le capitaine, dont l’ignorance avait perdu le navire, fit preuve de la plus insigne lâcheté. Lorsque son devoir lui commandait d’être le dernier à quitter son bord, il descendit à la hâte dans son canot et donna si précipitamment l’ordre du départ que le radeau, remorqué par les embarcations, s’éloignait déjà quand on s’aperçut que tout le monde n’avait pas encore eu le temps de quitter le bord.
Trois embarcations revinrent donc à la frégate pour reprendre les oubliés, qu’on estimait au nombre d’une vingtaine tout au plus. En reconnaissant que ce nombre dépassait soixante, le sentiment de la conservation personnelle amena une sorte de révolte chez ceux qui occupaient les canots déjà bien encombrés. Ils se refusèrent à prendre ces autres compagnons d’infortune dont le poids ferait couler les embarcations. Il fallut l’énergie et les menaces des officiers, qui avaient conservé leurs armes, pour faire accoster la frégate.
Au nombre de ceux qui n’avaient pu quitter à temps la Méduse, se trouvaient au premier rang Dumouchet, notre excellent Bokel et les jeunes mariés, qui, par conséquent, assistaient d’en haut à la scène des canots.
A ce moment une voix souffla à l’oreille de Dumouchet.
—Suivez donc mon conseil.
—Ah! c’est vous! dit Dumouchet en reconnaissant le vieux cambusier, toujours aussi tranquille que s’il s’était agi d’une partie de quilles.
—Restez sur la Méduse, dit le bonhomme.
Livré à lui-même par la détente de la remorque des canots revenus à la frégate, le radeau, tout en tournant, s’était rapproché du bâtiment.
—Merci du conseil, mais je n’en profite pas, dit Dumouchet au cambusier.
Et s’élançant à la mer, il gagna le radeau à la nage.
Une quarantaine de ceux que les canots venaient chercher tant à contre-cœur trouvèrent place dans les embarcations. En accepter plus, c’était s’exposer à couler sur place.
—Nous allons revenir pour vous prendre, cria un officier au groupe qui restait encore sur la frégate.
Et les canots se dirigèrent vers le radeau pour y déposer ceux qu’ils avaient recueillis et retourner ensuite au vaisseau. Mais, sur le radeau, tellement surchargé qu’il enfonçait de plus d’un pied dans l’eau, il y eut une telle résistance à accepter les nouveaux venus que la moitié seulement put parvenir à s’y faire admettre.
Une fois encore le sentiment de la conservation personnelle éclata dans toute sa force en cette circonstance. Les canots n’ayant pu trouver, par l’opposition des gens du radeau, qu’à s’alléger de la moitié de ceux qu’ils avaient transportés, leurs équipages mutinés refusèrent de retourner à la Méduse prendre une nouvelle charge qu’il leur faudrait garder et, malgré l’ordre des chefs, ils se remirent aux toulines qui les aidaient à remorquer le radeau.
Qu’on juge du désespoir de ceux qu’on abandonnait quand, du pont de la Méduse, ils virent s’éloigner le radeau et les canots! Ces malheureux étant au nombre de dix-sept!!!
Les embarcations contenaient deux cent trente-cinq personnes.
Le radeau en emportait cent cinquante-deux.
Parmi eux, se trouvait le bon Bokel, qui, de loin, envoyait des baisers à Paméla, laissée par lui avec son mari sur la Méduse. Il aurait bien pu céder sa place à son enfant, le cher homme, mais il n’avait écouté que sa tendresse paternelle, qui lui recommandait d’éviter un chagrin à sa fille. Sachant à quel désespoir profond serait en proie Paméla si elle avait l’horrible malheur de perdre un père qu’elle adorait, il s’était empressé de se sauver la vie pour épargner des larmes à sa fille.
Timoléon avait immédiatement deviné l’épouvantable vérité, mais il eut encore la force de sourire à sa jeune femme quand elle tourna vers lui un regard plein d’angoisse qui semblait l’interroger.
—Ne crains rien, ma chérie, ils vont revenir, dit-il d’une voix calme.
Comme Paméla remuait la tête d’une façon dubitative, il ajouta:
—C’est une manœuvre, te dis-je, pour s’aider du vent qui doit les ramener à bâbord. Ils vont revenir, je te l’affirme. Ne faut-il pas qu’ils emportent des vivres?
Et, ce disant, Polac montrait les caisses et tonneaux de provisions qui encombraient le pont, car, telle avait été la précipitation à abandonner la frégate que, de cet amas de vivres préparés la veille, les quatre cents naufragés n’emportaient pas de quoi se nourrir pendant quarante-huit heures.
Cependant Bokel, du bord du radeau où il avait trouvé place, envoyait toujours des baisers à sa fille avec une ardeur joyeuse qui prouvait combien il était heureux d’avoir conservé un père à Paméla.
A la tombée de la nuit, embarcations et radeau n’apparaissaient plus que comme une tache noire à l’horizon.
Des dix-sept abandonnés, deux déjà étaient morts; l’un avait été étouffé par un accès de colère; l’autre pris de folie furieuse, s’était jeté à la mer.
—Demain, quand nous nous réveillerons, nous trouverons les canots revenus pour nous conduire à terre... car elle est là, tout près, la terre... comme qui dirait deux fois la distance de la Bastille à la Madeleine, tu sais? répétait Polac pour rassurer sa femme.
Mais Paméla était une brave petite créature qui, la première peur passée, n’avait plus besoin d’être rassurée. Elle avait compris en quelle terrible situation ils se trouvaient et faisait bravement face au danger. Dans ce courage, il y avait beaucoup de l’exaltation particulière à la pianiste. Car ici-bas, où la Providence ne créa rien d’inutile, il faut bien que le piano ait une raison d’être. Sur son instrument, Paméla avait écorché une foule de romances qui, toutes, répétaient au refrain que nul sort au monde n’est plus doux que de mourir avec celui qu’on aime... Et Paméla, s’étant bien franchement amourachée de la longue perche qui lui servait d’époux, ne répugnait pas trop, sur la foi des refrains de romance, à savourer ce qu’il peut y avoir de doux à quitter cette vie au bras de celui qu’on aime.
L’excès de fatigue physique et de lassitude morale fit que le sommeil vint, à son heure, surprendre les jeunes époux qui s’endormirent sans songer au lendemain.
Pendant la nuit, sans qu’ils parvinssent à l’éveiller tout à fait, il sembla à Timoléon entendre des coups sourds sur un des flancs de la Méduse, mais il les attribua aux flots se brisant sur le bordage du vaisseau immobilisé dans son moule de vase.
Au petit jour, le couple s’éveilla et, tout aussitôt, monta sur le pont. Si certains qu’ils fussent d’être abandonnés, l’espérance, qui ne s’éteint jamais au cœur du plus désespéré, les poussait à croire que, peut-être, une surprise agréable les attendait là-haut.
Il ne se trompaient que de moitié. La surprise les attendait réellement, mais elle était loin d’être agréable.
Le pont de la Méduse sur lequel, la veille, ils avaient laissé leurs compagnons d’infortune, était complétement désert!
Ces coups sourds qui avaient inquiété le sommeil de Polac avaient pour cause la construction d’un radeau qui, avant le jour, avait emporté ses constructeurs loin de la Méduse. (Disons tout de suite que de ces malheureux, au nombre de douze, on n’entendit jamais parler. Le vent qui soufflait alors de terre dut les emporter au large.)
La situation se teintait en noir plus foncé pour Polac et sa femme.
Ils se voyaient seuls sur la Méduse!
Ou plutôt ils croyaient être seuls, car le bruit d’un pas pesant qui les fit se retourner les mit en présence du cambusier, l’ami de cet ingrat Dumouchet qui n’avait pas voulu suivre son conseil de rester à bord.
Il regarda un instant les jeunes gens avec cet air d’un propriétaire qui, croyant être seul à venir humer l’air dans son jardin, y rencontre deux autres promeneurs.
—Tiens, fit-il, vous n’êtes donc pas partis, cette nuit, avec les autres?
—Nous dormions, répondit Polac.
—Alors vous dormiez d’une rude force, car, je vous en réponds, ils faisaient un furieux tapage!
—Que vous avez entendu alors?
—Je n’ai pas pu fermer l’œil.
—Mais, puisque vous n’avez pas, comme nous, dormi à l’heure du salut, je puis vous retourner votre question: Pourquoi n’êtes-vous pas parti avec les autres?
—Parce que, de plus de quatre cents que nous étions sur la Méduse, je suis le seul qui n’ait pas stupidement agi. Embarcation et petit ou grand radeau n’ont emporté que des imbéciles qui, de gaîté de cœur, ont été s’exposer à des dangers qu’ils pouvaient s’éviter.
—En quoi faisant? demanda Paméla.
—En faisant comme vous et moi, ma petite mère... en restant sur la Méduse.
—Ah bah! fit Timoléon à ces paroles qui semblaient contenir une légère espérance.
—Suivez bien mon raisonnement, dit le cambusier.
—Je le suis! Paméla, suis-le aussi.
—A l’heure qu’il est, les trois navires qui nous accompagnaient dolent être arrivés au Sénégal... Ils vont d’abord nous attendre... En ne nous voyant pas paraître, ils prendront l’alarme. Alors l’Echo, qui, après nous avoir fait tous les signaux pour nous prévenir du danger, nous a quittés, quand nous allions nous jeter tout droit sur ce banc de sable maudit, répandra le bruit de notre naufrage... Vous me suivez toujours?
—Si votre langue avait des talons, je vous dirais que je marche dessus... Continuez.
—Aussitôt les navires se mettront à notre recherche, battant la mer, en quête des naufragés qu’ils supposeront naturellement s’être sauvés dans les embarcations et, vu notre grand nombre, sur un radeau... A mesure qu’ils les rencontreront, ils les ramèneront à Saint-Louis... puis ils viendront nous chercher, car il est impossible que pas un des naufragés ne parle des dix-sept compagnons laissés sur la frégate.
Peu à peu l’espoir était rentré dans le cœur des jeunes époux. Néanmoins une objection vint à la pensée de Timoléon:
—A votre tour, suivez bien mon raisonnement, dit-il au vieux marin.
—Bon, allez.
—Si de tous ceux qui sont partis, les navires ne rencontraient personne... qui, diable! leur parlerait de nous?
—Oui, cela est possible; mais à défaut de l’équipage on voudra savoir ce que la frégate est devenue et, immanquablement, l’Echo ou l’Argus viendra explorer le banc... C’est donc pour nous une affaire de patience.
—Une patience de combien?
—Quinze jours... un mois peut-être.
—Et le navire résistera un mois?
—La vase dans laquelle il est entré lui sert pour ainsi dire d’emplâtre. Depuis trois jours, l’eau n’a pas monté d’un pouce dans la cale. Pour tout démolir, il faudrait une tempête de premier calibre et nous sommes à cette époque de l’année où le calme plat retient souvent deux mois entiers un navire sous le soleil brûlant du tropique... La Méduse tiendra donc un mois... Nous n’avons qu’à attendre.
—Soit! attendons, dit gaiement Paméla.
—Attendons en nous donnant du bon temps... en passant les heures aussi agréables que possible, ajouta le cambusier.
—Et à quoi pouvons-nous rendre les heures aussi agréables que possible... Ce n’est pas en faisant des promenades à cheval? avança Polac.
D’un geste, le cambusier montra les immenses provisions entassées sur le pont.
—Regardez donc cela, dit-il, sans compter ce qu’il y a encore en dessous... Par bonheur, la cuisine du navire n’est pas noyée... Donc, mangeons!... Donnons-nous des bosses de victuailles.
—Mangeons! répétèrent Polac et sa femme, d’autant plus faciles à convaincre qu’ils reconnaissaient que manger et dormir étaient les uniques passe-temps que leur offrait la Méduse.
Ils mangèrent donc... sans la crainte de voir bientôt s’épuiser l’immense garde-manger où s’entassaient les vivres que le gouvernement français avait destinés ravitailler la colonie qui lui était rendue.
Ils mangèrent, dormirent, remangèrent, redormirent, bref, une vie réglée qui les mettait six fois à table en vingt-quatre heures.
Et quels repas!!!
Car, nous l’avons dit, Paméla et surtout Timoléon étaient deux belles fourchettes!
De sorte qu’à six repas par jour, ils en étaient à leur trois cent vingt-quatrième séance à table quand, au lever de la cinquante-quatrième aurore, depuis leur abandon sur la frégate, le cambusier, à la vue d’une voile à l’horizon, cria aux deux époux:
—Voici l’Argus qui vient nous délivrer[A].
[A] NOTE DE L’ÉDITEUR: Ce fait de trois individus restés pendant cinquante-quatre jours sur la Méduse et retrouvés par l’Argus est historique.
A ce moment même, Paméla, en couvant son mari d’un regard de tendresse, était en train de se dire:
—Est-ce parce que j’adore Timoléon?... mais il me semble moins maigre.
Toutes les prédictions du vieux marin s’étaient réalisées de point en point. Après avoir cherché en mer et ramené au port les embarcations et le radeau des naufragés, les navires de l’expédition étaient repartis en quête de savoir ce que la mer avait laissé de la Méduse.
L’œil du cambusier ne s’était pas trompé à la voilure du bâtiment qui venait les délivrer au bout de près de deux mois d’attente. C’était bien l’Argus qui arrivait.
Quatre heures après, les jeunes mariés quittaient la Méduse, où s’était passée leur étrange lune de miel, pour monter sur le brick, qui, tout aussitôt, cingla vers Saint-Louis du Sénégal.
—Nous allons enfin toucher l’héritage de mon oncle! s’écria Timoléon.
—Et revoir papa! continua Paméla.
Du papa et de l’héritage, il avait été peu ou prou parlé pendant ces cinquante-quatre jours où, menacés de n’être plus le lendemain de ce monde, les époux avaient uniquement vécu l’un pour l’autre.
—Pauvre père! Doit-il être dans des transes à notre sujet! ajouta la fille du tailleur.
—Heu! heu! fit Polac, qui avait assez étudié son beau-père pour être certain que les transes en question n’avaient pas dû fort tourmenter le gros homme. L’espoir de se retrouver bientôt en présence de Bokel n’inspirait au gendre qu’une satisfaction si tiède qu’elle aurait pu passer pour de la froideur.
Quand l’Argus jeta l’ancre devant Saint-Louis, Polac obtint de sa femme qu’elle resterait à bord pendant qu’il irait à terre s’assurer d’un logement.
—Papa doit y avoir songé pour nous. Je suis certaine que tu vas le trouver t’attendant sur le port pour te recevoir dans ses bras, lui annonça sa femme en le laissant partir.
Comme Timoléon l’aurait parié d’avance, aucun Bokel n’était venu à sa rencontre.
—En ce moment, le gros égoïste doit être encore à ronfler, pensa Polac en traversant la ville qui s’éveillait, car il était petit jour, circonstance à noter, attendu qu’elle réservait une surprise au jeune homme.
Son plan était tout simple: il consistait, au lieu de perdre son temps à la recherche du beau-père, à se rendre tout droit chez le solicitor anglais, John Hughesdon, l’exécuteur testamentaire de l’oncle, qui ne refuserait pas l’hospitalité au neveu de celui dont il avait été le meilleur ami.
Avant de faire frapper Polac à la porte du solicitor, il faut bien préciser en quel état d’esprit il s’y présentait. Quand les deux nouveaux mariés étaient montés à bord de l’Argus, ils avaient été précédés sur le pont par le vieux cambusier. En quelques mots, il s’était fait renseigner sur les suites du naufrage. Les détails étaient si épouvantables que le père la Méduse avait fait la leçon à l’équipage pour qu’on ne troublât pas cette joie de la délivrance qu’éprouvaient les jeunes époux. On s’était contenté de leur dire que le radeau avait été rencontré en mer par un navire qui l’avait ramené au port, et, comme ce renseignement leur avait été fourni par des bouches souriantes et des voix calmes, les jeunes gens, tout à leur propre satisfaction d’avoir quitté la Méduse, n’avaient pas pensé à demander d’autres informations sur une catastrophe dont ils croyaient être les plus intéressantes victimes, eux restés cinquante-quatre jours sur la carcasse de la frégate abandonnée.
—N’effarouchez pas mes tourtereaux! disait à chacun le cambusier, qui veilla, pendant la traversée, à ce que rien ne pût altérer la quiétude du ménage.
Donc, Polac, en descendant à terre au petit jour, ignorait tout. Sauf des nègres qui ne parlaient que le yolof, il ne rencontra personne qui le renseignât dans les rues désertes. Le seul individu auquel il s’adressa pour se faire indiquer la demeure du solicitor comprenait bien le français, mais c’était un muet qui lui fit signe de le suivre et le conduisit à destination. En route, le guide se livra bien à une pantomime pleine de feu, qui interrogeait et racontait tout à la fois, mais elle demeura inintelligible pour Polac. La Providence, qui fit jadis parler l’âne de Balaam, ayant jugé inutile, en cette circonstance, de rendre la parole à ce muet si gesticulant, il s’en suivit que Timoléon arriva devant la demeure de l’Anglais dans la plus profonde ignorance des faits accomplis.
On était matinal chez John Hughesdon, car, au premier coup de marteau, une négresse vint ouvrir au visiteur, qu’elle introduisit dans un petit parloir où elle le laissa pour aller prévenir son maître.
En ce pays où l’habitant demande à tous les moyens connus de le préserver des caresses trop ardentes du soleil, les jalousies et stores étaient déjà baissés pour protéger, contre le soleil levant, le peu de fraîcheur que la nuit avait fait entrer dans le local.
Arrivant du dehors, Polac, dont les yeux étaient encore éblouis par la clarté du jour, crut entrer dans une cave, et il cherchait à tâtons une chaise sur laquelle il pût s’asseoir et se tenir immobile dans cette obscurité quand, tout à coup, à deux pas de lui, retentit une voix qui s’écriait:
—Tiens, c’est toi!
Puis, après un court silence:
—Est-ce que tu ne me reconnais pas?
Reconnaître eût été difficile pour Polac, qui, bien que ses yeux eussent fini par s’habituer à ces demi-ténèbres, n’apercevait devant lui qu’une certaine ombre dont les contours se dessinaient ni plus ni moins dodus que ceux d’un manche à balai.
Cette ombre s’impatienta de ne pas recevoir de réponse. Elle se dirigea vers une fenêtre dont elle souleva le store en disant:
—Voyons, ne me reconnais-tu pas?
Ce que voyait Timoléon dans cet angle d’un jour éclatant était épouvantable au possible. C’était un vrai visage de spectre, jaune, décharné aux pommettes saillantes, aux yeux renfoncés dans leurs orbites... on eût dit un déterré de deux mois! Et sur cette face hideuse, qui donnait le frisson, il fut impossible à Polac en consultant les souvenirs, de pouvoir mettre un nom.
Le spectre attendit un instant, puis, de cette voix affaiblie et sifflante, qu’il avait depuis le début de la rencontre, il prononça.
—Je suis Dumouchet.
—Toi??? cria Polac, que la plus immense surprise fit reculer de trois pas.
—Oui, moi, reprit le cousin, moi, un des survivants du radeau de la Méduse. Nous étions partis cent cinquante-deux... Quand l’Argus nous a recueillis en mer, nous n’étions plus que quinze, dont cinq sont morts à leur arrivée à terre... Oh! l’horrible drame qui a duré treize jours! Nous-nous sommes battus pour quelques gouttes de vin qui nous restaient... cette nuit-là a coûté la vie à soixante-cinq de nous... puis la soif, la folie causée par un soleil torride, la faim ont tué les autres... Et quelle faim! une faim de bête féroce! qui s’est assouvie par d’épouvantables moyens... j’ai mangé de... de la...
Dumouchet fut interrompu dans son récit par l’entrée d’un grand homme à favoris rouges.
C’était le solicitor Hughesdon qui salua les deux cousins en disant:
—Messieurs, veuillez me suivre; les balances sont prêtes dans la cour.
Sur cette invitation laconique, il ouvrit une porte, ce qui permit aux jeunes gens d’apercevoir une balance dont les larges plateaux avaient servi à peser des douzaines de négrillons en l’heureux temps de la traite.
Il fallut soutenir le pauvre Dumouchet pour qu’il pût s’installer sur un plateau. Il n’avait vraiment plus que le souffle.
Quant à Timoléon, à moitié idiot par la surprise que lui avaient causée l’aspect et l’histoire de son cousin, il s’était déjà mis en marche lorsque, brusquement, il s’arrêta en poussant un cri de fureur.
Il se trouvait devant un meuble qui lui avait fait défaut pendant les cinquante-quatre jours passés sur la Méduse.
Ce meuble était une glace!!!
Au lieu de ce Timoléon en lame de couteau qu’il s’était connu, la glace lui réflétait un bon gros garçon bien portant et de hautes couleurs. C’était à croire qu’il était entré dans la peau du Dumouchet fleuri qu’il narguait deux mois auparavant.
Il n’en monta pas moins dans son plateau, ce qui, incontinent, enleva celui du cousin avec une facilité désespérante pour l’époux de Paméla.
—Je paye mes deux mois de ripailles sur la Méduse, se dit Timoléon la rage au cœur.
Alors s’éleva la voix solennelle du solicitor qui disait:
—L’héritage est acquis à Baptiste Dumouchet!
Son arrêt rendu, l’homme aux favoris rouges salua encore et partit en laissant les cousins, chacun sur son plateau, où les immobilisait, l’un sa faiblesse, l’autre son désespoir.
Après un petit temps de silence, Dumouchet remua doucement la tête et d’une voix légèrement railleuse:
—Hein! fit-il, croiras-tu maintenant aux prédictions des cartes, gros incrédule!
Timoléon appelé gros par Dumouchet, c’était une bien amère ironie du sort. L’heure n’était pas à la plaisanterie pour l’infortuné Polac. A son immense déboire de perdre les millions se joignait la perspective redoutable d’avoir bientôt à tomber sous la férule de l’avide Bokel, qui, furieux de sa spéculation avortée, allait lui faire la vie dure. Aussi faut-il pardonner à Polac l’injuste colère avec laquelle il répondit à la raillerie bien innocente de son cousin:
—Gros incrédule!... Cesse tes sottes plaisanteries, voleur d’héritage!
Au lieu de répliquer qu’il avait gagné loyalement cet héritage au prix des souffrances les plus inouïes, Dumouchet se contenta de prononcer ce seul mot:
—Ingrat!!!!!
Au ton qui avait accentué ce reproche inattendu, Timoléon s’était subitement cabré.
—Moi? un ingrat!... Quel service m’as-tu donc rendu, mon cher? s’écria-t-il.
—Un service immense... et, surtout, rare.
—Rare? répéta Polac.
—Oui, très-rare.
Ils étaient seuls. Nul ne pouvait les entendre. Alors l’échappé du radeau de la Méduse, se penchant à l’oreille de son cousin, lui souffla bien bas:
—JE T’AI MANGÉ TON BEAU-PÈRE!
En apprenant quel avait été le sort de Bokel, le feu sombre qui brillait dans l’œil de Timoléon sembla avoir brusquement perdu la moitié de son éclat. Il s’éteignit même tout à fait quand Dumouchet eut ajouté ce renseignement que le gendre ignorait:
—Ton beau-père... qui avait cinquante bonnes mille livres de rente.
En songeant à ce qu’avait été, au poids, le digne tailleur, il crut que le cousin se vantait en s’attribuant toute la gloire d’un exploit gastronomique qui, forcément, avait réclamé de l’aide pour pouvoir être accompli.
A son tour, il se pencha vers... le tombeau de Bokel et lui demanda:
—Qu’est devenu Filandru?
—Mort d’indigestion, le gourmand! répondit Dumouchet en rougissant un peu, preuve incontestable qu’il avait été pincé en flagrant délit de gasconnade.
Il est d’usage à Paris que les ivrognes, vagabonds, maraudeurs et autres mécréants de pire espèce, dont la police a fait une râfle nocturne et qu’elle à soigneusement mis sous clé, soient conduits, le matin venu, chez le commissaire de police du quartier, qui, après interrogatoire, décide si le gibier sera expédié à la préfecture ou s’il sera remis en liberté après semonce plus ou moins verte.
C’est à cette partie de ses fontions que M. O***, un des commissaires de police du IXe arrondissement, était en train de procéder le matin du premier dimanche de juin 1871, c’est-à-dire quinze jours, tout au plus, après la fin du second siége de Paris.
De toute l’engeance que lui avait amenée le coup de filet des agents, le prisonnier que le commissaire interrogeait au moment où débute notre récit ressemblait si peu à tous les compagnons de poste qui l’avaient précédé sur la sellette, que c’était à croire que le magistrat, suivant une locution populaire, se l’était réservé pour la bonne bouche.
C’était un grand et fort beau garçon de vingt-cinq ans, à la chevelure brune, à la tournure élégante, aux manières distinguées, vêtu à la dernière mode. Il y avait vraiment à s’étonner, en jugeant sur l’apparence, de voir un si charmant cavalier en une pareille situation.
Pourtant, un observateur qui aurait attentivement examiné le jeune homme, n’aurait pas tardé à reconnaître, en tenant pour vrai que les yeux sont le miroir de l’âme, que le regard dudit beau garçon n’était pas d’une limpidité irréprochable. Il s’éclairait, par instants, d’une expression qui trahissait une forte dose de ruse doublée d’énergie.
Le cas qui avait amené ce gaillard-là sous les verrous, et que nous allons bientôt détailler, n’était certes pas des plus graves, mais on pouvait supposer qu’il avait mis entre les mains du commissaire un fil qui, tout mince qu’il semblait être, pouvait, si le magistrat avait l’idée de le suivre jusqu’au bout, mener à quelque chose de beaucoup plus compromettant; car, bien que notre jeune homme affectât une sorte de tranquillité dédaigneuse, un nuage d’inquiétude s’assombrissait sur son front à mesure que l’interrogatoire se poursuivait.
Cette anxiété échappait-elle à M. O***? Nous ne saurions le dire. Mais nous pouvons constater qu’il ne posait pas ses questions à l’aveuglette, car il paraissait être des mieux renseignés sur le compte de celui qu’il interrogeait.
—Bref, Maurice Prévannes, disait-il, on ne vous connaît aucune fortune, et pourtant vous menez un train de vie qui nécessite des ressources acquises.
—Je mange mes économies, répondit celui qu’on venait d’appeler Maurice Prévannes.
—Vos économies? Où et quand avez-vous pu faire des économies? poursuivit le commissaire d’un ton légèrement ironique.
—Mais je n’ai pas été toujours sans place.
—C’est vrai, vous aviez une place de commis au bureau des «Polices d’assurances sur la vie» de la compagnie: LA PRÉCAUTION, place dont vous avez été congédié si lestement qu’on peut en conclure que ceux qui vous ont remercié n’avaient pas à se louer grandement de vous... Mais la question n’est pas là... Cette place vous fut accordée en souvenir de votre père défunt, qui avait été un des meilleurs et des plus anciens employés de LA PRÉCAUTION... Vous l’avez occupée pendant quatre années et elle vous rapportait quinze cents francs... C’est donc sur cette somme, quatre fois émargée, que vous prétendez avoir fait les économies qui alimentent votre vie actuelle...
Sans attendre une réponse, le commissaire ajouta en pesant sur les mots:
...et vous aident à subvenir aux frais de votre liaison avec la fille connue dans le monde galant sous le nom de Lurette Baba... une de ces créatures dont les faveurs sont haut cotées.
—Est-il donc inadmissible qu’une de ces créatures, comme vous les appelez, soit capable d’une liaison désintéressée? riposta Maurice d’un ton plein de la plus cynique fatuité.
Nous l’avons dit, ce Prévannes était réellement un fort beau garçon. Sa prétention d’être aimé pour lui-même par une courtisane n’était donc pas de la catégorie des choses miraculeuses. En conséquence, le commissaire lâcha le lièvre qu’il avait levé et, sans plus insister sur ce point, il continua:
—Soit! admettons le désintéressement de mademoiselle Lurette Baba!... Mais vous n’en vivez pas moins ensemble, et la vie, telle que vous la menez, est coûteuse. Vous avez deux domestiques; votre appartement est du prix de trois mille francs.
Puis, comme Prévannes ouvrait la bouche pour répondre, M. O***, voulant prévenir une explication qu’il sentait venir, se hâta d’ajouter:
—Vous ne me direz pas, j’aime à le croire, que c’est la fille Baba qui solde ces dépenses, car, au moment où vos relations ont commencé, tout ce qu’elle possédait venait d’être vendu par huissier à la requête de ses nombreux créanciers.
M. O***, on le voit, était un commissaire fort au courant de ce qui se passait dans son quartier.
Maurice s’était mordu les lèvres en entendant ainsi mettre sur le tapis le passé de sa Dulcinée. Le commissaire lui avait-il coupé l’herbe sous le pied en rendant impossible la version, dénuée de toute vergogne, qu’il avait préparée? Toujours est-il qu’il se contenta de hausser les épaules en homme qui dédaigne de relever une injure inepte.
Du reste, il aurait voulu parler qu’il n’en aurait pu trouver le temps, car le commissaire avait immédiatement repris:
—Cette vente a eu lieu en août 1870, à l’époque de nos premiers désastres. Depuis, le blocus de Paris et tous les sinistres et terribles événements qui se sont succédé n’ont pas fait l’époque propice pour la tribu des demoiselles Baba... Donc, depuis onze mois, cette fille a été et est encore à votre charge.
Cela posé, M. O***, revenant à ses moutons, termina en ajoutant:
—Nous disons donc que c’est avec vos seules économies... ces fameuses économies que...
Soutenir plus longtemps son thème devant un adversaire aussi ferré sur les informations eût été maladroit. Maurice Prévannes, faisant une concession, interrompit le magistrat en répliquant:
—Oui, avec mes économies... auxquelles il faut encore ajouter quelques ressources que je possédais et qui se sont épuisées peu à peu.
—Ah! ah! fit M. O***, pourquoi donc ne pas le dire tout de suite. Ainsi vous aviez des ressources?... Et lesquelles?
—J’ai vendu mon argenterie.
—Argenterie qui vous venait de feu votre père, n’est-ce pas? dit le magistrat du ton le plus naïf du monde.
Mais cette naïveté sonna sans doute faux à l’oreille de Maurice, qui, au lieu de saisir la perche qu’on lui tendait, répondit en secouant la tête:
—Non, monsieur, je l’avais achetée après une heureuse veine au jeu.
—Chez quel bijoutier?
Prévannes, à cette question, eut un très-court moment d’hésitation, puis répondit:
—Je ne saurais vous désigner le bijoutier, attendu que cette argenterie était d’occasion. Elle m’avait été vendu par un ami dans la gêne, pauvre garçon qui a été tué à la bataille de Champigny.
A cette réponse, le commissaire regarda Maurice dans les yeux, et d’un ton moqueur:
—Une argenterie d’occasion! répéta-t-il; alors il faut reconnaître que l’occasion a été on ne peut plus complète puisque cette argenterie s’est trouvée justement marquée à vos initiales: M. P., Maurice Prévannes.
A vouloir se montrer fin, le commissaire en arrivait vraiment à être niais. Pourquoi cette question saugrenue? N’était-il pas du dernier simple de se dire que Maurice, après son acquisition faite, avait donné ses initiales à graver?
Et pourtant, sous cette remarque absurde, devait se cacher quelque danger pour Prévannes, car il pâlit légèrement comme si le magistrat, sans s’en douter, avait effleuré une corde désagréablement sensible au jeune homme.
Hâtons-nous d’ajouter que M. O***, fit tout de suite amende honorable de son observation ridicule en ajoutant au plus vite:
—Que le hasard vous ait fait trouver votre chiffre sur ces couverts ou que vous l’ayez fait graver après l’achat, c’est un détail de nulle importance, car je n’ai aucunement l’intention de vous contester la propriété de cette argenterie.
A cette conclusion, le jeune homme poussa un soupir de satisfaction qui, pourtant, ne dépassa pas les lèvres.
De son côté, le commissaire s’était mis à sourire. Pas plus que la naïveté de tout à l’heure, ce sourire ne parut de bon augure au beau garçon, qui sembla se raidir contre l’approche d’un coup de Jarnac.
—Oh! oh! fit le magistrat, n’allez pas me prendre pour un sorcier parce que je sais que l’argenterie vendue portait vos initiales... Je l’ai tout simplement appris de M. Rodieri, le bijoutier du faubourg Montmartre, auquel vous avez fait la vente... Je ne me souviens même plus trop à propos de quoi il m’en a parlé...
Au nom du bijoutier, Prévannes avait fermé les yeux comme s’il craignait que son regard trahît le trouble qui venait de s’emparer de lui. Il ne les rouvrit qu’en entendant le commissaire avouer son manque de mémoire sur la circonstance qui l’avait mis en rapport avec le bijoutier.
Mais, tout à coup, M. O*** se frappa le front en s’écriant:
—Parbleu! voici le souvenir qui me revient!... Est-ce que, huit jours après qu’il vous avait acheté l’argenterie en question, vous n’êtes pas encore venu proposer à Rodieri de lui vendre un lot de bijoux.... de vieux bijoux tout démodés?
Cette nouvelle question eut pour effet de faire se crisper les poings du jeune homme avec une violence qui accusait une rage sourde. Si Prévannes n’avait pensé aux deux vigoureux sergents de ville qui l’avaient amené du poste et qui attendaient dans l’antichambre, il y a gros à parier qu’il aurait étranglé le commissaire.
—Et même, continua ce dernier, si je me souviens bien, il paraîtrait que, Rodieri vous ayant adressé quelques demandes au sujet de ces bijoux, vos réponses ont été si confuses qu’il a refusé de conclure... C’est alors qu’il est venu me faire part du fait, en m’apprenant que, huit jours auparavant, il vous avait acheté votre argenterie... il me l’a même montrée. J’ai pu ainsi constater qu’elle était marquée M. P. Il paraît aussi, à ce que m’a dit Rodieri, que la plus grande partie des bijoux que vous proposiez portaient pareillement vos initiales. C’est même cette circonstance qui, laissant un doute en votre faveur au bijoutier, lui a fait commettre la faute de vous permettre de reprendre ces bijoux.
A cette fin de phrase, Maurice se redressa convulsivement, les lèvres frémissantes, l’œil tout étincelant de fureur.
Ce qui n’empêcha pas le commissaire de demander d’un petit ton bien doux:
—Est-ce encore après une heureuse veine au jeu que vous aviez acheté ces bijoux, qui, au bas mot de Rodieri, valent une trentaine de mille francs?
En admettant que Maurice avait avancé un premier mensonge à propos de sa veine au jeu, il est présumable que le bis repetita placent n’était pas de son goût, car il répondit d’une voix brève et sèche:
—Cette fois, monsieur, vous auriez pu encore me demander si je ne les tenais pas de feu mon père.
—Ah! vraiment! ils vous viennent de feu votre père, ces bijoux... qui valent trente mille francs! s’écria le commissaire d’une voix qui chantait ironiquement.
—En doutez vous?
—Nullement, nullement, puisque vous me le dites... Seulement je me demande pourquoi, au moment de sa mort, votre père passait pour être si complétement dénué de ressources que c’est la compagnie la Précaution qui s’est chargée de tous les frais de funérailles de son ancien employé?
En vérité, ce M. O*** faisait partie de la bande des chercheurs de petite bête, gens qui ont au suprême degré le don de vous porter sur les nerfs. Rien n’est donc plus concevable que la sorte d’emportement avec laquelle notre jeune homme s’écria;
—Alors dites tout de suite que je suis un voleur!
Sur cette exclamation, le magistrat, au lieu de s’avouer qu’il avait été trop loin, secoua la tête, et, en forçant le ton goguenard de sa voix:
—Eh! eh! fit-il, je ne jurerais pas que non... d’autant mieux que certaines personnes, qui vous connaissent plus intimement que moi, sont les premières à le crier bien haut.
—Qui donc? gronda Maurice.
Ensuite, par un revirement subit qui lui fit maîtriser sa colère:
—Au fait, reprit-il, je ne suis pas ici pour une affaire d’argenterie et de bijoux... Je vous somme d’aborder dans votre interrogatoire, la cause de mon arrestation, fort étrangère à toutes ces questions avec lesquelles vous me torturez depuis une heure.
—Euh! euh! tout s’enchaîne ici-bas, riposta M. O***, toujours moqueur.
Puis, en chat las de jouer avec sa souris avant de l’étrangler, il ajouta brusquement:
—Écoutez ce passage du rapport d’un des agents qui, hier soir, vous ont consigné au poste.
Et il se mit à lire lentement:
«Attirés par les cris: à l’assassin! nous pénétrâmes dans la maison. Au milieu de l’escalier, nous rencontrâmes une jeune femme échevelée, blanche d’effroi, tremblant de tous ses membres. Elle fuyait devant un homme qui la poursuivait à coup de cravache...»
Sur ce terrain-là, Prévannes se sentait sans doute plus solide; car il interrompit la lecture pour dire impudemment:
—J’ai bien le droit de corriger ma maîtresse, il me semble.
Après une légère moue de dégoût, le commissaire riposta, sans quitter des yeux le procès-verbal:
—C’est un droit que votre maîtresse est loin de reconnaître, car elle a été la première à réclamer votre arrestation... et, cela, en des termes qui ne plaident pas en votre faveur.
—Des termes? répéta Maurice dont l’aplomb parut se déranger d’un cran.
—Oui, ils sont là consignés dans ce rapport. Voulez-vous les connaître?
—Sans doute.
Le commissaire sauta des yeux quelques lignes et reprit sa lecture:
«Quand, après une vigoureuse résistance de sa part, nous nous fûmes emparés de cet homme, la femme s’écria: Débarrassez-moi de ce brigand-là, mes bons messieurs! Oh! ne craignez pas d’avoir mis la main sur le collet d’un honnête homme! C’est une affreuse canaille! J’en sais long sur son compte, allez!... Si je voulais parler, je l’enverrais loin!»
S’arrêtant à ce point de sa lecture, le magistrat leva les yeux vers Maurice, qui avait écouté, l’œil fixe et les sourcils froncés.
—Eh bien? fit-il.
Le beau gars haussa brusquement les épaules.
—Est-ce qu’on doit prendre au sérieux les paroles d’une femme jalouse et furieuse! répondit-il.
—Alors, selon vous, c’est la jalousie qui a causé cette scène?
Il y eut, chez Prévannes, un peu d’hésitation avant de répondre:
—Oui... et je suis certain que Baba, en admettant qu’elle se les rappelle, doit être au désespoir d’avoir prononcé de telles paroles.
—C’est ce que je serai à même de vérifier quand je l’interrogerai...
L’assurance que Maurice cherchait à montrer eut l’air de se démentir à cette nouvelle que sa maîtresse serait interrogée séparément. Avait-il menti en affirmant le dire de mademoiselle Lurette sans importance aucune? Craignait-il une vengeance qui se traduirait par des révélations? Ou bien, certain de n’être pas trahi par Baba, avait-il simplement peur d’une imprudence bien involontaire de la part de la donzelle? Pour mieux apprécier sa situation, il voulut d’abord savoir à quoi s’en tenir.
—Ah! elle va venir? dit-il d’un ton dégagé.
—Non, pas maintenant... L’ordre de se rendre à mon bureau est pour l’après-midi.
Cette réponse ne devait pas être du goût de Maurice, car il eut besoin de raffermir sa voix en demandant:
—Et moi... jusqu’à ce moment-là?
—Vous? On va vous reconduire au poste, où vous attendrez ce que je déciderai de vous après l’interrogatoire de la fille Baba.
Ce disant, le commissaire avançait la main vers le timbre qui allait appeler les sergents de ville, quand, dans la pièce voisine, s’éleva un bruit de voix, puis, la porte s’ouvrant tout à coup, une jeune femme apparut en s’écriant:
—J’entrerai, vous dis-je... Je veux qu’on me rende mon Maurice.
Brune, potelée, la dent sur les lèvres, fraîche au possible, en un mot, des plus charmantes, telle était Lurette Baba, qui, après avoir repoussé les sergents de ville tentant de la retenir, faisait ainsi son entrée dans le cabinet du commissaire.
Et sans perdre de temps:
—N’est-ce pas, monsieur, continua-t-elle d’une voix câline, que vous allez me le rendre, ce bon chéri... Hier, voyez-vous, c’était de la plaisanterie.
—Plaisanterie à coups de cravache, dit le commissaire dont, en même temps que le ton se faisait sévère, l’œil s’adoucissait en détaillant le gracieux visage de Baba.
Que voulez-vous! Tout commissaire est doublé d’un homme, et, chez M. O***, l’homme était un gourmand de jolis minois.
—Est-ce qu’il y a une loi qui défend d’aimer à être battue? demanda Lurette avec un petit sourire adressé à Maurice.
—Alors, reprit le commissaire, puisque les coups sont tant de votre goût, comment se fait-il que vous les receviez de si mauvaise grâce... en criant à l’assassin... et, surtout, en traitant de canaille, dont vous savez pis que pendre, celui qui s’efforce de vous plaire à tour de bras?
—Moi? fit Lurette, qui avait vraiment l’air de tomber des nues.
—Oui, vous... Écoutez ce passage du rapport que je vais lire pour la seconde fois.
Et le magistrat relut encore:
«Débarrassez-moi de ce brigand-là, mes bons messieurs. Oh! ne craignez pas d’avoir mis la main sur le collet d’un honnête homme! C’est une affreuse canaille! J’en sais long sur son compte, allez! Si je voulais parler, je l’enverrais loin.»
Cela lu, le commissaire ajouta:
—Eh bien, voyons, c’est le moment, je vous écoute, parlez... Qu’avez-vous à révéler?
Mais la pauvre Baba était bien loin de songer à des révélations. A mesure qu’elle avait écouté, son visage avait passé par toutes les phases d’une surprise énorme, et ce fut d’une voix brisée qu’elle s’écria:
—Ah! mon Dieu! qu’on est bête quand on est en colère!
Puis fondant en larmes, elle s’élança au cou de Prévannes en bégayant:
—Comment! j’ai pu dire cela de toi, mon bon chéri! Ah! pardonne-moi... j’étais folle... pardonne-moi... tu sais bien que je n’en ai jamais pensé un mot.
Et elle embrassait le beau garçon à pleins bras, tout convulsivement. Ce qui ne l’empêcha pourtant pas d’entendre Maurice qui lui soufflait à l’oreille:
—Joue la jalousie.
L’ordre avait été donné si vite, si bas, si bien à couvert sous un sanglot de Lurette que le commissaire de police crut avoir prévenu toute confidence en s’empressant de dire:
—Assez!... et répondez-moi.
Baba tourna aussitôt son visage baigné de pleurs vers le magistrat.
—Ainsi vous rétractez vos paroles d’hier? continua ce dernier. Votre amant n’est pas un coquin qui doit tout craindre de vos révélations... et que, suivant votre dire, vous mèneriez loin si l’envie vous venait de parler?
A ces mots, une bouffée de colère rageuse succéda aux attendrissements de Lurette, qui, montrant son mignon poing crispé à Prévannes, s’écria:
—Eh bien! non, non, je ne rétracte rien... c’est un gredin! un gueux! un scélérat fini!
Puis, en baissant sa tête séduisante sous les yeux de M. O***, presque à la portée de ses lèvres, elle poursuivit d’une voix fébrile:
—Voyons, regardez-moi, monsieur le commissaire, est-ce que je ne suis pas gentille? Est-ce que je ne vaux pas toutes ces poupées de la haute pour lesquelles il me délaisse? Oh! oui, j’en sais sur le monstre! Et si je voulais bavarder, je connais plus d’un mari qui lui ferait passer un vilain quart d’heure... Si ce n’est pas une indignité, je vous le demande, de m’avoir battue, hier, parce que j’essayais de l’empêcher de rejoindre une de ces fameuses princesses qu’il me préfère...
Chez mademoiselle Baba les impressions se succédaient rapides et fort différentes. Après le chagrin et la colère vint subitement la gaîté. Elle éclata de rire en s’écriant:
—Ah! je le vois d’ici, ce nez qu’a dû faire la princesse en attendant toute la nuit son beau vainqueur qui trépignait de fureur au poste.
Et elle tourna encore son poing vers Maurice en s’écriant:
—Hu! hu! vilain sacripant! tu n’as pas encore été assez puni!... il devrait y avoir une loi pour châtier les infidèles de ta force.
Pendant que Baba parlait, le commissaire avait jeté les yeux sur Prévannes. Le jeune homme répondit à ce regard par un demi-sourire de triomphe qui, bien clairement, voulait dire: Hein! avais-je raison de vous affirmer que tout cela était pure affaire de jalousie?
—Voilà donc l’explication que vous donnez de vos paroles d’hier quand on a arrêté Prévannes? reprit le magistrat en revenant à Lurette.
Baba ouvrit des yeux effrayés.
—Mais, balbutia-t-elle, mes paroles ne signifiaient pas autre chose... Quel sens leur avez-vous donné?... Ah! il ne faut pas me faire peur comme cela... Rendez-moi mon Maurice... il n’est coupable que d’infidélité... N’est-ce pas que vous allez me le rendre? Est-ce que vous m’avez crue quand j’ai dit qu’il n’avait pas été assez puni?
—Ainsi vous retirez votre plainte? demanda le commissaire un peu ému par ce ton de prière.
Mais, avant que Lurette eût pu répondre, on entendit, dans la pièce qui précédait le cabinet, glapir une voix aiguë et pleurarde qui disait:
—Ma femme! J’ai perdu ma femme! il faut que M. le commissaire m’aide à retrouver ma femme!!!
Ceux qui avaient charge de veiller au huis clos du cabinet durent, sans doute, s’opposer à ce que le nouvel arrivant forçât une consigne déjà si lestement violée par mademoiselle Baba, car, au murmure de plusieurs voix qui probablement engageaient le hurleur à la patience, succédèrent encore ces paroles:
—Non, pas une minute! je veux le voir tout de suite! je ne puis attendre... il me faut ma femme! qu’on retrouve ma femme... ma Clarisse adorée!
Dès le début de ces vociférations, le commissaire avait dressé l’oreille et pointé le nez dans la direction de la porte derrière laquelle éclatait l’organe criard du moderne Orphée réclamant son Eurydice. Ce moment d’attention ou, pour dire plus juste, d’inattention fut cause qu’il n’aperçut point une rapide scène qui se passa à côté de lui.
Au premier son de la voix en question, Lurette Baba avait pâli en fixant sur Maurice un regard effaré. Celui-ci, à la vue de ce trouble, avait vivement, d’un doigt posé sur ses lèvres, fait ce geste qui, dans tous les pays du monde, recommande le silence.
Cependant le commissaire avait donné un coup de timbre placé sur son bureau.
—Qu’est-donc, Jacquet? demanda-t-il à son secrétaire que cet appel avait fait comparaître.
—C’est un monsieur tout en larmes qui veut absolument entrer... Je crois bien que nous avons affaire à un fou, car...
Mais le secrétaire Jacquet n’eût pas le loisir de compléter ces renseignements. Il avait commis la faute en entrant de ne pas refermer sa porte derrière lui. Ce fut par cette ouverture que celui dont on parlait fit irruption dans le cabinet ni plus ni moins impétueusement qu’une trombe. Il fit pirouetter Jacquet, renversa une table chargée de papiers, deux chaises et un lavabo, bouscula brutalement la pauvre Lurette qui se trouvait sur son passage et vint s’abattre sur le ventre, à l’angle du bureau de M. O***. Puis, sans nullement se préoccuper de tout ce désastre, il promena, sur les assistants, un regard hébété qui cherchait le commissaire et qui finit par s’arrêter sur Maurice. Après quoi, éclatant en larmes, il se mit à beugler:
—On m’a pris ma femme! Je la réclame! Qu’on me retrouve ma Clarisse!
—Veuillez retourner dans la pièce à côté, je suis à vous dans un instant, dit le commissaire.
Mais cet époux éploré, qui s’était avachi dans un fauteuil, remua la tête en bégayant au milieu d’énormes sanglots:
—Non, tout de suite! tout de suite!
Il était en proie à un tel désespoir que M. O***, pris de pitié, empêcha, d’un geste de main, les deux agents accourus à la rescousse du secrétaire Jacquet, de rudoyer le malheureux; puis, d’un second signe, il congédia ses trois subordonnés.
Du reste, pour ce qu’il restait au magistrat à dire ou à faire, cet infortuné n’était pas un témoin qui pût le gêner; mieux aurait valu se méfier d’un soliveau. Tout à son chagrin, il s’était caché la tête dans ses mains et, à demi étouffé par ses sanglots, il répétait ce refrain:
—Ma Ririsse, ma Clarisse!
Le laissant donc gémir en son coin, M. O*** revint à Baba, qui s’était rapprochée de Prévannes comme si, près de ce dernier, elle cherchait un défenseur contre un danger sérieux et imminent.
En somme, le cas de Maurice était des moins pendables. Du moment que Lurette retirait sa plainte, la faute avait été largement expiée par une nuit passée au poste. De plus, ainsi que nous l’avons annoncé en commençant cette véridique histoire, il y avait à peine quinze jours que s’était terminé le second siége de Paris, ce qui veut dire que les sévérités et le zèle de la police avaient biens d’autres chats à fouetter avant de perdre le temps à sévir pour quelques coups de cravache octroyés à une femme qui, circonstance atténuante, avouait ne pas détester ce genre de régal.
Donc le commissaire lâcha la main.
Mais avant de laisser son homme prendre la poudre d’escampette, il jugea utile de pimenter sa clémence d’une verte semonce. Il avait à cœur de bien préciser que les explications de la jolie fille ne l’avaient qu’à demi convaincu et que, sur d’autres points, il gardait une conviction qui faisait ses réserves pour l’avenir.
—Prévannes, dit-il, je consens à vous remettre en liberté.
Ensuite, s’adressant à Baba:
—Je vous le rends, mais sachez bien qu’une seconde fois me trouverait moins crédule à tous vos contes de jalousie.
Probablement que la joie de voir Maurice libre avait coupé net la parole à mademoiselle Baba. Elle, tout à l’heure si jacasse et tant expansive, au lieu d’éclater en joyeux remercîments, ne témoigna sa reconnaissance que par un demi-sourire et un léger mouvement de tête. Pas un mot ne sortit de ses lèvres, qui, de roses qu’elles étaient à son arrivée, étaient devenues blêmes.
—Quant à vous, continua M. O***, en revenant à Prévannes, tenez-vous aussi pour bien dit qu’à la première occasion que vous me fournirez de m’occuper de vous, je chercherai mieux à fixer mon soupçon que j’ai affaire à un chevalier d’industrie, sur lequel je vous préviens qu’à dater d’aujourd’hui je ne cesserai d’avoir l’œil.
C’était dur à avaler pour le beau Maurice, si fier et si bravache au commencement de la séance. L’épithète de chevalier d’industrie aurait dû le faire bondir! Il est à supposer qu’il avait mis de l’eau dans son vin et qu’il s’était dit qu’au prix d’un sacrifice d’amour-propre il valait mieux en finir sans ergoter. Il leva les yeux au plafond, haussa légèrement les épaules, fit une moue de dédain, mais s’en tint strictement à la pantomime, car, pas plus que Lurette, il ne lâcha une parole.
Cependant le commissaire avait donné un double coup de timbre.
—Laissez passer monsieur, dit-il aux deux sergents de ville de planton qui se présentèrent.
Puis en guise de congé définitif:
—A l’avenir, marchez droit, mon garçon, car, vous en êtes prévenu, je vous surveillerai.
S’il est vraiment beau de savoir se maîtriser, Prévannes méritait incontestablement des éloges, car cette autre phrase injurieuse ne lui fit pas ouvrir la bouche.
Sans le plus petit mot, sans autre adieu qu’un salut de la tête, les deux amants s’éloignèrent avec une certaine précipitation.
—Ah çà, ils sont donc devenus muets? pensa le commissaire étonné.
Après quoi il se mit à examiner l’homme, l’époux de Ririsse, qui, maintenant, la tête renversée sur le dossier du fauteuil et le nez en l’air, était dans un tel état de prostration qu’il ne pouvait avoir rien vu ni entendu de ce qui venait de se passer à un mètre de lui.
Ce geigneur, qui doit être le héros principal de notre aventure, était un homme d’environ trente ans, commun d’allures, lourd de gestes, grotesquement fagoté en ses habits et porteur d’une chevelure blonde et frisottée surmontant une vraie tête de mouton qui accusait la bonté niaise et crédule.
Aussi le commissaire, qui, quand il s’adressait à lui-même, n’était pas tenu à cette sévérité d’expressions que comportaient ses fonctions, formula-t-il ainsi son jugement:
—C’est un vrai melon!
A ce moment, son regard, qui, de l’examen du visage, avait passé à l’inspection des vêtements pour juger à peu près de la position sociale de l’individu, s’arrêta sur le gros bouton en or d’une manchette qui dépassait la manche du paletot.
—Tiens! il porte les mêmes initiales que ce Maurice Prévannes, se dit le magistrat en apercevant les deux lettres M. P. qui se détachaient en relief sur le bouton.
Sa remarque faite, mais sans y attacher la moindre importance, il allait secouer son homme pour le tirer de sa torpeur, quand, après un petit coup frappé, la porte du cabinet s’ouvrit pour laisser passer la tête du secrétaire Jacquet.
—Monsieur, annonça-t-il à mi-voix, il y a là une brave femme d’une cinquantaine d’années... domestique de son état, m’a-t-elle dit... qui demande à vous parler.
—Eh bien! qu’elle attende que j’en aie fini avec monsieur, dit le commissaire en montrant celui qu’il avait mentalement traité de melon.
—Ah! qu’elle attende, répéta le secrétaire d’un ton désappointé, c’est que...
—Que quoi? fit le supérieur en voyant son employé hésiter à achever sa phrase.
—C’est qu’il va bientôt être midi, lâcha timidement Jacquet.
Ce simple renseignement valait tout un discours. Il rappelait au fonctionnaire qu’on était au dimanche du congé de quinzaine, jour où, à partir de midi, le bureau fermait, se reposant du soin des affaires de cette demi-journée sur le commissariat du même quartier le plus voisin, chargé, suivant l’usage, de l’intérim.
Or, que son chef reçût cette femme, c’était, pour Jacquet, voir se reculer l’heureux moment de prendre la clef des champs.
C’est juste! fit le supérieur, comprenant à demi-mot. Alors dis à cette personne, si ce n’est personnellement à moi qu’elle a affaire, qu’elle repasse demain matin. Sinon, envoie-la au commissariat de la rue Taitbout, qui, aujourd’hui, fait notre intérim.
—Bien! dit Jacquet joyeux.
Tout s’enchaîne ici-bas. A un mince détail qu’on a eu le tort de négliger s’accroche bien souvent un gros événement qui vous surprend plus tard. Disons tout de suite que si M. O*** avait reçu cette femme, il se serait évité tout le tintouin qu’allait lui procurer l’être qui venait de se relever de dessus son fauteuil en débitant d’un ton lamentable:
—Ma Ririsse! où est ma Clarisse?
—C’est ce que nous chercherons à deviner tout à l’heure, dit le commissaire, profitant de cette entrée en matière. Apprenez-moi d’abord comment vous vous nommez.
—Mathurin Poliveau.
—Votre profession? Votre domicile?
—Rentier... rue Richer, 41.
—Depuis quand êtes-vous marié?
—Depuis huit mois.
Le commissaire aimait à prendre le taureau par les cornes. Cette fois, du reste, l’occasion y prêtait, car, rien qu’à voir cette face de niais, il y avait cent à parier contre un que madame Poliveau, fatiguée de la vie en commun avec un tel mari, était allée, au loin, se créer une vie à part.
Aussi M. O*** lâcha-t-il cette question quelque peu brutale:
—Vous dites donc que madame Poliveau a quitté le domicile conjugal.
Une pile électrique n’aurait pas mieux secoué Mathurin que cette phrase. Il se redressa plus ferme qu’un ressort d’acier, la face empreinte de cette surprise que peut causer une chose phénoménale, et d’une voix vibrante:
—Quitté!!! s’écria-t-il, et pourquoi l’aurait-elle quitté? Elle qui ne pouvait vivre à plus d’une toise de moi sans souffrir, tant elle m’adorait! Pauvre fleur qui s’étiolait dès que je ne la réchauffais pas de mes baisers! L’eau est moins nécessaire aux poissons que l’air que Clarisse respirait près de moi!... Quitté le domicile conjugal! dites-vous?... Oh! non, il a fallu une infâme violence pour l’arracher à ces lieux où tout lui parlait de son époux...
—Est-il idiot? Est-il fou? se demanda le commissaire.
Et, pour décider la question, il reprit à haute voix:
—Votre femme est-elle petite ou grande, brune ou blonde?
—Je n’en sais rien, dit tranquillement Mathurin Poliveau.
Cette fois ce fut au tour du commissaire d’être surpris.
—Comment! s’écria-t-il, au bout de huit mois de mariage, vous ne savez pas encore comment était votre femme!
—Non... puisque je ne l’ai jamais vue, répondit Mathurin.
A cette réponse fort inattendue, le commissaire regarda Poliveau bien en face et, pour la première fois, remarquant l’expression égarée des yeux, il se donna aussitôt une solution au problème qu’il s’était posé.
—Décidément, c’est un fou, pensa-t-il.
Puis, en praticien qui a eu maintes fois affaire aux aliénés et qui sait combien ils s’irritent d’une contradiction, il reprit:
—En vérité! vous n’avez jamais vu votre femme?
—Non, au grand jamais!
—Et pourtant, si j’ai bien entendu tout à l’heure, vous me la représentiez comme une fleur qui s’étiolait loin de vos baisers...
Tout à coup Poliveau tressauta en se frappant le front avec force.
—Ah! que je suis bête! s’écria-t-il. J’oubliais de vous conter un détail.
—Lequel?
—Il n’y a pour ainsi dire que d’avant-hier matin que j’ai l’usage de la vue.
—Ah bah! fit M. O***, ne se départant pas de l’idée qu’il avait un fou devant lui.
—Oui, j’étais aveugle... Comme c’était pour moi une torture de ne pas voir le visage de ma Clarisse, j’avais consulté en cachette plusieurs de nos célébrités médicales. Sur l’espoir qui m’avait été donné, je me suis échappé, en tapinois, un beau matin de mon ménage pour aller me renfermer dans la maison de santé où j’ai subi l’opération... Pendant trois semaines j’ai vécu avec un bandeau sur les yeux... Ah! que le temps m’a été long!...
—Madame Poliveau ne venait donc pas vous voir dans cette maison de santé?
—Mais non, mais non, vous ne m’avez donc pas compris quand je vous ai dit que j’étais parti en tapinois... C’était une surprise que je voulais faire à ma Ririsse!.. Seulement je lui avais fait parvenir un billet contenant ces seuls mot: «Recueille-toi dans ton adoration pour moi et attends-toi à un immense bonheur.» Vous comprenez que ce billet était de toute nécessité pour empêcher la pauvre folle d’amour de courir se jeter à l’eau dès qu’elle ne se verrait plus abritée sous mon aile... Ne m’a-t-elle pas répété cent fois: «Allons vivre au Malabar, seul pays où il soit permis à une veuve de monter sur un bûcher.»
Tout en écoutant d’un air sérieux, M. O*** se faisait une pinte de bon sang.
Cependant il se rétractait:
—J’avais tort, il n’est pas fou, se disait-il, c’est un idiot... et de première force.
—Bref, avait continué Poliveau, après trois semaines pendant lesquelles, de jour en jour, on avait rendu de moins en moins épais le bandeau qui me couvrait les yeux depuis l’opération, le docteur me signa avant-hier ma liberté... Ce fut par des bonds à déconcerter un tigre que je franchis la distance qui me séparait de mon domicile... Une flèche n’aurait pu me suivre... Enfin j’arrive, j’entre, je gagne la chambre à coucher, ce sanctuaire de nos amours, et je m’y élance en m’écriant: «Clarisse, ne t’évanouis pas de bonheur! Je ne suis plus aveugle!...» Et qu’est-ce que je trouve?
—Oui, qu’est-ce que vous trouvez dans le sanctuaire de vos amours?
—Le lit sans draps!!!
—Ah! bah! fit le commissaire, qui s’attendait à un tout autre dénouement.
Mathurin Poliveau remua gravement la tête et reprit d’un ton sérieux:
—Je ne sais pas si je vous ai dit que je suis très-observateur?
—Non, vous ne me l’avez pas dit, mais je m’en suis vite aperçu.
—Je possède un instinct infaillible qui, sur le plus faible indice, me fait deviner les choses... Ce lit sans draps fut donc pour moi une révélation.
—Expliquez-vous.
—J’ai immédiatement compris avec quelle épouvantable violence on avait dû enlever Clarisse au milieu de la nuit ou de bon matin... La pauvrette, j’en donnerais ma main à couper, s’est si bien cramponnée à sa couche qu’il a fallu emporter avec elle les draps qu’on ne pouvait lui arracher des mains.
—Quand on pense qu’elle aurait tout aussi bien pu se cramponner à son sommier, quelle gêne pour ceux qui l’enlevaient! avança M. O***, qui s’amusait au possible.
—Hein! oui, n’est-ce pas? appuya Mathurin.
Le commissaire eut l’air de réfléchir.
—Une observation, dit-il.
—Parlez.
—N’aviez-vous pas écrit à madame Poliveau de se recueillir en l’adoration qu’elle a pour vous? Au lieu d’admettre l’enlèvement, ne pouvons-nous pas supposer qu’elle ait quitté son logis...
—Quitter un logis où tout lui parlait de moi, c’est impossible! déclara sèchement Mathurin.
—Soit! mais enfin supposons-le... Et qu’elle ait choisi quelque coin isolé pour s’y recueillir, suivant vos ordres, dans son adoration.
Poliveau secoua encore la tête à la façon d’un magot de la Chine.
—Mon instinct ne me trompe jamais, vous dis-je. Clarisse a été enlevée... et pour longtemps! La preuve en est que ceux qui ont fait le coup ont eu, en même temps, la précaution d’emporter tout son trousseau, linge, robes, chaussures...
Jusqu’alors M. O*** s’était amusé en homme qui trouve une occasion de rire; mais aux derniers mots de Mathurin, le commissaire se réveilla en lui et immédiatement flaira choses de son ressort.
—Ah! ah! dit-il, on a fait maison nette chez vous?
—Non, non, entendons-nous bien, reprit Poliveau, j’ai dit qu’on avait enlevé tout ce qui était à l’usage de ma femme... Ils ne m’ont pas laissé un ruban, une épingle, un fil... rien qui me rappelle que Clarisse est restée huit mois dans ce logis.
Et l’infortuné Mathurin, repris par le désespoir, se mit à fondre en larmes en ajoutant:
—C’est à croire que je n’ai jamais été marié de ma vie... Rien ne m’est resté qui le prouve.
—Oh! à défaut de tout cela, vous avez encore l’acte de mariage qui vous a été délivré à la mairie où votre union s’est célébrée, objecta M. O***.
Ces paroles redoublèrent le Chagrin de Poliveau qui bégaya avec peine:
—Voilà qui vous trompe... Oui, je l’avais, cet acte... Clarisse me l’a fait souvent toucher... Mais les gueusards qui ont enlevé ma colombe ont aussi fait main basse sur ce papier.
Il y eut, de la part de Mathurin, toute une tempête de sanglots et de gémissements entre la réponse ci-dessus et les mots qui suivirent:
—Et le malheur, c’est qu’il m’est impossible de m’en procurer un double... J’ai été hier à la mairie du IXe arrondissement pour le demander. Les commis m’ont ri au nez en me disant: «Ah! çà, d’où sortez-vous? Vous ne savez donc pas que les registres des mairies... et celui où vous deviez être inscrit, se trouvant plein, était du nombre... avaient été envoyés aux archives de la Ville, avenue Victoria, qui ont été dernièrement incendiées de fond en comble... Tout l’état civil des Parisiens est anéanti... Ce sont eux qui vont nous aider à le reconstituer... Au lieu de nous en réclamer un double, apportez-nous donc plutôt l’acte qui vous a été délivré à l’époque de votre mariage.» Et, là-dessus, ils m’ont renvoyé en riant de plus belle.
—C’est vrai, pensa le commissaire qui, un moment avait oublié tous les désastres du second siége de Paris.
Puis à haute voix:
—Il vous reste encore la ressource de vous adresser à l’église où a été célébrée la cérémonie religieuse.
A quoi Poliveau remua encore la tête en disant:
—Nous n’avons pas été mariés à l’église... à cause de la différence de religion... Moi, je suis catholique et Clarisse est du culte de Mahomet.
Malgré son sérieux revenu, le magistrat ne put résister à un éclat de rire qu’il parvint à déguiser à peu près en éternument.
—Ah! madame Poliveau était musulmane? reprit-il après avoir raffermi sa voix.
—Oui, elle descendait même du Prophète... Elle eût été homme qu’elle aurait eu droit au cafetan vert et à la corde en poil de chameau autour de la tête... Madame Nubadar me l’a bien souvent répété.
—Oh! oh! Et qu’était cette dame Nubadar?
—Ma belle-mère... une veuve... Elle et sa fille étaient les dernières descendantes d’une famille qui, jadis, a régné en Tunisie.
A ce moment, pour la seconde fois, la porte du cabinet s’entr’ouvrit pour laisser passer la tête du secrétaire Jacquet.
—Il est midi, monsieur. Puis-je partir? demanda-t-il d’une voix mal assurée, qui semblait craindre un contre-temps.
—Oui, allez, dit le patron.
Puis, comme le repinçant au vol:
—Ah! à propos, fit-il, et cette femme de tout à l’heure, l’avez-vous renvoyée au commissariat de la rue Taitbout?
—Elle a refusé. C’est vous, personnellement, qu’elle veut voir.
—Alors elle reviendra?
—Oui, demain, à la première heure.
—Bon!... Partez, Jacquet.
Jacquet ne se le fit pas répéter. On l’entendit s’éloigner avec cette louable précipitation de l’employé qu’un excès de zèle n’invitait pas à sacrifier au devoir sa demi-journée et surtout, sa soirée, qu’il avait consacrée d’avance à la onze cent seizième représentation du Courrier de Lyon. Jacquet, disons-le, n’aimait pas à dépenser son argent à la légère, et il attendait, on le voit, que le temps eût bien établi le succès d’une pièce avant de se payer cette nouveauté.
Le commissaire revint à Poliveau, qui, cependant, s’était mis à ramasser les papiers qu’il avait éparpillés sur le parquet à son entrée.
—On s’est joué de cet imbécile, mais dans quel but? se demanda M. O*** en le regardant se traîner à quatre pattes.
Etait-ce affaire d’argent?
Après un petit silence pendant lequel Poliveau s’était relevé, le commissaire, abondant dans le sens que le mari donnait à la disparition de sa Clarisse, demanda:
—Ainsi, monsieur Poliveau, les ravisseurs de votre femme ont enlevé tout ce qui était à son usage?
—Tout, absolument tout.
—Et de ce qui vous appartenait?
—Rien.
—On n’a rien distrait de votre caisse, par exemple?... L’avez-vous vérifiée?... Car vous m’avez dit être rentier.
—Oui, mais rentier sans caisse... Je vis d’une rente viagère de 6,000 francs, qui m’est payée par la compagnie LA PRÉCAUTION... Et, je l’avoue, je ne fais pas d’économies.
Pourquoi M. O***, qui, depuis midi, était libre de déposer ses fonctions, fut-il pris du désir de consacrer à Mathurin ces quelques heures d’un repos qui lui était acquis au bout de chaque quinzaine? C’est qu’on n’est pas impunément homme du métier et que plus le flair vous a révélé qu’une affaire est difficile à creuser, plus on se sent tourmenté de l’envie d’en avoir le dernier mot.
En conséquence, le magistrat dit à cet époux sans femme:
—Retournez chez vous, monsieur Poliveau. Dans une heure vous aurez ma visite.
En effet, après avoir déjeuné à la hâte, le fonctionnaire curieux prit le chemin de la rue Richer.
En route, le commissaire, à l’aide d’une série de pourquoi? se posa le problème qu’il avait à résoudre.
Pourquoi une femme... jeune ou non, belle ou laide, la question n’était pas là... avait-elle partagé, pendant huit mois, la vie de cet aveugle? Ce n’était, à coup sûr, pas pour son esprit, pour sa beauté, ni pour sa fortune puisque là, chez ce rentier en viager, il n’y avait pas le plus mince capital à râfler. On pouvait pourtant se dire que si cette femme sortait d’une sordide misère, les six mille livres de rente lui représentaient, en somme, une aisance dont il était doux de jouir. Il était loisible aussi de supposer que c’était par bonté d’âme qu’elle s’était faite la compagne d’un infirme. Mais alors, dans l’un ou l’autre cas, pourquoi au moment où l’aveugle venait de retrouver la vue, avait-elle disparu après avoir pris le soin de ne laisser derrière elle aucune trace de son existence de huit mois dans le logis conjugal?
M. O*** aurait pu se répondre que, peut-être, madame Poliveau était un horrible monstre, quelque phénomène de laideur qui, après avoir joui, en sécurité, de la tendresse d’un mari aveugle, n’avait plus osé affronter le regard clairvoyant de son époux opéré.
Certes, M. O*** aurait dû s’en tenir à cette hypothèse, mais, malgré lui, son instinct de limier le poussait vers des causes plus véreuses. Son scepticisme n’admettait pas le monstre, et de plus, il niait le mariage... ce mariage qui n’avait pas passé par l’église pour cause de mahométisme.
—On aura joué une comédie quelconque à mon crétin, se disait-il en riant au souvenir de Poliveau se vantant d’avoir épousé une descendante du Prophète.
Mathurin habitait une partie du troisième étage d’un bâtiment au fond de la cour. Ce fut lui qui vint ouvrir au coup de sonnette du visiteur. Son visage était inondé de larmes.
—J’étais dans le sanctuaire, lâcha-t-il d’un ton plaintif pour expliquer ce ruissellement de pleurs.
En suivant Mathurin qui le conduisait au fond de l’appartement, tout droit au fameux sanctuaire, M. O*** put remarquer un de ces solides et confortables mobiliers, sans élégance pourtant, tels qu’il s’en fabriquait encore, il y a quarante ans, pour la bourgeoisie, qui ne courait pas alors au cliquant et à la camelote.
Le vol... en admettant ce vol dont la méfiance du commissaire ne voulait pas démordre... n’avait donc rien à démêler avec le mobilier. Pendules, rideaux, tapis, tableaux ou autres accessoires d’un enlèvement facile étaient bien à leur place et ne laissaient à nu aucun coin qu’on pût croire avoir été dépouillé. Tout autre, moins entêté que le commissaire, se serait rendu à l’évidence, c’est-à-dire à l’examen, qu’il n’avait été emporté rien autre que ce qui était à l’usage particulier de la fugitive Clarisse.
La preuve en était dans tous les tiroirs, vides ou ouverts que Poliveau, en attendant le fonctionnaire, venait d’inspecter encore une fois avec l’espérance d’y retrouver un objet quelconque qui eût appartenu à sa femme.
—Vous voyez, dit-il, pas un fétu! ils ont tout pris, ces misérables qui m’ont ravi ma Clarisse.
Ayant renoncé à faire admettre par cet époux convaincu l’idée que sa femme avait fort bien pu décamper sans se faire le moindrement prier, le commissaire tendit à Mathurin la perche que sa manie préférait.
—C’est vrai! répondit-il... Rien!... Pas même un portrait qui vous aide en vos recherches... et vous montre les traits de la personne aimée.
Poliveau se prit la chevelure à poigne-mains et de sa voix glapissante:
—Non. Rien! rien! répéta-t-il. A-t-on vu sort pareil au mien! Etre marié et ne pas connaître sa femme! Elle passerait à côté de moi dans la rue qu’il me serait impossible de dire: C’est elle! c’est ma Clarisse! ma colombe!... Pas le plus petit moyen de reconnaissance!
—Oh! si... il en est un, avança M. O***.
—Lequel donc?
—Vous la reconnaîtriez bien à la voix, j’imagine sans peine?
—Ah! ça! oui! beugla Mathurin. Tenez! je l’entendrais seulement faire son puuh! puuh! comme quand elle soufflait sur sa soupe, que ce serait suffisant pour me révéler ma Clarisse.
—Vous voyez donc bien que tout n’est pas désespéré... Et puis n’avez-vous pas pensé qu’il existe encore un autre moyen?
Mathurin ouvrit une bouche et des yeux agrandis par la curiosité.
—Dame! poursuivit le fonctionnaire, ne pouvez-vous pas arriver à votre femme par ses parents et amis? Elle n’était point sans famille, n’est-ce pas!... Ne m’avez-vous pas parlé de votre belle-mère, madame veuve Nubadar?
—Hélas! fit Poliveau.
—Etes-vous donc mal avec elle?
—Hélas! refit l’ex-aveugle, la pauvre femme n’est plus de ce monde! Huit jours après mon mariage, elle a été écrasée par un omnibus... Je voulais, malgré ma cécité, suivre son enterrement, mais j’ai été obligé de rester au logis pour consoler Clarisse à demi folle de douleur.
A mesure que Mathurin avançait dans le chapitre des confidences, le commissaire s’ancrait mieux dans la persuasion que le crétin avait été la victime d’une mystification de la plus haute volée.
—Connaissons d’abord les compères, se dit-il, je chercherai plus tard le motif qui les a fait agir.
Et, là-dessus, il repartit:
—Alors cette infortunée madame Nubadar s’en est allée à sa dernière demeure sans personne qui suivît son convoi?
—Mais si, mais si... ils étaient deux. D’abord Touriquet, ce brave ami Touriquet... lui qui a fait mon mariage.
—Eh bien? qui vous dit que ce n’est pas chez M. Touriquet que votre femme est allée se recueillir en son adoration!
—Hélas! soupira derechef Poliveau.
—Est-ce qu’il a été aussi écrasé par un omnibus?
—Non, mais, à ce que m’a dit Clarisse, il a été coupé en trois par une bombe pendant le bombardement de Paris.
—Diable! fit M. O*** sans rire.
—Oui, en trois.
—Savez-vous que j’ai tellement peur de me heurter encore à une catastrophe que je n’ose poursuivre mes questions.
—Poursuivez quand même.
—Alors quelle est la seconde personne, dont vous parliez qui, avec défunt M. Touriquet, a suivi le convoi de la bonne madame Nubadar?
—C’est l’oncle Canivel.
—Oncle à vous?
—Non, oncle à ma femme.
—Et, je l’espère, il n’est pas mort, lui?
—Hélas! gémit Poliveau.
—Oh! oh! encore un omnibus ou une bombe?
—Non, non, mais il a disparu. Impossible à moi de le retrouver... Tenez, il faut que je vous conte cela.
Le commissaire, à ces mots, poussa doucement Mathurin sur un fauteuil et s’installa sur un autre en disant:
—Puisque vous voulez bien m’instruire, cher monsieur Poliveau, prenez donc les choses au début et apprenez-moi comment s’est conclu votre mariage.
—Mon père venait de mourir... commença la mari de Clarisse...
—Pardon, dit M. O***, après l’avoir interrompu d’un geste, d’abord quelques détails sur feu votre père.
—J’avais deux ans quand mon père devint veuf. A ce chagrin s’en joignit un autre, celui de me voir peu à peu perdre la vue, car je n’étais pas aveugle de naissance. Soit qu’il se fût adressé à des médecins moins habiles ou moins hardis que le médecin qui m’a opéré, il crut mon infirmité incurable et, dès lors, il n’eut plus d’autre souci que d’assurer l’avenir qui m’attendait après sa mort. Il était caissier dans une importante maison de banque qui lui avait accordé un petit intérêt dans ses affaires. Tout ce qu’il pouvait faire d’économies, mon père le plaçait à fonds perdu sur ma tête, sachant bien que je serais incapable d’administrer jamais une fortune, moi que mon infirmité mettait à la merci du premier intrigant venu. C’est à la prudence paternelle que je dois donc cette rente viagère de 6,000 francs que me paye le compagnie La Précaution.
Quand il n’avait pas sa Clarisse en tête, Mathurin Poliveau, on le voit, n’était plus d’une conversation aussi stupide ni d’une crédulité à faire rire les ânes.
Il continua:
—Une après-midi, il y a neuf mois, au milieu de septembre...
—Quelques jours à peine avant le blocus de Paris, pensa le commissaire.
Et, interrompant:
—Saviez-vous alors que Paris était à la veille d’être assiégé? demanda-t-il.
—Nullement, je vivais, ou, plutôt, mon père me faisait vivre dans une telle ignorance de ce qui pouvait m’inquiéter que je ne me doutais de rien. Je reprends: Une après-midi, il y a neuf mois, au milieu de septembre, on apporta au logis le corps de mon père, que la rupture d’un anévrisme avait tué en pleine rue.
Si M. O*** n’avait pas cru aux deux trépas tragiques de la veuve Nubadar et du sieur Touriquet, la mort de M. Poliveau père le trouva parfaitement crédule; mais il en nota la soudaineté comme le premier jalon de la piste qui ferait trouver les farceurs ou les escrocs... les faits lui apprendraient comment il fallait qualifier ces inconnus... qui s’étaient joués de l’ancien aveugle.
—Après le décès de mon père, avait repris Mathurin, je me trouvai bien triste, et surtout bien isolé, car, séparé du monde par ma cécité, j’étais réduit à la seule compagnie de Javotte, entrée à notre service depuis le mariage de mes parents... car elle était sœur de lait de ma mère... et dont mon père m’avait toujours vanté le dévouement. Grave erreur de sa part, comme vous allez bientôt le voir.
Un matin, elle ne descendit pas de sa mansarde, et l’heure du déjeuner était déjà sonnée depuis longtemps qu’elle n’avait pas encore paru. Je me démenais comme une âme en peine en l’attendant, car, ne pouvant me guider à tâtons que dans mon logis qui m’était connu, je n’osais faire l’ascension des étages supérieurs et tenter de trouver la chambre de ma bonne, que je ne savais où située dans les méandres du couloir des combles de la maison.
L’estomac à jeûn et l’esprit troublé par la crainte que Javotte fût tombée tout à coup si gravement malade qu’elle n’avait pu descendre, j’étais donc dans un grand embarras, quand, à ce moment, un grand coup de sonnette retentit à la porte d’entrée du logement.
M. O*** arrêta le conteur.
—Un renseignement? demanda-t-il. A cette époque, vous habitiez déjà ici?
—Non, je ne suis venu ici qu’après mon mariage. Nous demeurions alors rue Cassette, au deuxième étage d’une maison dont mon père, au moment où il mourut, avait l’intention de déménager, car, dans les derniers mois, l’immeuble avait été donné en principale location à un marchand de meubles. Celui-ci, pour utiliser ses marchandises, transformait peu à peu les étages en logements garnis, grave désagrément qui peuplait la maison d’un tas de gens inconnus qui se renouvelaient par trop fréquemment.
—Bon à noter! pensa le commissaire, toujours à l’affût du lièvre sur lequel il prendrait chasse.
Ensuite, tout haut:
—Revenons à ce coup de sonnette qui retentit alors que vous étiez si inquiet du retard de votre bonne.
—J’allai ouvrir et, aussitôt, j’entendis ces paroles articulées par une voix franchement amicale:
—Mon cher voisin, je viens vous offrir mes services, car j’ai pensé que vous deviez être grandement désorienté par l’abandon de votre servante.
—Comment? Javotte m’a abandonné! m’écriai-je, abasourdi par cette nouvelle inattendue.
—Je vous répète ce que m’a conté tout à l’heure le concierge auquel cette créature sans cœur a annoncé, hier soir, en filant avec sa malle, qu’elle avait assez de son métier de chien d’aveugle... Alors je me suis dit: Touriquet, mon ami, ce brave jeune homme aveugle doit être bien empêtré par cette indigne conduite. On se doit aider entre voisin de carré... Et j’ai sonné à votre porte.
—Quoi! Javotte est ainsi partie, après trente longues années de services! répétai-je avec un étonnement douloureux.
—Bah! bah! fit mon voisin Touriquet. Comme vous ne sauriez chercher vous-même une autre bonne, je me charge de vous en trouver une plus jeune et plus fidèle que votre Javotte... Mais, pour le quart d’heure, il faut s’occuper du plus pressé, c’est-à-dire de votre déjeuner. Il me reste, du mien, un peu de jambon et une tranche de pâté; permettez-moi de vous offrir ces victuailles.
Effectivement il revint, dix secondes après, en m’apportant les comestibles annoncés.
Que vous dirai-je! Un frère n’aurait pas été plus dévoué que Touriquet. Notre vie devint intime. Il fut mon ange protecteur.
A mesure que Poliveau parlait, le commissaire étudiait sa physionomie naïve et il y lisait l’expression de la plus crédule bonne foi. Sceptique en diable qu’il était, il ne croyait pas à cette fuite de Javotte, que, selon lui, on devait avoir fait disparaître pour assurer la réussite du projet inconnu dont ce Touriquet était le premier metteur en scène.
Sans se douter en quelle piètre estime son auditeur tenait le Touriquet, dans lequel, lui, voyait un ange protecteur, l’ex-aveugle avait continué l’histoire de son passé:
—Oui, cet excellent Touriquet... qu’une bombe devait bientôt couper en trois... fut pour moi presque une mère. Quand, honteux d’abuser ainsi de sa complaisance infatigable, je lui rappelais sa promesse de me chercher une autre domestique, il me répétait doucement: Patience! patience! peut-être vous trouverai-je mieux qu’une servante... Je m’occupe de vous. Patience! patience!
En effet, le matin du cinquième jour, il me demanda brusquement:
—Auriez-vous du goût pour le mariage?
—Puis-je penser au mariage avec mon infirmité! m’écriai-je.
—Toute femme est faite de dévouement. Sachez prendre la plus mauvaise et, du fond de son cœur, vous ferez sortir bonté, sympathie, tendresse, abnégation, sacrifice, etc., etc... Avez-vous lu Piron, ce grand moraliste? Non, n’est-ce pas?... C’est lui qui a dit: «Chez la femme, le besoin d’héroïsme est encore plus impérieux que celui de la faim»... Et il avait raison, ce vertueux écrivain que je m’étonne de ne pas voir plus répandu dans les lycées.
Alors, comme je secouais la tête, plein du doute de pouvoir jamais trouver l’occasion de tenter l’héroïsme d’une femme, il reprit:
—Tenez, je connais une jeune fille d’une telle sensibilité qu’elle est incessamment tourmentée du désir de se sacrifier... il faut presque lui attacher les mains, quand elle sort, pour l’empêcher de donner les vêtements qu’elle a sur le corps à la première pauvresse mal vêtue qu’elle rencontre... C’est comme je vous le dis, et, vous savez? moi, mentir pas plus gros que ça, me rendrait malade toute une semaine.
—Mais, je vous crois, mon bon Touriquet.
—Eh bien, pour en revenir à cette demoiselle, que j’aille lui dire. «Je connais un jeune aveugle, seul en ce monde, bien triste, sans un cœur qui le soutienne... et lui prépare ses repas;» aussitôt elle tremblera de tous ses membres et finira par s’évanouir sur les genoux de sa mère... C’est comme je vous le dis, et je ne mens jamais, j’ai la fierté de le répéter.
—Je vous crois, je vous jure que je vous crois, m’écriai-je en devinant à sa voix qu’il me soupçonnait de douter de sa sincérité.
—Oui, répondit-il, voilà bien la compagne de votre vie telle qu’il vous la faudrait.
—Oh! oui! fis-je du fin fond de mon cœur.
Après un petit silence, il ajouta:
—Malheureusement, il y a un obstacle.
—Lequel?
—Elle n’a pas le sou!
—Mais je ne tiens pas à l’argent, moi!... Et si, de son côté, la personne voulait se contenter de ma modeste aisance... Si vous l’interrogiez adroitement?
—Tu! tu! tu! je me garderai bien d’une pareille maladresse... Ah! ouiche! Elle pense bien à l’argent, la chère âme! Qu’est-ce qu’elle demande avant tout? Se sacrifier à une infortune... Mais, de votre aisance, elle s’en soucie comme d’une bulle de savon! Voilà comme elle est... J’aime mieux vous le dire brutalement, car je ne sais pas farder la vérité.
Il réfléchit un peu, puis:
—Je tâterai madame veuve Nubadar, reprit-il... c’est la mère de l’ange.
Cette nuit-là, je ne dormis pas.
Le lendemain, quand entra Touriquet, l’émotion me serrait si fort la gorge que j’eus bien de la peine à prononcer ces deux mots:
—Eh bien?
—Avant tout, une question? dit-il.
—Répondez-moi avec cette franchise dont je vous donne l’exemple... Ne tergiversez pas.
—Je vous jure de ne pas tergiverser. Posez sans crainte votre question.
—La voici: Prendrez-vous le turban?
—Quel turban?
—En un mot, vous ferez-vous mahométan?
—Pourquoi me faire mahométan?
Après ma promesse de ne pas tergiverser, Touriquet dut lire sur ma figure que si je ne répondais pas, c’était sincèrement faute de comprendre.
—Ah! oui, tiens, c’est vrai! s’écria-t-il, j’ai oublié de vous prévenir hier que ces dames sont musulmanes... Deux descendantes du Prophète; leur famille a régné jadis sur la Tunisie... Je vous en préviens pour que vous ne m’accusiez pas plus tard de vous avoir fait des cachotteries... Franc comme l’or, moi!
Et sans me laisser le temps de répondre:
—Ainsi, poursuivit-il, vous ne prendrez pas le turban? Non, n’est-ce pas?... Du reste, j’avais prévu la chose et, d’avance, j’ai tout arrangé à la commune satisfaction... Chacun gardera son culte... Seulement il n’y aura pas naturellement de cérémonie religieuse. C’est ce qui a été décidé pour ne donner la préférence à personne... Rien qu’une cérémonie civile... Un tour à la mairie, voilà tout.
Aux derniers mots de Touriquet, je m’étais mis à trembler de tous mes membres, et ce fut d’une voix brisée par une joie délirante que je balbutiai:
—Quoi? Cette jeune personne veut bien se dévouer au bonheur du pauvre aveugle!
Touriquet comprit alors le piége que je lui avais tendu en le laissant parler. Il lâcha un énorme juron, puis, tout plein de colère contre lui-même:
—Oh! je n’en fais jamais d’autres! gronda-t-il. Me voilà bien, moi, avec ma franchise qui ne sait jamais rien garder!!!
Ensuite, se calmant:
—Eh bien, oui, reprit-il, l’affaire est arrangée... Mais vous n’aurez pas l’air de vous douter que ces dames sont consentantes.
Le tremblement m’avait repris.
—Alors, bégayai-je, quand vous m’avez proposé, cette demoiselle a bien voulu m’accepter?
—Il est arrivé à Clarisse... elle se nomme Clarisse... ce que j’avais prévu. En apprenant qu’il s’agissait de se sacrifier à une infortune, elle s’est évanouie sur les genoux de sa mère, madame Nubadar.
A ce nom, il se hâta d’ajouter:
—Ah! à propos de madame Nubadar, j’ai un conseil à vous donner. Cette noble étrangère possède imparfaitement notre langue... Elle use d’un français baroque, appris un peu partout... Ne vous avisez pas de rire de ses locutions étranges... Après le mariage, si l’envie vous tient de converser avec votre belle-mère, vous en serez quitte pour apprendre le turc... Je me suis laissé dire que cette dame, en langue turque, est pétillante d’esprit... Mais, ce soir, quand vous l’entendrez, pour ne pas sourire, ne cessez pas de vous dire que vous êtes en présence d’une étrangère qui daigne parler le français pour vous mettre à l’aise... Ne m’en veuillez pas de cette leçon, que vous dicte mon amour de la vérité.
—Comment? dis-je, ce soir? Quand je la verrai?... Mais vous me présentez donc ce soir même à cette dame et à sa fille?
—Mieux que cela, mon cher. Je suis chargé de vous mener ce soir dîner à l’hôtel Nubadar, en petit comité, bien entendu... On a décommandé l’ambassadeur d’Angleterre qui devait y venir piquer l’assiette aujourd’hui... Ah! on mange bien à l’hôtel Nubadar, je vous en réponds.
Sur ces dernières paroles, il partit après m’avoir donné cet avis en guise d’adieu:
—Tenez-vous prêt pour sept heures, je viendrai vous chercher en voiture.
A l’heure dite il fut exact.
C’était la première fois de ma vie que j’allais prendre un repas hors de chez moi. Jamais, au grand jamais, je n’avais goûté, je vous le jure, d’autre cuisine que celle de Javotte.
Dans la voiture, Touriquet ne cessa de me vanter l’hôtel Nubadar, sa chère exquise, son service de table, son nombreux personnel et, avec cette franchise qui lui était habituelle, il me répéta plusieurs fois:
—Quel dîner nous allons faire! Je ne vous cache pas que je m’en lèche les doigts d’avance.
Enfin le fiacre s’arrêta.
—Nous voici arrivés devant la demeure de la noble étrangère, m’annonça cette perle des amis.
Au moment où nous franchissions la porte de l’hôtel Nubadar, une voix féminine fit entendre ces paroles:
—Faut-il ouvrir des huîtres à ces messieurs? Elle sont bien fraîches aujourd’hui.
—Oui, oui, ma belle, quatre douzaines, répondit Touriquet.
Puis il me souffla à l’oreille:
—C’est la camériste de madame Nubadar qui guettait notre arrivée.
Arrivés au premier étage, nous tournâmes dans un long couloir tout plein de bruit de voix, de rires, de chants, d’accords de pianos... et, surtout, d’une lourde odeur de cuisine.
—Ce sont les gens de la maison qui prennent du bon temps... Madame Nubadar est une indulgente maîtresse, m’apprit Touriquet pour m’expliquer ce tapage.
Enfin une porte s’ouvrit et mon ami me poussa en me soufflant:
—Saluez; vous êtes en présence de l’illustre veuve.
J’étais encore en train de m’incliner que la mère de mon ange s’écriait.
—Ah! clampins! vous v’là donc! J’ai l’estomac qui me colle au dos tant j’ai faim! Enfin, nous allons becqueter!... Pas vrai, Clarisse?
—Oui, maman, répondit une voix qui résonna à mes oreilles comme une harpe éolienne.
—Tenez, mettez-vous là, entre votre future et moi, me dit tout bas Touriquet en me guidant vers un fauteuil.
A quoi, il ajouta cette recommandation:
—Soyez aimable, galant et très-spirituel... mais pas de gros mots, ni rien qui sente la caserne ou la brasserie... Choisissez vos phrases dans le dix-huitième siècle; époque Louis XV de préférence... on savait alors badiner sans offusquer le beau sexe.
Il fut interrompu dans ses excellents conseils par la voix de madame Nubadar qui disait:
—Allons, hue! Touriquet, chacun devant son râtelier et pensons à jouer des mandibules.
—Hein! quel français! me murmura encore mon ami. Comme on devine bien tout de suite qu’on est en présence d’une étrangère... Je sais bien qu’au fond, on finit par comprendre ce qu’elle veut dire, mais, entre Bossuet et elle, comme langage, on est forcé de constater une différence regrettable.
Touriquet ne m’avait pas trompé en m’annonçant qu’à l’hôtel Nubadar on faisait large chère. Avec une profusion orientale, il y avait tout un régiment de plats qui laissaient le choix aux convives. La preuve en est qu’à peine fûmes-nous assis, la voix d’un homme (celle de l’officier de bouche, à ce que m’apprit Touriquet) prononça respectueusement ces mots:
—Que faut-il servir à ces dames? Bifteks, côtelettes, rognons sautés... C’est aujourd’hui le jour de l’esturgeon à la Rossini... Je ne saurais trop le recommander.
—Donne-nous de tout, mon fiston, nous patienterons pour le reste, commanda madame Nubadar.
Que vous dirai-je? J’avais le cœur qui battait à me rompre la poitrine. J’aurais voulu parler: impossible, la langue me plaquait au palais; impossible aussi de manger: ma gorge contractée n’aurait rien laissé passer.
Cette inertie de ma part fut sans doute taxée d’indifférence et fut cause que le commencement du dîner demeura froid. Pour couvrir ce silence glacial, Touriquet s’efforçait de jouer des mâchoires avec un fracas infernal. Enfin j’entendis de petits rires qui, j’en suis certain, avaient pour but d’éveiller ma gaîté, de me mettre à mon aise, de fondre ma timidité.
—Chouette fricot!!! s’écria complaisamment madame Nubadar, voulant me fournir l’occasion d’une réplique, d’un mot flatteur pour le repas qu’elle nous offrait, d’un éloge de son cuisinier.
Mais non. J’étais d’autant mieux paralysé par l’émotion que plusieurs fois, j’avais senti la douce main de Clarisse effleurer la mienne.
—Mais parlez donc, animez le dialogue, dites n’importe quoi... mais, vous savez, rien qui sente la caserne, me soufflait Touriquet.
Et comme je restais de marbre:
—Au moins, récitez-leur une fable, ajoutait-il.
Rien! la crainte m’étranglait.
En véritable ami dévoué, mon voisin cherchait à me galvaniser.
—La petite vous dévore des yeux, me murmurait-il. Elle est littéralement pendue à vos lèvres... Vous lui débiteriez seulement l’alphabet, qu’elle boirait le son de votre voix.
Mais ces encourageantes paroles ne faisaient que redoubler mon émoi, sans me délier la langue.
La bonne madame Nubadar eut pitié de mon embarras et, dans son mauvais français, elle lui trouva une excuse.
—A la bonne heure! s’écria-t-elle, voilà comme je comprends, moi, qu’on chique les vivres... sans parler!... On apprécie mieux la boustifaille.
Cette bonté, à la fois fine et délicate, de la femme d’Orient qui venait à mon aide, opéra mieux sur moi que tous les conseils de Touriquet. La douce émotion de la reconnaissance fondit ma glace, dégourdit ma langue, me desserra la gorge.
Je sentis que j’allais parler.
A ce moment l’officier de bouche entra en disant d’une voix triste:
—Il m’arrive un petit malheur: j’avais offert à ces dames un poulet au cresson... mais il ne nous reste plus de poulet.
—Alors mettez-nous un peu plus de cresson, dis-je d’un ton dégagé.
Je croyais rendre sa politesse à madame Nubadar en lui venant ainsi à l’aide; en mettant de l’huile sur le froissement d’amour-propre d’une maîtresse de maison qui voit tout à coup le poulet manquer à ses convives.
Mais, alors que je triomphais d’avoir si bien débuté, j’entendis gronder à mes oreilles la voix sévère de Touriquet qui disait:
—Plaisanterie déplacée... Je vous avais pourtant bien prévenu: Rien qui sente la caserne!... Mieux valait réciter une fable.
La terreur d’avoir commis une bévue, bien involontaire, je vous le jure, car j’en suis encore à la comprendre, me refigea immédiatement la langue.
Cependant, sous la table, mon genou avait rencontré un autre genou. Cinq ou six fois je risquai une légère pression. Encouragé, j’allais continuer, quand, à voix basse, Touriquet me dit vivement:
—Non, merci, j’en ai assez, ça me donne le mal de mer... Adressez-vous à droite.
Du moment que mon sage mentor m’encourageait, je crus devoir persévérer dans cette façon de faire parler mon cœur et j’avançai la jambe dans la direction voulue.
Aussitôt retentit le fracas d’un violent éternument dans un verre, auquel succéda une petite pluie de vin, puis, après une vive quinte de toux, la noble étrangère articula péniblement ces mots:
—Quelle andouille que ce Touriquet qui va me pousser le genou quand je suis en train de boire! J’ai failli étrangler.
Mon excellent ami devina que je m’étais trompé d’adresse et, malgré sa profonde horreur du mensonge, il endossa la faute.
—C’est le champagne qui me travaille un peu les nerfs.
Car nous en étions au champagne. Les plats s’étaient succédé avec une rapidité qui prouvait l’activité du personnel de l’hôtel Nubadar.
Enfin l’illustre étrangère prononça d’un ton légèrement empâté:
—Ouf! j’en ai ma claque!... Et toi, Clarisse?
A cette question, grandement prosaïque, mademoiselle Clarisse répondit de son organe mélodieux avec une intonation de prière:
—Oh! maman, je t’en prie, ne me trouble pas, laisse-moi à mon bonheur.
Que voulait-elle dire? Je ne l’aurais pas compris sans Touriquet, qui me prit le bras en me soufflant vivement:
—Vous venez de sentir au front comme une brûlure, n’est-ce pas?
—Non, pourquoi?
—Si, si, le front doit vous avoir brûlé... Ah! si vous aviez vu quel regard de feu Clarisse vous a lancé!
Et me serrant encore le bras pour arrêter mon transport de joie:
—Chut! chut! fit-il, n’abusez pas d’une confidence échappée à ma franchise... Triomphez, mais à la façon, de l’Indien, avec un visage de bois.
L’officier de bouche était encore venu nous faire ses dernières offres. Sur notre refus de rien prendre de plus, il se retira; mais, deux minutes après, il reparut et je l’entendis qui, sans mot dire, posait une assiette sur la table. Après quoi, il s’en alla.
Ma fine oreille d’aveugle perçut alors le bruit du froissement d’un papier que madame Nubadar venait de prendre sur l’assiette.
Il y eut un petit silence, puis la digne mère de mon ange lança ces mots:
—Mazette! c’est salé!!! Tiens, regarde donc un peu, Clarisse.
Et elle passa ledit papier à sa divine progéniture qui, bientôt, répondit:
—Oui, c’est raide.
A quoi Touriquet, auquel l’ange avait donné le papier, ajouta à son tour:
—En effet, c’est poivré!...
Je poussai du coude mon ami, ce qui était ma manière de l’interroger sur la signification de cette scène incompréhensible pour moi.
Avec son inépuisable complaisance, le bon Touriquet me souffla aussitôt:
—Rien qui menace vos amours.... Je vous ai dit que pour nous recevoir, on avait décommandé l’ambassadeur d’Angleterre, qui comptait piquer ici l’assiette ce soir... De colère d’avoir été évincé, il vient d’écrire à madame Nubadar un billet de la dernière raideur.
Puis, tout haut et gracieusement:
—Croyez, mesdames, que mon ami Poliveau n’ignore pas la coutume orientale qui veut qu’après un repas pris en commun, les deux sexes se séparent, les dames pour aller jouir de la sieste dans le gynécée, les hommes pour rester à fumer l’opium.
Sur mon honneur! j’ignorais cette coutume d’Orient, mais je n’en fis pas moins un geste de tête pour sanctionner ce que venait de dire Touriquet.
—Ma foi, oui, j’avoue que je ne suis pas fâchée de détaler... Viens, Clarisse, déclara la maman.
J’entendis un bruissement de vêtements et de chapeaux que les dames remettaient.
—Saluez... elle se retirent, m’annonça le dévoué Touriquet.
La porte était à peine refermée que mon Mentor me demandait brusquement:
—Vous venez de vous sentir une impression de fraîcheur sur le front, n’est-ce pas?
—Non, pourquoi?
—Ah çà! ni le chaud, ni le froid, vous ne sentez donc rien!... Comment! vous n’avez pas senti sur votre front le baiser que Clarisse, de ses fraîches lèvres, vient de vous envoyer de loin, avant de suivre sa mère.
Puis, sans me donner le temps de parler, il me frappa sur l’épaule, en s’écriant d’un ton joyeux:
—Eh! eh! l’affaire est dans le sac! La petite en tient sous l’aile et, si j’en crois un signe qu’elle m’a adressé entre le rôti et la salade, madame Nubadar vous agrée. Ah! mon gaillard, il ne faut pas vous confier des femmes!... En un rien de temps, vous les attelez à votre char.
—Vrai? vrai? répétai-je à chaque phrase en étouffant de satisfaction.
—Comme je vous le dis... Ah! j’ai bien eu peur un instant, j’ai cru votre barque chavirée avec cette malencontreuse affaire du cresson... Je vous avais pourtant averti: Rien qui sente la caserne!
—Si vous vouliez m’expliquer en quoi j’ai manqué de...
—Non, non, pas d’explications... je n’aime pas à humilier mes amis... Passons l’éponge... c’est oublié.
Après un court silence, il reprit:
—Maintenant, permettez-moi un conseil.
—Parlez, je vous en supplie.
—Il faut tout de suite bien vous poser dans la maison par un large pourboire aux domestiques... C’était un des grands moyens du duc de Richelieu, l’irrésistible séducteur... Avez-vous une centaine de francs sur vous?
—Oui, je les possède.
—Sans quoi, je vous les aurais avancés... Bien, donnez, dit-il en prenant mes louis.
Au coup de sonnette de Touriquet, entra aussitôt quelqu’un que je reconnus, à son pas, pour être l’officier de bouche de madame Nubadar.
—Tenez! fit simplement mon ami en jetant l’or dans une assiette.
Ensuite, il mit mon bras sur le sien.
—A présent, trop heureux mortel, je vais vous reconduire chez vous, ajouta-t-il.
M. O*** avait écouté sans mot dire, riant sous cape de l’épaisse niaiserie du narrateur.
Jusque-là, le récit de Poliveau n’avait encore mis en scène qu’un trio de matois se régalant aux frais d’un imbécile qui s’imaginait avoir dîné dans le monde.
—Monsieur Poliveau, avez-vous quelquefois mangé dans un restaurant? demanda le commissaire pour s’assurer si l’ex-aveugle était resté la dupe de cette comédie.
—Dans un restaurant? Jamais! au grand jamais!... Ne vous ai-je pas dit qu’à l’exception de ce jour où ma regrettée belle-mère me fit l’honneur de m’admettre à sa table, je n’ai jamais mangé d’autre cuisine que celle du logis? répondit Mathurin étonné de cette question qui lui semblait ne rimer avec rien.
Jusque-là, nous le répétons, la chose n’avait encore que l’allure d’une mystification et rien ne faisait pressentir au magistrat le but mystérieux qui, pendant huit mois, avait fait vivre cette Clarisse, une rusée coquine, aux côtés d’un pareil nigaud.
Pour comprendre que le Touriquet et la Nubadar n’étaient que de simples comparses, le commissaire n’avait qu’à se souvenir, suivant le récit de Mathurin, que grâce à une bombe et à un omnibus, ils allaient bientôt sortir de scène pour laisser la place au personnage principal, le Deus ex machina, celui qui tenait les principaux fils du pantin et au profit duquel la farce, indubitablement, avait été jouée.
Craignant, s’il posait des questions, de voir Poliveau s’étendre en divagations prolixes, le commissaire le remit sur la voie en disant:
—Bref, vous fûtes mariés?
—Oui, monsieur, huit jours après je couronnais légitimement les feux de Clarisse devant M. le maire.
—A la mairie du IXe arrondissement, m’avez-vous dit? demanda M. O*** en insistant.
—Oui, monsieur, au premier étage.
—Bah! et pourquoi pas au rez-de-chaussée où se trouve la salle des mariages? dit le commissaire qui flairait une nouvelle comédie.
—Parce que, m’a appris Touriquet, les peintres, justement ce jour-là, collaient du papier neuf dans la salle des mariages.
—Mais, pour un mariage, la loi exige des témoins? avança M. O***.
—Nous les avions. De mon côté Touriquet et l’oncle Canivel.
—Ah! oui, cet oncle de votre femme que vous n’avez pas pu retrouver, continua le commissaire devinant que l’oncle Canivel devait être le Deus ex machina qu’il attendait.
—Précisément.
—Et, du côté de mademoiselle Nubadar?
—De son côté, les deux témoins étaient de grands dignitaires turcs dont les noms m’échappent, mais qui étaient couchés tout au long sur mon acte de mariage disparu. C’est Touriquet qui me les a présentés au sortir de la mairie.
—Et vous leur avez serré la main pour les remercier, dit M. O*** peu convaincu de l’existence de ces deux personnages, car il trouvait la pantalonnade trop compliquée en compères.
—Non, il n’y a pas eu de poignées de mains parce que Touriquet m’a dit que c’était contraire à l’étiquette orientale, mais je ne les en ai pas moins remerciés chaleureusement des vœux qu’ils ont bien voulu faire pour mon bonheur. «Que Mahomet étende sa chaussure sur toi», m’a dit l’un... «Allah est grand! a prononcé l’autre, qu’il te fortifie le cœur avec la moelle des lions noirs»... Hein! comme c’est oriental.
—Tout ce qu’il y a de plus oriental! répondit M. O*** sans rire le moindrement.
Puis, désireux de suivre la farce jusqu’au bout, il s’empressa d’ajouter:
—Donnez-moi donc quelques détails sur la séance à la mairie.
—Que puis-je vous conter de particulier! Rien, ma foi! Le maire, qui parlait du nez avec un accent alsacien, nous a lu les articles du Code, puis il a adressé quelques conseils à Clarisse. «Soyez bonne femme de ménage, a-t-il dit; ayez de l’ordre, toujours de l’ordre; l’ordre de la femme est une richesse qu’elle apporte au mari. Que vos armoires, vos meubles, vos placards soient toujours bien en ordre. Ne laissez pas un coin sans l’épousseter. Rangez, rangez toujours... Visitez sans cesse et partout... Avec une femme qui ne visite rien, la poussière et l’humidité ruinent plus vite un mari que les spéculations de Bourse.» Voilà, en substance, ce que le maire a daigné dire à Clarisse.
—Très-bien! très-bien! fit le commissaire, auquel son instinct de policier venait de révéler que, sous cette allocution stupide, la tête de l’anguille commençait à montrer son museau.
Cependant Poliveau avait continué:
—En sortant de la mairie, après avoir été quittés par l’oncle Canivel et les deux dignitaires Turcs, nous allâmes, ma belle-mère, ma femme, Touriquet et moi, faire un déjeuner-dînatoire à l’hôtel Nubadar, où, cette fois encore, je donnai cent autres francs pour que les serviteurs de ma belle-mère pussent boire à mon heureuse union.
M. O*** avait pointé sur l’oncle Canivel, qui lui paraissait suspect en diable, il avait hâte de le voir à l’œuvre.
Aussi, ne laissant pas, à propos de ce mariage à la mairie dont il ne croyait pas un traître mot, son conteur battre longtemps les buissons, il coupa vite au court en disant en forme de résumé:
—Bon! vous voilà marié; votre déménagement de la rue Cassette à la rue Richer est fait; un omnibus a écrasé votre belle-mère; Touriquet a reçu sa bombe; voilà qui est convenu... Maintenant, continuez votre récit à deux mois du mariage, en pleine félicité conjugale... Parlez-moi de l’oncle Canivel avec lequel vous ne m’avez pas fait faire encore connaissance.
—Oui, oui... ce bon vieillard si étrangement disparu...
—Ah! c’était donc un vieillard?
—Quatre-vingt-huit ans, très-bien conservé, majestueux sous la neige de sa chevelure, du moins à ce que m’a appris ma femme qui me répétait: «Tu ne saurais t’imaginer quel saint respect j’éprouve à poser mes lèvres sur son vénérable front.» Oh! oui, il devait être bien conservé, car sa voix, la seule chose dont je pouvais me rendre compte, était fraîche et jeune. Ririsse m’affirmait que cela tenait à ce qu’il avait conservé toutes ses dents... Le fait est qu’il devait les avoir solides, car, à son âge, il vous broyait des os de poulet et de côtelettes tout aussi facilement que s’il eût mâché du beurre.
—Il dînait donc chez vous?
—Trois fois par semaine et, tous les dimanches, il nous recevait à son tour.
Avec un niais de la force de Mathurin, il n’était besoin d’étudier préalablement certaines questions. Sa stupide prétention d’avoir été un dieu pour sa femme le cuirassait contre tout soupçon qui aurait effleuré la vertu de son épouse. Le commissaire ne se gêna donc pas pour demander à brûle-pourpoint:
—Il aimait tendrement votre femme, ce bon vieillard?
—Eh! eh! fit Mathurin d’un air fin, s’il faut vous l’avouer, je crois qu’il me donnait la préférence. Il m’avait voué toute son affection et me la prouvait en prenant mes intérêts... Je ne prétends pas dire qu’il n’aimât pas sa nièce, mais, avec elle, il se montrait sévère. Et quand je plaidais pour Clarisse, il me répondait qu’à toute jeune femme il ne faut pas laisser le temps de prendre un mauvais pli... qu’on doit les dresser tout de suite au ménage, à l’économie, à la propreté, etc. Aussi tous les jours, il ne cessait de lui répéter:
—Souviens-toi de ce que t’a dit le maire, le jour de ton mariage, le jour où tu as eu le bonheur de t’appeler Poliveau: «L’ordre de la femme est une richesse qu’elle apporte au mari... Avec une femme qui ne visite rien, la poussière et l’humidité ruinent plus vite un mari que les spéculations de Bourse.»
Il lui ordonnait d’épousseter, d’essuyer, de frotter tel ou tel meuble et de ranger son contenu.
—Tiens! s’écriait-il, je suis certain que tu n’as pas rangé l’intérieur de ce secrétaire.
—Mais si, répondait Clarisse, voici trois fois déjà que je l’ai visité.
—Tu, tu, tu... visité comme tu visites... à la six quatre deux... sans penser à faire prendre l’air aux tiroirs... Je parie cinq sous que l’humidité s’y est mise... que le meuble sent le moisi.
Et il se levait en ajoutant:
—Il faut que je m’en assure.
Alors il se mettait à passer l’inspection du meuble en marronnant entre ses dents:
—Je gage que ce tiroir n’a pas été épousseté... que celui-ci n’a pas été rangé... que cet autre est plein de poussière... Le maire te l’a pourtant dit: «Rangez toujours, visitez sans cesse et partout.» Oui, le maire te l’a dit... N’est-ce pas, Poliveau?
J’étais bien forcé de l’avouer.
La pauvre Clarisse avait beau protester de son ordre, de sa propreté, il ne voulait pas démordre de son inspection qu’il poussait jusqu’à la minutie.
—Avec les secrétaires, prétendait-il, on ne saurait prendre trop de précautions... La mort des secrétaires, bien souvent, provient des compartiments à secret qu’on ignore. La moisissure s’y met et on ne s’en doute pas... Est-ce que votre secrétaire possède des compartiments à secret, mon cher Mathurin?
Je répondais n’en rien savoir... Mon père ou Javotte auraient pu le dire, mais moi, aveugle, je l’ignorais.
Et son horreur de la poussière était telle qu’il mettait le meuble la tête en bas et le secouait, le secouait pour dégager, affirmait-il, la poussière des rainures.
Ce faisant, il répétait à Ririsse:
—Le maire n’a pas eu le temps de te l’apprendre, mais voilà comment on s’y prend pour nettoyer un secrétaire bien à fond.
Et ce qu’il disait était chez lui une conviction, car, derrière ma femme qui passait ses journées entières à visiter et à épousseter chaque pièce de mobilier, je puis dire que tous mes meubles, l’un après l’autre, ont passé une dizaine de fois par les mains de l’oncle Canivel.
Sur ces derniers mots, Mathurin Poliveau secoua tristement la tête, en débitant d’une voix plaintive:
—Qu’est-il devenu, ce brave oncle?... Disparu!... Qui sait si les misérables qui m’ont enlevé ma femme, n’ont pas assassiné le digne vieillard pour l’empêcher de m’aider à retrouver Clarisse.
Alors, fondant en larmes, il reprit son antienne:
—Retrouver Clarisse... moi, tout seul... Est-ce que cela m’est possible, puisque je ne l’ai jamais vue!
La lumière se faisait peu à peu pour le commissaire depuis qu’il était, pour ainsi dire, en présence des deux premiers rôles de cette farce dont l’aveugle avait été le Jocrisse.
Il comprenait que s’ils avaient jugé bon de faire de Clarisse une descendante du prophète Mahomet, c’est que cela coupait facilement court à toute cérémonie religieuse dont la parodie eût été autrement difficile que celle de l’état civil, faite sous clef, à un premier étage, à l’aide de quatre ou cinq compères de second ordre qu’on avait ensuite évincés.
Mais ce que M. O*** avait écouté de son oreille la plus attentive, c’était le récit de la fouille, vingt fois répétée sans résultat, que les deux complices avaient exécutée dans tous les meubles du logis.
—Que voulaient-ils dénicher? si c’eut été de l’argenterie, des bijoux, ils auraient mis tout de suite la main dessus, se disait-il. Ce qu’ils cherchaient devait être quelque chose d’un mince volume, un tout petit paquet, voire un simple papier, un objet enfin pouvant tenir dans le compartiment secret d’un meuble... Oui, mais quel était cet objet? Voilà le hic.
De morne qu’il était, le désespoir de Poliveau tourna brusquement à la rage. Notre héros s’empoigna la chevelure à deux mains, grinça des dents et piétina sur place en s’écriant à pleine voix:
—Ah! maudite soit ma fatale idée d’avoir été me faire opérer! Si j’avais toujours le bonheur d’être aveugle, ma douce colombe serait près de moi à palpiter sous mon aile et je n’aurais pas perdu le cher oncle Canivel, qui soignait si bien mes meubles.
Plus encore que Mathurin, le commissaire tenait à savoir ce qu’était devenu l’oncle Canivel. Il prit le ton de reproche amical pour dire au mari de la douce colombe:
—Mais, à Paris, une personne ne disparaît pas aussi facilement. Peut-être avez-vous mal cherché?
—Mal cherché! répéta Poliveau indigné, j’ai à me reprocher, je le confesse, d’être méfiant, peu crédule, toujours sur mes gardes; cela tient à ma nature de profond observateur... mais, moi, être ingrat, jamais!... Oh! que oui! je l’ai cherché, ce bon vieillard qui m’inondait de sa tendresse... Je ne vous ai donc pas conté comment j’ai constaté la disparition de ce digne parent?
—Non, et je serais heureux de l’apprendre.
—A ma sortie de la maison de santé, avant-hier, je vous ai dit que j’étais accouru chez moi plus rapide que la foudre. En ne trouvant plus Clarisse au logis, ma première pensée fut qu’elle devait être chez le cher oncle.
—Dont vous saviez l’adresse?
—Sans doute; puisque nous allions dîner chez lui tous les dimanches.
—C’est qu’alors vous étiez aveugle et que votre femme pouvait très-bien vous conduire chez l’oncle sans penser à vous donner une adresse dont votre infirmité n’avait que faire.
—Oh! que vous connaissez mal ma divine Clarisse!... Elle n’avait rien de caché pour moi, la chère âme... Son bonheur était de me renseigner sur tout, en me disant toujours: «Si je venais à mourir...» car il faut vous apprendre qu’elle avait la faiblesse des pressentiments, ce qui la faisait me répéter sans cesse: «Je suis trop heureuse près de toi, la mort doit être jalouse de ma félicité.»
Bref, pour en revenir à mon sujet, elle me disait: «Si je venais à mourir, tu serais trop embarrassé à chaque pas... je dois donc te munir d’avance de tous les renseignements possibles. Nous sommes rue Dauphine, 18, ne l’oublie pas.»
Et même, quand nous entrions dans l’allée, elle ne manquait jamais de me donner cet avertissement: «Prends-garde aux deux marches!» Car il y avait deux marches à monter avant d’arriver au pied de l’escalier.
Donc, avec l’espoir de retrouver Ririsse chez notre oncle bien-aimé, je monte en fiacre et je me fais conduire rue Dauphine, 18... J’arrive et la première chose que je cherche à reconnaître, c’est la double marche... Elle n’y était plus!... Mais je me dis: «On aura abaissé le sol de l’allée depuis ma visite à l’oncle. Tant mieux, ces deux marches étaient un vrai casse-cou...» Parvenu devant la loge, je demande au portier si le vénérable M. Canivel est chez lui.
Il me regarde et me répond:
—Canivel? Connais pas... Nous n’avons jamais eu de locataire de ce nom-là.
—C’est pourtant bien ici le nº 18.
—Tout ce qu’il y a de plus 18.
Alors l’idée me vient que je me suis probablement trompé de maison et je reprends:
—Est-ce qu’il n’y a pas eu dernièrement un changement dans les numéros des maisons de la rue?
—Pas depuis Louis XVIII, me réplique le concierge.
Enfin, apprenez que, une par une, j’ai été demander l’oncle dans toutes les maisons de la rue sans pouvoir parvenir à retrouver ce noble vieillard... Comprenez vous cela? hein!
—Vraiment, vous m’étonnez! lâcha M. O*** à tout hasard, car, en ce moment, il était tout à la pensée de ce que pouvaient être devenus la Clarisse et l’oncle qui avaient si prestement déménagé au moment où la dupe qu’ils exploitaient allait recouvrer la vue... Avaient-ils eu le temps de faire leur coup? ou bien la guérison de l’aveugle les avait-elle surpris avant la réussite?
Il fut tiré de ses réflexions par un nouveau hurlement de Poliveau, qui, s’en prenant encore à sa chevelure, se dépouillait le crâne en beuglant:
—Plus de Clarisse! Plus d’oncle!... Pourquoi ai-je eu la bêtise de me faire opérer!... A quoi me sert la vue? je vous le demande.
—Mais à voir clair, dit le commissaire.
L’ex-aveugle eut un sourire amer.
—A voir clair! répéta-t-il, quelle erreur! quelle erreur complète?
—Ah bah! fit M. O***.
—Oui, erreur, vous dis-je, c’est précisément depuis que j’ai retrouvé la vue que je n’y vois plus.
—Expliquez-moi donc cette particularité, mon cher monsieur Poliveau.
—Sans doute. Autrefois, quand j’étais aveugle, j’allais à tâtons, j’assurais mon pied à chaque pas; l’instinct me guidait; mille remarques m’aidaient à me conduire; bref, j’avais cette sagacité de l’aveugle qui flaire l’obstacle, devine la direction à suivre et le coin à tourner. Tout m’était renseignement; un bruit habituel à droite, une odeur à gauche (un serrurier et un rôtisseur, je suppose), un pavé plus ou moins raboteux, tel trottoir en pente, tel endroit où l’air plus vif m’indiquait un carrefour. Chaque détail se casait dans mon cerveau et me traçait ma route dont je ne déviais plus... Voilà comme j’étais quand je ne voyais pas!... Et je vous prie de croire que je n’ai jamais manqué d’arriver au but fixé... Tenez, par exemple: il a suffi qu’on m’ait guidé deux fois pour me conduire au siége de la Compagnie la Précaution et, toujours, depuis, j’ai été tout seul toucher mon mois de rente viagère.
Après avoir repris haleine, Poliveau continua d’un ton vraiment navré:
—A présent que j’ai retrouvé la vue, c’est tout autre chose. Soit que le jour m’éblouisse, soit manque d’habitude, je dégringole dans les escaliers, je me jette sur les passants, je ne manque pas un trou, je suis perdu à dix pas de chez moi, j’ai failli me faire écraser vingt fois depuis deux jours, je me heurte à chaque angle... La preuve de cela, ne vous l’ai-je pas donnée ce matin en entrant dans votre bureau? j’ai renversé des meubles, éparpillé des papiers, bousculé une dame...
Et, s’interrompant, Mathurin leva les deux mains au ciel, poussa un énorme soupir et lança cette exclamation:
—Oh! oui, j’y voyais cent fois plus clair quand j’avais les yeux au bout d’un bâton.
Puis, comme s’il croyait n’avoir pas assez prouvé, il ajouta:
—Mais ce guignon ne me suit pas que pour la marche, il préside à tous mes actes. Me fiant à mes yeux, je ne surveille plus mes mouvements. Si je veux prendre un verre, mon coude renverse la carafe... Je m’assieds à côté d’un siége, tous les malheurs, quoi! Quand j’étais aveugle, je procédais doucement: j’avançais la main avec prudence, mes doigts palpaient intelligemment, ils reconnaissaient au toucher entre deux objets pareils de forme, ils se décidaient sur le poids... Ah! ouiche! à présent, le sens du toucher est émoussé, la différence de poids m’échappe... Que dis-je, elle m’échappe... bien mieux encore! elle me trompe. Pas plus tard que ce matin je m’en suis aperçu à déjeuner.
—Est-ce que vos côtelettes vous ont paru être plus légères qu’autrefois? demanda le commissaire en riant.
—Non, pas mes côtelettes... mais mon argenterie, les couverts qui me viennent de mon père... autrefois ils semblaient plus lourds à ma main d’aveugle... La vue que j’ai retrouvée, je vous le répète, m’a fait perdre cette finesse de tact que je possédais.
Et Poliveau, lançant encore ses mains vers le ciel, recommença sa phrase:
—Oh! oui, j’y voyais cent fois plus clair quand j’avais les yeux au bout d’un bâton.
Son geste d’élever les mains en l’air avait apporté le bouton de manchette de Poliveau sous les yeux du commissaire, qui, une seconde fois, vit gravées en relief, ces deux initiales M. P. qu’il avait déjà remarquées le matin dans son cabinet.
A cette vue, une idée traversa rapidement le cerveau de M. O***.
Il venait d’être parlé d’un coquin disparu et de sa complice, de la compagnie la Précaution, de couverts d’argent; joignez à cela ces initiales, et vous comprendrez pourquoi le commissaire se trouva brusquement porté à se souvenir de Maurice Prévannes, ex-employé de la Précaution, qui avait vendu des couverts d’argent marqués M. P.—Et, en même temps, il pensa à mademoiselle Lurette Baba, une gaillarde fort capable d’avoir joué le rôle de Clarisse.
—Si c’était eux! pensa le fonctionnaire.
Mais, en homme prudent qu’il était, il se garda bien de s’aventurer sur un simple soupçon.
—Montrez-moi donc vos couverts? demanda-t-il à Mathurin.
Poliveau en alla chercher un dans le buffet de la salle à manger.
—Ils sont en argent, n’est-ce pas? reprit le commissaire, qui, du premier coup d’œil, venait de s’assurer qu’ils étaient en ruolz.
—Je le crois... du reste, tels qu’ils sont, ils me viennent de mon père, répondit Mathurin en allant remettre en place le couvert qui lui avait été rendu.
—On lui a volé les vrais qu’on a remplacés par ceux-là, pensa M. O*** pendant la courte absence de notre héros.
Et quand ce dernier fut revenu:
—Dites-moi, reprit le magistrat, ne m’avez-vous pas prétendu que vous sauriez reconnaître votre femme à la voix?
—Rien qu’à l’entendre faire: Puh, puh, pour refroidir sa soupe.
A cette réponse, le soupçon de M. O*** se corsa de cet autre souvenir que, le matin, Prévannes et Baba n’avait plus ouvert la bouche dès que Poliveau avait fait irruption dans le cabinet.
Après un petit silence donné à la réflexion, M. O*** regarda notre héros en semblant se demander s’il fallait tenter l’aventure dont l’idée venait de lui surgir en tête.
La face niaise du bonhomme et le récit de son mariage accusaient chez Mathurin une si monstrueuse crédulité que le commissaire crut pouvoir se risquer à mettre son projet à exécution.
—Monsieur Poliveau, dit-il, voulez-vous me permettre d’être franc avec vous?
—Mais je ne déteste pas la franchise... Mon pauvre Touriquet, s’il était encore de ce monde, vous l’attesterait.
—Eh bien! à mon avis, vous avez mal cherché votre oncle.
—Mal cherché! fit Mathurin en tressautant de la surprise qu’on mît en doute son zèle à découvrir le bon vieillard.
—Non, non, je m’exprime mal... Je voulais dire que vous vous y êtes peut-être mal pris pour retrouver M. Canivel.
—Comment! mal pris! je suis entré dans toutes les maisons de la rue... Que pouvais-je faire vraiment de mieux?
Le commissaire prit une mine hésitante:
—De la rue Dauphine, n’est-ce pas? reprit-il en pesant sur les mots.
—Sans doute, de la rue Dauphine.
La figure de M. O*** devint encore perplexe; il secoua la tête, puis il finit par dire:
—Ne vous seriez-vous pas trompé par hasard... Votre oncle ne demeurait-il pas rue Constantine... ou des Feuillantines... ou des Capucines... ou tout autre terminaison en ine?
—Que diable peut vous faire supposer cela! s’écria Poliveau, en ouvrant des yeux grands comme des portes cochères.
Tout semblait dire à M. O*** que Prévannes et Lurette Baba étaient le couple qui s’était joué de l’aveugle, mais, en homme qui n’agit que sur preuves, il voulait que ce fût Mathurin qui les lui livrât.
En conséquence il débita le petit thème qu’il venait de préparer:
—Voyez-vous, mon cher monsieur, il arrive bien souvent qu’on s’entête sur un nom, un mot, une désinence, en s’imaginant qu’ils vous sont fournis par la mémoire. Dans votre cas, il se peut fort bien que votre mémoire vous donne la désinence en ine et que votre esprit se bute sur le mot Dauphine... ce qui fait que, de la meilleure foi du monde, vous avez été chercher rue Dauphine votre excellent oncle qui, peut-être, habite rue Constantine.
Poliveau se laissa prendre à cette conclusion.
—Oui, s’écria-t-il, vous devez avoir raison. Savez-vous ce que je vais faire?
—Quelque chose de très-ingénieux, je n’en doute pas.
—Je vais acheter un Indicateur des rues de Paris et, toutes les rues dont les noms se termineront en ine, je les visiterai maison par maison.
—Heu! heu! fit M. O***, cela peut vous mener bien loin et durer fort longtemps.
—Je ne vois pas d’autre moyen.
—Parce que votre intelligence ou plutôt votre mémoire ne veut pas s’en donner la peine... Voyons, rappelez-vous ce que disiez tout à l’heure.
—Que disais-je?
—Que vingt fois vous étiez allé chez l’oncle Canivel, soit avec madame Poliveau, soit seul quand vous avez connu le chemin.
—Souvenez-vous, à présent, de ce que vous vous êtes écrié dans un moment de colère.
—Aidez-moi un peu.
—Voici, je crois, vos paroles: «A quoi me sert la vue! Je n’ai jamais vu plus clair que du temps où j’avais les yeux au bout d’un bâton.»
—Je le répète encore.
—Eh bien?
—Eh bien! quoi?
—Qu’est-ce qui vous empêche, pour une fois encore, de supposer vos yeux au bout d’un bâton? Ainsi, ce soir, quand les rues seront désertes, pourquoi ne vous mettriez-vous pas en route, les yeux fermés et le bâton en main?... En redevenant aveugle, vous retrouverez cette ancienne sagacité dont vous m’avez parlé... Tous vos points de repère vous reviendront à la mémoire... vos...
Poliveau ne le laissa pas achever.
Il se mit à bondir par la chambre en hurlant:
—Vous avez raison... Je n’y pensais pas!... Ah! le bon conseil!... Vous êtes pour moi un sauveur... un second Touriquet.
—Ainsi c’est convenu, n’est-ce pas?
—Je voudrais être déjà à ce soir.
—Et vous me permettrez de vous accompagner?
—De tout cœur... Vous verrez que je vous conduirai tout droit chez l’oncle Canivel.
Et Mathurin battit l’air de ses deux bras étendus en criant:
—Brave oncle! il me tarde de l’embrasser...
—Par lui, nous apprendrons ce qu’est devenue madame Poliveau, ajouta le commissaire, jugeant bon de donner un coup d’éperon à la bonne volonté de Mathurin.
Tout à coup Poliveau devint pâle.
—J’ai une peur! dit-il en frémissant.
—Laquelle?
—Que ma colombe m’en veuille de ne plus être aveugle.
—N’en croyez rien.
—Dame! écoutez donc: pourquoi Clarisse m’a-t-elle épousé? Par amour du sacrifice... pour consacrer son existence entière à un aveugle. Du moment que je vois, le but de sa vie est manqué.
—Oh! avec vous, il y a de la ressource. Vous avez tant de qualités auxquelles une femme peut rattacher son amour!... Elle vous aimait pour votre cécité, elle vous aimera maintenant pour votre esprit.
—Allons! je vous crois, je vous crois, dit Mathurin rassuré.
Ensuite reprenant sa gaîté:
—Vous verrez ce soir comme mon instinct et mes habitudes d’aveugle vont me faire marcher à droite, à gauche, tourner au bon coin, enfiler la vrai voie... Et quand je m’arrêterai en disant: «C’est là!» vous pourrez être certain que nous serons devant la maison... Le bouton de la sonnette du concierge est une rose en cuivre; je vous l’annonce d’avance.
—Ainsi c’est convenu, à ce soir?
—Je vous attendrai pour partir.
Il était minuit passé quand le commissaire revint chez Poliveau. Celui-ci l’attendait, tenant à la main ce bâton qui allait guider le magistrat vers les coupables.
A cette heure les passants étaient devenus rares et le trottoir, par conséquent, était libre.
—En route! dit gaiement Poliveau.
—Allons, fermez les yeux et ne les ouvrez plus.
—Je m’en garderai bien, répondit Mathurin, qui le bâton tendu, fit son premier pas.
M. O*** le suivait par derrière.
Arrivé au bout de la rue, Poliveau donna deux coups de bâton devant lui, deux autres à sa droite, et, pour prouver son aptitude d’aveugle, annonça au commissaire:
—Tenez, c’est ici que je prends à droite.
—Bon, je m’en doutais! se dit le magistrat en voyant son homme, au premier crochet, tourner le dos à la rue Dauphine.
Restait à savoir si la promenade durerait longtemps.
Toujours tâtant du bout de son bâton, Poliveau remonta le Faubourg Montmartre, tourna dans la rue Lafayette, enfila le boulevard Haussmann, et arriva enfin à l’Opéra.
M. O*** se gardait bien de parler de peur de distraire le marcheur.
Celui-ci ralentit bientôt son pas pour dire:
—Hein! vous y reconnaissez-vous? N’est-ce pas que je suis dans le bon chemin?
—C’est pourtant vrai que vous allez rue Dauphine, répondit le commissaire.
La vérité était que, pour la troisième fois, Mathurin venait de faire le tour de l’Opéra.
—Je repars! annonça-t-il.
—Surtout n’ouvrez pas les yeux, recommanda M. O***, tremblant pour la réussite de l’épreuve.
—Oh! non, non, soyez tranquille. Si je risquais seulement un œil, je me perdrais aussitôt.
Sa marche continua encore pendant un quart d’heure.
Puis Poliveau s’arrêta net.
—Eh bien! fit le commissaire, est-ce que vous ne retrouvez plus votre chemin?
—Pas du tout... nous sommes arrivés.
—Ah! bah! lâcha M. O***, étonné.
On était à l’entrée de la rue de Provence, juste à cent pas du point de départ.
Et ils avaient marché pendant une heure.
—Je dois être arrêté devant une porte? reprit Poliveau, les yeux toujours fermés.
—Oui.
—Alors vérifiez vous-même si le bouton de sonnette figure une rose.
—Oui, c’est une rose, avoua le commissaire après vérification faite.
—Eh bien! c’est la maison de l’oncle Canivel, je vous en réponds... Dans le couloir nous allons rencontrer les deux marches.
Ce disant Poliveau, qui avait rouvert les yeux, étendit la main vers le bouton pour sonner.
—Pardon, fit le magistrat en lui arrêtant le bras.
—Oh! nous pouvons monter malgré l’heure avancée, le cher oncle se couche très tard; nous allons le trouver encore sur pieds, dit l’ex-aveugle se méprenant sur les intentions du commissaire.
—Oui, mais j’ai une crainte... Ne se peut-il pas que M. Canivel, de même que madame Poliveau, ait été victime de quelque violence... Qui sait si nous n’allons pas trouver là-haut leurs bourreaux les gardant à vue?
Caver sur la crédulité de Mathurin, c’était être certain d’avance de réussir. Il goba si bien la bourde qu’il répondit aussitôt:
—Et ce doit être ces mêmes bourreaux qui ont empêché le vieillard de me donner de ses nouvelles... C’est probablement un d’eux qui a joué le rôle du portier qui m’a répondu ne pas connaître de Canivel dans la maison. Ah! ils avaient bien ourdi leur trame.
—En conséquence, reprit M. O***, comme nous ne sommes que deux et qu’ils sont sans doute nombreux...
—Qui sait? cent peut-être.
—Vous ne voyez donc aucun inconvénient à ce que nous nous fassions accompagner?
Deux sergents de ville passaient, faisant leur ronde, M. O*** les appela et se fit connaître. Ils se mirent aussitôt à ses ordres.
—A présent, monsieur Poliveau, écoutez-moi bien, j’ai une petite leçon à vous faire. Ces deux hommes et moi, après la porte ouverte, nous nous tiendrons dans l’obscurité du vestibule. Vous, vous continuerez votre chemin, jusqu’à la loge du concierge... Il est inutile de nous montrer si cet homme vous laisse monter... Nous ne paraîtrions que dans le cas où il voudrait vous faire violence... car je tremble à cette idée, que vous venez d’émettre, que nous avons probablement affaire à un faux portier.
—Je vous ai dit que j’étais très-observateur.
—Vous avez mieux fait que le dire, vous me l’avez prouvé, avança le commissaire, qui, depuis qu’il s’était résolu à jouer du Poliveau, était arrivé, on le voit, à acquérir, un beau talent.
—Bon! c’est convenu! A présent, je sonne, dit Mathurin en étendant la main.
—Non, pas encore; il me reste à vous faire une dernière et très-sérieuse recommandation. Cet homme vous croit sans doute encore aveugle, jouez donc l’aveugle, quoi qu’il arrive... Lui apprendre ou lui laisser découvrir que vous voyez clair serait lui donner l’éveil, le pousser à quelque brutalité ou lui faire donner un signal d’alarme aux brigands qui ont séquestré votre oncle vénéré.
Après ces instructions qui n’avaient d’autre but que de bien dégager la route pour pouvoir surprendre les coupables, le commissaire ajouta:
—Maintenant, sonnez.
La porte s’ouvrit et Poliveau, suivi par M. O*** et les deux sergents de ville qui marchaient sur la pointe du pied, s’avança dans un assez long, mais étroit vestibule, parfaitement obscur, car, à cette heure, le gaz était éteint.
—Prenez garde... voici les deux marches... Hein! vous les avais-je annoncées! souffla Poliveau à l’oreille du commissaire.
—Chut! chut! fit ce dernier, allez de l’avant, ne vous occupez pas de nous... et surtout n’oubliez pas votre rôle d’aveugle.
Puis il poussa Mathurin.
Il était temps, car le concierge, en costume de nuit, venait de sortir de sa loge, tenant une bougie dont la lumière ne put dissiper que l’obscurité d’un tiers du vestibule.
Et il se mit à dire:
—Est-ce vous qui rentrez, mademoiselle Léontine?... Dépêchez-vous de monter, car ils se battent encore là-haut comme des enragés.
A ce moment, Mathurin, son bâton en avant, sortit de l’ombre, s’avançant vers la loge.
—Tiens! c’est vous, monsieur Poliveau, dit le concierge en le reconnaissant; malgré l’heure avancée de la nuit, je n’en suis pas moins votre respectueux serviteur.
Et, à l’appui de ce qu’il venait de débiter, le respectueux serviteur, qui croyait avoir toujours affaire à un aveugle, tira une langue énorme à Mathurin.
Le commissaire n’eût pas fait d’avance la leçon à Poliveau qu’il se fût peut-être trahi à l’aspect de cette langue qui s’exhibait à six pouces de son visage. Il demeura la face immobile, les yeux grands ouverts et se contenta de demander:
—Mon oncle est chez lui?
—Faut avouer que vous choisissez bien votre heure pour rendre vos visites! reprit le concierge, qui riait silencieusement avec force grimaces sous le nez de celui qu’il croyait toujours privé de la vue.
Entre deux rires, il se reprit:
—Suis-je bête! j’oublie que, pour vous, il n’y a ni midi ni minuit!
Puis il eut l’air de se consulter et murmura:
—Après tout, c’est leur affaire... Je vais leur envoyer l’oiseau, ils s’en arrangeront... J’en ai assez de ces gens-là qui se bûchent à attirer encore la police!
Alors répondant à la question de Mathurin:
—Oui, oui, fit-il, vous allez le trouver, votre oncle... et votre femme est aussi là-haut qui veille à ce qu’il ait une bonne nuit.
Ce disant, le portier retirait la langue, faisait les cornes de ses deux doigts placés sur le front et était écarlate de son rire étouffé.
Cependant il retrouva sa respiration pour ajouter:
—Allons, montez près du vieillard. Probablement que c’est votre femme qui viendra ouvrir au coup de sonnette, car la bonne est descendue tout à l’heure pour aller leur chercher deux ou trois plats à un restaurant de nuit, attendu qu’ils veulent souper.
Poliveau ne se le fit pas répéter deux fois et, prenant la rampe, il enfila l’escalier sans s’attarder à écouter le portier, qui lui disait:
—Le gaz est éteint; prenez donc mon bougeoir.
Offre, du reste, que le concierge ne renouvela pas, car, tout aussitôt, il rentra dans sa loge en marmottant:
—Que ferait-il de mon bougeoir? Est-ce que le gaz n’est pas toujours éteint pour lui?
Arrivé au deuxième étage, Poliveau n’eut pas besoin de sonner. La bonne, en allant chercher le souper, avait oublié ou jugé inutile de fermer la porte, qu’elle avait laissée entre-bâillée.
Poliveau allait la pousser, quand il en fut empêché par le commissaire, qui, suivi de ses deux sergents de ville, venait de monter doucement l’escalier aussitôt qu’il avait vu le portier rentré dans sa niche.
—Y pensez-vous? souffla M. O*** à l’oreille de Mathurin... Risquer de tuer votre Clarisse par un saisissement de joie trop subite!... Attendons plutôt en silence et guettons la minute, qui ne peut tarder, où ils parleront de vous.
—Oui, vous avez raison; j’allais, pour ainsi dire, devenir un assassin... Je tuais ma Clarisse! répondit tout bas Poliveau, tremblant à la pensée du crime qu’il avait été sur le point de commettre.
Laissant ses deux agents à la porte du logis avec consigne de couper toute retraite, M. O***, tenant, par prudence, le bras de Mathurin, se glissa doucement dans l’antichambre.
—Écoutons, dit-il à l’ex-aveugle.
Il y avait certes matière à écouter, car on se disputait fort de l’autre côté d’une porte sous laquelle filtrait un rayon de lumière.
—Vas-tu m’ennuyer longtemps encore avec tes rengaînes?... allons, tais-toi ou je cogne, grondait une voix furieuse.
—C’est maître Prévannes! se dit le commissaire en reconnaissant l’organe du beau gars.
Cette menace de coups n’effrayait pas la personne à laquelle on l’adressait, car aussitôt une voix, voix de femme, répondit:
—Oui, tu n’es qu’un misérable... tu n’as même pas la probité des voleurs qui ne compromettent point ceux qui les ont aidés.
—Tais-toi! ordonna encore la voix d’homme dont l’accent de colère avait monté d’un ton.
Si M. O*** n’avait solidement maintenu Poliveau, il est probable que ce dernier allait se précipiter dans la chambre.
—Chut! chut! fit le commissaire..
—C’est ma Clarisse! je reconnais sa voix suave, murmura Mathurin sous la main que le commissaire lui avait posée sur les lèvres.
Notons, en passant, que cette voix, qui retentissait si suave aux oreilles du mari, avait, en ce moment, les intonations les plus canailles qu’il fût possible d’imaginer. Une harengère, bien en veine, n’aurait pas trouvé mieux.
Devant l’orage, compliqué d’une grêle de coups de poings, qui planait sur elle, Clarisse, ou plutôt Lurette Baba, ne courba point la tête. Elle répliqua immédiatement:
—De quoi étions-nous convenus dans l’affaire de l’abruti? Que si nous ne réussissions pas à mettre la main sur le magot, en un mot, que si le coup était raté, nous décamperions sans rien laisser derrière nous qui pût nous nuire, sans rien faire qui donnât à l’aventure d’autre air que celui d’une plaisanterie faite à un idiot... C’est à cette condition que je t’ai prêté mon aide, car je ne tenais pas à aller reverdir dans une des maisons de campagne que la préfecture de police met à la disposition de ses clientes... Malgré la chose dite, qu’as-tu fait, toi, brigand?
—Veux-tu te taire! prononça Maurice le poing levé.
—Tu as volé les couverts de l’imbécile...
On entendit retentir un coup sourd.
—...et ses diamants.
A un second coup donné succéda le bruit de la chute d’un corps.
Puis la voix affaiblie de Lurette continua:
—...et en allant les vendre, tu as donné l’éveil à la police.
Les coups pleuvaient dru. Un d’eux, sans doute, fut plus terrible que les autres, car la victime poussa un long gémissement de douleur, suivi de ces mots balbutiés péniblement:
—Oh! comme j’ai eu tort de ne rien avouer, ce matin, au commissaire!
—Mais il est toujours temps de parler, Lurette Baba, dit M. O*** en apparaissant sur le seuil de la chambre où se passait la scène.
Si le magistrat s’était décidé à pousser la porte, c’était qu’il lui était impossible de contenir plus longtemps Poliveau, qui se démenait pour aller arracher sa colombe adorée aux serres du vautour.
Hélas! la colombe adorée était étendue sur le parquet, se défendant mal contre les coups de talon de botte que lui octroyait le vautour.
L’entrée de M. O*** fut un coup de théâtre.
Clarisse, qu’un dernier coup venait d’atteindre en pleine poitrine, s’évanouit entre les bras de Poliveau qui, oubliant ou n’ayant pas compris ce qu’il avait entendu, s’était élancé vers elle en s’écriant:
—Sous mon aile! ma colombe, sous mon aile!
Quant à Prévannes, la vue du commissaire, pénétrant en son logis à cette heure, lui avait donné à deviner que, cette fois, il allait en cuire pour lui. Sa première pensée fut de fuir et il prit un élan qui devait renverser M. O*** lui barrant la route.
Mais il y avait chez le commissaire, qui en était à sa centième arrestation de malfaiteur, une pratique de circonstance qui le mettait sur ses gardes. D’un mouvement de côté, il évita Prévannes que son élan amena tout droit entre les bras des deux sergents de ville.
—Conduisez cet homme au poste, ordonna le magistrat.
Et, quand Maurice eut disparu, il revint à Baba, toujours évanouie, à laquelle un peu d’eau fraîche sur le visage aurait mieux convenu que les larmes brûlantes dont l’inondait Poliveau en bégayant:
—C’est moi, ton soleil, ton adoration, le miel de ton existence!
M. O*** prit une carafe sur la table, qui attendait ce souper pour lequel la bonne était absente, et aspergea de quelques gouttes le visage de Baba.
En rouvrant les yeux, la première chose que vit Lurette fut la face de Mathurin penchée vers elle.
—Mon imbécile! murmura-t-elle.
—Mon Dieu! elle ne m’a pas reconnu! gémit douloureusement Poliveau.
M. O*** posa la main sur l’épaule de Mathurin et, après l’avoir fait se relever, il lui demanda d’un ton sévère:
—Monsieur Poliveau, tenez-vous à être le bourreau de votre femme?
—Oh! non! non!
—Alors il faut vous éloigner, car il est incontestable que, dans l’état où elle se trouve, elle n’est pas de force à supporter l’immense joie qu’elle éprouvera en vous retrouvant... C’est même un bonheur inouï qu’elle ne vous ait pas reconnu, car ça la tuait du coup... Vous avez donc à choisir: rester et être son bourreau, ou vous éloigner pour me laisser la préparer au bonheur de se retrouver sous votre aile.
Ensuite, comme les deux sergents de ville étaient revenus du poste, il leur montra Poliveau en disant:
—Reconduisez monsieur.
Et tout bas à un des agents:
Ayant ainsi fait le champ libre à son interrogatoire, M. O***, aidé de la servante, revenue les mains vides de sa quête d’un souper, transporta Lurette sur un lit, et, à eux deux, ils la tirèrent de son évanouissement.
Un flot de sang inonda les lèvres de la lorette à sa première parole.
—Oh! le brigand, il m’a donné un bien mauvais atout... je dois avoir quelque chose de brisé dans ma boîte, dit-elle en montrant sa poitrine meurtrie par les coups de talon de botte.
Puis, après avoir promené ses yeux autour de la chambre:
—Tiens, fit-elle, je me suis donc trompée, tout à l’heure, il m’avait semblé voir le bec de mon serin.
—De votre mari, voulez-vous dire? avança le commissaire.
Malgré sa souffrance, Baba eut un sourire.
—Lui! un pareil chinois! mon mari?... Plus souvent!!! lâcha-t-elle de sa voix triviale.
Et, après un petit silence, elle ajouta:
—N’empêche pourtant qu’avec cet oison-là, nous avons fièrement rigolé.
—Mais enfin quel a été le but de toute cette comédie? demanda M. O***.
Lurette eut un instant d’hésitation à trahir son amant, mais, à ce moment, une toux de souffrance lui ramena le sang aux lèvres.
—Il m’a tué, le gredin! murmura-t-elle.
Alors, sous l’impulsion de la colère, elle reprit:
—Pour me venger, je vais tout vous dégoiser, mon commissaire.—Maurice était employé à la compagnie La Précaution, au bureau des polices de rentes viagères. On n’était pas content de lui et on lui avait signifié son congé immédiat avec indemnité d’un mois d’appointements. Le dernier jour qu’il avait été à son bureau, il revint ici en me disant:
—Veux-tu m’aider à mettre la main sur un lopin de 40,000 francs?
Et il me raconta qu’au moment où il allait sortir du bureau d’où il était congédié, il s’était présenté un monsieur pour demander qu’on lui préparât la police d’une rente viagère en faveur de son fils, dont il apporterait, le lendemain, le capital de 40,000 francs.
Ce monsieur était un de ces bavards qui aiment à mettre tout le monde au courant de leurs affaires. Il conta donc à Maurice que son fils était aveugle, qu’il lui avait déjà constitué 6,000 francs de rentes viagères, mais qu’il voulait augmenter cette rente par l’apport de ce second capital de 40,000 francs.
—Mon fils ne s’en doute pas, ajouta-t-il, c’est une surprise que je lui ménage, il ne l’apprendra qu’après l’affaire faite... Sans jamais lui en rien dire, j’ai économisé lentement cette nouvelle somme.
—En la déposant au fur et à mesure à la Banque de France? dit Maurice au hasard, car, en ce moment-là, il ne songeait pas à mal.
—Du tout, répondit l’autre, ils sont chez moi, dans une cachette, tout aussi en sûreté que dans les caves de la Banque.
Après avoir donné ses nom, prénoms, et adresse pour qu’on lui dressât la police, il partit en répétant qu’il apporterait la somme le lendemain.
Deux minutes plus tard, Maurice, après avoir pris ses cliques et ses claques, quittait à son tour le bureau où il ne devait plus revenir.
Arrivé dans la rue, la première chose que vit Maurice fut le corps d’un homme tué, disait-on, par la rupture d’un anévrisme, que des sergents de ville emportaient...
Et dans cet homme, il reconnut le monsieur qui, tout à l’heure, était sorti de son bureau.
Aussitôt il songea à ce capital de 40,000 francs dont lui avait parlé le défunt, cette somme ignorée du fils aveugle, enfouie dans une cachette, dont nul n’avait connaissance... et, alors seulement, l’eau lui vint à la bouche.
Dès le lendemain fut organisée cette comédie qui devait nous mettre à même de fouiller tous les meubles à notre aise. Le début était facile, attendu que notre pigeon à plumer habitait, rue Cassette, une maison dont la majeure partie était louée en garni par un marchand de meubles qui en était le principal locataire. Pour 25 ou 30 francs par mois, on pouvait donc ainsi aller se mettre à l’affût sous le même toit que le gibier.
—Mais, fit le commissaire en interrompant, il y avait une vieille bonne près de l’aveugle, une nommée Javotte?
—Attendez donc. Oui, il y avait une servante et ce fut Bernisier qui sut l’embobiner.
—Bernisier? répéta le commissaire étonné de ce nom nouveau.
—Bernisier, qui, pour Poliveau, prit le nom de Touriquet. C’était un ami de Maurice, ancien commis voyageur... un fainéant et un buveur de première force, mais drôle comme tout, avec des idées comme pas un, et, par-dessus le marché ventriloque... qu’il vous en faisait mourir de rire, surtout dans la scène où il imitait toute une famille d’Auvergnats enfermés dans une tabatière..... En lui promettant une part dans l’affaire, Maurice le décida à être des nôtres.
Le commissaire interrompit Baba. Pendant qu’on était en train, il voulait couler à fond la question des comparses.
—Et madame Nubadar? demanda-t-il.
—C’était maman.
—Elle est morte?
—Pas le moins du monde. Elle continue à crier son poisson dans la rue en poussant sa voiture à bras. Dans le commencement, elle croyait à une plaisanterie... à l’histoire de se faire rincer le bec et remplir l’estomac par un imbécile. Mais, quand elle a eu flairé la chose, elle nous a dit: «Ça, ce n’est pas de la marée assez fraîche pour moi, je vous lâche, mes bibis.»
M. O*** n’insista pas sur ce point, mais il reprit:
—Ah! non, lui, il s’est fait casser la tête par une ruade de cheval pendant le siége.
—Et le maire alsacien qui recommandait tant de soigner les meubles?
—Il sortait du gosier du ventriloque Touriquet.
—Et les deux dignitaires turcs qui ont servi de témoins au mariage à la mairie?
—Toujours le ventriloque Touriquet... C’est chez lui, au premier, au fond de la cour, rue Bergère, qu’a eu lieu la prétendue cérémonie à la mairie.
Ainsi renseigné sur les compères, M. O*** revint à ses moutons en disant:
—A présent, apprenez-moi comment Touriquet est parvenu à écarter Javotte.
—Oh! bien simplement. Touriquet avait été, rue Cassette, louer la chambre garnie la plus voisine de l’appartement de Poliveau. A cette époque, l’ennemi arrivait à marches forcées et Paris allait être bloqué... Javotte s’alarmait pour son jeune maître aveugle qui ne se doutait de rien. Touriquet sut si bien forcer au noir la situation qu’il la décida à emmener son maître loin de Paris. Mais il lui conseilla, avant de faire partir l’aveugle, d’aller d’abord lui préparer une retraite.
—Nous avons encore au moins dix jours devant nous, lui affirmait-il.
La servante le crut, et, sur la promesse qu’il lui fit de veiller sur l’aveugle pendant sa courte absence, elle partit. Le lendemain, Paris était bloqué et elle ne put rentrer. Si elle y est revenue aujourd’hui, elle n’a pas dû retrouver son maître, car, en déménageant de la rue Cassette à la rue Richer, nous avons tout fait pour qu’on ne pût découvrir nos traces.
Il n’y avait plus pour M. O*** qu’une seule question à poser:
—Que vous reste-t-il des quarante mille francs? demanda-t-il.
—Rien, dit Baba.
—Vous avez donc tout gaspillé?
—Nous n’avons pas dépensé un sou... pour l’excellente raison que nous n’avons rien trouvé... pas un radis!... Nous avons eu beau fouiller et archi-fouiller les meubles, nous n’avons pas déniché un monaco. Il faut croire que le père était un vrai blagueur.
M. O***, à cette réponse, crut que Baba, après avoir cédé au mouvement de colère qui l’avait fait parler, ne voulait pas compromettre davantage Prévannes.
—Le juge d’instruction lui en fera dire plus, se dit-il.
Et il alla se coucher.
Le lendemain, quand le commissaire descendit à son bureau, le secrétaire Jacquet, qui était à son poste, lui montra une vieille femme, assise dans un coin.
—Voici la femme, dit-il, qui a tant insisté hier pour vous voir et qui, au lieu d’aller au bureau de la rue Taitbout, avait annoncé qu’elle reviendrait ce matin.
M. O*** la fit passer dans son cabinet.
—Monsieur le commissaire de police, dit-elle en lui tendant un paquet, je viens vous faire ce dépôt... Il y a là dedans quarante mille francs qui appartiennent à mon maître que je ne puis retrouver... un nommé M. Poliveau.
—Mais alors, vous êtes Javotte? s’écria M. O***.
—Pour vous servir, répondit la vieille servante, un peu étonnée d’être connue.
Et pourquoi vous adressez-vous à moi?
—Parce que, là-bas, rue Cassette où a demeuré mon maître, tout ce que je suis parvenue à découvrir, c’est que M. Poliveau devait habiter cette partie du IXe arrondissement que vous administrez..... Comme je me propose d’aller de porte en porte demander mon maître, et que, durant mes recherches, je pourrais perdre cette somme, je vous la dépose pour...
—Au lieu d’aller de porte en porte, courez rue Richer, 41, ma brave Javotte, dit le commissaire, qui, en cent mots, la mit au courant.
Mais arrêtant la servante qui s’élançait joyeuse:
—C’est donc vous qui aviez retiré cette somme de l’endroit où l’avait cachée M. Poliveau père? demanda-t-il.
—Oui, pour pouvoir subvenir aux besoins de mon jeune maître hors de Paris, car, à ce moment de la guerre, le payement de la rente viagère par la Précaution devait forcément subir un retard.
—Alors, vous connaissiez la cachette?
—Oh! M. Poliveau père n’avait rien de caché pour moi, dit Javotte en rougissant un peu.
Maurice Prévannes a été condamné à cinq ans de prison pour le vol des couverts et des bijoux.
Lurette Baba est morte à l’hôpital, où on l’avait transportée, des suites du mauvais traitement que lui avait fait souffrir son amant.
Et, quoi que M. O*** ait pu lui dire, Mathurin Poliveau n’en a pas moins mis un crêpe de veuf à son chapeau[B].
[B] Cette nouvelle n’est qu’un épisode extrait par l’auteur de son roman «LE COMTE OMNIBUS», actuellement sous presse. (Note de l’éditeur.)
FIN
| NOUS MARIONS VIRGINIE | 2 |
| TIMOLÉON POLAC | 79 |
| LES YEUX AU BOUT D’UN BATON | 225 |
——————
E. AUREAU.—IMPRIMERIE DE LAGNY.
End of Project Gutenberg's Nous marions Virginie, by Eugène Chavette
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK NOUS MARIONS VIRGINIE ***
***** This file should be named 41307-h.htm or 41307-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/4/1/3/0/41307/
Produced by Laurent Vogel, Chuck Greif and the Online
Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.